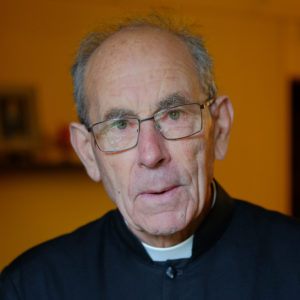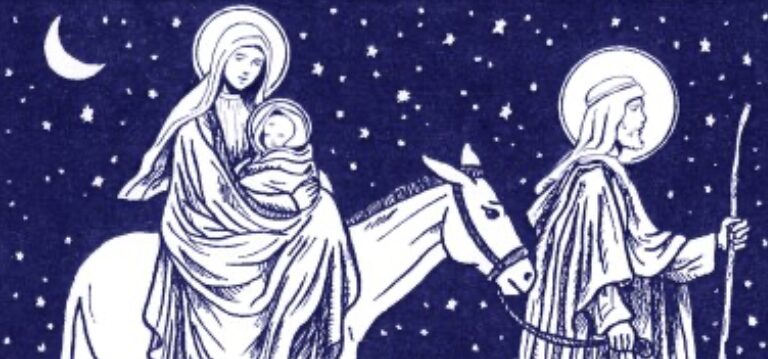7 allée du Château, 36290 Saint-Michel-en-Brenne
Messe Dimanche & Fêtes
10h30
Messe en Semaine
7h15 (en général)
grandes fêtes: se renseigner
Prieur
Vue du chœur
L'ancien autel de la chapelle, devenu autel latéral. Mgr Lefebvre a célébré sur celui-ci
Saint Joseph
Le maître autel
Le cloitre extérieur
Saint Cyran, le patron du lieu.
Le parc de l'abbaye
Le portail d'entrée
Vue vers l'arrière de la chapelle
L'église Saint Cyran
L'intérieur de la nouvelle chapelle
Pour préparer la fête de Noël dans l'esprit de l’Église.
Paru le 22 octobre 2025
Les Sœurs de la Fraternité Saint-Pie X présentent leur Maison-mère dans une nouvelle vidéo.
Paru le 17 septembre 2025
Un livre écrit par les Sœurs de la Fraternité Saint-Pie X vient de paraître pour aider et réjouir parents et éducateurs.
Paru le 7 juillet 2025