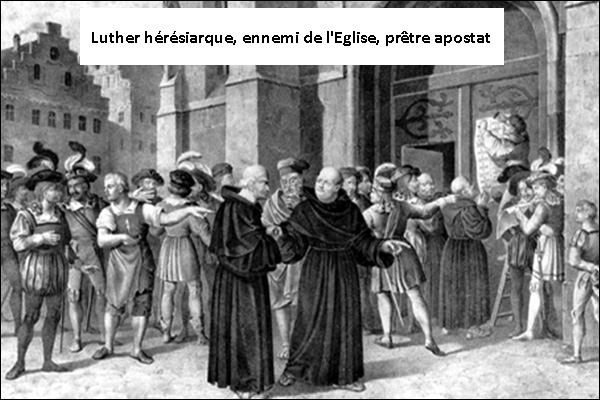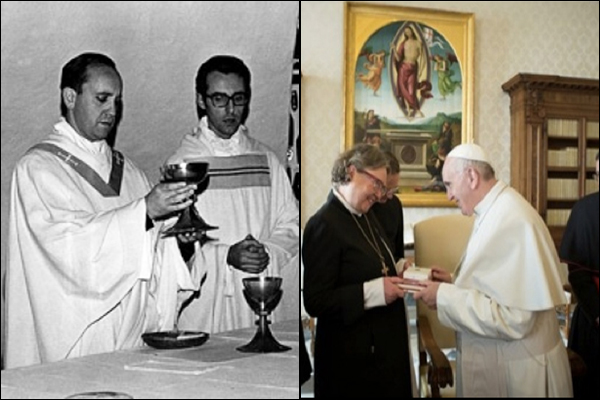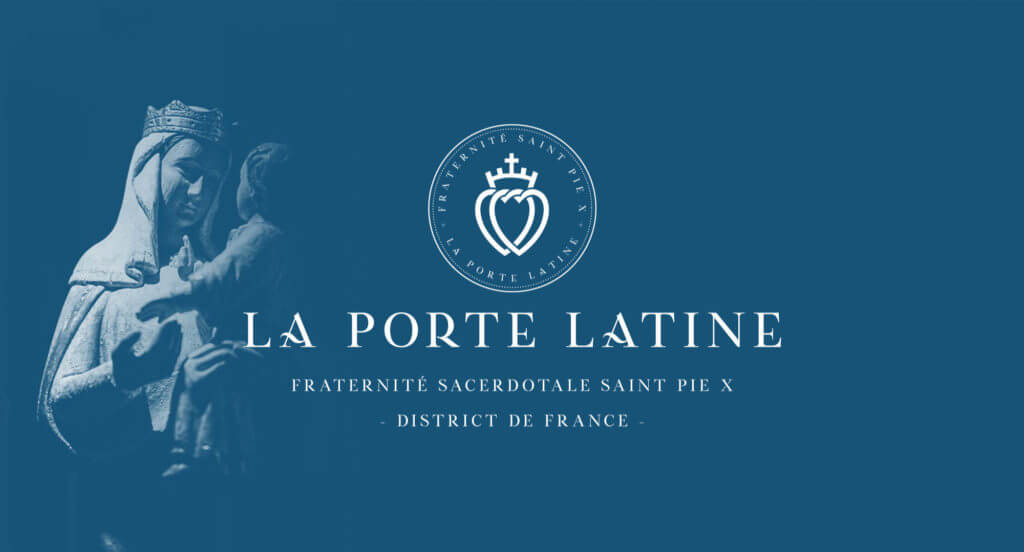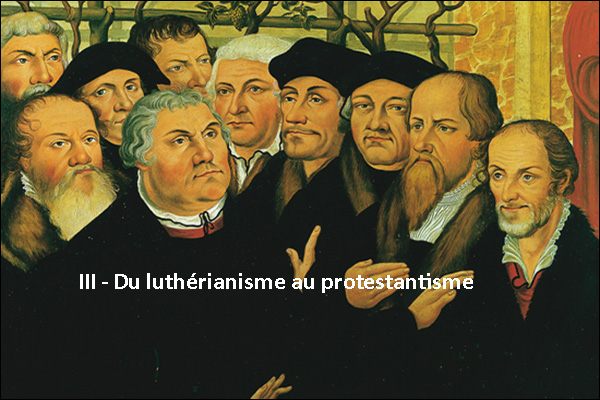I – Sa vie
En 2017, va être célébré le cinq centième anniversaire de l’affichage par le moine augustin Martin Luther, sur une église de Wittemberg, de 95 thèses qui, en particulier, condamnent la pratique des indulgences, telle que l’enseigne l’Église, mais également d’autres points touchant à la foi, comme le Purgatoire.
Cet acte public est considéré usuellement comme le début de ce qu’on appelle communément, mais faussement, la « Réforme », alors qu’il s’agit en vérité d’une révolution, d’une destruction de la véritable foi, d’une apostasie et d’une révolte contre Dieu et Notre Seigneur. Dès 1517, en réalité, et malgré les péripéties qui suivront, Martin Luther a rompu de cœur avec l’Église du Christ, et ne suit plus que ses vues personnelles erronées et diaboliques.
Pourtant, Martin Luther fut auparavant un moine pieux et zélé. Né en 1483 d’une bonne famille chrétienne, Martin est attiré très tôt par la religion, le rapport avec Dieu, plus tard la théologie. Alors que son père souhaite qu’il devienne juriste, il décide de se faire moine augustin, entrant dans cet ordre en 1505. Ordonné prêtre en 1507 (il était déjà diplômé en philosophie), il obtient le doctorat en théologie en 1512. A partir de cette date, sa vie sera celle d’un enseignant et d’un prédicateur.
Luther avait reçu une formation assez poussée, et il a certainement été influencé sur le plan intellectuel par la lecture de plusieurs grands auteurs, qu’il s’agisse d’Aristote, de Guillaume d’Ockham ou de Gabriel Biel. Mais il est clair que Luther recevait ces influences selon son propre tempérament, qui était très affirmé, comme sa carrière subséquente le montrera. Il est donc peu probable que le contact avec ces écrivains ait réellement été déterminant dans son évolution.
En réalité, c’est par rapport à lui-même, sur la base de sa vie intérieure personnelle, de son expérience spirituelle intime, que Luther va bâtir un nouveau système religieux, qui n’aura plus rien à voir avec l’enseignement de l’Église, ni avec la vérité du christianisme.
Luther était doté un tempérament riche et passionné, celui qui fait les grands hommes quand ceux qui le possèdent acceptent de le mettre au service de la vérité et du bien. Mais le corollaire d’un tel tempérament, ce sont évidemment de fortes tentations. Luther était l’objet de telles tentations, sans doute en ce qui le concerne tentations contre la chasteté, attrait pour la bonne chère, propension à la colère, esprit d’indépendance, penchant à l’orgueil. Lorsqu’on affronte ces tentations et qu’avec la grâce du Christ on les surmonte, non seulement elles ne nous font pas déchoir, mais ce combat nous vaut des mérites, et la puissance de la passion maîtrisée vient donner de l’énergie à l’homme. C’est en ce sens que la parole de Hegel est fondée : « Rien de grand ne s’est fait sans passion ».
Mais Luther souffre des assauts de ces tentations, même s’il les repousse. Il voudrait, comme saint Pierre lors de la Transfiguration, être déjà parvenu à la vie céleste, avoir déjà « revêtu le Christ », se trouver dès maintenant dans un état de rectitude parfaite qui n’appartient pas à cette vie terrestre, sauf exceptions très particulières. Une certaine obsession du salut l’envahit, plus exactement l’obsession de la certitude de son salut : et parce que les tentations continuent à le harceler, créant chez lui un sentiment de culpabilité, il finit en quelque sorte par désespérer de la vie chrétienne, de l’efficacité de la grâce et des moyens ordinaires de la recevoir et de la conserver (prières, sacrements, jeûnes, etc.).
En 1515, il commence, dans le cadre de son enseignement, à commenter les épîtres de saint Paul, et notamment la première d’entre elles selon l’ordre de la Bible, l’épître aux Romains, d’une immense richesse, d’une fulgurance incroyable, mais aussi d’une difficulté redoutable de compréhension. A partir de ce qu’il croit comprendre de ce texte, uniquement selon son sens propre et sans se référer à la tradition ecclésiastique, en fonction de son problème intérieur (« Puis-je être sauvé alors que je ressens encore des tentations ? »), Martin Luther élabore une nouvelle théologie chrétienne qui, dès ce moment, est radicalement incompatible avec celle de l’Église catholique, même si la rupture extérieure et publique va prendre un certain temps.
Selon la doctrine catholique, en effet, grâce aux mérites du Christ, l’homme qui accepte la Révélation divine par la foi et qui, mû par l’espérance du salut divin, veut se repentir de ses péchés et se tourner vers Dieu, obtient par la grâce que ses péchés lui soient ôtés, que son âme soit régénérée et sanctifiée en sorte qu’il devient, selon le mot de saint Pierre, « participant de la nature divine » (2 P 1, 4). Le chrétien qui vit de la charité est donc, ainsi que le dit souvent saint Paul, un « saint », parce qu’il a été purifié, transformé, sanctifié intérieurement, et qu’il est devenu réellement l’ami de Dieu par une ressemblance effective et stable. Et, étant l’ami de Dieu, il fait spontanément les œuvres de Dieu, les bonnes œuvres de la vertu, qui lui méritent, par la grâce du Christ présente en lui, le salut du Paradis.
Luther rejette cette vérité. Pour lui, selon qu’il le ressent psychologiquement, le fait d’avoir embrassé la foi et la vie chrétienne n’ôte pas de l’âme le péché [en réalité, il s’agit de la tentation, qui n’est pas péché si l’on n’y consent point]. Pour Luther, le chrétien reste, en fait, toujours pécheur et ennemi de Dieu, son âme demeure tout à fait corrompue. Mais comme le Christ a mérité par le sacrifice de la croix le salut pour les hommes, si par la « foi » (qui consiste selon Luther en une confiance dans ce salut obtenu par le Christ), je crois fermement que je suis sauvé, alors le manteau des mérites du Christ recouvre les souillures de mon âme, et le Père, voyant ce manteau sur moi (grâce à la « foi-confiance »), m’agrée pour le Paradis. Les bonnes œuvres n’ont donc aucun pouvoir de mérite, puisque l’homme reste toujours pécheur intérieurement, mais elles encouragent simplement le chrétien à persévérer dans la « foi-confiance ».
Tel est le cœur de ce que Luther appelle « la vérité de l’Évangile ». De là découle naturellement le reste de son système. Et en premier lieu, la remise en cause de l’Église institutionnelle. Celle-ci n’est pas divine, d’abord parce qu’elle prétend que l’homme peut se sauver par les bonnes œuvres, alors que, comme Luther en a fait l’expérience décevante dans la vie monastique, ces bonnes œuvres sont incapables d’ôter le péché [en réalité, redisons-le, il s’agit de la tentation, qui n’est pas péché si l’on n’y consent point] ; ensuite parce qu’elle a abandonné la « vérité de l’Évangile », à savoir le salut par la seule « foi-confiance ».
Par circularité, ce rejet de l’Église justifie la démarche luthérienne, à qui l’on pourrait reprocher d’inventer selon son esprit propre un nouvel Évangile, ce qui est la définition même de l’hérétique. Mais puisque l’Église elle-même a trahi la « vérité de l’Évangile », il est logique et nécessaire que Luther, par un « libre examen » de l’Écriture, retrouve cette vérité et la transmette au peuple de Dieu égaré par une hiérarchie illégitime. « A moins qu’on ne me convainque de mon erreur par des attestations de l’Écriture ou par des raisons évidentes – car je ne crois ni au pape ni aux conciles seuls puisqu’il est évident qu’ils se sont souvent trompés et contredits – je suis lié par les textes de l’Écriture que j’ai cités, et ma conscience est captive de la Parole de Dieu ; je ne peux ni ne veux me rétracter en rien » (déclaration de 1521 devant la Diète de Worms présidée par Charles-Quint).
Puisque l’âme du chrétien n’est pas transformée par la grâce, les sacrements n’opèrent plus rien de réel en elle, et donc l’adage classique : « Les sacrements opèrent ce qu’ils signifient » perd tout sens. En vérité, les sacrements se contentent de signifier la « foi-confiance » et de la réchauffer. Et donc, ne doivent être conservés que les sacrements qui produisent cet effet psychologique.
Pour la même raison, la messe, renouvellement non sanglant du sacrifice du Christ, qui nous en applique quotidiennement les mérites, perd toute signification. Seul sera conservé un mémorial de la Cène, pour nous faire souvenir de l’unique sacrifice du Christ sur la croix et raviver notre foi-confiance en sa rédemption.
Toutefois, Luther ne se contente pas cette mise à l’écart de la messe. Prêtre en rupture de ban, moine infidèle à ses vœux, il développe une haine véritablement pathologique à l’égard du saint sacrifice. Ses mots à ce sujets sont effrayants, et finiraient par faire croire qu’il était possédé du démon : « La messe, déclare-t-il en 1521, est la plus grande et la plus horrible des abominations papistes ; la queue du dragon de l’Apocalypse ; elle a déversée sur l’Église des impuretés et des ordures sans nom ». Et il renchérissait en 1524 : « Oui, je le dis : toutes les maisons de prostitution, que pourtant Dieu a sévèrement condamnées, tous les homicides, meurtres, vols et adultères sont moins nuisibles que l’abomination de la messe papiste ». Et, avec beaucoup de lucidité, il concluait : « Si la messe tombe, la papauté s’écroule ».
Puisque l’Église institution (ce que Luther appelle avec mépris « la papauté ») n’existe plus comme prolongement du Christ, le croyant (par la foi-confiance) se trouve seul devant Dieu. Il est éclairé extérieurement par la Bible (qu’il doit évidemment lire personnellement, d’où la nécessité de Bibles en langue vulgaire), et intérieurement par le Saint-Esprit qui lui permet de discerner dans la Bible ce qui convient à sa vie chrétienne. Comme l’écrit justement Boileau, « tout protestant fut pape, une Bible à la main ».
Puisque la « hiérarchie », étymologiquement le « pouvoir sacré », de l’Église est aboli par Luther, ses successeurs remettront en cause progressivement les autres pouvoirs humains : le protestantisme est d’essence révolutionnaire. Par ailleurs, chacun étant renvoyé à sa propre intériorité, sans médiation ecclésiale, il est logique de séparer radicalement la vie religieuse de la vie politique, par la laïcisation. Il n’est donc pas étonnant que, dans l’établissement de la République laïque en France, dans la mise en place de l’école sans Dieu, dans la montée de l’anticléricalisme et finalement dans la réalisation de la séparation radicale de l’Église et de l’État, on trouve nombre de protestants, au premier rang desquels Ferdinand Buisson, le principal collaborateur de Jules Ferry.
Les bonnes œuvres, notamment les vœux monastiques, étant inutiles et trompeuses, Luther se laïcise et, dès 1525, se marie avec une ancienne religieuse, Catherine de Bora, dont il aura six enfants. D’une façon générale, l’essentiel n’est pas d’éviter le péché, de combattre les tentations (c’est ce qu’a fait Luther durant sa période catholique, mais il estime, à tort, qu’il a échoué), puisque de toute façon l’homme reste intérieurement pécheur. Ce qui compte, c’est de s’agripper au manteau des mérites du Christ pour s’en envelopper et échapper ainsi, quoique toujours ennemi de Dieu, à la colère divine, Dieu voyant sur nous les mérites de son Fils bien-aimé. C’est tout le sens de la maxime de Luther à son ami et biographe Philippe Mélanchthon, dans sa lettre du 1er août 1521 : Pecca fortiter, sed fortius crede (« Pèche fortement, mais crois plus fortement encore »).
L’Église catholique est pour sa part, aux yeux de Luther, « la grande prostituée de Babylone », et il faut l’attaquer et l’annihiler par tous les moyens. Luther va ainsi multiplier les pamphlets orduriers, et ses disciples vont détruire systématiquement les monuments catholiques, torturer et assassiner les évêques, les prêtres, les religieux et de très nombreux fidèles, sans compter les guerres atroces qu’ils déclencheront.
Lorsque Martin Luther meurt, le 18 février 1546, l’Europe est à feu et à sang pour de longues années, à cause de lui. Des millions d’âmes ont apostasié de la foi catholique et quitté la voie du salut en raison de ses fausses doctrines et de ses exemples pernicieux.
Même si l’Église va connaître, dans les années qui vont suivre, un magnifique renouveau grâce à une pléiade de saints et au grand mouvement réformateur dont le concile de Trente est le symbole ; même si d’immenses foules vont entrer dans l’Église grâce à un splendide travail missionnaire ; malheureusement, des nations entières, aveuglées, auront suivi les erreurs et mensonges de l’ancien moine augustin et ne reviendront pas à la vérité salutaire.
Luther aura ainsi vraiment été l’ennemi de la grâce du Christ, qu’il prétendait pourtant honorer. Ce qui nous sépare de lui est donc beaucoup plus important que ce qui pourrait nous unir à lui. C’est pourquoi aucun catholique conscient de ce qu’il doit au Christ et à l’Église ne pourra jamais louer ou honorer Luther.
Abbé Grégoire CELIER, prêtre de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X