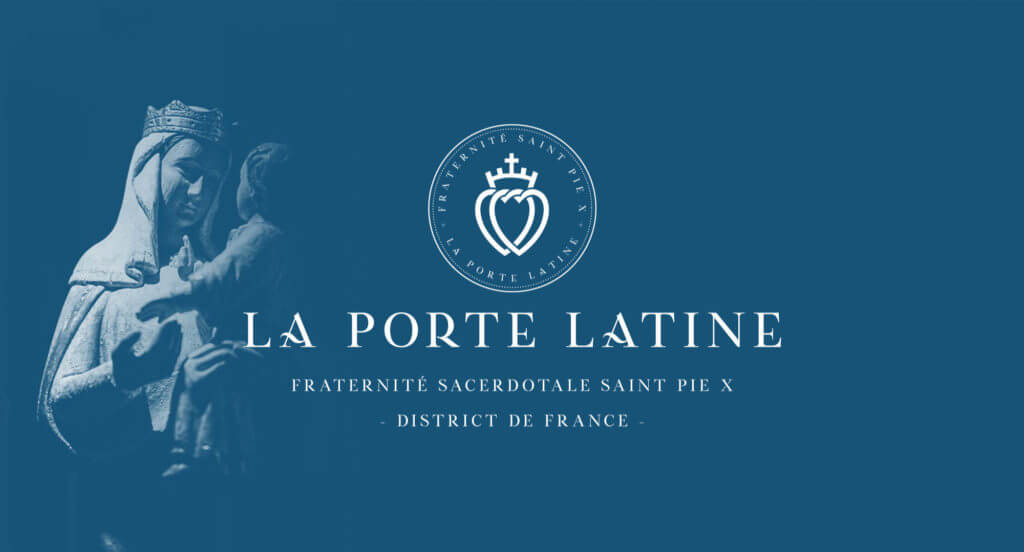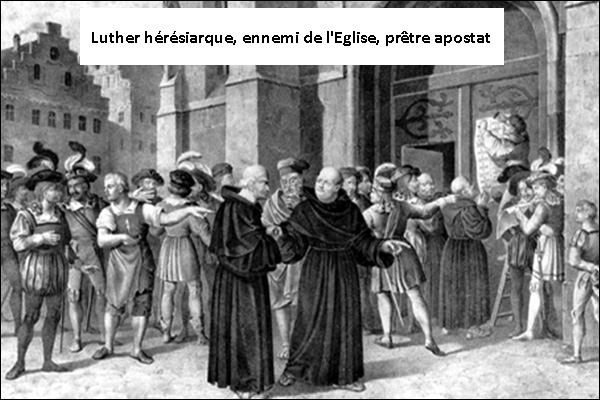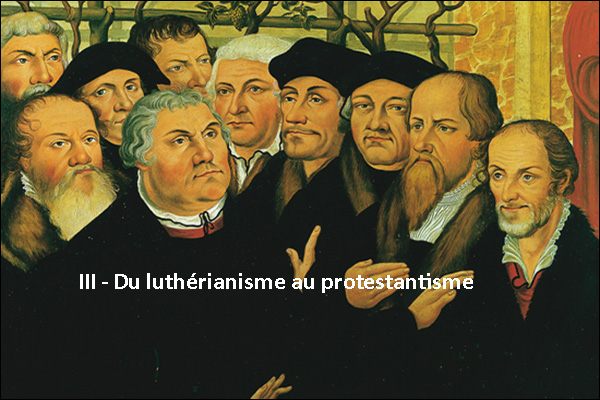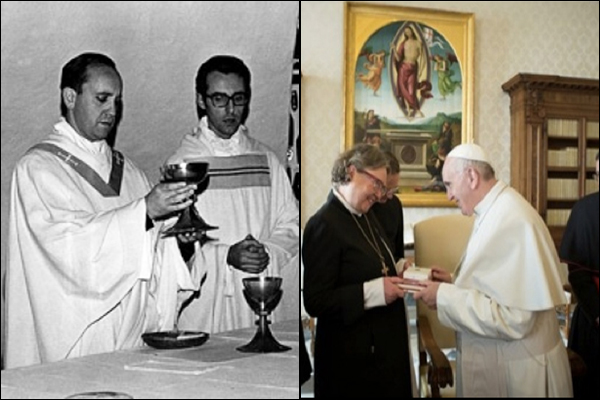Il y a cinq cents ans, exactement le 31 octobre 1517, Martin Luther placardait à la porte de son couvent ses 95 thèses. Ce fut le début de l’action d’éclat de ce moine augustin, professeur de sciences bibliques à l’Université de Wittemberg, au départ de ce que l’histoire devait retenir sous le nom de Réforme protestante.
A l’occasion de cet anniversaire, les églises et communautés se réclamant du protestantisme ont entrepris de célébrer leur héros, à l’origine, selon eux, d’un renouveau bienfaisant pour l’Eglise tout entière.
Le 31 octobre 2016, en Suède, le pape François s’est associé à cet événement, en signant une Déclaration commune avec le chef de la communauté luthérienne. Tous deux se sont déclarés « reconnaissants pour les dons spirituels et théologiques reçus à travers la réforme ».
Dans son sillage, de nombreuses initiatives ont été menées un peu partout en vue d’associer les catholiques à cet anniversaire. Citons, à titre de simple illustration, l’archevêque de Strasbourg, Mgr Jean-Pierre Grallet, qui a participé le 6 décembre 2016 à une célébration œcuménique avec des dignitaires protestants en faisant cette prière :
« Esprit Saint, aide-nous à nous réjouir des dons qui ont été faits à ton Eglise à travers la Réforme, apprends-nous à nous repentir des murs de divisions que nous et nos prédécesseurs avons construits ».
Quels sont donc ces « dons spirituels et théologiques » que la Réforme luthérienne a faits à l’Eglise ? Est-ce le rejet du saint sacrifice de la Messe, de la grâce sanctifiante et de la plupart des sacrements ? Est-ce la révolte contre la hiérarchie catholique, la négation de la visibilité de l’Eglise et spécialement de la papauté ? Est-ce encore la remise en cause du magistère, la haine des vœux de religion et de toute vie religieuse cloîtrée ? Ou le rejet de parties entières de l’Ecriture Sainte, le refus des indulgences de l’Eglise, de la sanctification par les œuvres, du suffrage des saints ?
Forcément dubitatif et perplexe, le catholique est en droit de se demander quels sont les dons que la réforme protestante a apportés à l’Eglise. Mais plus fondamentalement, la question qui se pose est de savoir s’il est juste de parler de réforme de l’Eglise, et si Luther mérite vraiment le qualificatif autant que la qualité d’authentique réformateur. Car, après tout, la sainte Eglise n’a jamais manqué de saints réformateurs venus renouveler son zèle et son ardeur missionnaire. Que l’on songe à saint Pacôme ou saint Antoine, à saint Benoît, saint Bernard, saint Dominique ou saint François d’Assise, ou encore à la réforme grégorienne, à l’action d’un saint François de Sales, d’un saint Vincent de Paul, d’un Monsieur Olier, d’un Dom Guéranger…
Luther en son temps
Luther naît en Saxe à Eisleben dans la nuit du 10 au 11 novembre 1483. Il est baptisé en l’église Saint-Pierre le 11 et reçoit le nom de Martin.[1] C’est une famille purement allemande. Luther – ou Luder, Lueder, de Lothar, signifie « le pur », « le sincère ». Il donnera parfois à son nom une tournure grecque : Eleutheros ou Eleutherius, « le libérateur ».
Entrée à l’Université d’Erfurt en 1501, il suit le cursus de philosophie à la Faculté des Arts avant d’entrer quatre ans plus tard, à la suite d’un vœu précipité, au noviciat des moines augustins d’Erfurt. Ordonné prêtre en 1507, il obtient le bonnet de docteur en philosophie en 1512 et devient professeur. A partir de 1515 il commente la Bible, notamment les livres des Psaumes et les épîtres de saint Paul aux Romains, aux Galates et aux Hébreux.
Apparemment professeur sans histoire, il traverse en réalité de graves crises intérieures : tentations contre la chair, désespoir, angoisses sur son salut. Il voudrait être sûr d’être sauvé alors qu’il est pécheur et retombe sans cesse, et ne voit pas comment échapper à la justice de Dieu.
La lumière, croit-il, se fait au cours de « l’expérience de la tour » (Turmerlebnis) qu’il rapporte dans ses Propos de table. C’est une tour du couvent de Wittenberg, sans doute le cabinet d’aisance. C’est là qu’il comprend que la justice divine s’identifie à la justification par la foi, qui est don de Dieu. Sola fides : seule la foi sauve. Car l’homme est impuissant face aux forces du péché, il est corrompu totalement, même après le baptême. En fait, il est simul peccator et justus pécheur en réalité, mais juste en espérance, en vertu de la promesse de Dieu. L’homme est incapable de travailler à sa propre justice, à son amendement. Telles sont les premières intuitions qui font de Luther un moine défiant envers toute sécurité que l’on voudrait s’acheter trop facilement en ce monde par quelque œuvre méritoire que ce soit.
L’affaire des indulgences
Ces premières intuitions vont se cristalliser autour de l’affaire des indulgences.[2] A l’époque, la basilique Saint-Pierre de Rome est en pleine reconstruction depuis que le pape Jules II a entrepris, en 1505, de raser l’édifice constantinien. A partir de 1507 sont accordées des indulgences en vue de financer le chantier colossal qui met à mal les finances du Saint-Siège. Léon X les renouvelle en 1514. Elles sont prêchées en 1517 en Allemagne du nord. Les indulgences, qui permettent de remettre la dette temporelle due aux péchés pardonnés mais restant à satisfaire, sont accordées contre l’œuvre à accomplir – ici une aumône ou contribution en argent – aux conditions ordinaires, à savoir une bonne confession et une sainte communion. Elles peuvent être gagnées pour les vivants et pour les morts.
Luther juge d’abord qu’ « accorder et gagner des indulgences est une pratique très utile ». Mais il y voit bientôt une fausse sécurité : « Nous devons veiller à ce que les indulgences ne deviennent pas une cause de sécurité, de paresse, de négligence envers la grâce intérieure ». Comme si se confesser et communier étaient des signes de paresse ou de négligence de la grâce ? C’est précisément le contraire.
Finalement, le 31 octobre 1517, il placarde sur les murs de son couvent 95 thèses pour attaquer cette pratique, sur un ton mordant. Il attaque le pouvoir de juridiction du pape et de la hiérarchie sur le trésor de l’Eglise, constitué par l’ensemble des mérites du Christ et des saints. Qui plus est, aussitôt traduites – elles avaient été placardées en latin –, ces thèses font de Luther une sorte de porte-parole des aspirations, des rancœurs et des doléances germaniques contre Rome.
Le succès qu’il rencontre, les soutiens qui se déclarent pour l’encourager, sa faconde naturelle montent à la tête de ce moine qui, avec son caractère entier, fougueux, entêté, violent, va prendre une assurance que rien ne pourra briser. Il est devenu un révolté, un chef de file.
Vers la rupture
Luther, se sachant protégé par le prince-électeur de Saxe, refuse malgré son vœu d’obéissance de se rendre à Rome où il est convoqué pour s’expliquer. Le pape dépêche alors l’évêque de Gaète, le cardinal Thomas de Vio dit Cajetan. Celui-ci rencontre le moine augustin à Augsbourg en octobre 1518. Luther ne rétracte aucune de ses thèses. Mieux, il en appelle à un concile pour juger le pape.
L’année suivante, il rejette la Tradition comme source de la Révélation. L’Ecriture est la règle unique de la foi : sola scriptura. Il rejette aussi l’autorité des conciles et du pontife romain. Il refuse l’infaillibilité de l’Eglise. De plus en plus, il est convaincu que le pape est l’Antéchrist. Luther agit désormais en prophète d’une nouvelle Eglise, invisible, sans hiérarchie, sans pape, sans sacerdoce. Enfin il en vient à attaquer la plupart des sacrements qu’il dénonce comme des inventions impies : confirmation, eucharistie, extrême-onction, mariage, et surtout l’ordre. Il est pourtant prêtre ; il se hait lui-même.
L’année 1520 marque le point de non-retour.[3] Sa pensée autant que sa doctrine se structure pour former un corps de doctrine où les hérésies le disputent à l’esprit schismatique. Au mois de mai, il fait paraître son traité consacré à la papauté romaine (Von dem Papsttum zu Rom). C’est un clair refus de son institution divine. Le pape n’est qu’un tyran, au même titre que le Turc ! La véritable Eglise est invisible ; elle rassemble spirituellement tous ceux qu’unit la foi au Christ, seule cause de justification et de salut. Le pouvoir des clefs promis par le Seigneur réside uniquement dans la communauté d’où découlent les actes du culte, et non dans la hiérarchie instituée par le Christ. Cajetan a vu juste en publiant dès 1521 un opuscule sur Le successeur de Pierre dont le sous-titre est « l’institution divine du souverain pontificat de l’évêque de Rome ».[4]
Au mois d’août 1520, Luther publie son traité le plus important, adressé à la noblesse allemande (An den Christlichen Adel deutscher Nation). Résolument il se tourne vers les princes temporels pour les rallier à ses thèses et protéger la nouvelle religion qu’il entend fonder. Il faut, leur dit-il, renverser trois murailles : 1) La distinction entre les ecclésiastiques et les laïques ; 2) Le droit du pape d’interpréter seul l’Ecriture ; 3) Sa juridiction universelle et son pouvoir de convoquer les conciles.
Le raisonnement est simple et terriblement efficace. Le baptême suffit à conférer le sacerdoce universel à tous. En conséquence chaque chrétien a le droit d’interpréter à sa guise l’Ecriture Sainte et de juger de la foi. Il en va de même pour la convocation d’un concile : le premier venu peut le faire, « mais nul ne le peut aussi bien que ceux qui ont en main le glaive temporel ». C’est phrase est lourde de sous-entendus. Elle contient en fait la soumission de l’Eglise à l’Etat. Luther se cherche des appuis pour rejeter l’autorité du pouvoir spirituel, sans pour autant être accusé de détruire l’ordre social et le caractère naturel de toute autorité.
Pour justifier la hardiesse de ses théories et le rejet complet de l’institution ecclésiastique, Luther publie en octobre 1520 un nouveau traité au titre provocateur : De captivitate Babylonica Ecclesiæ. On y trouve explicitement le rejet de la doctrine et de la pratique des sacrements. Pourtant, il conserve le baptême, y compris celui des enfants, ce que lui reprocheront bientôt les anabaptistes, parmi lesquels il compte ses premiers soutiens et même des amis. Il conserve aussi la Cène, mais sans le saint sacrifice de la Messe qu’il exècre. Il rejette la transsubstantiation et le sacrement de l’ordre. Le pasteur, qui conduit le culte, n’est que le chef de l’assemblée. Il autorise enfin la communion sous les deux espèces et l’emploi de la langue vernaculaire.
Le même mois paraît encore le traité De la liberté chrétienne, où Luther réaffirme que le chrétien est justifié par la foi sans les œuvres, qu’il rejette définitivement. Seule la justification par la foi est la vraie liberté qui affranchit de tout péché. C’est la théorie du Esto peccator et pecca fortiter, sed fortius fide et gaude in Christo qui victor est peccati, mortis et mundi : « Sois pécheur, et pèche fortement, mais crois plus fort et réjouis-toi dans le Christ qui est vainqueur du péché, de la mort et du monde ».[5] C’est le développent du simul peccator et justus que le novateur avait déjà exposé dans son Commentaire de l’épître aux Romains, quelques années auparavant : c’est l’imputation de la promesse du salut qui suffit à justifier l’homme, même pécheur et dépourvu de la grâce sanctifiante.
Pour Luther, l’Eglise est réduite en servitude, déportée à Babylone sous le joug du pape, qu’il identifie à l’Antéchrist. « Tout se passe, écrivent les auteurs de L’histoire des conciles, comme si le réformateur reportait sur la foi, la foi seule, cette certitude, cette sécurité qu’il reprochait aux chrétiens de son temps de placer dans les œuvres, dans les Indulgences ! »[6] Ce faisant il doit rejeter les passages de l’Ecriture qui proclament que sans les œuvres, la foi est morte (cf. Jac. 2, 26). Luther substitue à la foi de l’Eglise sa propre construction intellectuelle, son opinion, celle d’un serf-arbitre illuminé par son expérience personnelle. Par ce moyen il entend justifier sa révolte contre les vœux et la libération de ses angoisses et scrupules de conscience. Bientôt il prétendra imposer ses vues à toute la Chrétienté, par les armes des seigneurs laïcs.
Telle est la réforme de Luther, une réforme d’abord idéologique, dogmatique, et non la réforme des mœurs et de la discipline que l’Eglise appelait de ses vœux. Dans une lettre au pape Léon X, il écrit d’ailleurs : « C’est contre les doctrines impies que je me suis dressé, et j’ai sévèrement mordu mes adversaires, non pas à cause de leurs mauvaises mœurs, mais à cause de leur impiété. » Quelques mois plus tard, en février 1521, son disciple Mélanchton résume le cœur de l’entreprise protestante : « Luther mène la guerre contre les doctrines perverses, contre les dogmes impies et non contre les vices privés des représentants du sacerdoce ».
Ils se trompent donc complétement ceux qui prétendent que le protestantisme fut une saine réaction à la décadence du catholicisme et qu’il fut animé par une intention de réforme des mœurs. Il s’agit d’une entreprise d’une tout autre nature : un rejet, une révolution complète contre la foi catholique et l’Eglise fondée sur Pierre.
L’évêque de Luçon le comprendra bien. Un siècle après l’affichage des thèses de Luther, le futur cardinal de Richelieu présentera la Réforme comme une hérésie menaçant les institutions religieuses et politiques, « une irruption du désordre fondée sur le détournement des Ecritures et la méconnaissance de la tradition ».[7]
De l’hérésie au schisme
Le pape Léon X prohibe les théories du moine augustin le 15 juin 1520 (Bulle Exsurge Domine) : 41 propositions sont condamnées, et Luther est sommé de s’expliquer. Devant les professeurs et les étudiants de Wittemberg, il brûle l’« exécrable bulle de l’Antéchrist » en public, le 10 décembre de la même année. Il en fait un bûcher avec les recueils des décrétales des papes et plusieurs ouvrages scolastiques. Rome se décide à excommunier le moine révolté le 3 janvier 1521.
La révolte de Luther passe alors au plan politique. Convoqué à la diète de Worms en avril 1521, l’hérésiarque muni d’un sauf-conduit refuse de se rétracter. L’empereur Charles-Quint le met au ban de l’Empire comme excommunié, schismatique obstiné et hérétique notoire. Mais le prince-électeur Frédéric de Saxe le sauve : il le fait enlever et mettre en sûreté au château de la Wartburg. C’est là que Luther travaille à la traduction, en allemand, de la Bible.
Bientôt il se dissocie de son fidèle disciple Thomas Müntzer, prophète illuminé qui soulève les paysans contre les impies. Luther se tourne résolument vers les seigneurs de Saxe, Hesse, Brandebourg, etc. L’année 1525 verra la terrible répression de la guerre des paysans, tandis que Luther épouse, le 13 juin 1525, Catherine Bora, une ancienne religieuse. Ayant foulé au pied tous ses vœux, Luther confie aux princes le soin d’imposer la réforme dans les paroisses et les abbayes. Il profite du désordre général, du sentiment national allemand violemment anti-romain, et de la cupidité des seigneurs. Ceux-ci reçoivent le pouvoir de conduire la réforme en réglementant le culte et en s’accaparant les biens de l’Eglise. Forts de ce jus reformandi tombé entre leurs mains, les détenteurs du pouvoir laïc lancent la sécularisation des monastères, font main basse sur les églises et ses trésors. Partout éclatent de violentes émeutes, des scènes de vandalisme et de destruction iconoclaste. Cette lutte acharnée contre les reliques, les statues, les tabernacles, les lieux de pèlerinages et de dévotion conduit à des destructions colossales, surtout lorsque les fidèles tentent de s’y opposer.
Luther meurt en 1546 impénitent, laissant de sa vie l’image d’un ivrogne grivois et violent. Décidément, il s’était bien révolté contre les dogmes de l’Eglise, et non contre les vices et les abus du clergé.
Conclusion
La réforme luthérienne est moins une vraie réforme qu’une révolution jetant par terre dogmes, pratiques religieuses, liturgie, sacrements et autorités divinement établies. Elle coupe l’Eglise latine en deux. D’un côté, les pays qui resteront fidèles à la doctrine catholique et soumis à la juridiction de l’Eglise, de l’évêque de Rome. De l’autre, les pays qui embrasseront les idées nouvelles et tomberont entre les mains des seigneurs, de l’Etat.[8]
En ce 31 octobre 2017, où plusieurs manifestations œcuméniques sont organisées un peu partout, les autorités de l’Eglise actuelle prétendent fêter ou célébrer de bien tristes événements… Luther, on l’aura compris, fut l’un des plus grands hérésiarques de tous les temps, responsable, avec Arius, de la perte d’innombrables âmes.
Pour sa part, Mgr Fellay, le supérieur général de la Fraternité Saint-Pie X, a déjà expliqué « pourquoi nous ne pouvons pas célébrer dans la joie le 500e anniversaire de la Réforme protestante. Bien au contraire, nous pleurons cette cruelle déchirure. Nous prions et œuvrons, à la suite de Notre Seigneur, pour que les brebis retrouvent le chemin qui les conduira sûrement au salut, celui de la sainte Eglise catholique et romaine ».[9]
Abbé Christian Thouvenot, prêtre, Secrétaire Général de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X
Sources : Fsspx.news
- Hartmann Grisar, Martin Luther, sa vie et son œuvre, Paris, Lethielleux, 1931, 402 pages.[↩]
- De la Brosse, Lecler, Holstein, Lefebvre, Les Conciles de Latran V et Trente, coll. Histoire des conciles œcuméniques, tome X, Dumeige (dir.), Fayard, 2007, p. 117, sq.[↩]
- Résumé à partir de l’Histoire des conciles œcuméniques, tome X, Dumeige (dir.), op. cit.[↩]
- Edition française par l’abbé Jean-Michel Gleize, Courrier de Rome, 2004.[↩]
- « Sei ein Sünder und sündige kräftig, aber vertraue noch stärker und freue dich in Christus, welcher der Sieger ist über die Sünde, den Tod und die Welt ».[↩]
- Histoire des conciles œcuméniques, tome X, Dumeige (dir.), op. cit., p. 126.[↩]
- Cité par Arnaud Teyssier, Richelieu, l’aigle et la colombe, Perrin, 2014, p. 129.[↩]
- A. Boulanger, Histoire générale de l’Eglise, tome III, vol. VI, Emmanuel Vitte, 1938, p. 22.[↩]
- Lettre aux Amis et Bienfaiteurs n°87, 26 avril 2017.[↩]