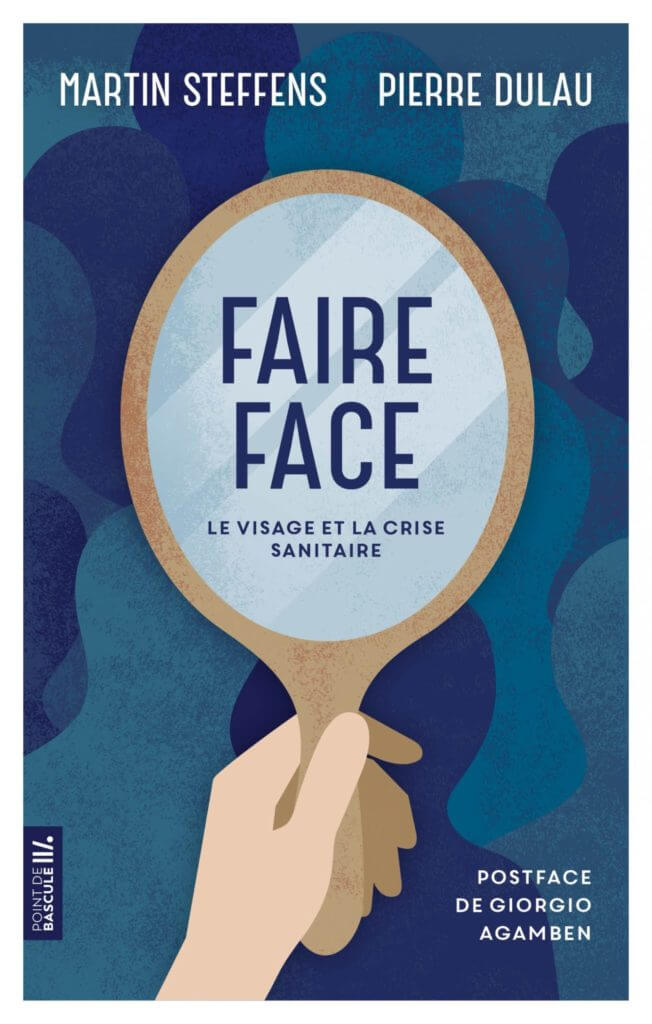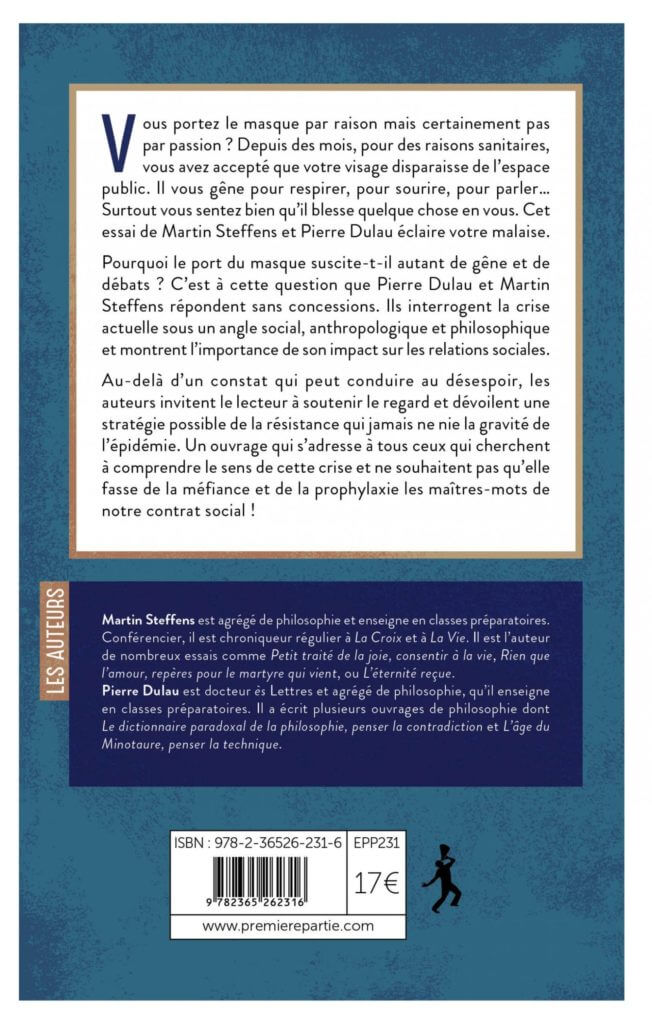Port du masque, entrée en vigueur du pass sanitaire, politique de vaccination… Martin Steffens et Pierre Dulau, tous deux agrégés de philosophie et professeurs en classes préparatoires, ont publié récemment dans leur ouvrage « Faire face – le visage et la crise sanitaire » [1], des réflexions au sujet de la « société de l’hygiénisme sécuritaire » dans laquelle nous entrons.
Martin Steffens et Pierre Dulau voient dans notre époque actuelle un moment clé, celui du passage à un nouveau type de société en prenant occasion d’un prétexte sanitaire : l’apparition du virus « Sars-CoV‑2. », le covid. Prétexte, oui, car derrière l’avalanche d’informations quotidiennes, les deux auteurs remarquent que les faits constatés et rigoureusement établis sont très souvent « ou bien rares, ou bien nombreux et discordants ». Il y a beaucoup de flou dans cette période : « les effets du virus sur la santé ne furent jusqu’à présent jamais tels que les remèdes envisagés dussent passer pour incontestables. Le doute demeure quant à savoir si les remèdes choisis (confinements, couvre-feux, annonces spectaculaires, pénalisation des écarts, restrictions radicales des libertés fondamentales…) ne sont pas pires que les maux. Le sentiment de « s’être fait avoir » traverse aujourd’hui l’esprit du plus honnête des hommes. » Si la présence d’un virus est évidemment constatée, il serait ridicule de l’équiparer à la peste noire ou au choléra, nous ne voyons pas de cadavres joncher les rues ni la population mondiale diminuer sensiblement. Richard Horton, le rédacteur en chef du Lancet[2], l’indiquait d’ailleurs en septembre 2020, « le covid-19 n’est pas une pandémie », loin de toucher le peuple entier, il n’est grave presque exclusivement que chez certaines personnes âgées ou fragiles. Ce qui donne de l’importance à ce virus, c’est que « les gouvernements choisirent de compenser par l’imagination et le conditionnement ce que l’expérience sensible ne pouvait offrir. Afin que la catastrophe n’eût pas lieu, on frappa catastrophiquement les esprits. » Par la peur instillée et les mesures de distanciation sociale, la société s’est trouvée radicalement modifiée.
Si ces mesures ne sont pas seulement liées à un problème sanitaire, alors concluent logiquement Steffens et Dulau, « il n’y a aucune espèce de raison pour que les restrictions à nos libertés fondamentales soient un jour entièrement levées. » Ce régime de l’hygiénisme sécuritaire devient permanent. Pourtant, actuellement, la plupart des gens de bonne volonté croient que ces mesures ne sont que provisoires, ils les prennent au sérieux dans l’espoir qu’en les respectant elles ne dureront pas, qu’ils contribuent au bien commun, montrent le bon exemple. Submergés depuis un an et demi d’informations qui orientent leur jugement, on leur fait miroiter un retour toujours futur à la liberté d’avant, mais qui ne vient jamais. C’est justement ce mécanisme de fausses promesses alléchantes qui permet aux restrictions de s’installer durablement. Leur logique fondamentale ne possède aucune limite en elle-même et, pour Pierre Dulau, « tout pouvoir qu’on cède à l’Etat, l’Etat n’y renonce jamais. C’est un principe historique. […] L’histoire n’est pas une phrase où l’on peut faire des pauses et revenir à l’objet principal.[3] »
L’humain distancié
Il est indéniable que le masque sanitaire porté habituellement modifie les apparences et les relations des uns et des autres, selon nos auteurs il « fait du visage humain une figure angoissée qui manque d’air et de celui qui le contemple, le spectateur impuissant d’une asphyxie. […] Cette humiliation physique quotidienne a pour propriété manifeste d’être disgracieuse ». Le masque est un « symbole de désunion, de défiance, de peur, d’évitement », de renoncement au Principe de Visibilité Réciproque nécessaire à toute relation humaine fondée sur une confiance donnée a priori. De même, par les mesures de distanciation, « l’autre est posé a priori comme une menace fantôme dont il faut se défier et, moi-même, je ne puis qu’apparaître que comme un mal dont il faudrait que chacun puisse toujours se préserver. » Cette séparation collective décourage les liens sociaux essentiels à la vie de toute communauté. Les seuls sourires licites deviennent ceux qu’arborent les publicités, ils donnent l’illusion que la liberté repose dans la consommation, l’argent.
Si la santé est un bien nécessaire – il faut en effet un minimum de santé pour pouvoir vivre et posséder les autres biens humains – elle n’est pas cependant le plus important des biens. On peut très bien sacrifier la santé pour une raison supérieure (le salut éternel, la foi, la cité politique, la famille…) car celle-ci n’est pas une fin en soi, elle est relative à des biens plus élevés. Les professeurs Steffens et Dulau nous invitent « à ne pas reculer devant le paradoxe : la surenchère de précautions sanitaires, la tentative pour faire de la communauté une société d’évitement grâce à un hygiénisme sécuritaire et technologique, tout cela, qui boucle la vie sur elle-même, ne satisfait en dernier ressort qu’un impératif au mieux bestial, au pire morbide. La pulsion de vie se fait ici pulsion de mort : ne chercher qu’à réitérer obsessionnellement la vie, afin qu’elle ne se perde pas, c’est ne plus la vivre. »
Testé, re-testé, à nouveau testé alors qu’il n’est pas malade, cas contact d’un cas contact, lui-même ayant croisé par hasard un cas contact, le citoyen sera bientôt conditionné à ne s’éprouver lui-même que comme un virus.
Steffens et Dulau remarquent également que Santé et Marché font bon ménage, « les maux s’accroissent à proportion des moyens conçus en amont d’eux pour les soulager. En convainquant chacun qu’il est une menace potentielle contre tous, on introduit cette idée que chacun est un malade potentiel, un malade qui s’ignore et qui a donc besoin de soins. » Tout un marché du soin s’ouvre et augure des affaires à proportion d’une demande surexaltée, « testé, re-testé, à nouveau testé alors qu’il n’est pas malade, cas contact d’un cas contact, lui-même ayant croisé par hasard un cas contact, le citoyen sera bientôt conditionné à ne s’éprouver lui-même que comme un virus. » La fascination entretenue par les médias engendre une nouvelle économie basée sur le spectre de la mort qu’entrainerait potentiellement une contamination, « le besoin d’écouler les stocks ne saurait manquer, un beau jour d’hiver, de produire par les mêmes biais les peurs qui viennent alimenter son industrie. De produire l’homme qui convient : craintif, scrupuleux, « citoyen », comme l’on dit désormais pour désigner ceux qui surjouent le jeu sanitaire. »
La vaccination, un nouveau contrat social
Dans un entretien donné au site d’information Aleteia le 9 juillet 2021[4], Pierre Dulau observe que, d’une certaine manière, « le vaccin, c’est le masque à l’intérieur du corps. Les gens ne se vaccinent pas pour arrêter de se protéger les uns les autres, ils se vaccinent pour ne plus jamais cesser de se protéger les uns des autres. » La même fuite en avant pour immuniser la vie contre la mort se prolonge. Il constate qu’ « à 95 ans, les gens ne meurent plus de vieillesse. Ils meurent du Covid. Autant dire qu’au fond, la vie devrait pouvoir se poursuivre indéfiniment si nous n’étions pas constamment mis en danger de la menace potentielle que constitue toujours notre voisin. » Avec le vaccin, la santé se trouve aussi soumise aux insatiables exigences économiques : « C’est aujourd’hui le système immunitaire de l’homme qui apparaît comme un nouveau marché exploitable […], il s’agit désormais de vous vendre le « forfait immunité » pour seulement 19,99 euros par mois. La nouveauté est que si l’on refuse, on perd des droits. »
Le pouvoir va jusqu’à mettre en place un jeu très dangereux, « après avoir joué la carte de la peur, utilise maintenant la carte du ressentiment en affirmant que les vaccinés vont être (où sont déjà) victimes des non-vaccinés. » Si beaucoup de gens se font vacciner sous la contrainte des obligations ou pour qu’on les laisse en paix, d’autres espèrent retrouver leur vie d’avant ou croient ainsi montrer l’exemple, mais selon Pierre Dulau répondant à Aleteia, ils « n’ont peut-être pas à l’esprit qu’on leur proposera une troisième, puis une quatrième dose, puis un nouveau type de traçage en temps réel de leur métabolisme, etc. Encore une fois, il n’y a pas de limite immanente à ce processus. » La vaccination devient ainsi « un acte d’adhésion à un nouveau contrat social de type technico-sanitaire fondé sur un idéal d’hygiène commune. »
Un discours moralisateur
Les slogans gouvernementaux assénés partout sur le mode publicitaire sont des plus simples : « quand on aime ses proches, on ne s’approche pas trop », « en restant chez soi, on sauve des vies ». Ils sont comme les commandements d’une nouvelle morale. Ce discours public, toujours selon l’ouvrage Faire Face de Steffens et Dulau, « entend nous convaincre que si nous nous comportons bien, nous vaincrons le virus ; ce qui signifie que si nous nous comportons mal, nous cherchons à le propager. » Les accusations de complotisme, d’assassinat des plus fragiles et de sédition pleuvent sur quiconque s’oppose fermement à la surenchère hygiéniste, le refus d’écouter les voix contradictoires est absolu. Un cercle infernal enfièvre les discours politiques : « si de telles mesures ne fonctionnent pas, si malgré le passeport sanitaire et les couvre-feux, il y a encore des malades, alors il faut renforcer ces contraintes ; mais si, à l’inverse, elles fonctionnent, si on s’imagine qu’on a pu endiguer la catastrophe du seul fait de l’anticiper, c’est donc qu’il faut les maintenir, voire, là encore, les renforcer […] L’Etat voit le mal partout, sauf en lui-même. Très exactement, il ne le voit qu’en nous. »
Enterrés vivants, bâillonnés, défigurés, nous serons encore accusés par notre fossoyeur bienveillant.
Cette leçon de morale permanente repose sur une politique de la défiance et de l’amertume, donnant l’impression infantilisante d’être soumis à une maîtresse d’école : « elle nous reproche de ne pas avoir mis notre masque, de ne pas avoir respecté les gestes barrières, de ne pas nous être fait dépister à temps […] Par notre faute, peut-être, l’Etat qui pourvoit héroïquement à tout, va devoir procéder à un nouveau confinement. […] Enterrés vivants, bâillonnés, défigurés, nous serons encore accusés par notre fossoyeur bienveillant. »
La vertu s’efface dans une telle société au profit du protocole détaillé, de la nouvelle morale technico-sanitaire. L’hygiénisme supplante le bien, la politesse, le savoir-vivre élémentaire, Steffens et Dulau notent avec justesse que « vivre sera désormais une affaire d’Etat. On formule l’hypothèse que les citoyens sont tous des barbares négligents et inconscients auxquels il faut apprendre à se laver les mains. L’hygiénisme sécuritaire coiffé par un Etat maternel, met fin aux mœurs. »
L’Etat tout-puissant
Les deux philosophes rappellent qu’ « il y a totalitarisme quand l’Etat perd tout contour, qu’il devient tout. », quand la vie politique ne s’articule qu’autour de l’allégeance à son projet, sans qu’aucune contradiction ne soit possible.
L’Etat, pour parvenir à cet état, détruit l’amitié entre les citoyens, s’ingère dans la vie familiale et privée. C’est bien ce que nous constatons, aux termes belliqueux du gouvernement « Guerre », « couvre-feu », « mobilisation », « traçage », « bataille », correspond un ennemi à combattre. Cet ennemi est déjà dans le pays, « on dira que l’ennemi est surtout le virus, que nous sommes unis dans notre lutte contre lui. Certes. Mais de cet ennemi, chacun a été présenté, avec insistance, comme le potentiel passeur. Ce qui signifie que chacun est pour son concitoyen un traître potentiel. » Chacun est combattant et traître simultanément, malade qui s’ignore[5] il se met lui-même en auto-surveillance en remplissant ses attestations de sortie ou en présentant son pass sanitaire, il surveille ses voisins…
Certains imaginent le totalitarisme comme le régime de l’ordre, en fait « c’est un régime de la surenchère contraignante qui dissimule l’absence d’un ordre réel. […] Lorsqu’on ne sait plus se décider de manière rationnelle, on infeste la vie de règles visant à en organiser jusqu’au moindre détail marginal. […] Comme les masques, l’Etat totalitaire colle à votre peau, au plus près de votre respiration. » Pour instaurer une telle situation, la peur est le ressort indispensable, il faut que la terreur soit instituée de façon permanente ; « les clips commandés par l’Etat, les annonces répétitives sur tous les médias, la litanie du nombre de décès, les messages d’avertissements dans tous les transports forment bel et bien un réseau de signes qui vise à faire de la crainte la passion dominante de la vie sociale. » On l’accentuera ou on la diminuera selon les comportements que l’on souhaite obtenir.
Peu importe ce dont on parle, pourvu qu’on le chiffre. D’où ce paradoxe abyssal : bien que, sur la totalité des vivants, peu d’hommes mourront du covid, tous auront été gravement atteints par la ritournelle de son évocation.
L’Etat totalitaire repose sur une vision archi technicisée de la société, tout processus doit absolument être chiffré. Seul compte le nombre : « le nombre des décès, de patients hospitalisés en service de réanimation, des individus malades, des porteurs asymptomatiques du virus, du taux d’incidence, etc. Ces nombres, bien sûr, n’ont par eux-mêmes aucun sens : ils ne sont que les ombres chiffrées d’un réel appauvri. Pourtant, ils ont cette efficacité propre de donner à la tendance totalitaire toujours plus de mobiles de se renforcer. Aussi ne cesse-t-elle de les invoquer. Ils sont l’apprêt du rationnel en régime déraisonnable. » Le règne de la technique, du calculable, du sigle abstrait (covid, test pcr, qr code, ephad, pass, etc.) vient réduire tout être, toute vie, à la dimension quantifiable et modélisable informatiquement, « Peu importe ce dont on parle, pourvu qu’on le chiffre. D’où ce paradoxe abyssal : bien que, sur la totalité des vivants, peu d’hommes mourront du covid, tous auront été gravement atteints par la ritournelle de son évocation. »
Que l’on soit pour ou contre les mesures prises par l’Etat, chacun doit concrètement se plier aux « bons réflexes » qui nous protègent de notre liberté. Les gestes imposés à tous sans limite sont, selon Jacques Ellul[6], typiques de la propagande moderne qui cherche à obtenir bien plus qu’une orthodoxie (pensée unique), une orthopraxie (pratique unique). Pour en arriver là, il faut casser la capacité de réflexion en soumettant de force la population à des injonctions contradictoires et absurdes : « à défaut de comprendre, le sujet agira. » Les exemples avancés par nos auteurs nous sont malheureusement bien familiers, on exhorte les citoyens « à prendre soin des plus fragiles tout en leur interdisant de les voir. Les inviter à partir en guerre, en restant chez eux. Se plaindre des risques de contaminations du fait de l’engorgement des supermarchés mais imposer le confinement dans les grandes villes dès 18 heures. Exhorter les citoyens à la responsabilité personnelle tout en leur promettant des amendes mirobolantes et des mois de prison ferme en cas d’infraction. Les inviter à jouir sans crainte d’un déconfinement qui s’accompagne pourtant d’un couvre-feu… » L’effet de toutes ces contradictions est de créer « un état de sidération qui redouble celui de la crainte initiale provoquée par la maladie. » Le citoyen perd tout jugement devant une multitude d’ordres incompatibles, désespère de sa liberté, n’a plus de goût pour rien. Le totalitarisme trouve alors un être parfaitement malléable, crédule, contrôlable, il pourra sans difficulté aller jusqu’à régler « les heures des repas, les manières d’aimer et de sourire, de se laver les mains et de mourir, les paroles autorisées et les paroles interdites. » C’est le despotisme de l’irrationnel, l’absurde devient normal.
Une société inversée
Par une sorte de suicide, la société actuelle renonce à la vie selon un mode inédit dans l’histoire de l’humanité, « c’est rendu possible par une illusion : celle qui consiste à croire que vivre serait, primordialement, conserver la vie. […] On peut la nommer, avec Olivier Rey[7], « l’idolâtrie de la vie ». On l’appelle aujourd’hui “santé publique” ». Pourtant aucune vie n’est possible sans qu’il y ait des risques à prendre, c’en est même la condition sous peine de se condamner à l’état de mollusque qui, même eux, finissent par mourir un jour ! Nos deux auteurs donnent l’image du marin qui de toute façon « coulera avec le navire, si par peur de se noyer, il refuse de se jeter à l’eau. »
Un monde d’esclaves n’a rien d’enviable, c’est pourtant ce qui se profile avec l’existence « d’un homme diminué au point de vouloir sa servitude et de chérir son effacement comme un moyen de salut paradoxal. De cette nouvelle religion de la désincarnation, le coronavirus est l’apocalypse asymptomatique. Ni odyssée tragique qui façonne des héros, ni charité fidèle qui révèle des saints, mais quoi donc alors, pour tenir lieu de monde humain ? » La terre comme antichambre de l’enfer, n’est-ce pas là le plus cher désir des anges déchus ?
Steffens et Martin ne manquent pas à la fin de leur ouvrage d’entrouvrir l’issue de secours, « le christianisme, ici, nous éclaire, qui nous dit que la vie ici-bas, dès lors qu’elle se prend pour l’absolu, n’est jamais qu’une mort […] Se consacrer exclusivement à sa vie, la retenir fiévreusement, c’est choisir sa propre damnation ». Fondamentalement, la vieille lutte des premiers chrétiens face à l’univers de la Rome païenne n’est pas finie, seules les circonstances changent, « l’univers covidique est un univers païen hyper-technologique, superstitieux et fétichiste, dont l’idéal d’existence est le service de réanimation où la vie est mesurée par la seule survie. » Pour nous, nous le savons, notre vie terrestre est ordonnée à plus élevé qu’elle, nous la recevons de Dieu pour retourner à Dieu par Notre-Seigneur Jésus-Christ.
Abbé Gabin Hachette
Faire face, le visage et la crise sanitaire, Martins Steffens et Pierre Dulau, Éditions Première Partie, avril 2021, 17 euros.
- Martin Steffens et Pierre Dulau, Faire Face – Le visage et la crise sanitaire, Editions Première Partie, 2021. Le présent article n’équivaut évidemment pas à une adhésion à tout ce que ces auteurs peuvent écrire par ailleurs.[↩]
- L’une des plus importantes revues scientifiques mondiales. Richard Horton, « COVID-19 is not a pandemic », The Lancet, 26 septembre 2020.[↩]
- Aleteia, entretien du 9 juillet 2021 avec Pierre Dulau « Nous entrons dans une société de l’hygiénisme sécuritaire ».[↩]
- Ibidem. Les réflexions de l’entretien ne sont pas en italique afin de les différencier de celles de l’ouvrage Faire Face.[↩]
- Dans la célèbre pièce de Jules Romain, Docteur Knock – le Triomphe de la médecine, tous les gens en bonne santé ne sont jamais que malades qui s’ignorent. La maladie est la norme, non la santé.[↩]
- Jacques Ellul, Propagandes, Economica, 1990, réimp. 2008, p. 36–38.[↩]
- Olivier Rey, L’Idolâtrie de la vie, coll. « Tracts », Gallimard, 2020.[↩]