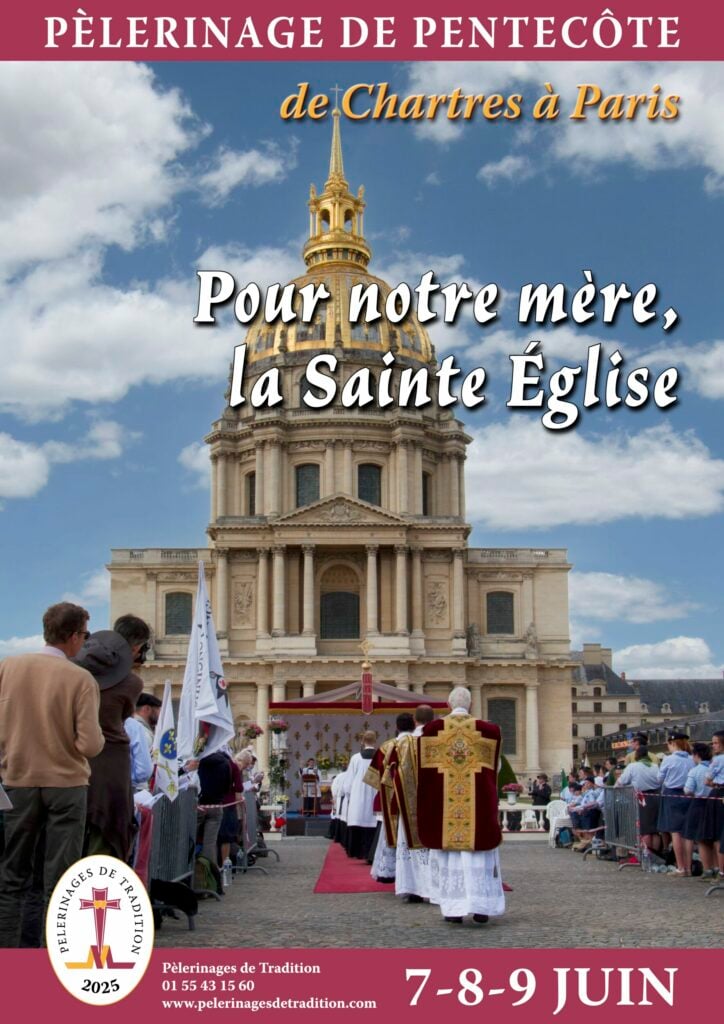Ce que les pèlerins viennent voir à Rome, ce ne sont pas seulement des œuvres d’art, mais encore l’héritage des Apôtres.
Le pèlerinage à Rome, outre la visite des grandes basiliques en vue de gagner l’indulgence, donne l’occasion de jouir d’un patrimoine artistique et historique exceptionnel. Pourtant, il est une visite qui revêt pour le catholique une signification de premier plan, quoiqu’elle n’éblouisse certes pas autant que la profusion de marbres, d’ors et de mosaïques qui ornent la Ville éternelle. Il s’agit des fouilles vaticanes.
Le visiteur est conduit sous la basilique Saint-Pierre, sous la crypte dite des grottes vaticanes, pour explorer les restes d’une nécropole antique. Ces pierres, ces maçonneries, mais aussi ces quelques fresques conservées ne parlent vraiment qu’au spécialiste. Mais au cours de la visite, on indiquera un conduit, au bout duquel on distingue une veilleuse allumée près d’un mur rouge. Un peu plus tard, une colonnette encastrée dans une maçonnerie est censée attirer l’attention. Enfin on arrive en vue d’un mur percé d’un trou irrégulier, et recouvert de graffitis. Dans l’ouverture on peut distinguer si on a bon œil quelques coffrets de plexiglas. Si le touriste est perplexe, le fidèle, lui, se met à genoux et chante « Tu es Petrus » : il s’agit des reliques du Prince des Apôtres. En vénérant ces restes sacrés, c’est non seulement la personne du pécheur de Galilée qu’on honore, mais encore l’institution divine du souverain pontificat dans l’Eglise.
La tradition de la présence des reliques de saint Pierre au Vatican avait été contestée par la Réforme, et aucune velléité de fouille n’avait été suivie d’effet, peut-être de peur de ne rien découvrir et d’attiser les sarcasmes. C’est lorsque le pape Pie XI mourut que, sur sa demande d’être enseveli aussi près que possible de la confession de la basilique vaticane, on commença à creuser, non pour fouiller, mais pour établir le monument. Assez rapidement on découvrit une chambre funéraire richement ornée de fresques. La Providence invitait à continuer.
Le pape Pie XII trouva en George Strake, un Américain qui avait providentiellement fait fortune dans le pétrole, un bienfaiteur prêt à financer des travaux longs et incertains, et qui devaient rester confidentiels. Les fouilles seront menées en deux campagnes, dans les années 40 et 50. De ce qu’on découvrit, et d’autres études, on peut tirer quelques éléments de l’histoire des reliques de l’Apôtre.
A sa mort, « victime d’une injuste jalousie » selon le pape saint Clément, crucifié la tête en bas dans le cirque de la résidence vaticane de l’empereur, Pierre est enseveli dans la nécropole voisine située sur la colline du Vatican. Sans doute les fidèles honorèrent discrètement sa sépulture.
Un modeste monument est érigé au milieu du 2e s., un mur rouge – celui qu’on distingue encore pendant la visite – percé de deux niches, une tablette soutenue par deux petites colonnes, dont l’une est encore visible. Les restes de saint Pierre sont enterrés sous ce monument, appelé « trophée de Gaïus » parce qu’un prêtre de ce nom mentionne vers 200 les « trophées » (monuments) des Apôtres Pierre et Paul à Rome.
Il semble établi qu’au milieu du 3e s., lors de la persécution de Valérien, les reliques sont exhumées et déplacées à la Catacombe de Saint-Sébastien pour éviter leur profanation. Les innombrables graffitis visibles en ce lieu attestent un culte particulier des deux Apôtres. Les reliques de saint Pierre sont rapportées au Vatican au plus tard à l’avènement de Constantin, mais placées non plus dans la cavité sous le trophée de Gaïus, mais par précaution dans un mur épais construit le long de l’édicule, enveloppées dans un riche tissu et scellées. La présence des reliques dans ce mur semble avoir été connue, car il est recouvert de graffitis dont le sens, déchiffré au 20e s., est clairement chrétien.
L’empereur Constantin fait ensuite édifier un mausolée autour de l’édicule pour honorer saint Pierre, et la première basilique dédiée à l’Apôtre. Elle sera saccagée par les Goths au 6e s., mais à la fin du même siècle, saint Grégoire le Grand fait ériger un autel au-dessus du monument, et surélever le sol de la basilique. La même opération est renouvelée par Calixte II au 12e s. Au 16e, on entreprend de reconstruire intégralement la basilique, qui sera achevée en 1612 sous Paul V. Le sol est finalement surélevé de 3m par rapport à celui de la basilique de Constantin, mais l’autel est bien situé à la verticale du premier monument funéraire de l’Apôtre.
Le visiteur qui s’approche de la confession voit au niveau des grottes vaticanes une niche ornée d’une mosaïque du Sauveur, légèrement décentrée par rapport à l’axe de symétrie de l’ensemble. Le mur orné d’une veilleuse qui provoque le décalage est celui qui contient les reliques de l’Apôtre.
C’est ce lieu qui est entouré de la dévotion de l’Eglise : non seulement les fidèles, mais encore les autorités : par exemple le pallium, insigne propre des archevêques, repose une nuit dans un coffret dans cette niche, près des reliques de saint Pierre, avant d’être remis solennellement aux nouveaux archevêques à la fête de saint Pierre et saint Paul.
Le culte des reliques n’empêche pas que Dieu soit le Dieu, non des morts, mais des vivants.
Bibliographie :
- John O’Neil : La tombe du pêcheur, Artège, 2020.
- Margherita Guarducci : Saint Pierre retrouvé, Saint-Paul, 1975.