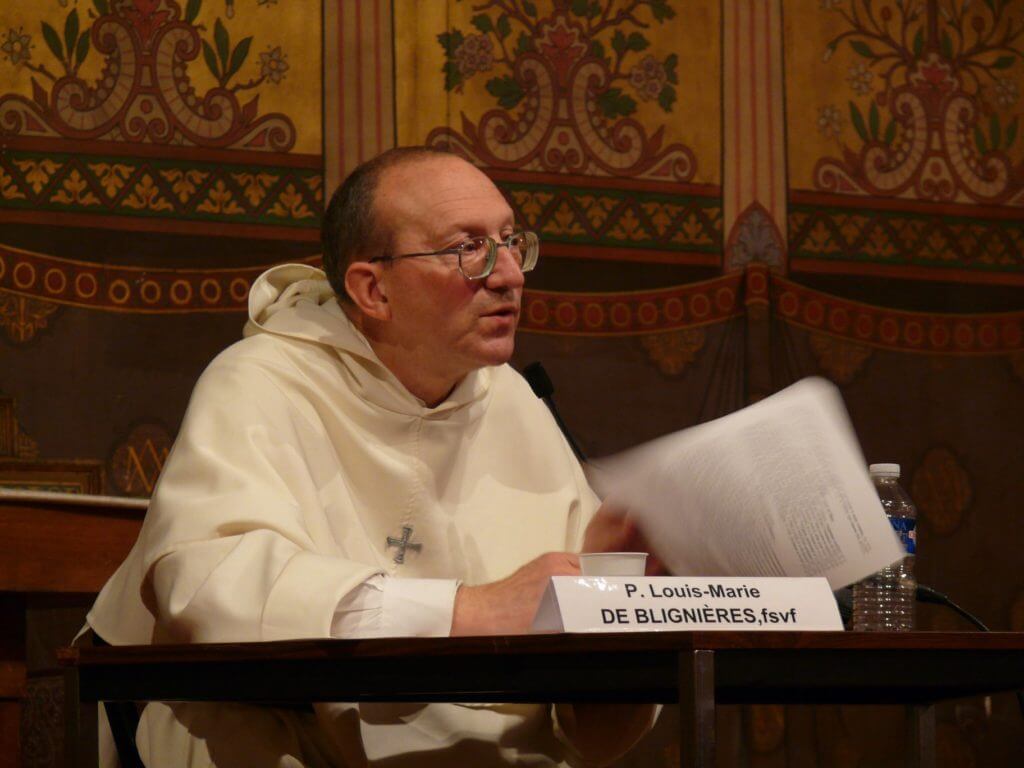Réponse aux sophismes de La Nef.
Note : Cet article reprend, à peine modifié pour La Porte Latine, celui paru sous le titre « Une lecture assidue » dans le numéro 687 du Courrier de Rome. Nous invitons nos lecteurs à le lire en sa version intégrale.
1. De l’opinion à la science.
1. La consécration d’un évêque par un autre évêque relève-t-elle du droit divin ou du droit ecclésiastique ? De la réponse à cette question dépend le jugement que l’on pourra porter sur les consécrations épiscopales opérées par Mgr Lefebvre en 1988 : y a‑t-il schisme ? En cette matière grave et technique, pour dépasser l’opinion commune et atteindre une certitude, il est nécessaire de recourir à une démonstration scientifique et ici, en matière théologique, celle-ci prend sa source dans l’argument d’autorité que représente l’enseignement du Magistère.
2. La juste compréhension de celui-ci réclame une certaine maîtrise. Et celle-ci se doit d’être particulièrement accomplie, dans une matière telle que l’ecclésiologie, dont les données essentielles sont directement impliquées par la solution des graves difficultés de l’heure présente. L’auteur du pamphlet publié sur la page du 27 mars 2025 du site de la revue La Nef le reconnaît d’ailleurs : « Certains défenseurs de la FSSPX soutiennent que Mgr Lefebvre n’a pas commis d’acte schismatique, car selon eux la prérogative de sélectionner les évêques ne serait pas une prérogative qui appartient au Pape de droit divin mais seulement de droit ecclésiastique. Or le droit ecclésiastique peut connaitre des exceptions en cas d’état de nécessité, ce qui permet de justifier les sacres. L’abbé Gleize, théologien officiel de la FSSPX résume bien cette position dans ses écrits. Toutefois, il reconnait que, si sacrer un évêque contre la volonté du Pape est interdit de droit divin, alors les sacres de 1988 seraient schismatiques. C’est donc cette unique prémisse qu’il faut examiner. Cela se fait par une lecture assidue du Magistère ».
3. Une lecture assidue du Magistère : voilà qui est bien dit et qui rejoint exactement ce que nous voulons dire ici. Mais, dans l’esprit de l’auteur de ces lignes, il est à craindre que l’assiduité en question n’aille pas dans le sens de la profondeur – et de la véritable intelligence de l’enseignement des Papes. Il est vain, en effet d’accumuler des quantités de citations du Magistère qui ne sont pas appropriées à la question à résoudre. Trop souvent, les apologistes de La Nef et d’ailleurs, lorsqu’ils entreprennent de contrer les positions de la Fraternité Saint Pie X, fonctionnent selon ce mode : ils dressent des catalogues, certes impressionnants, de citations, mais il n’est que trop clair qu’ils n’en ont pas la véritable intelligence, et qu’ils les exposent à leurs lecteurs d’une manière trop superficielle pour en donner la juste compréhension.
4. Il est à craindre que ce mode de procéder produise quelque effet sur les malheureux lecteurs de l’obédience Ecclesia Dei, qui croient trop naïvement avoir de quoi se conforter dans leur refus du supposé « schisme » de Mgr Lefebvre. Les citations longues et répétées du Magistère peuvent les impressionner, au vu d’une érudition rassurante et d’un recours apparent à l’argument principal et dirimant, qui est celui de l’autorité du Magistère. Mais en définitive, tout repose plutôt sur le crédit que les lecteurs accordent au faiseur de citations. Et à citer Pie XII, sans en donner la bonne intelligence, en est-on rationnel pour autant ? La foi est censée chercher l’intelligence et cette recherche est celle d’une science aux méthodes dûment éprouvées : celles-ci ne s’improvisent pas. Ici comme ailleurs la « tradition » n’est pas seulement la transmission d’un dépôt, elle est aussi la formation des intelligences.
2. Les textes de Pie XII.
5. Le site de La Nef voudrait s’appuyer sur la Lettre Encyclique du Pape Pie XII, Ad apostolorum principis, du 29 juin 1958. « Pie XII enseignait aussi » écrit l’apologète ecclésiadéiste, « que des consécrations épiscopales sans mandat pontifical sont : » de graves attentats contre la discipline et l’unité de l’Église, et (que) c’est notre devoir exprès de rappeler à tous que la doctrine et les principes qui régissent la constitution de la société divinement fondée par Jésus Christ sont tout différents « .
Plus loin, il rappelle que » personne ne peut conférer légitimement la consécration épiscopale sans la certitude préalable du mandat pontifical. Une consécration ainsi conférée contre le droit divin et humain et qui est un très grave attentat à l’unité même de l’Église, est puni d’une excommunication « . […] Ainsi, le Magistère enseigne bien que seul le Pape a privilège de droit divin de choisir les membres du Collège des évêques en vertu de sa primauté. De la même manière que le Christ seul envoie ses disciples à travers le monde, le vicaire du christ seul envoie (expressément ou tacitement) les évêques à travers le monde. Cela implique que l’on ne peut jamais devenir membre du Collège des évêques, contre la volonté du chef du Collège des évêques. Le sacre d’évêques contre la volonté expresse du Pape est donc nécessairement de nature schismatique ».
6. Pie XII est invoqué en même temps que saint Innocent I[1], saint Léon le Grand[2] et Pie IX[3]. Mais l’on est bien en droit de se demander si l’auteur du pamphlet produit par La Nef a saisi toute la signification de leurs écrits. Car ces trois passages font clairement allusion au pouvoir de juridiction, qui est communiqué non par la consécration épiscopale mais par l’acte de la volonté du Pape qui donne la mission canonique à l’évêque élu, qu’il soit déjà consacré ou non. Faut-il encore redire ces évidences[4] ? Le pouvoir épiscopal est spécifiquement double : d’une part, l’évêque se dit de celui qui possède et exerce le pouvoir épiscopal d’ordre, c’est-à-dire le pouvoir d’administrer le sacrement de l’ordre ainsi que celui de la confirmation ; d’autre part l’évêque se dit de celui qui possède et exerce le pouvoir épiscopal de juridiction, c’est-à-dire le pouvoir de gouverner une partie de l’Eglise, sous la juridiction suprême et universelle du Pontife romain. Les deux pouvoirs sont distincts et séparables ; l’un peut se trouver sans l’autre dans un sujet donné, bien que, la plupart du temps, les deux soient réunis dans le même sujet qui sera dit « évêque » dans les deux sens du terme. Et, ce qui importe ici, les deux pouvoirs ne sont pas communiqués de la même manière : le pouvoir épiscopal d’ordre est communiqué par tout évêque (même autre que le Pape) validement consacré et usant du rite de l’Eglise ; le pouvoir épiscopal de juridiction est communiqué par l’acte de la volonté du seul évêque de Rome, et de nul autre. Les textes cités de saint Innocent I, de saint Léon le Grand, de Pie IX et enfin de Pie XII parlent précisément de la communication du pouvoir de juridiction, laquelle, comme le disent ces Papes, relèvent exclusivement du successeur de Pierre. Mais il ne saurait être ici question du pouvoir d’ordre, ou, s’il en est question, cela se trouve en tant que, à la communication de ce pouvoir d’ordre par le sacre est de fait conjointe la communication d’un pouvoir de juridiction. Les textes invoqués soit ne s’entendent nullement du pouvoir d’ordre, soit s’entendent de lui par accident ou … par ailleurs. et c’est pourquoi, utiliser ces textes à propos du pouvoir d’ordre épiscopal serait commettre le sophisme de l’accident[5]. Ou tout simplement commettre l’impair bien scolaire d’un total hors sujet.
Le raisonnement de La Nef accumule des citations du Magistère sans en donner l’exacte intelligence. C’est un raisonnement faux, un sophisme, dont la fausseté repose sur la confusion entre le sacre donné avec juridiction (dont parlent les textes de Pie XII et tous les autres textes cités) et le sacre donné sans juridiction (dont les mêmes textes ne parlent pas).
7. Il est clair, en particulier, que lorsque Pie XII parle d’une consécration épiscopale accomplie « sans la certitude préalable du mandat pontifical », il s’agit précisément (comme l’indique tout le contexte) d’une consécration à laquelle est conjointe l’attribution d’une juridiction. Pie XII n’envisage donc pas ici la consécration épiscopale en tant que telle. Il parle formellement de l’attribution illicite du pouvoir de juridiction, commise à l’occasion d’une consécration épiscopale.
Le texte parle en effet de « hujusmodi consecratio »[6], renvoyant par là même aux précisions données dans la phrase précédente. Celle-ci parle exactement de « l’institution canonique donnée à un évêque », pour réaffirmer que celle-ci est réservée au seul Pontife romain : « De ce que Nous vous avons exposé, il suit qu’aucune autorité autre que celle du Pasteur suprême, ne peut invalider l’institution canonique donnée à un évêque ; aucune personne ou assemblée, de prêtres ou de laïcs, ne peut s’arroger le droit de nommer des évêques ; personne ne peut conférer légitimement la consécration épiscopale sans la certitude préalable du mandat pontifical »[7]. Si la consécration épiscopale n’est pas légitime sans la certitude d’un mandat pontifical, c’est dans la mesure où cette consécration vient s’adjoindre à la collation d’une juridiction. Le texte dit en effet : « une consécration ainsi conférée … », c’est-à-dire conférée en même temps que l’attribution d’un pouvoir de juridiction, que seul le Pape peut donner.
8. Ce que nous pouvons et devons dire, en nous appuyant sur les textes cités du Magistère, est que la consécration d’un évêque à laquelle est liée l’attribution d’un pouvoir de juridiction dépend de droit divin de la seule volonté du Pape. Mais aucun de ces textes ne peut servir d’argument d’autorité pour nous obliger à dire que la consécration d’un évêque à laquelle n’est pas liée l’attribution d’un pouvoir de juridiction dépende de droit divin de la seule volonté du Pape. L’on doit dire qu’elle en dépend, en raison de cette vérité divinement révélée que le Pape est le chef suprême de toute l’Eglise, mais il n’est nullement prouvé à partir des textes cités qu’elle en dépende de droit divin. Il est même prouvé, de l’avis des théologiens et des canonistes, qu’elle en dépend de droit seulement ecclésiastique, tout comme en dépend, à tout prendre, l’ordination d’un prêtre ou celle d’un diacre[8].
3. La lecture sophistique de La Nef.
9. Le raisonnement de La Nef accumule des citations du Magistère sans en donner l’exacte intelligence. C’est un raisonnement faux, un sophisme, dont la fausseté repose sur la confusion entre le sacre donné avec juridiction (dont parlent les textes de Pie XII et tous les autres textes cités) et le sacre donné sans juridiction (dont les mêmes textes ne parlent pas).
- « Du Siège apostolique découlent l’épiscopat et toute son autorité » (Lettre 29, au Concile de Carthage de 417, DS n° 217 ; « Pierre est l’auteur et du nom et de la dignité des évêques » (Lettre 30 aux Pères du Synode de Milève, DS n° 218).[↩]
- « Tout ce que Jésus-Christ a donné aux autres évêques, il le leur a donné par Pierre » (Sermon 4, Pour son anniversaire, Migne latin, t. LIV, col. 150).[↩]
- « Quant à Notre droit de choisir un sujet en dehors des trois candidats proposés, Nous n’avons pas cru devoir le passer sous silence, afin que dans l’avenir le Siège Apostolique ne fût jamais forcé de recourir à l’exercice de ce droit. Du reste, n’en aurions-Nous pas parlé, que ce droit et ce devoir seraient restés dans toute leur intégrité à la chaire de Saint-Pierre. En effet, les droits et les privilèges accordés à cette chaire par Jésus-Christ lui-même peuvent être attaqués, mais ne sauraient jamais lui être enlevés, et il n’est pas au pouvoir d’un homme de renoncer à un droit divin qu’il peut être parfois obligé d’exercer par la volonté de Dieu même » (Lettre encyclique Quartus supra à propos du schisme arménien, du 6 janvier 1873).[↩]
- Voir les articles parus dans les numéros de septembre 2019, juillet-août 2022 et octobre 2022 du Courrier de Rome.[↩]
- Voir l’article « Du bien penser au bien dire » dans le numéro du mois de mai 2025 du Courrier de Rome.[↩]
- « Itaque, si huiusmodi consecratio contra jus fasque impertitur, quo facinore gravissime petitur ipsa unitas Ecclesiae, statuta est excommunicatio specialissimo modo Sedi Apostolicae reservata, in quam ipso facto incurrit qui consecrationem ex arbitrio collatam recipit, atque etiam consecrans ipse » (AAS, t. L (1958), p. 612–613).[↩]
- « Ex iis, quae exposuimus, sequitur, ut nulla prorsus auctoritas, praeter eam, quae Supremi Pastoris propria est, institutionem canonicam alicui Episcopo concessam possit irritam efficere ; ut nulla persona nullusve coetus sive sacerdotum sive laicorum jus sibi queat arrogare Episcopos nominandi ; ut nemo consecrationem episcopalem valeat legitime conferre, nisi prius de pontificio mandato constiterit » (Ibidem).[↩]
- Voir l’article « Les sacres : suite … et fin ? » dans le numéro de mars 2025 du Courrier de Rome.[↩]