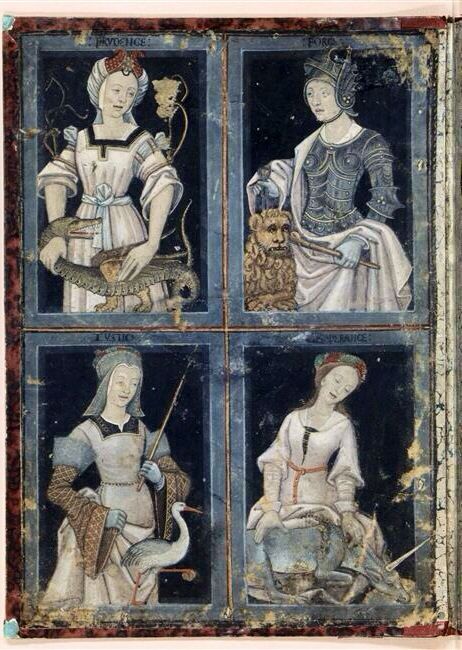Le pape a fait repentance pour la « doctrine jetée comme une pierre ». La doctrine est-elle devenue péché ?
La veillée pénitentielle du 1er octobre 2024, qui a précédé l’ouverture de la dernière session du synode, a marqué par les repentances pour sept péchés nouveaux. En particulier celui de la doctrine, réduite à « un tas de pierres mortes jetées sur les autres ». Le pape François fustige volontiers ceux qui « imposent des vérités ou des règles[1] ». Se trouvent dans le viseur tous ceux qui maintiennent que certains actes comme la contraception ne sont jamais licites, et qu’on ne peut accorder l’absolution et la communion qu’à celui qui renonce sincèrement à ses péchés graves. Ceux-là sont les « esprits moralisateurs, qui prétendent garder le contrôle de la miséricorde et de la grâce[2] », ils font preuve d’un « moralisme autosuffisant[3] ». La doctrine apparaît chez François non seulement comme un pur instrument de la volonté de puissance, mais encore comme complètement inadaptée à la formation des fidèles.
Ce faisant, le pape s’oppose frontalement à la sainte Ecriture ! N’est-ce pas Dieu lui-même qui promulgue une loi pour le peuple d’Israël, dont les dix commandements, assortis de sévères sanctions ? Cette loi comporte sans doute des préceptes cérémoniels qui pourraient être changés, mais elle explicite la loi naturelle qui, elle, ne souffre pas plus de réforme que la nature humaine elle-même.
On dit qu’elle est inscrite au cœur de l’homme parce que même sans en avoir reçu la connaissance, elle s’impose à un esprit honnête. Par exemple, l’enfant saisit après avoir cru à un mensonge le dommage que cela cause à la vie commune et à la confiance réciproque. Il a vite fait de généraliser au mensonge en général, au-delà de la mésaventure particulière dont il a été victime. Les principes moraux formulés comme des préceptes universels sont le résultat de cette simple opération de l’esprit. La doctrine morale n’est que la synthèse articulée des principes moraux, justifiés et expliqués par les principes les plus premiers, ceux qui expriment les tendances fondamentales de l’homme à vivre, à se perpétuer, à connaître et aimer Dieu et à vivre en société[4], et surtout le principe premier qui demande de faire le bien et fuir le mal. Si on rejette la doctrine, autant se repentir solennellement d’être de nature humaine !
Pourtant, en caricaturant lourdement l’attitude « moralisatrice » pour la pourfendre plus facilement, François pointe du doigt une difficulté réelle : ces principes moraux sont universels, et nous devons vivre, prendre des décisions et agir dans des circonstances particulières. Nous n’avons pas affaire au « Bien » ou au « Juste » en soi, mais à des personnes et des situations concrètes et complexes. Les principes universels de la morale suffisent-ils ? Non, puisqu’ils sont universels. Il y faut en outre l’appréciation de la situation : l’action que je me propose d’accomplir est-elle mensonge ou restriction mentale légitime ? Schisme ou garantie légitime de la vie chrétienne des fidèles en leur donnant des évêques ? Meurtre, ou cessation de soin exagérés ? Avortement ou acte thérapeutique qui sauve une vie ? Le principe universel ne le dit pas, il indique le comportement à adopter lorsqu’on aura identifié la situation.
Or bien souvent pour décider ce qui est péché ou non, ou entre deux actions légitimes laquelle est la meilleure, il faut l’exercice de facultés qui relèvent de la sensibilité, car ce sont elles qui appréhendent le concret et le singulier. Ce que Blaise Pascal, mais aussi François, appellent le « cœur ». Aussi le chrétien doit non seulement apprendre le catéchisme et les principes de la théologie morale qui lui indiqueront ce qui est conforme ou non à la loi de Dieu, mais encore former son cœur pour apprécier judicieusement la nature des actes qui se proposent à lui, aimer les actions nettes et prendre en horreur les situations équivoques. Alors le « cœur » ne s’oppose pas à la raison, il la complète ! Et sans lui on risque fort d’être le moraliste abstrait que François caricature.
Mais comme cette notion de « cœur » est vague, elle permet d’y confondre la force d’âme vertueuse de saint Jean-Baptiste qui reproche à Hérode son adultère jusqu’au martyre, et la lâcheté du pasteur qui, par une sympathie mal placée, se dérobe à son devoir de prédication en gémissant : « Qui suis-je pour juger ? »
Le cœur aura toujours ses raisons, mais la vertu, celle qui sauve et sur laquelle nous serons jugés, consiste à agir selon la droite raison éclairée par la foi. Alors si on est sincère comme François le souhaite[5], « on sait qu’on est dans la vérité quand on ne peut plus choisir. » (Gustave Thibon)