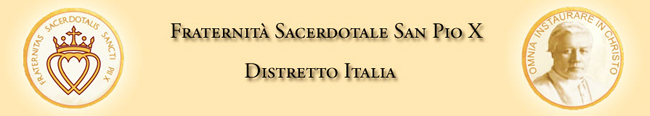Le 27 juin, une belle église d’Italie a accueilli la cérémonie de vêture et de professions des Sœurs Consolatrices du Sacré-Cœur de Jésus. Une parabole de l’avenir de l’Eglise ?
Narni, charmante cité médiévale d’Ombrie, en Italie, est célébrée pour son histoire riche, son architecture admirablement préservée et ses paysages naturels d’une beauté saisissante. Les visiteurs peuvent débuter leur périple à la splendide co-cathédrale dédiée au premier évêque de la ville, saint Juvénal — l’une des églises les plus nobles et prestigieuses de la région. De là, une courte promenade conduit à la célèbre Piazza Priora. En contournant à gauche le théâtre municipal et en poursuivant l’ascension, les voyageurs découvrent une petite place portant le nom de saint François d’Assise.
Sur le côté nord-ouest de cette place se dresse une église, ultérieurement consacrée à saint François, fondée par le saint lui-même peu après 1213, grâce à l’élan et au soutien des habitants et de leur évêque, Ugolino. Ami proche de saint François, l’évêque Ugolino l’invita cette année-là à prêcher à Narni. Les sermons et miracles du saint portèrent des fruits spirituels si abondants que les citoyens, profondément attachés à lui, soutinrent généreusement l’établissement de son ordre dans la ville. Les archives historiques mentionnent que saint Antoine de Padoue, saint Bernardin de Sienne et le bienheureux Pietro Arietense visitèrent également ce couvent. Saint François accomplit plusieurs miracles à Narni, dont quatre sont gravés dans la mémoire historique : à la demande de l’évêque, il guérit un paralytique par le signe de la croix ; il rendit la vue à une femme aveugle ; il chassa un démon d’une autre femme ; et il bénit une femme enceinte dont les enfants précédents étaient morts peu après leur naissance, assurant la survie et l’épanouissement de son prochain enfant.
En contournant l’extérieur de l’église, les visiteurs découvrent des éléments architecturaux gothiques du XVe siècle — murs, fenêtres étroites et une porte reflétant le style intérieur de la tribune et de la chapelle de saint François. Ces éléments sont façonnés dans une pierre locale soigneusement taillée et polie. La porte d’entrée, bien que modeste, exhale une élégance raffinée avec ses arches concentriques ornées de corbeaux, de petites colonnes et de rosaces, flanquée des lions traditionnels, dont un seul subsiste, gravement endommagé. Au-dessus de la porte se trouve une niche, mi-ancienne, mi-moderne, abritant une peinture du XVIIIe siècle de la Madone de Lorette.
L’église, tout comme sa chapelle, a traversé de grandes épreuves. Lors de l’occupation française, elle fut supprimée et transformée en écurie et en quartiers militaires pour les soldats de passage. Plus tard, elle fut cédée au chevalier Paolo Eroli, dont le palais jouxte l’édifice, et utilisée comme entrepôt de bois. Avec le recul, ce fut une chance : abandonnée aux soldats, la structure n’aurait peut-être pas survécu. Finalement, les fils d’Eroli, Silvio et Pietro, restaurèrent son lien avec l’Église. Après des travaux de nettoyage et de réparation, la chapelle fut rouverte au culte public par la Confrérie de la Miséricorde.
Cette église, jadis extraordinaire, était richement ornée pour inspirer l’admiration et la prière fervente adressée à Dieu Tout-Puissant. Aujourd’hui, hélas, elle est cruellement dépouillée de sa beauté d’antan en raison de la négligence. Pourtant, malgré ces pertes, quelques fresques ont résisté, témoignant d’une résilience face au temps, aux intempéries et à la négligence — le plus grand ennemi de la beauté. Ces fresques demeurent visibles, offrant aux visiteurs un aperçu de la gloire passée de l’église.

La restauration de l’église ne nécessite ni tests archéologiques approfondis ni recherches d’archives. Les fresques subsistantes, avec leurs motifs et leurs couleurs, offrent un guide clair pour redonner à l’édifice sa splendeur originelle. Ce détail résonne avec la fête du Sacré-Cœur de 2025, lorsque huit sœurs prononcèrent leurs premiers vœux dans la congrégation des Sœurs de la Consolation du Sacré-Cœur, et douze autres prirent l’habit dans cette même église. La cérémonie fut magnifique, riche en traditions et en détails complexes maîtrisés par les Italiens. Parmi les sœurs, on comptait des Américaines, Indiennes, Cambodgiennes, Françaises, Allemandes, Australiennes, Kényanes, Canadiennes et Suisses. Ce fut véritablement une cérémonie internationale. Après tout, nous sommes catholiques, et ce nom dit tout. Bien que beaucoup d’entre elles ne se comprenaient pas et que la plupart ne parlaient pas italien dans cette ville si italienne, toutes pouvaient suivre la messe, recevoir la communion et apprécier la beauté de la liturgie. Cela montre, une fois encore, quel trésor magnifique nous possédons.
À l’image des fresques endurantes, cette cérémonie n’était pas seulement un vestige d’un passé glorieux, mais un modèle pour la restauration future de cet espace sacré. Nous ne sommes pas à la fin d’une ère, mais à l’aube d’une nouvelle. Le renouveau approche, promettant d’être aussi glorieux, sinon plus, qu’auparavant. La clé réside dans la fidélité, le respect de la tradition et la résistance à la corruption et à la négligence qui menacent tout ce qui est sacré. Et pour tout cela : Merci, Monseigneur ! Vous nous avez montré ce qu’il faut faire et comment le faire. Puissions-nous rester fidèles à ce que vous nous avez donné et le transmettre à la génération suivante !
Vidéo de la cérémonie :
Images : chaîne YouTube du District d’Italie.