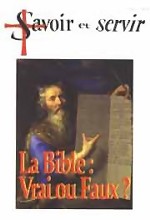Journaliste, polémiste, épistolier, écrivain et, avant tout, catholique.
Parmi les nombreuses très fortes personnalités qui marquèrent le XIXe siècle, Louis Veuillot s’est taillé une place de choix qui ne tient pas seulement à une intelligence exceptionnelle. Journaliste, polémiste, épistolier, écrivain et, avant tout, catholique ; cet homme de conviction sans concession, a laissé, à travers ses écrits, la description de ce qu’il fût pour la France, l’Eglise et son siècle.
Dans tous les sens du terme et dans toutes les situations, ce fût un homme d’honneur, méprisant les profits matériels pour en défendre de plus hauts.
Jamais il ne cacha ses modestes origines où, avant lui, nul de sa lignée paternelle ni maternelle, ne sut lire ni écrire, mais dans leur condition si modeste, on relève déjà de forts caractères ; ainsi, son aïeule maternelle, Marianne Adam, en 1793, menaça hautement, la plus lourde cognée de son mari en mains, d’abattre le premier qui oserait toucher au grand crucifix du village ; elle l’eût fait et personne n’osa s’approcher. Du côté paternel, les révolutionnaires confisquèrent le moulin dont vivait chichement l’ancêtre Veuillot. La mort et la misère s’en suivirent et l’un des nombreux orphelins, François, père de Louis, réussit, par des efforts prodigieux d’intelligence et de courage à devenir tonnelier. Il ne savait pas lire et depuis sa tendre enfance, dût gagner sa vie au jour le jour. Il devait mourir à 50 ans, à Bercy, épuisé par un dur labeur quotidien qui ne lui assura jamais que le strict minimum. Ainsi que l’écrit son fils, arrivant juste à temps pour le trouver à l’agonie :
« …C’était un simple ouvrier, sans orgueil et sans lettres. Mille infortunes obscures et cruelles avaient traversé ses jours remplis de durs labeurs… ».
Sa femme, une autre Marianne Adam, avait hérité de la fierté et de l’ardeur au travail des siens. Elle en eût bien besoin dans le milieu des besogneux de cette époque.
Leur vie de ménage débuta en Gâtinais, à Boynes. Un fils, Louis, leur naquit en 1813. Au bout de cinq ans de labeur et d’épargne, le peu d’argent recueilli leur fût enlevé par un négociant malhonnête. Pour cacher leur nouvelle misère, la famille partit vers Paris, à Bercy, où naquit un second fils, Eugène. Louis Veuillot raconte à ce sujet :
« La plus ancienne joie dont je me souvienne, fût de voir ce beau petit frère endormi dans son berceau. Dès qu’il pût marcher, je devins son protecteur… ».
Et les deux frères grandissent, souvent séparés, inséparables toujours. Plus tard, il y eût deux sours : elles furent ses filles. Le premier argent qu’il gagna fût pour elles ; il ne voulût pas que leur enfance ressemblât à la sienne ; Annette et Elise Veuillot reçurent au couvent des oiseaux, une belle et bonne éducation.
Dès 4 ans, Louis avait fréquenté l’école de Boynes où on lui donna un petit alphabet. Après la première leçon, il déchira la page qu’il savait, n’étant pas d’humeur à apprendre deux fois la même chose. On le punit. Il recommença. Pour mettre fin à cette manie de la destruction, il reçut un abécédaire tracé sur une planche, qui lui servit à son instruction, mais aussi à frapper sur le dos de ses camarades. Il fallût le lui ôter. Après quelques mois passés à Bercy, à 5 ans, Louis est renvoyé à Boynes„ chez ses grands-parents.
Là, mis à l’épluchage du safran, comme tout le monde au village, il comprit immédiatement, mais en eût vite assez et déclara qu’il avait autre chose à faire. Aucune mesure ne vînt à bout de sa résistance. Cet enfant était indomptable. A l’école, il est le premier.
L’instituteur prédit qu’il ira loin. Une sorcière des environs annonce qu’il sera empereur ! En attendant, il se casse le bras et attrape la petite vérole dont il restera profondément marqué au visage. De cette enfance agreste, il conservera toujours l’amour des champs et l’horreur du boulevard parisien.
Il ne reverra ses parents qu’à 10 ans et sa mère aura du mal à le reconnaître. A Bercy, avec un maître ivre du matin au soir, il n’apprend rien, si ce n’est quelques leçons de syntaxe, d’histoire et des rudiments de latin que lui donne un sous-maître qui s’était pris d’affection pour lui. Il fait sa première communion sans préparation, ni lendemain et, la misère aidant, il va lui falloir gagner sa vie. Par des amis, 20 F par mois lui sont offerts chez Me Delavigne avoué à Paris. Voici ce qu’il en dira plus tard :
« J’allais demeurer hors de la maison paternelle. J’avais 13 ans, abandonné dans le monde, sans guide, sans conseils, sans amis, pour ainsi dire sans maître, à 13 ans, sans Dieu ! O destinée amère… ».
N’ayant pas seulement de quoi se suffire, il arrive dans un milieu de clercs cultivés, aisés, insouciants, qu’il surprend par son intelligence, amuse, et intéresse. On lui prête des livres qu’il dévore ; on lui donne des billets pour le spectacle, il n’en manque aucun. Il reçoit quelques leçons ; l’étude de Me Delavigne lui tient lieu d’université. Il y fait la connaissance de Gustave Olivier, l’ami qui le guidera et surtout, lui apprendra qu’il peut être aimé. Quelle découverte pour cet enfant tellement sensible sous l’écorce dont il se protége !
A 15 ans, le voici troisième clerc avec 30 F par mois et logé. Son éducation et son instruction se poursuivent au gré des circonstances. Un petit article de lui est inséré dans le Figaro, et on arrive en 1830, à la chute de Charles X, qu’il observe et décrit :
« J’avais 17 ans quand je vis les médiocres enfants de la bourgeoisie qui m’entouraient s’applaudir d’avoir démoli l’autel et le trône ; j’avais 18 ans quand je vis la bête féroce abattre la croix ; déjà mes anciens compagnons se félicitaient moins. Débordés aussitôt que vainqueurs, les bourgeois effarés appelaient de toutes parts au secours. N’ayant sans doute ni assez de tête ni assez de cour, il leur fallut accepter des enfants comme défenseurs de l’étrange ordre social qu’ils venaient d’établir ».
Grâce à Gustave Olivier, il entre alors dans sa carrière de journaliste à « L’écho de la Seine Inférieure ».
A Paris, Bugeaud qui l’a remarqué, l’envoie à Périgueux au titre de rédacteur en chef de la feuille gouvernementale. Il a 19 ans et en deux ou trois ans, il désarçonne tous ses détracteurs. C’est un polémiste cinglant auquel la société périgourdine subjuguée ouvre ses salons et l’adule. On le reçoit partout ; il s’amuse, fait des dettes mais travaille et porte un regard aigu sur ce qui l’entoure. Il papillonne et laissera un peu de son cour à Périgueux.
En 1834–1835 Gustave Olivier lui apprend qu’il est chrétien. Louis Veuillot en est troublé.
A Paris, Guizot revenu au gouvernement cherche des journalistes. Sur les conseils de Gustave Olivier, Veuillot quitte la province pour entrer dans le journal « La charte de 1830 » ; en 1837, il passe à « La Paix ».
Il mène une vie désordonnée, dépense plus qu’il ne gagne et n’est pas heureux. A nouveau, Gustave Olivier est sur son chemin, en partance pour Rome et Constantinople, entraînant Louis.
« Il était temps, a‑t-il jugé plus tard. J’avais 24 ans, je devenais philosophe ; la fortune me souriait. J’avais vu bien des hommes, je commençais à mépriser bien des choses. Au détour du chemin, je rencontrai Dieu. Il me fit signe ; j’hésitais à le suivre. Il me prit par la main, j’étais sauvé ».
Ces quelques lignes résument l’âpre combat qui se livra dans son âme, à Rome, changeant instantanément le cours et le sens de sa vie.
Vers la même époque, Alphonse de Ratisbonne, de passage également à Rome, en visiteur, y recevait une foudroyante grâce de conversion. Les Jésuites présentèrent le nouveau converti au Pape Grégoire XVI, puis lui conseillèrent un détour par Lorette, sur le chemin du retour, d’où le titre du livre « Rome et Lorette » lequel relate les étapes de sa conversion.
A partir de ce moment, en raison du combat qu’il ne cessera plus de mener pour la catholicité, il aura des contacts fréquents avec les Papes successifs, Pie IX et Léon XIII. Il n’était évidemment plus question de Constantinople et, de retour à Paris où la situation politique n’est pas tellement claire, il retrouve, mais avec une toute autre optique, ses amis d’hier, de la bohême, du Ministère et de la presse. Il écrit son premier article dans « L’univers religieux » fondé par l’abbé Migne.
En 1841, se situe l’épisode algérien lorsqu’il accompagne Bugeaud, nommé gouverneur général de ce pays, à Alger, tout en restant en liaison étroite avec Guizot. Sur place, l’observateur qu’il est, fait les mêmes remarques qui viendront du général Lyautey et du Père de Foucauld :
« Tant que les arabes ne seront pas chrétiens, ils ne seront pas Français et tant qu’ils ne seront pas Français, nul gouverneur, nulle armée ne pourra garantir la durée de la paix. Or, ils ne seront pas chrétiens tant que nous ne saurons pas l’être nous-mêmes ».
Cette vision était prophétique et s’est réalisée. Il ajoute :
« la France multiplie les prodiges de son ancien courage pour conquérir un royaume infidèle, mais elle ne songe qu’à le gagner à ses comptoirs et ne veut point le gagner à son Dieu ».
Il en aura vite assez des combats auxquels il participe et, peu intéressé par les profits matériels ou honorifiques, il demande à rentrer en France où il arrive « noir comme un chaudron » et « ayant vieilli de dix ans ».
Resté en termes de parfaite confiance avec Guizot, ce dernier propose de le renvoyer à Alger afin de l’avoir près de lui lorsqu’il y viendra. En quelque sorte, un poste d’ambassadeur. Mais le projet traîne et Veuillot est beaucoup plus intéressé par le développement de la presse catholique, bien qu’elle paye fort peu alors qu’il avait pris à sa charge ses deux jeunes sours et, depuis sa conversion, payait progressivement ses dettes.
Pour cette presse catholique, Louis Veuillot refusait la moindre aide du gouvernement pour lui assurer une totale indépendance ; il refusait également toute attache politique, ce qui fit immédiatement de lui la cible des ennemis de Dieu et d’une certaine bourgeoisie, des libéraux des timorés ; mais que lui importait.
Sous les attaques les plus venimeuses et les plus douloureuses, celles de ses confrères et de ses obligés, si nombreux, il restera toujours sur la même voie adoptée une fois pour toutes. Quoiqu’il en soit, « L’Univers » avec la plume et la signature de Veuillot, passera immédiatement de 1 600 à 6 000 abonnés.
Louis et Eugène Veuillot travaillent ensemble à « L’Univers » dès 1842. Ils se complètent merveilleusement :
« Nous sommes encore ces deux frères qui se rendaient ensemble à l’école, portant leurs provisions dans le même panier, ayant les mêmes adversaires, les mêmes soucis, la même fortune et les mêmes plaisirs »,
dit Louis Veuillot. Le journal sera interdit par Napoléon III en 1860 pour avoir publié l’encyclique de Pie IX contre sa politique en Italie. Il reparaîtra en 1867.En 1871, la commune l’interdira à nouveau. Le journal subira ainsi des éclipses pour des motifs politiques ou religieux en désaccord avec le gouvernement du moment.
En 1841, au milieu de tout ce tapage politique, Veuillot songe au mariage, mais sans hâte car, dit-il :
« Quand je suis tracassé, je prie, je travaille et tout passe. Quand je serai marié si ma femme me tracasse, elle ne passera point. Il faudra certainement à cette pauvre femme, beaucoup de patience ».
L’année suivante, il écrit au même abbé Morisseau de Tours :
« Si vous connaissez une bonne fille, qui ait beaucoup de piété, beaucoup de douceur, de la simplicité, de la santé, qui puisse me faire un peu de musique et qui possède de quoi se nourrir, c’est tout ce qu’il me faut »,
car ses sours en pension, Eugène à Angers et leur mère remariée au bougnat Antoine, il souffre de la solitude. En 1845 :
« Je me suis marié à 32 ans, un peu par hasard, comme tout le monde. Deux abbés avaient arrangé tout cela avec les parents de Mathilde Murcier, très petits bourgeois de Versailles, forts simples chrétiens. Ils me dirent que ce mariage me convenait. Je me laissais faire… ».
Il raconte les épisodes burlesques et tendres qui accompagnèrent ce rapide et très heureux mariage. Le premier grand combat auquel Veuillot se trouva mêlé comme rédacteur de « L’Univers », fût celui de la liberté de l’enseignement. Il s’agissait du combat pour la conquête des esprits que se livraient la bourgeoisie libérale et anticléricale contre l’Eglise.
Les idées de 89 avaient laissé en héritage, dans ce domaine, un lourd carcan peser sur l’éducation des enfants et sur l’université. Comme tous les opposants, Louis Veuillot fut sanctionné et son poste lui valut une amende de 3 000 F et un mois de prison qui lui attirèrent une immense popularité.
La mauvaise loi de 1844 que l’on devait à M. de Falloux n’a pas fini, à ce jour, après plus de cent cinquante ans, de causer un grand dommage à l’enseignement. Il fallut trente sept ans pour en triompher, à cette époque. Après 1830 qui chassa Charles X du trône, 1848 renversa « l’usurpateur », Louis-Philippe, dont le sang portait bien des tares.
« La machine craque de toutes parts et tombe véritablement en pourriture », notait Veuillot en 1847. Même désordre dans les rues ; une nouvelle fois la république réapparaît ; les légitimistes pensent au comte de Chambord ; c’est Napoléon III qui arrive en 1851.
Un an plus tard, Dieu va frapper au cour son fidèle serviteur : en 1852, à la naissance de sa sixième fille, son épouse meurt d’une péritonite. Quelques mois avant, Thérèse, sa cinquième fille était morte ; puis, en 1855, la diphtérie emporte successivement Marie, l’aînée, âgée de 9 ans, en juin, Gertrude, la seconde, en juillet et Madeleine, la dernière, en août, la seule que son père vit encore en vie. Dans ce foyer dévasté, il ne reste que deux frêles petites filles, Agnès et Luce. Le désespoir de cet homme fut immense ; Elise Veuillot, la plus jeune sour de Louis, venue remplacer au foyer la mère disparue y restera désormais définitivement.
Pour Louis Veuillot, son foyer était le havre de paix et de joie où il venait se retremper. Sa foi va l’aider puissamment, mais il connu des retours de désespoir que le travail ne parvenait pas toujours à dissiper. A la moindre maladie des deux survivantes, il était sujet à l’angoisse de la mort précoce qui fut le lot de tant de ses contemporains (prédite par N.D. de la Salette en 1846).
L’amitié joua un grand rôle pour Louis Veuillot, reçu amicalement dans tous les milieux. Il connut et fréquenta toutes les personnalités de son temps. Il aimait faire des séjours à Solesmes où sa venue était accueillie avec joie. Son départ y laissait des regrets, en attendant sa prochaine visite. Il aimait également l’accueil des curés de campagne, en contact avec le milieu de ses origines. Très sensible au charme féminin qui répondait mieux que les hommes à son besoin d’épanchements et d’affection, Veuillot restait cependant prudent et dès sa jeunesse, il sut prendre ses distances avec des correspondantes trop sentimentales. Mais à Charlotte de Grammont, il pouvait écrire :
« J’aime à vous dire que je vous aime » ;
à Olga de Pitray, la benjamine de la comtesse de Ségur :
« Dernière amie de ma jeunesse, première de ma vieillesse », ou « Que vos yeux sont beaux ! Je vous adore et ne vous définis point ».
Il évoquait volontiers le passé avec la pieuse Madame Volnys qu’il avait admirée, jeune homme. Aux abords de la cinquantaine, à Rome, Louis Veuillot s’éprit d’une comtesse belge de 36 ans, Juliette de Robertsart, mais avec laquelle les choses tournèrent subitement court. Ce merveilleux et intarissable épistolier réserva cependant le meilleur de son cour à ses proches, mais il savait s’adresser à chacun comme s’il était l’unique ami.
Parmi ses innombrables déplacements, il faut mentionner les pèlerinages successifs qu’il fit à Rome où il était reçu affectueusement par le Pape en tant que défenseur de l’Eglise. Par Nadar qui a fait le portrait photographique de toutes les personnalités de son époque, nous en avons un de lui à la cinquantaine.
Albert de Mun qui le vit vers ce moment en disait, qu’au-delà de cette merveilleuse intelligence, c’était encore la bonté qui émanait le plus de lui. Et de fait, sa générosité était à la mesure de tout ce qu’il possédait, il aidait et donnait sans compter, ne tenant rancune d’aucun mauvais procédé. En 1874, il voit le départ de ses deux filles : Agnès épouse le commandant Pierron et Luce, la dernière, entre à la Visitation. A cette occasion, voici ce qu’il écrivait :
« Rien ne m’a fait plus de peine et plus de joie que ta résolution. La joie est dans mon âme et ne peut entrer dans mon cour, la peine est dans mon cour et ne peut pas troubler mon âme. En vérité, mon enfant, j’ignorais à quel point tu m’étais chère. Quand tu étais petite et que tu faisais présent d’une épingle ou d’une paille, tu disais « Je vous le donne, mais pas pour tout à fait ». Je dirais bien au Bon Dieu : pas pour tout à fait ! Cependant, Dieu sait que c’est pour tout à fait ».
Et il signait « Ton ancien père ».
A l’automne de cette même année 1874, Louis Veuillot est frappé d’une attaque cérébrale plus nette que les alertes précédentes. Il écrit moins, la parole est parfois un peu embrouillée. Il aura la joie de voir, en 1875, la liberté de l’enseignement catholique enfin obtenue ; en 1878, l’érection de la basilique du Sacré-Cour, à Montmartre où, dans une chapelle latérale, on peut voir son effigie et son nom. Avec l’âge, le temps est venu de voir mourir les amis et les ennemis. Il écrit des oraisons funèbres qui suscitent parfois des tollés lorsque le mot juste est asséné trop nettement.
En 1879, il dicte ou écrit, mais très peu et n’est plus capable d’aucune correspondance. Le 20 mai 1880, une quarantaine de lignes pour honorer la mémoire de Mgr Pie, seront les dernières. Louis Veuillot accepta la lente désintégration de ses cinq dernières années. Dès 1872, il se plaignait de ses jambes et de ses yeux :
« Il n’y a plus de mer ni de forêt qui puissent rétablir de vieux outils. Mais on peut voir le ciel sans yeux et y monter sans jambes, c’est la consolation » écrira- t‑il encore, et « L’éternité est bien inventée car, malgré tant de bonnes raisons, nous ne sommes pas faits pour mourir ».
A la fin, il n’avait plus l’épée à la main, mais un chapelet. Louis Veuillot est mort le 7 avril 1883.
Il représente le cas unique d’un fils du peuple analphabète devenu un très grand journaliste.
Avec son exceptionnelle faculté d’assimilation et de travail, malgré des yeux vite fatigués et souvent malades, il fut capable de toucher à tout sans se noyer dans le détail et l’érudition, en allant tout de suite à l’essentiel.
Comment a‑t-il appris le latin ? Un peu à l’école mutuelle, un peu à l’étude de Me Delavigne, un peu à Périgueux, un peu à Rome, huit jours à Fribourg, un peu auprès d’Henri Hignard (normalien), tout cela à des époques espacées lui permettant de dominer parfaitement cette langue, de donner des citations des Pères de l’Eglise, de Cicéron, de faire une critique en règle d’un discours en latin d’Auguste Nisard.
Pour ses ouvrages religieux, il en est de même en théologie. Sa culture générale est prodigieuse. Il a analysé avec lucidité les méfaits du modernisme et du progrès dans ses expressions diverses. Il a su détecter et pousser en avant de futures personnalités ; ce fut le cas pour la comtesse de Ségur et Léon Bloy, par exemple apprécier des auteurs dont il ne partageait pas les idées, ainsi de George Sand.
Ce fut un grand critique, objectif et incisif, sans la malveillance que l’on employa souvent contre lui.
Et au-dessus de tout cela, une foi étonnante qui ne se payait pas de mots, mais qu’il vivait et mettait en pratique dans toutes les situations. La papauté de l’époque l’avait bien reconnu et si Pie IX le reçut si souvent et si son nom suffisait à lui ouvrir les portes du Vatican, Léon XIII disait de lui qu’il parlait comme un Père de l’Eglise.
Le silence est retombé maintenant sur Louis Veuillot qui dérangerait ceux contre lesquels il s’est battu toute sa vie avec l’orientation que lui avait donnée son baptême catholique romain.
G.T. – Toulouse