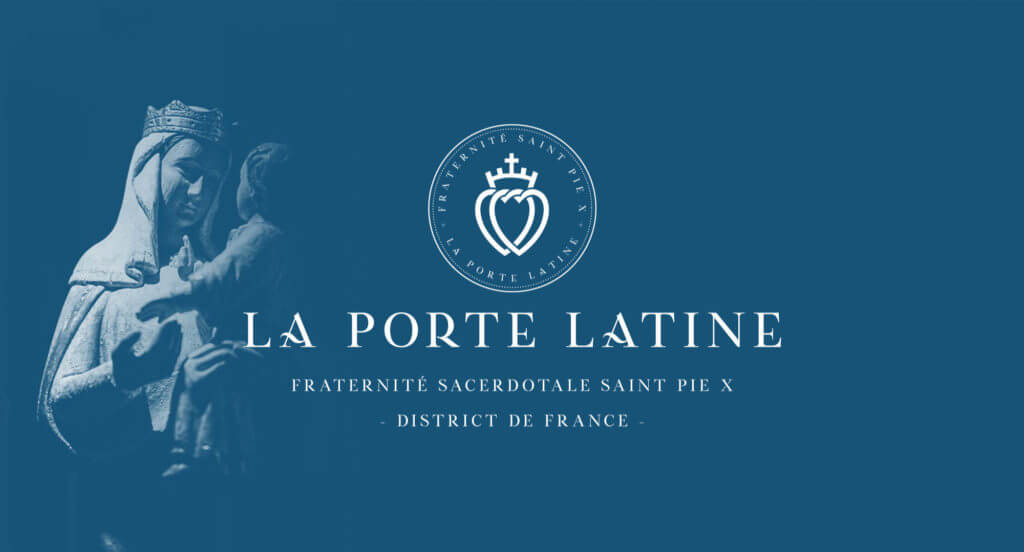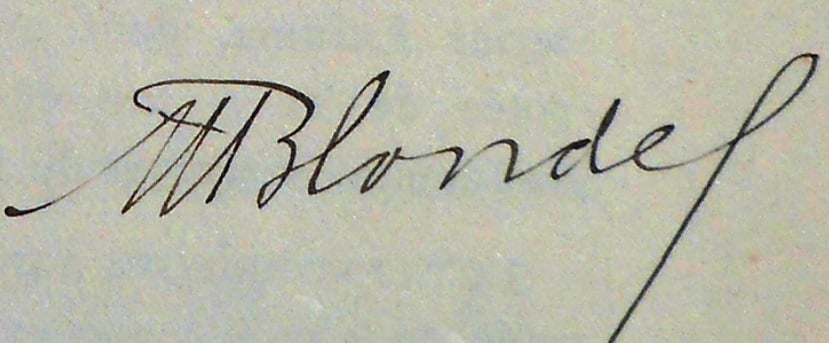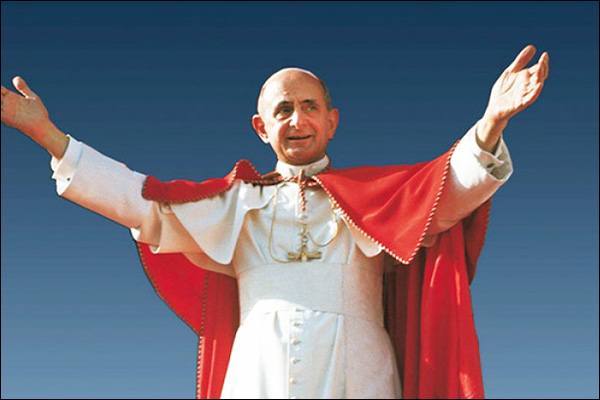Le titre de « Docteur » est mérité par celui dont les enseignements ont donné le double exemple de son orthodoxie et de sa science éminente.
1. « Il faut garder non seulement ce qui nous est transmis dans les saintes Ecritures, mais aussi les explications des saints docteurs qui nous les ont conservées intactes ». Ainsi s’exprime saint Thomas d’Aquin, lui-même plus tard qualifié de « Docteur commun de l’Eglise »[1]. Cette réflexion n’est pas restée lettre morte, si l’on songe que les œuvres du docteur angélique comportent environ 8000 citations des « saints docteurs ».
2. Le terme de « docteur » peut s’entendre dans un sens large et impropre et il désigne alors le théologien pris comme tel. Le même mot peut s’entendre dans un sens strict et propre et il désigne un titre, celui qui est « officiellement donné par la hiérarchie de l’Eglise[2] à des écrivains ecclésiastiques remarquables par la sainteté de la vie, la pureté de l’orthodoxie et la qualité de la science »[3]. Melchior Cano[4] montre en quoi les docteurs se distinguent des Pères de l’Église, titre qui est réservé à des personnages ayant vécu dans les premiers siècles[5] : les Pères ne sont pas tous des docteurs et les docteurs ne sont pas tous des Pères. Les docteurs constituent en effet, avec les Pères, deux espèces différentes de témoins, sur lesquels le Magistère de l’Eglise a la possibilité de s’appuyer pour indiquer le sens authentique de la doctrine divinement révélée dans les Ecritures. Chez les Pères comme chez les Docteurs (c’est le point commun qui fait d’eux des témoins autorisés) est requise l’orthodoxie, c’est à dire la conformité parfaite de leurs enseignements avec le dépôt révélé. La différence est que chez les Pères est requise l’ancienneté, tandis que chez les Docteurs est requise l’érudition, c’est à dire une science éminente, cette éminence pouvant se signaler en extension en raison de l’étendue de leurs écrits ou en intensité, en raison de la profondeur de leur génie. L’auréole des Docteurs, dit saint Thomas, est la récompense de leur science, c’est à dire le fruit de la victoire qu’ils ont remportée en chassant le diable des intelligencesSupplément à la Somme théologique de saint Thomas d’Aquin, question 96, article 7 : « Perfectissima victoria contra diabolum obtinetur quando aliquis non solum diabolo impugnanti non cedit, sed etiam eum expellit, et non solum a se sed etiam ab aliis. Hoc autem fit per praedicationem et doctrinam ». C’est une œuvre de miséricorde spirituelle.)). Autre différence : le titre de Docteur fait l’objet d’une attribution officielle, qui se réalise par un décret solennel du Souverain Pontife et par le précepte qui est donné, de célébrer la messe et de réciter l’office liturgique correspondants ; le titre de Père en revanche fait l’objet d’une attribution immémoriale, basée sur la coutume.
3. Il est indubitable, cependant, qu’aussi bien les Pères que les Docteurs peuvent mêler une part de pensée personnelle à la pure expression de la croyance commune : toute parole d’un docteur de l’Église n’est pas parole de l’Église. L’historien du dogme doit donc distinguer avec soin ce qui dans leurs écrits a vraiment valeur catholique et ce qui, au contraire, n’est qu’opinion personnelle ou « infiltration de courants idéologiques non traditionnels »[6]. Mais il est clair que ladite « infiltration » ne saurait, chez un saint docteur, prendre les proportions d’une erreur problématique car sinon en opposition, ou du moins en dissonance trop sensible vis-à-vis non seulement de la doctrine divine et catholique mais encore de la doctrine commune des théologiens.
4. Ce point est d’importance et nous voudrions ici en souligner à nouveau les présupposés[7]. La vie personnelle d’un saint docteur, envisagée du point de vue de la vertu morale, est autre que sa réflexion personnelle, envisagée du point de vue de la vertu intellectuelle. L’hérésie, qui s’oppose à la vertu de la foi théologale, implique comme celle-ci les deux points de vue, celui de la vie intellectuelle inséparable de celui de la vie morale. Car l’hérésie est l’erreur voulue en connaissance de cause, et en opposition consciente à l’autorité divine rendue manifeste à travers la proposition de l’Eglise. Mais si l’hérésie est une erreur (et une erreur voulue), toute erreur n’est pas une hérésie, car il est des erreurs, et même des erreurs doctrinales, qui ne sont pas voulues comme telles, c’est à dire qui ne résultent pas d’une opposition consciente à l’autorité de Dieu et de l’Eglise, et qui vont même de pair avec une vie personnelle irréprochable sur le plan de la vertu morale. Mais l’erreur reste néanmoins ce qu’elle est et c’est pourquoi, même si par hypothèse pure (dato non concesso) un écrivain ecclésiastique pouvait mériter les honneurs d’une béatification ou d’une canonisation, l’Eglise pourra hésiter voire se refuser à lui décerner le titre de « Docteur de l’Eglise ». La canonisation est méritée par celui qui a donné l’exemple de ses vertus héroïques. Le titre de « Docteur » est mérité par celui dont les enseignements ont donné le double exemple de son orthodoxie et de sa science éminente. Certes, la sainteté doit toujours aller de pair avec l’orthodoxie. Mais il se peut qu’elle ne se rencontre pas toujours avec l’orthodoxie ni avec la science éminente requises au titre de « Docteur ». Dans quelle mesure l’une et l’autre doivent-elles s’avérer exemplaires ? C’est au Pape qu’il appartient d’en juger, mais il doit pour cela tenir compte de tout ce que réclame, dans les circonstances présente, la sauvegarde du bien commun de toute l’Eglise, qui est constitué par sa Tradition.
5. Béatifié par Benoît XVI en 2010, le cardinal John Henry Newman (1801–1890) a été canonisé par François le 13 octobre 2019. Et voici que, ce jeudi 31 juillet, un communiqué de la salle de presse du Saint-Siège, rapporte que lors de l’audience accordée au cardinal Marcello Semeraro, préfet du dicastère pour les Causes des Saints, le Pape Léon XIV « a confirmé l’avis favorable de la session plénière des cardinaux et évêques, membres du dicastère pour les Causes des saints, concernant le titre de docteur de l’Église universelle qui sera prochainement conféré à saint John Henry Newman »[8].
6. Dans l’attente des arguments que le Pape ne manquera pas de donner pour justifier l’attribution de ce titre, nous pouvons déjà redire ici ce que nous avons écrit il y a six ans, lors de la canonisation du feu cardinal. « Même si la foi personnelle de Newman est demeurée intacte, sa réflexion personnelle ne saurait bénéficier d’une recommandation trop marquée de la part de l’Eglise »[9]. Cela se voit clairement dans l’un des principaux écrits de sa période catholique, An Essay in Aid of a Grammar of Assent, ordinairement désigné en raccourci comme la Grammar of Assent, la « Grammaire de l’assentiment ». Henri Bremond (1865–1933) fit un l’éloge que l’on sait de « cette merveilleuse Grammar of Assent, qui est pour plusieurs d’entre nous et qui sera plus encore pour les générations prochaines ce que la Somme de saint Thomas et le Discours sur la Méthode furent pour les générations précédentes »[10]. Mais cet éloge devait rencontrer, la même année où il fut décerné à Newman, un contradicteur redoutable, dans les colonnes de la Revue de philosophie[11], que devait d’ailleurs reproduire l’année suivante la Revue thomiste[12]. L’abbé Emile Baudin (1875–1949), professeur de philosophie au Collège Stanislas, à l’Institut Catholique de Paris et à la Faculté de théologie catholique de Strasbourg, est l’auteur de cette magistrale étude qui fait le point sur « La Philosophie de la foi chez Newman ». Il y porte la critique suivante.
7. « Newman ne paraît pas seulement être un psychologue se contentant d’étudier le fait et le comment de sa foi, mais encore un philosophe essayant d’en tirer, d’une façon plus ou moins consciente et voulue, une théorie générale de la croyance. Quel est le fondement de cette philosophie – si cette expression peut être employée pour caractériser un système si ondoyant ? Newman paraît très convaincu que le principe, le point de départ et le fond de sa doctrine se trouvent dans les données de l’expérience. Il pense offrir ce que l’on appellerait en style comtien[13] une doctrine positive de la foi, basée sur les faits, rien que sur les faits. Mais il semble plutôt qu’il suit un procédé inverse à la méthode scientifique et qu’il fait appel à l’expérience pour établir une doctrine préconçue. Ainsi son œuvre entière ne serait qu’un vaste raisonnement par assumption[14] avec, pour assumption fondamentale, le fidéisme[15] pris comme doctrine, et plus encore comme attitude. Elle n’aurait donc pas de fondement objectif. Le fidéisme, chez Newman, est d’abord un besoin et une attitude, puis une doctrine, puis une psychologie »[16]. Newman part du fait de sa croyance et il entend montrer que celle-ci se justifie (ou que l’objet de sa croyance est crédible) parce qu’elle apparaît à l’expérience conforme aux aspirations de sa vie profonde, avec sa recherche personnelle de la vérité. On reconnaît là ce que les théologiens désignent commel e motif de crédibilité interne individuel. Newman met l’accent sur lui, au risque de négliger d’autres motifs sans lesquels celui-ci resterait insuffisant, les motifs de crédibilité externes, comme les miracles et les prophéties. De ce fait, dans le newmanisme, « tous les arguments sont subjectifs, toute foi se confond avec le désir de croire et toute vérité vraie avec notre vérité utile. Le pragmatisme religieux, établissant des utilités, doit donc offrir une justification intégrale de la foi intégrale, en dépit des restrictions et des distinctions introduites par la raison raisonnante »[17].
8. Mgr Honoré, qui reste l’un des spécialistes reconnus de la vie et de la pensée de Newman[18], n’avait donc pas tort, lorsqu’il voyait dans la Grammaire de l’assentiment le développement magistral « des intuitions que Blondel reprendra plus tard dans son Action »[19]. Blondel, le philosophe de l’action, faisait en effet reposer la foi sur les nécessités vitales de l’action humaine. Newman ne va certes pas directement jusque-là, en adoptant ce qui sera le principe même du modernisme de Blondel. Mais il lui ouvre déjà la porte. « « Laissons faire des démonstrations », dit Newman, « à ceux qui en ont le don … Pour moi, il est plus conforme à mon propre tempérament de tenter une preuve du christianisme de la même manière non formelle qui me permet de tenir pour certain que je suis venu en ce monde et que j’en sortirai ». L’argument se ramène à « une accumulation de probabilités variées ». Il tient que « à partir de probabilités nous pouvons construire une preuve légitime suffisante pour donner la certitude » »[20]. Cette dernière réflexion est capitale, car elle montre que Newman entend bien aboutir à une certitude. C’est justement pourquoi son argument, tiré de la thèse des probabilités convergentes, ne tombe nullement sous le coup de la condamnation du décret Lamentabili, qui, en 1907, dix-sept ans après la mort du cardinal, sanctionnera comme réprouvée et proscrite la proposition suivante : « L’assentiment de la foi repose en dernière analyse sur un ensemble de probabilités »[21]. Newman dit que le fait de la révélation peut être prouvé par un tel ensemble de probabilités et que la raison arrive à en dégager une certitude légitime, tandis qu’aux yeux des modernistes, même pour ceux qui saisissent le mieux les arguments les meilleurs de l’apologétique, ceux-ci ne peuvent élever personne au-dessus des probabilités[22]. Et il ne faut pas oublier non plus que Newman se préoccupait avant tout, comme un pasteur, de de la foi des simples … Mais il reste, même avec cela, que le fidéisme immanentiste[23], sous-jacent à l’apologétique de Newman, tout inconscient qu’il fût, avait de quoi aboutir un jour jusqu’à la philosophie de l’action d’un Maurice Blondel.
9. Est-il opportun de valoriser du titre de Docteur de l’Eglise l’auteur d’une telle réflexion ? Réflexion si ondoyante, dit l’abbé Baudin, que le système de sa pensée y est « à peu près invertébré » et que « rien n’est plus périlleux que l’effort de dessiner un équivalent d’ossature à un tel organisme »[24] ? … Outre l’orthodoxie nette et claire, trouverait-on là l’éminence d’une science savamment construite ? Nous croyons malheureusement avoir quelques raisons d’en douter.
Image : Public Domain Mark 1.0 Universal
- Saint Thomas d’Aquin, Commentaire sur le Traité des Noms divins de Denys l’Aréopagite, chapitre II, leçon 1. Le docteur angélique explique ici que le recours à l’autorité des saints docteurs est le moyen de conserver intacte la règle de l’Ecriture. « Quia nos, a sacra Scriptura recipientes manifestationem Dei, ea quae in sacra Scriptura sunt posita, oportet nos custodire sicut quamdam optimam regulam veritatis, ita quod neque multiplicemus, addentes ; neque minoremus, subtrahentes ; neque pervertamus, male exponentes ; quia dum nos custodimus sancta ab ipsis custodimur et ab ipsis confirmamur ad custodiendum eos qui custodiunt sancta. Oportet enim non solum conservare ea quae in sanctis Scripturis sunt tradita, sed et ea quae dicta sunt a sacris doctoribus, qui sacram Scripturam illibatam conservaverunt ».[↩]
- Autrefois cette consécration a pu être donnée par le Magistère ordinaire des évêques ; aujourd’hui elle est réservée au Pape lui-même, agissant seul ou à la tête d’un concile œcuménique.[↩]
- Robert Lesage, « Docteurs de l’Eglise » dans l’Encyclopédie publiée sous la direction de Gabriel Jacquemet, Catholicisme hier aujourd’hui et demain, t. III, 1952, Letouzey et Ané, col. 936.[↩]
- Melchior Cano (1509–1560), op, est l’un des principaux théologiens de l’Ecole de Salamanque, au seizième siècle. Son œuvre principale est le Traité des lieux théologiques (De locis theologicis), qui fut publié après sa mort en 1563.[↩]
- Melchior Cano, Des lieux théologiques, livre VII, chapitres 1 et 2.[↩]
- Lesage, ibidem.[↩]
- Voir l’article « Newman » dans le numéro du Courrier de Rome de décembre 2019.[↩]
- https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2025–07/cardinal-newman-proclame-docteur-eglise.html[↩]
- Article « Newman » dans le numéro du Courrier de Rome de décembre 2019, § 9, p. 8.[↩]
- Henri Brémond, Newman. Essai de biographie psychologique, Paris, 1906, p. 8.[↩]
- Revue de philosophie des 1er juin 1906 (p. 571–598), 1er juillet 1906 (p. 20–55), 1er septembre 1906 (p. 253–286) et 1er octobre 1906 (p. 373–391).[↩]
- Revue thomiste de 1906, p. 723–733 et de 1907, p. 222–231.[↩]
- C’est-à-dire selon le style d’Auguste Comte (1798–1857), auteur du mode de pensée positiviste, lequel entend se baser uniquement sur des faits[↩]
- Le raisonnement par assomption est un raisonnement qui présuppose la vérité d’une interprétation donnée des faits (appelée « hypothèse »), et qui en déduit les conséquences logiques. Si ces conséquences rendent suffisamment compte des faits, l’interprétation est tenue provisoirement pour vraie.[↩]
- Le fidéisme est une position tantôt philosophique et tantôt théologique, selon laquelle la vérité ne peut être établie qu’au moyen d’un argument d’autorité ; la vérité est objet de croyance ou de foi, non de science. Le fidéisme revêt différentes formes selon qu’il considère que doit être objet de croyance toute vérité ou seulement quelque type de vérité, comme la vérité religieuse. Le fidéisme qui entend se dispenser de la démonstration de l’existence de Dieu ainsi que des motifs externes et objectifs de crédibilité rationnelle (les miracles et les prophéties) a été condamné par l’Eglise.[↩]
- Revue thomiste de 1906, p. 728.[↩]
- Revue thomiste de 1907, p. 226.[↩]
- Cf. Jean Honoré, « Newman » dans Catholicisme, hier aujourd’hui et demain, t. IX, Letouzey et Ané, 1982, col. 1183–1188.[↩]
- Honoré, ibidem, col. 1186.[↩]
- H. Tristram et F. Bacchus, « Newman » dans le Dictionnaire de théologie catholique, t. XI, première partie, Letouzey et Ané, 1931, col. 395.[↩]
- Proposition condamnée n° 25, DS 3425[↩]
- Cf. à ce sujet les réflexions de S. Harent dans l’article « foi » du le Dictionnaire de théologie catholique, t. VI, première partie, Letouzey et Ané, 1947, col. 194–195.[↩]
- Le fidéisme immanentisme est une conception de l’apologétique où la vérité crue apparaît vraie principalement dans la mesure où elle est conforme aux aspirations intimes de la conscience.[↩]
- Revue thomiste de 1906, p. 723.[↩]