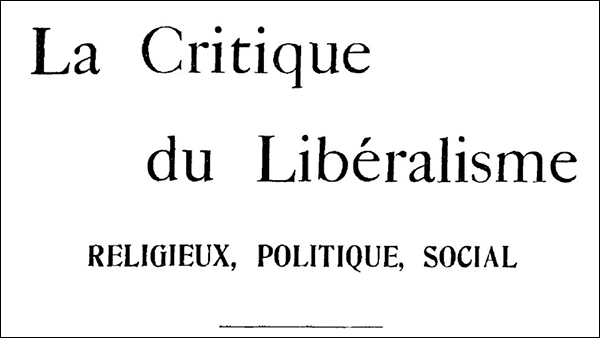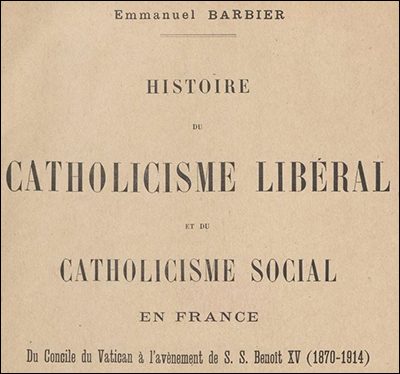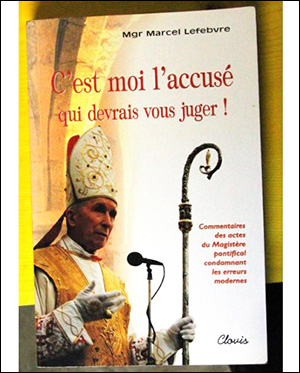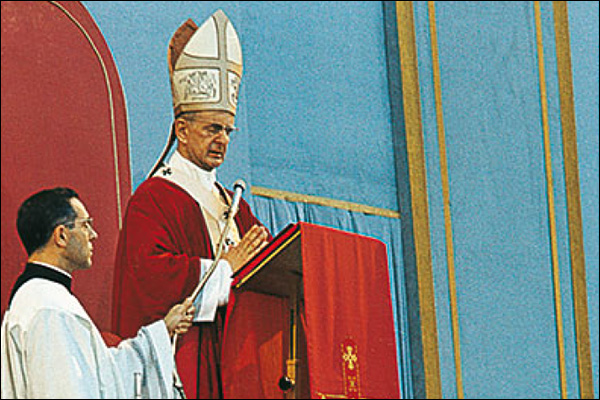I – Pour répondre clairement à cette question, il faut expliquer d’abord ce qu’on entend par cet adjectif.
D’après la simple raison, libéral a deux sens principaux : 1° il veut dire généreux par les idées, par les sentiments ou par des œuvres ; 2° il signifie partisan de la doctrine qualifiée par le mot de libéralisme.
Dans le premier sens du mot, libéral, tout le monde doit l’être, et, en un certain sens, tout le monde l’est, au moins en quelques circonstances. Toutefois, pour être distingué par cette épithète, une générosité accidentelle ou intérimaire ne suffit pas ; il faut être généreux habituellement, par tournure d’esprit, inclination de sentiment, dominante d’œuvres ; quelques actes de générosité, comme il y en a dans toute vie, ne suffiraient pas pour être appelé libéral.
Léon XIII était-il libéral en ce sens ? Oui, Léon XIII était libéral en ce sens qu’il y a, dans sa vie et durant son pontificat, beaucoup d’actes d’une insigne générosité, actes commandés par sa haute situation et auxquels il ne pouvait manquer sans déchoir. Mais était-il libéral en son fond, par inclination naturelle, entrain de nature, abandon gracieux du caractère ? Non, en ce sens, il n’était pas libéral, il était plutôt le contraire, ayant été, toute sa vie, homme de pensée, de réserve, puisant ses inspirations dans sa tête et ne prenant ses décisions que suivant les inspirations de sa sagesse. La générosité, comme tout le reste, avait là sa source et n’en découlait que suivant Tordre de ses conseils.
Léon XIII était-il libéral dans le sens plus étroit de prodigalité pécuniaire ? Non, encore ; Léon XIII ne voulait pas de dettes, il mettait de Tordre dans ses affaires, et, pour le maniement des fonds, il était plutôt économe d’argent. Et ceci ne doit point se prendre en mauvaise part ; l’économie, la retenue sont aussi des vertus qui priment la générosité. Une générosité qui ne serait ni économe, ni sage, prendrait un autre nom.
Maintenant Léon XIII était-il, par ses doctrines et par ses actes, politiquement libéral dans le sens donné par la Charte de la Révolution ; ou, seulement, dans le sens plus restreint, exposé par Dupanloup, dans son livre de la Pacification religieuse, publié en 1845 ?
Libéral, dans le sens de la Révolution, un Pape ne peut pas l’être en principe, puisque les principes de la Révolution ont été condamnés par Pie VI, comme contraires au bien de la société et de l’Eglise ; et condamnés, proscrits plus solennellement par Pie IX, dans le Syllabus, synthèse de toutes les erreurs libérales, dont Léon XIII lui-même a plus d’une fois authentiqué les condamnations. Un pape peut être encore moins libéral en fait, dans le sens révolutionnaire ; car les actes de la Révolution, comme tels, sont autant d’attentats contre la religion, contre l’Eglise et contre le Saint-Siège Apostolique.
Dans le sens plus restreint, dans le sens de Dupanloup, dans le sens de réconciliation de l’Eglise avec la société moderne, Léon XIII, de ce sollicité pendant tout son pontificat, n’a pas été, non plus, libéral. Lisez, avec des yeux de lynx et un” esprit compréhensif, tous ses actes, vous n’y trouverez pas un mot dont puissent se prévaloir les partisans du catholicisme libéral. On avait cru un instant, de bons esprits, comme Emile Ollivier et Maurice d’Hulst, avaient paru admettre que l’Encyclique Immortale Deiabondait dans le sens de Dupanloup. L’Encyclique Libertas pulvérisa ces illusions. Non, non, non ; jamais Léon XIII, ni dans sa correspondance privée, ni dans ses actes publics, n’a dit un mot, un seul mot, dont puissent justement se prévaloir les partisans du libéralisme.
Pour serrer la question de plus près, pratiquement, Léon XIII n’est-il pas au moins suspect de libéralisme ? — La réponse dépend du sens donné au mot pratiquement. Le libéralisme part de ce principe que la vérité se suffit à elle-même ; qu’il suffit de la dire pour la faire valoir et que son expression pleine et entière suffit à la revendication de ses droits et à l’accomplissement de ses devoirs. Léon XIII, à coup sûr, a dit la vérité dans sa plénitude ; il l’a dite dans la mesure où la sollicitaient les circonstances ; il l’a dite partout, toujours, à temps et à contretemps, sans aucun autre souci que de faire honneur aux devoirs de sa charge. L’a-t-il fait pratiquement, dans le sens du libéralisme, pour le savoir, il faudrait scruter ses intentions et cela n’est au pouvoir de personne. On voit bien qu’il a dit tout ce qu’il fallait dire, qu’il l’a dit comme il fallait le dire, avec toute l’exactitude et la précision désirables. Mais rien ne prouve qu’il ait voulu que-cela se fit au profit du libéralisme.
Le dernier refuge de l’imputation du libéralisme contre Léon XIII consisterait à dire que ce Pontife, dans tous ses actes pontificaux, s’est borné à l’expression de la vérité, à renonciation du droit et du devoir, sans intimer, par ordre, de respecter l’un et d’accomplir l’autre. Mais cela, en fait, ne peut pas se dire ; car Léon XIII a su donner des ordres et intimer des défenses. La seule chose qui subsisterait, en faveur de l’accusation, c’est que Léon XIII, spécialement dans ses rapports avec le gouvernement français, a suivi un parti de conciliation, depuis le premier jusqu’au dernier jour de son .pontificat. Cette conduite n’est pas un acte de doctrine, c’est un acte de gouvernement, un acte de souveraineté- Le pape s’est tenu à cette résolution de condescendance, à ce parti de temporisation pour des raisons qui lui ont paru bonnes, dont l’effet n’a pas répondu à ses espérances, dont l’échec a dû empoisonner son âme, surtout lorsque, au dernier jour de son existence, il a pu voir que sa longanimité, sa bonté, sa sagesse aboutissaient à cette loi scélérate de séparation, qui n’est, de son vrai nom, qu’une loi de suppression par oppression, un solennel outrage, jeté non seulement à la religion catholique et à l’Eglise Romaine, mais à tous les faits de l’histoire, à tous les principes de la sociabilité, à toutes les traditions du genre humain, à toutes les exigences de Tordre social, à la conciliation de l’autorité avec la liberté, et au bon renom de la France. La condescendance de Léon XIII aboutit, sous nos yeux, aux pires gâchis et à la quasi désespérance.
II – Le pape Léon XIII n’a donc été, en aucun sens du mot, un pape libéral ; a‑t-il été davantage un pape conciliateur ?
Des écrivains partagent les successeurs de saint Pierre en deux catégories : les papes intransigeants et les Papes conciliateurs. On ne peut guère nier, en effet, à prendre les pontificats dans leur ensemble, que les uns ne paraissent incliner davantage à la conciliation ; les autres, à l’intransigeance. Les Papes sont hommes ; ils ont un tempérament divers et un esprit différent ; ils sont influencés plus ou moins par le spectacle des événements et par leur commerce avec les hommes. La résultante de leur pontificat peut être sagement appréciée, doit faire place à toutes les nuances de jugements, depuis l’intégrité la plus exigeante jusqu’à la conciliation la plus aimable ; mais, à nos yeux, tel n’est pas le sens de la question.
La question ici posée, n’est pas une question d’histoire, c’est une question dogmatique. La question est de savoir si un- Pape peut être exclusivement intransigeant ou exclusivement conciliateur ; à telle enseigne qu’il soit entièrement l’un et qu’il ne puisse être aucunement l’autre. La question, ainsi posée, n’a pas de sens. Qu’un Pape comme homme, soit tout ce qu’il voudra, dès qu’il devient le successeur de saint Pierre, le vicaire de Jésus-Christ, il devient, par son titre et par la tradition du Saint-Siège, le dépositaire de l’Evangile, le continuateur légal de ses successeurs, l’homme qui doit appliquer, au gouvernement de l’humanité, des dogmes immuables et des lois sacrées. En vertu de son mandat divin, le successeur de saint Pierre tient la place de Jésus-Christ : il remplit sa fonction, comme la remplirait Jésus-Christ, s’il n’était pas remonté au ciel. Avec cette différence toutefois que Jésus-Christ était Dieu et homme tout ensemble ; et que le Pape n’est qu’un homme, mais vicaire d’un Dieu. Homme, il en a les faiblesses et la peccabilité, vicaire de l’homme-Dieu, il a reçu les prérogatives de souveraineté, d’infaillibilité, d’unité, nécessaires à sa fonction. Comme homme, il peut être conciliateur tant qu’on voudra ; comme vicaire de Jésus-Christ, il ne peut, dans sa fonction publique, qu’en avoir la-charité et l’intransigeance. Son infaillibilité n’entraîne pas son impeccabilité ; elle implique seulement qu’en matière de foi, de moeurs et de discipline générale, il ne peut pas tomber dans Terreur.
L’infaillibilité doctrinale du souverain pontife a moins d’étendue que la souveraineté de son gouvernement. L’infaillibilité a un objet très limité : son exercice est d’ailleurs rare ; elle sert plus à défendre la vérité révélée contre les assauts qu’à l’étendre par des définitions dogmatiques. Le gouvernement unique et souverain du Pape est, au contraire, de tous les jours et de toutes les heures. Le Pape a la sollicitude de toutes les églises ; son autorité s’applique, d’une façon directe et immédiate, à tous les diocèses. Par les recours, parles consultations, par les événements et incidents de la vie quotidienne, il est amené à donner, sur chaque chose, des avis, des conseils, des règles de direction. Dans cette application de chaque jour, il a l’assistance de Jésus-Christ et les illuminations du Saint-Esprit ; l’intervention du miracle est ordinaire, habituelle dans son existence. D’autre part, il a le conseil des cardinaux, l’aide des congrégations, l’appui des divers dicastères. De plus, il reçoit, par visite ou par correspondances, une foule d’informations à recevoir ou à contrôler. Le Vatican est l’endroit du monde où l’on sait le mieux ce qui se passe dans tous les coins de l’univers. De la fenêtre de sa chambre, un Pape voit le monde entier. Dans ces conditions, le Pape possède, avec le gouvernement des âmes et l’administration des affaires, tous les éléments d’une singulière sagesse. On en voit les marques dans toutes ses réponses. Matériellement, lorsqu’on mesure de l’oeil les monceaux de papiers et d’affaires, sur quoi doit descendre le jugement du Pontife Romain, on est, étonné qu’un seul homme puisse s’y reconnaître ; et l’on admire invariablement l’admirable prudence qui préside à tous ses conseils.
Mais enfin, pour ceci, le Pape n’est pas infaillible ; il juge selon sa sagesse ; elle est grande, elle est privilégiée, elle excite dans tous les siècles l’admiration de l’histoire. Mais enfin, par la force des choses, Par cette part d’incertitude et d’obscurité inhérente aux affaires humaines, elle peut n’atteindre pas toujours à la perfection et avoir des ombres. Il n’y a peut-être pas de pape dans la vie duquel on ne puisse trouver des effacements ou des lacunes. C’est le fait des choses humaines ; ce serait merveille qu’il n’y en eut pas ; mais s’il s’en rencontre, cela ne tourne ni contre l’institution, ni contre l’homme. Cela est ainsi parce que cela ne peut pas être autrement.
De là ces jugements divers que, de très bonne foi et en toute équité, les historiens portent sur les Papes des différents siècles. Les historiens aussi peuvent se tromper ; ils peuvent, dans leurs récits, exagérer les choses en bien ou en mal”; mais, où ils ne se trompent pas, en principe, c’est quand ils admettent des perspectives diverses et des appréciations différentes. S’ils peuvent se tromper sur le détail, ils ne se trompent pas sur le point qui consiste avoir les choses sous des aspects différents, à porter des jugements divers, en approchant, comme les asymptotes, toujours de la ligne, sans peut-être l’atteindre jamais.
Nous ne posons pas ici la question d’erreur matérielle. Il est sûr que tout historien peut ignorer quelque chose et s’abuser lui-même. Nous disons seulement que si, en pratique, dans les choses humaines, il n’y a pas de bien absolu, on ne peut y atteindre qu’une perfection relative, qui laisse place à des desiderata, mais sans impliquer condamnation d’un pouvoir dont la perfection, certainement très grande, ne peut pas atteindre toujours, pour chaque chose, au sommet de la perfection.
L’infaillibilité du Pape ne comporte pas de possibilité d’erreur ; le gouvernement du Pape ne peut pas n’en pas comporter, dans une faible mesure, sans doute, mais enfin dans une mesure quelconque. Ce défaut, inhérent aux choses humaines, nécessaire, fatal, n’atteint pas l’auréole qui ceint le front des Pontifes Romains. Les Pontifes Romains sont les démiurges de l’humanité ; leur qualité de vicaires de Jésus-Christ, prouvée par l’infaillibilité de leurs décisions, est prouvée aussi par l’invariable prudence de leur gouvernement. On y voit bien la marque de l’homme : on y voit mieux encore le signe de Dieu. Ce qui est des humains met même la part de Dieu en plus vif relief et en plus éclatante splendeur. Les Zoïles qui nient cela sont les taupes de l’histoire ; ils ne voient pas clair et déclament follement.
III – Ces principes sont incontestables ; il faut les examiner maintenant dans la pratique ; et, pour ne pas nous perdre dans le vague, les concréter dans un événement contemporain.
« Dieu dit Léon XIII, dans l’Encyclique Immortale Dei, a divisé le gouvernement humain entre deux puissances : la puissance ecclésiastique et la puissance civile ; celle-là préposée aux choses divines, celle-ci préposée aux choses humaines. Chacune d’elles en son genre est souveraine ; chacune est renfermée dans des limites parfaitement déterminées et tracées en conformité de la raison et de son but spécial. Il y a donc comme une sphère circonscrite, dans laquelle chaque puissance exerce son droit jure proprio. Chacune a sa souveraineté et aucune des deux n’est tenue d’obéir à l’autre, dans les limites où chacune d’elles est enfermée par sa constitution, pour la gestion des intérêts qui sont de sa compétence. »
D’après cet enseignement du Pape, il faut maintenir la distinction du domaine politique et du domaine religieux ; mais il faut maintenir en même temps leurs rapports nécessaires, et à raison de leur objet distinct et de leur fin, coordonner l’une à l’autre dans leurs relations. « S’il est vrai, dit l’abbé Barbier, que la politique n’est et ne peut être que l’application de la morale au gouvernement du. pays, dans les Etats chrétiens, et si la morale est essentiellement liée à la religion, il s’ensuit avec évidence que l’Eglise, le Pape, gardien de la morale et de la religion, ont, à ce titre, un droit d’intervention dans la politique. Ce droit, l’Eglise le tient du triple pouvoir doctrinal, législatif et judiciaire, inhérent à sa constitution divine. Aucun catholique.ne peut le contester, ni s’y soustraire. C’est par usage de ce droit que le souverain pontife Léon XIII, dans sa Lettre aux Français, rappelait l’obligation d’accepter le gouvernement établi, de se soumettre aux lois justes émanant de lui et le devoir des catholiques de s’élever au-dessus des divisions des partis, afin de concentrer leurs efforts dans, la résistance, à la conjuration anti-religieuse » [1].
La moralité des actes civiques, et politiques est soumise directement au Pape, mais la politique pontificale et ses directions diplomatiques ne se réclament de cette autorité qu’autant qu’elles visent et atteignent le rapport de la politique avec la- morale et la religion. Hors de là, elles n’obligent nullement en conscience. « Cette politique, dit encore l’abbé Barbier, ces directions, se réfèrent à des questions de tactique ; elles varient avec les temps, les lieux, les circonstances, les hommes et sont sujettes à des méprises même chez des Papes les plus éclairés. »
En dehors de son ministère propre, un Pape est en affaires constantes et en, négociations quotidiennes, pour objets de son ressort, avec tous les gouvernements de la terre. Quant au Pape Léon XIII, après le règne intransigeant de Pie IX, il inclinait, dès 1878, à plus de ménagements envers les pouvoirs politiques et l’opinion libérale. En France, particulièrement, il conseilla le ralliement à la forme républicaine. Mais il eut soin de faire remarquer trois choses :
1° qu’il n’entendait pas outrepasser les limites posées par ses prédécesseurs quant à la valeur respective des formes politiques ; 2° qu’il ne voulait inquiéter personne dans son for intérieur et voulait, au contraire, respecter les convictions traditionnelles des anciennes familles ; et 3° qu’il distinguait entre la constitution et la législation, que, par conséquent, les catholiques français, observateurs fidèles et exemplaires de la constitution républicaine, devaient employer toutes les ressources de leur génie, de leur zèle et de leur courage, à combattre la législation anti-chrétienne des sectaires actuellement au pouvoir. On peut même dire sans forcer la note, que, par ses diverses interventions, le Pape voulait ménager, aux catholiques, leur accession au pouvoir, et, par conséquent, renverser les sectaires francs-maçons.
On ne peut pas, sans aveuglement positif et sans injure formelle, attribuer, au Pape Léon XIII, l’intention, même lointaine, défavoriser les sectaires opportunistes ou radicaux. La République, en effet, telle qu’ils l’entendent, n’est pas une forme de gouvernement démocratique et populaire ; c’est, pour eux, un dogme, une créance impie, en tant qu’elle affirme son opposition irréductible, non seulement aux idées et aux sentiments de l’Evangile ; mais encore aux vérités premières de la religion naturelle et de la philosophie. Leur République, c’est un symbole grossier, athée et matérialiste, que la franc-maçonnerie impose comme base à notre législation. Depuis trop longtemps, telle est bien la forme sous laquelle la République se présente ; elle veut imposer, à une nation libre et chrétienne, un gouvernement pour lequel le pouvoir n’est rien, s’il ne sert à maintenir la domination intolérante d’une secte, qui ne tient aucun compte des convictions religieuses de l’homme, qui ne veut laisser à la religion aucune place ni dans les particuliers, ni dans les familles, ni dans la société française.
On ne peut, dis-je, sans faire injure à Léon XIII, le supposer capable de conniver, si peu que ce soit, aux agissements de ces êtres bas et scélérats, dont le règne est un attentat continu contre les institutions primordiales du genre humain. Que, par crainte du pis et espoir du mieux, il ait omis de leur résister aussi promptement, aussi entièrement, aussi radicalement, qu’il le fallait, c’est possible. Mais il ne s’abusait pas sur la perversité de leurs idées, sur l’énormité de leurs lois, sur le peu d’espoir de leur résipiscence. S’il caressa l’espoir qu’un mouvement de fond catholique, une saute de vent, un retour quelconque, pouvait changer la force des choses, c’est une illusion qui trompa ses espérances ; mais la faute n’en est pas au Pape.
La faute en est à tous ces fricoteurs politiques qui se coiffaient bravement de la protection du Pape, et qui, en France, sous prétexte de suivre les consignes pontificales, les faussèrent constamment et les firent diverger, pour s’assurer les bénéfices d’un déraillement national. Qu’un de Mun et quelques autres aient essayé, sur le terrain de politique pure, de réaction et de contre-révolution, ils en avaient le droit et peut-être aussi le devoir. L’insuccès ne prouve rien contre la licite et la probité de leur initiative. Mais d’autres furent moins loyaux ; sans couleur d’obéir au Pape, de suivre les conseils du Pape, d’assurer le succès de sa politique, ils se fabriquaient tout simplement des opinions de droit commun et de divers centres par quoi, loin de servir la cause chrétienne, ils la desservaient. Nous avons vu ce triste jeu se poursuivre, pendant des années ; je me demande s’il ne se poursuit pas encore sous Pie X, pendant que les sectaires achèvent de démolir l’Eglise et de perdre la France.
Mais imputer de telles aberrations à l’héroïque Pie X et au temporisateur Léon XIII, non, non, non. Ces agissements ne sont pas leur fait, et ne sauraient être leur faute. C’est la faute et le crime des sectaires de droite dont la république et la démocratie ne sont guère, au fond, que des machinations de l’enfer, mais d’un enfer plus imbécile que méchant, pervers tout de même. Nous ne voulons pas personnaliser ce débat.
JUSTIN FÈVRE, Protonotaire apostolique.
Source : La Porte Latine
- Rome et Faction libérale populaire, p. 10.[↩]