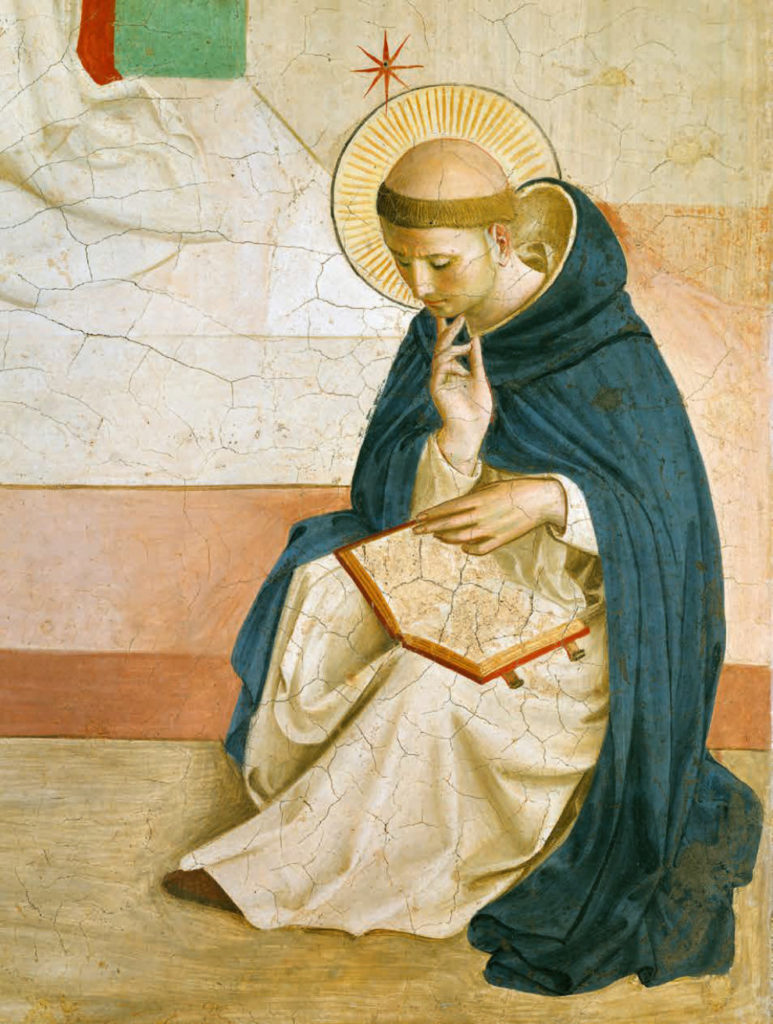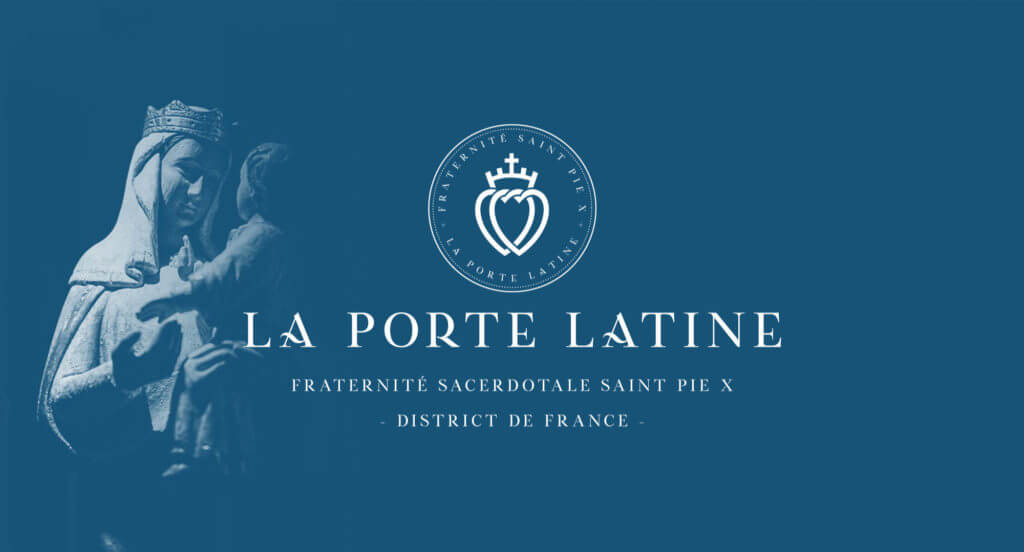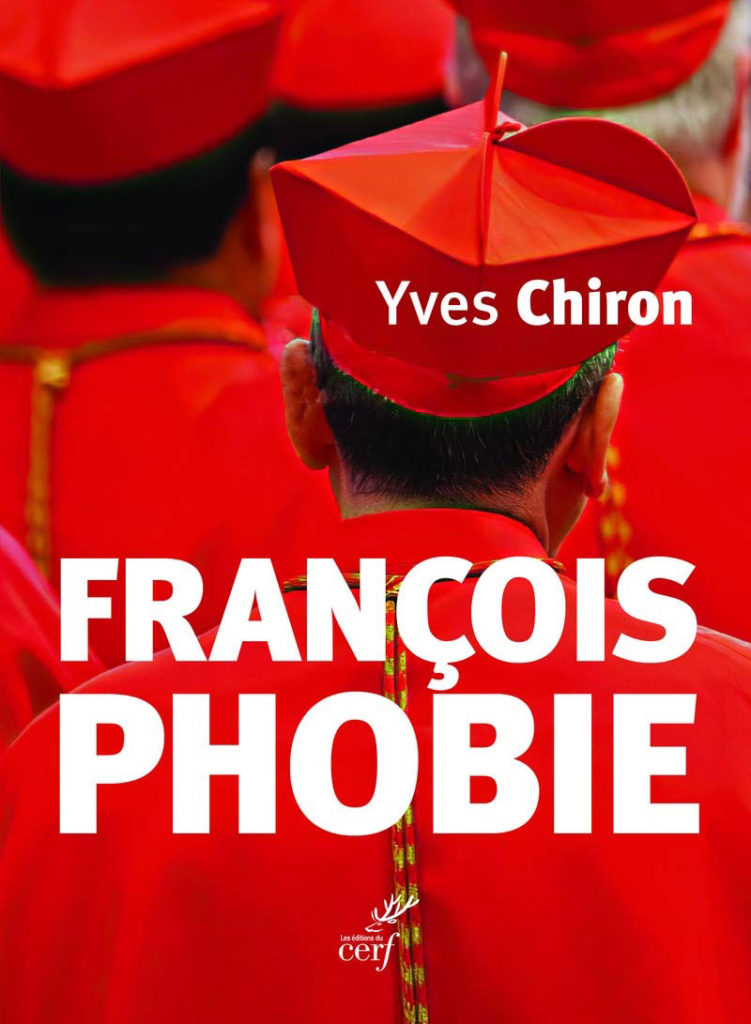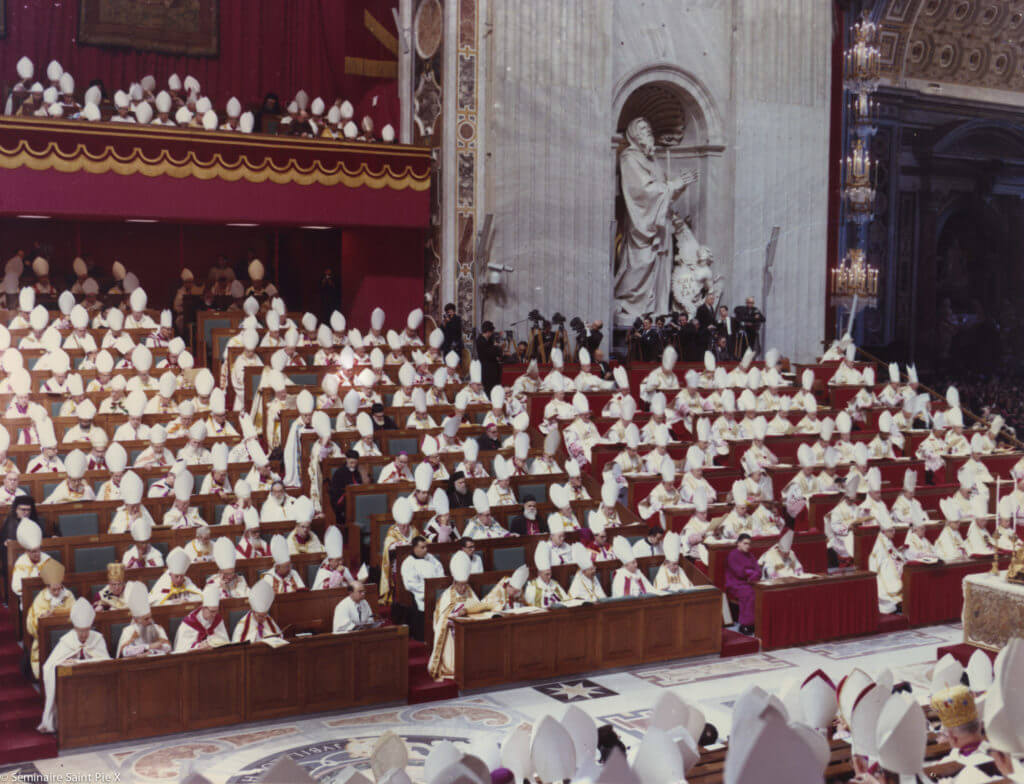Un catholique n’a pas le choix : soit il accepte ce que l’Église a toujours enseigné, et alors il rejette les nouveautés contradictoires. Soit il accepte les nouveautés, mais alors il doit rejeter le Magistère de l’Église.
Une chose ne peut pas être et ne pas être en même temps et sous le même rapport. En d’autres termes, si une proposition est vraie, alors la proposition contradictoire est nécessairement fausse, et réciproquement. C’est évident. Si une personne nie un tel principe, alors elle affirme quelque chose, à savoir que ce principe est faux. Mais en affirmant cela, elle rejette la proposition contradictoire, à savoir que ce principe n’est pas faux. Elle admet donc qu’il est impossible d’être et de n’être pas en même temps[1].
C’est en vertu de ce principe que tout catholique est capable de rejeter certaines propositions qui contredisent ce qui est enseigné par le Magistère de l’Église. Or, il se trouve que, depuis le concile Vatican II, nous constatons des contradictions entre ce que l’Église a toujours enseigné comme appartenant à la doctrine catholique, et ce que les hommes d’Église d’aujourd’hui enseignent. Finirons-nous par devoir nier le principe de non-contradiction ?
Voici six contradictions.
1re contradiction
Proposition A : Les catholiques sont les seuls à avoir le droit de ne pas être empêchés, par quelque pouvoir humain que ce soit, de s’exprimer publiquement.
Proposition B : Les catholiques ne sont pas les seuls à avoir le droit de ne pas être empêchés, par quelque pouvoir humain que ce soit, de s’exprimer publiquement.
La proposition A est enseignée parle pape Pie IX dans l’encyclique Quanta cura publiée en 1864. Certes, Pie IX admet que les pouvoirs publics puissent tolérer l’expression de l’erreur. Mais la tolérance est bien différente de la reconnaissance d’un droit. Comme l’a bien expliqué Léon XIII dans son encyclique Libertas, une fausse religion ne possède pas le droit de se répandre.
Quant à la proposition B, elle se trouve au numéro 2 de la déclaration Dignitatis humanae du concile Vatican II. Elle est reprise dans le Catéchisme de l’Église catholique de 1992 qui dit au numéro 2108 : « Ce droit naturel [à la liberté religieuse] doit être reconnu dans l’ordre juridique de la société de telle sorte qu’il constitue un droit civil ».
2e contradiction
Proposition A : L’Église du Christ et l’Église catholique sont absolument identiques.
Proposition B : L’Église du Christ et l’Église catholique ne sont pas absolument identiques.
La proposition A est enseignée parle pape Pie XII dans son encyclique Mystici corporis publiée en 1943 et dans son encyclique Humani generis de 1950. En outre, Pie XI parle des communautés non catholiques comme relevant d’une « fausse religion chrétienne, entièrement étrangère à l’unique Église du Christ »[2].
La proposition B se trouve dans la constitution Lumen Gentium du concile Vatican II, au numéro 8. Il est écrit en effet que l’Église du Christ « subsiste dans l’Église catholique ». Cette expression, d’après la Sacrée Congrégation pour la doctrine de la foi[3], signifie que, sous le rapport de la durée et de l’unicité, l’Église du Christ et l’Église catholique sont identiques. Mais sous le rapport de la présence agissante, l’Église du Christ est distincte de l’Église catholique parce que plus large que cette dernière.
3e contradiction
Proposition A : Il y a un seul sujet du pouvoir suprême de l’Église.
Proposition B : Il n’y a pas un seul sujet du pouvoir suprême de l’Église.
La proposition A se trouve dans la constitution Pastor æternus du concile Vatican I, selon laquelle seul le pape est le chef suprême de l’Église.
La proposition B se trouve dans le concile Vatican II, au numéro 22 de la constitution Lumen Gentium, selon laquelle il existe deux sujets du pouvoir suprême dans l’Église : d’une part le pape seul, et d’autre part les évêques unis au pape. Cette thèse se trouve aussi enseignée explicitement dans le Code de droit canonique de 1983 au canon 336.
4e contradiction
Proposition A : L’Esprit du Christ refuse de se servir des communautés séparées de l’Église catholique comme des moyens de salut.
Proposition B : L’Esprit du Christ ne refuse pas de se servir des communautés séparées de l’Église catholique comme des moyens de salut.
Même si le Saint Esprit ne refuse pas d’agir DANS ces communautés pour donner la grâce aux âmes de bonne volonté (cf Mystici corporis de Pie XII et la Lettre du St Office de 1949 [4] ), le Saint Esprit refuse d’agir PAR ces communautés. En effet, La proposition A est enseignée équivalemment par le quatrième concile du Latran, chapitre premier, rappelant qu’il n’y a pas de salut hors de l’Église catholique. Cette doctrine se trouve aussi dans l’encyclique Mirari vos de Grégoire XVI, dans le Syllabus de Pie IX (propositions condamnées n°16 et 17) ainsi que dans l’encyclique Satis cognitum de Léon XIII.
La proposition B est enseignée par le concile Vatican II dans le décret Unitatis redintegratio, numéro 3. Il y est écrit en effet : « (…) Ces Églises et communautés séparées, bien que nous croyions qu’elles souffrent de déficiences, ne sont nullement dépourvues de signification et de valeur dans le mystère du salut. L’Esprit du Christ, en effet, ne refuse pas de se servir d’elles comme de moyens de salut ».
5e contradiction
Proposition A : L’ancienne Alliance est abrogée.
Proposition B : L’ancienne Alliance n’est pas abrogée.
La proposition A est enseignée par saint Paul au chapitre VII de l’épître aux Hébreux : « Car le sacerdoce étant changé, il était nécessaire qu’il y ait aussi un changement de loi. (…) Il y a ainsi abolition de la première ordonnance, à cause de son impuissance et de son inutilité », Le Concile de Florence enseigne de même dans la bulle Cantate Domino du 4 février 1442 [5]. Le pape Pie XII écrit aussi dans l’encyclique Mystici corporis : « La mort du Rédempteur a fait succéder le Nouveau Testament à l’Ancienne loi abolie ».
La proposition B est enseignée par le pape Jean-Paul II en 1980 : « (…) L’ancienne Alliance, jamais révoquée par Dieu »[6]. De même dans son discours du 11 septembre 1987 : « (…) Un seul Dieu, qui a choisi Abraham, Isaac et Jacob, et a conclu avec eux une alliance d’amour éternelle, qui n’a jamais été révoquée »[7]
Elle est enseignée aussi par le pape François : « Un regard très spécial s’adresse au peuple juif dont l’alliance avec Dieu n’a jamais été révoquée »[8]. Elle se trouve aussi dans le Catéchisme de l’Église catholique de 1992, au n°121 : « L’ancienne Alliance n’a jamais été révoquée »[9].
6e contradiction
Proposition A : La peine de mort peut être permise moralement.
Proposition B : La peine de mort ne peut pas être permise moralement.
La proposition A est enseignée non seulement par saint Thomas d’Aquin [10], mais par le Magistère constant de l’Église. En 1208, le pape Innocent III impose aux Vaudois une formule d’abjuration qui contient cette proposition : « Nous affirmons que le pouvoir séculier peut, sans péché mortel, prononcer des peines capitales, pourvu qu’il porte cette sentence dans un procès et non par haine, après délibération et non sans précaution » [11]. En 1520, le pape Léon X condamne cette proposition de Luther : « Que les hérétiques aient été brûlés est contraire à la volonté de l’esprit » [12]. En 1891, le pape Léon XIII, en condamnant le duel, reconnaît le droit de l’autorité publique d’infliger la peine de mort [13]. De même Pie XI dans l’encyclique Casti connubii [14].
La proposition B est enseignée par le pape François. Dans un discours du 11 octobre 2017, il affirme : « La peine de mort est inadmissible car elle attente à l’inviolabilité et à la dignité de la personne » ; citation reprise par la Congrégation pour la Doctrine de la foi le 1er août 2018 pour modifier le nouveau Catéchisme de l’Église catholique de 1992.
Conclusion
Un catholique dont l’intelligence fonctionne normalement n’a donc pas le choix : soit il accepte ce que l’Église a toujours enseigné, et alors il rejette les nouveautés contradictoires. Soit il accepte les nouveautés, mais alors il doit rejeter le Magistère de l’Église.
Source : Courrier de Rome n° 689
- Voir Aristote, Métaphysique, L. IV, ch. 3 et 4.[↩]
- Pie XI, Encyclique Mortalium animos du 6 janvier 1928, AAS, t. XX, p. 11 : « Quae cum ita se habeant, manifesto patet, nec eorum conventus Apostolicam Sedem ullo pacto participare posse, nec ullo pacto catholicis licere talibus inceptis vel suffragari vel operam dare suam ; quod si facerent, falsae cuidam christianae religioni auctoritatem adiungerent, ab una Christi Ecclesia admodum alienae ».[↩]
- “Réponses aux dubia sur certaines questions ecclésiologiques” du 11 juillet 2007 dans La Documentation catholique, n°2385, p. 717.[↩]
- Lettre à l’archevêque de Boston du 8 août 1949, Dz 3866 à 3873.[↩]
- Décret pour les Jacobites, Dz 1348.[↩]
- Discours aux représentants de la communauté juive de Mayence, 17 novembre 1980, § 3 :“Von Gott nie gekündigten Alten Bundes” (www.vatican.va).[↩]
- “It is Sitting at the beginning of our meeting to emphasize our faith in the One God, who chose Abraham, Isaac and Jacob, and made with them a Covenant of eternal love, which was never revoked” (www.vatican.va).[↩]
- Exhortation apostolique Evangelii gaudium du 24 novembre 2013, n°247.[↩]
- Mame, 1992, p. 38.[↩]
- Somme théologique, IIaIIae, q. 64, art. 2 et 3.[↩]
- Dz 795.[↩]
- Dz 1483.[↩]
- Dz 3272.[↩]
- Dz 3720.[↩]