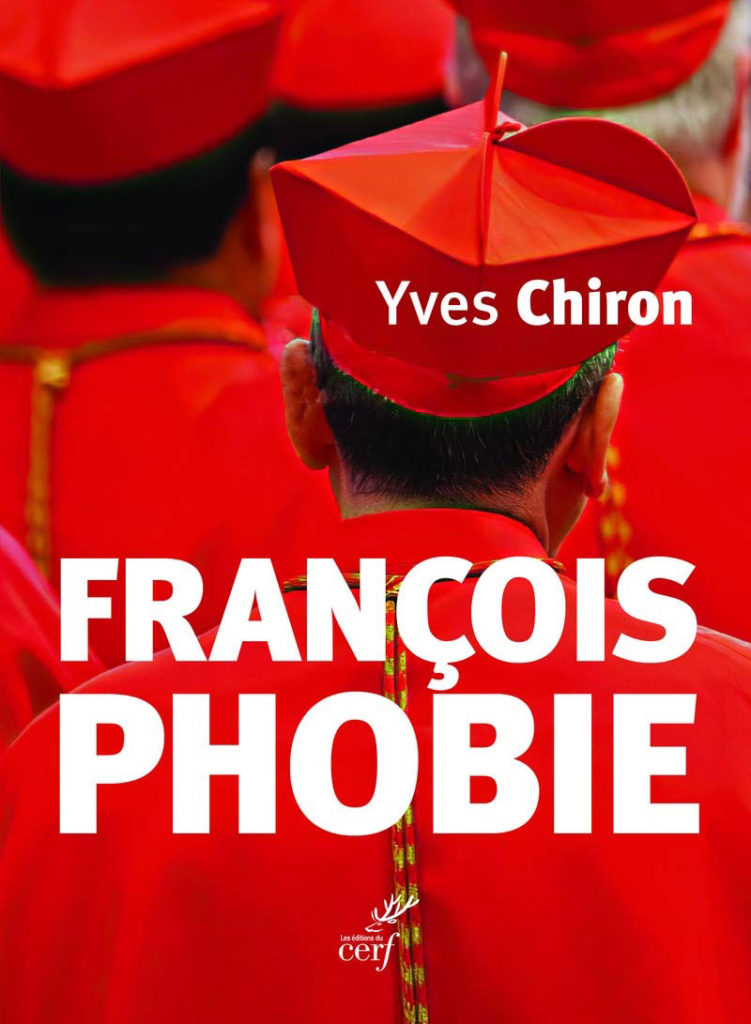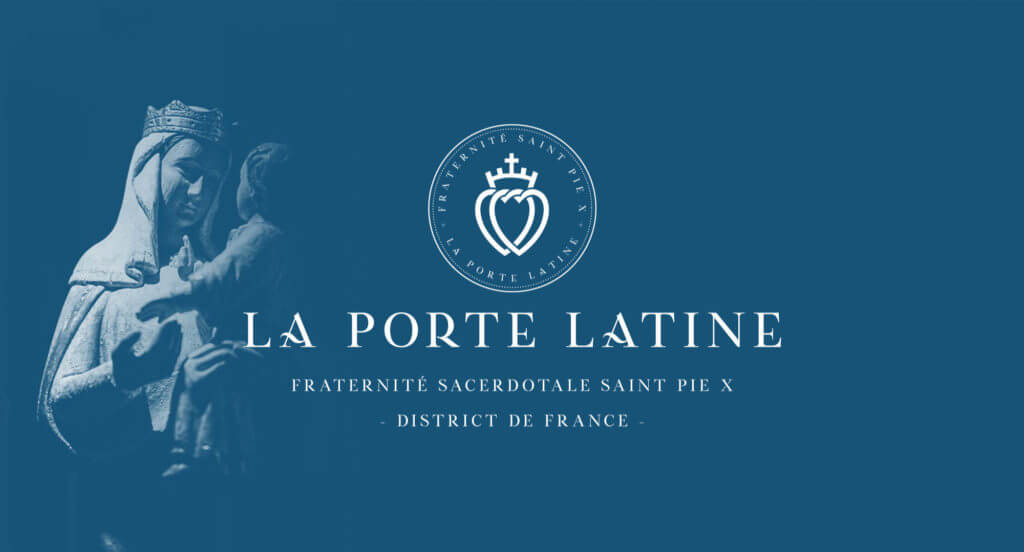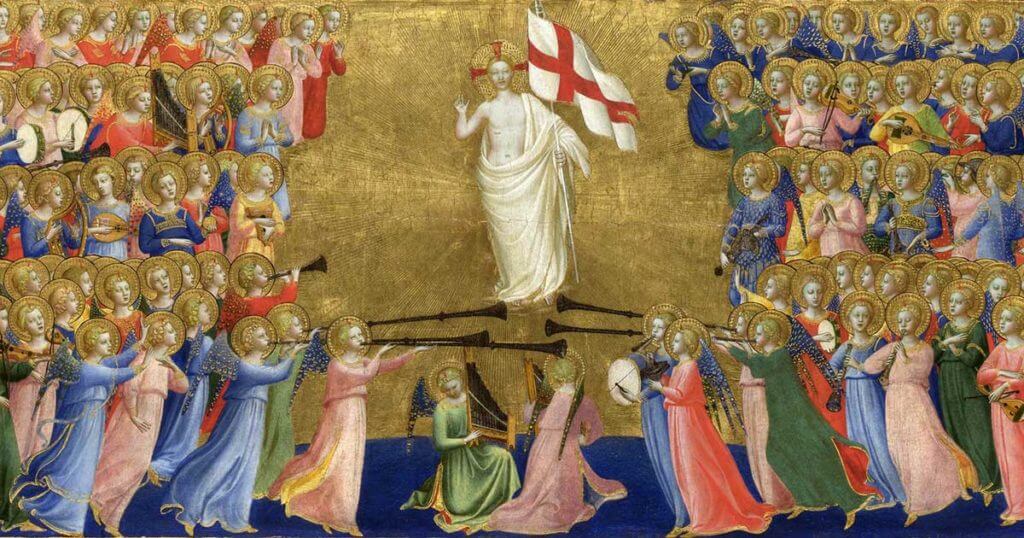Dans deux Encycliques, le Pape François est allé puiser son inspiration ailleurs que dans les sources de la Révélation divine, ailleurs que dans les monuments de la Tradition catholique. Il a trouvé son inspiration auprès d’un schismatique, pour Laudato si ́, et auprès d’un infidèle, pour Fratelli Tutti.
A cinq ans d’intervalles, le Pape François vient de publier deux Lettres Encycliques, dont on peut dire qu’elles se veulent décisives pour l’orientation que prend désormais la doctrine officielle dans l’Eglise depuis Vatican II. Et cette orientation est mise à chaque fois par le Pape lui-même sous le patronage de saint François d’Assise. Le 24 mai 2015, avec Laudato Si, le Pape faisait déjà une référence explicite au Cantique des créatures : « Dans ce beau cantique », écrivait-il, « [le saint d’Assise] nous rappelait que notre maison commune est aussi comme une sœur, avec laquelle nous partageons l’existence, et comme une mère, belle, qui nous accueille à bras ouverts »[1] . Le 3 octobre 2020, avec Fratelli Tutti, le Pape fait référence au texte de la Règle des frères mineurs : « Fratelli Tutti écrivait saint François d’Assise, en s’adressant à tous ses frères et sœurs, pour leur proposer un mode de vie au goût de l’Évangile. Parmi ses conseils, je voudrais en souligner un par lequel il invite à un amour qui surmonte les barrières de la géographie et de l’espace »[2]
2. Cette référence à saint François d’Assise n’est pas anodine, car elle entend mettre en lumière le lien profond qui relie les deux Encycliques, dans la pensée du Pape. « Ce Saint de l’amour fraternel », est-il dit en effet au tout début de la récente Encyclique, « ce Saint de la simplicité et de la joie, qui m’a inspiré l’écriture de l’encyclique Laudato si ́, me pousse cette fois-ci à consacrer la présente nouvelle encyclique à la fraternité et à l’amitié sociale »[3] . L’inspiration est donc la même dans les deux cas, et au-delà d’une pieuse dédicace, le propos entend manifester un lien organique qui doit garder toute son importance. Ce lien profond apparaît dès le début de Fratelli Tutti, lorsque le Pape évoque le sens de la fraternité chez le Poverello : « En effet, saint François, qui se sentait frère du soleil, de la mer et du vent, se savait encore davantage uni à ceux qui étaient de sa propre chair »[4] . Le sens de la fraternité rejoint ici le sens de l’écologie : l’un et l’autre doivent se situer sur le même plan, et de l’un à l’autre il y a – du moins dans la pensée du Pape – une simple différence de degré, le sens de la fraternité étant seulement plus aigu que celui de l’écologie.
3. Un autre indice atteste la parenté profonde des deux Encycliques. Le Pape indique en effet plus loin quelles furent ses « sources d’inspiration » pour l’un et l’autre de ces deux textes. « Si pour la rédaction de Laudato si ́ », écrit-il, « j’ai trouvé une source d’inspiration chez mon frère Bartholomée, Patriarche orthodoxe qui a promu avec beaucoup de vigueur la sauvegarde de la création, dans ce cas-ci, je me suis particulièrement senti encouragé par le Grand Imam Ahmad Al-Tayyeb que j’ai rencontré à Abou Dhabi pour rappeler que Dieu a créé tous les êtres humains égaux en droits, en devoirs et en dignité, et les a appelés à coexister comme des frères entre eux » [5]. Dans les deux Encycliques, le Pape est allé puiser son inspiration ailleurs que dans les sources de la Révélation divine, ailleurs que dans les monuments de la Tradition catholique. Il a trouvé son inspiration auprès d’un schismatique, pour Laudato si ́, et auprès d’un infidèle, pour Fratelli Tutti.
4. L’idée centrale qui relie les deux Encycliques, et qui est attestée à travers ces deux indices, est de chercher « à vivre en harmonie avec tout le monde »[6], sans imposer des doctrines. Saint François en effet, aux dires du Pape, « ne faisait pas de guerre dialectique en imposant des doctrines, mais il communiquait l’amour de Dieu » et c’est ainsi qu’il a été « un père fécond qui a réveillé le rêve d’une société fraternelle »[7]. Ce rêve de la société fraternelle, qui veut réaliser l’harmonie de tous les êtres humains, prolonge le rêve écologique, qui veut réaliser l’harmonie de toutes les créatures. Et il s’agit dans les deux cas du rêve d’une union des volontés (ou de ce que la philosophie appelle l’union des tendances appétitives) dans le même amour, qui ne pourra se réaliser que si elle est affranchie de toute référence proprement doctrinale. Sur ce, nous pouvons observer deux choses.
5. Premièrement, nous retrouvons là le même genre d’ambition dont le rêve (puisqu’il s’agit d’un rêve) a été déjà condamné par le Pape Pie XI, dans l’Encyclique Mortalium animos du 6 janvier 1928. Contrairement à ce que prétend le Père Jean-Michel Garrigues [8], il n’est donc pas possible de recevoir cette Encyclique du Pape François en continuité avec le Magistère constant de l’Eglise catholique. En effet, dit Pie XI, vouloir fonder l’unité des volontés dans l’amour ou la fraternité, sans la faire reposer sur l’unité des intelligences dans la doctrine, cela revient à soutenir que les différentes religions signifient de façons diverses un même sentiment religieux naturel, qui en serait comme le dénominateur commun. Et cela revient à faire profession de naturalisme, c’est à dire à nier l’existence d’une religion divinement révélée, pour se contenter d’un état de nature pure. L’économie concrète du salut, telle qu’elle a été voulue par Dieu, ne consiste pas dans une religion naturelle inscrite au cœur de l’homme, mais dans une religion révélée, unique et définitive, dont l’organe authentique est l’Eglise catholique et elle seule, unique et définitive telle que Dieu l’a voulue : unique et définitive dans ses sacrements, unique et définitive dans son Magistère, garant de l’unité de doctrine et de foi.
6. Deuxièmement, qui dit fraternité dit filiation. De quelle filiation peut-il s’agir, dès lors que l’on prétend s’affranchir de l’unité de la foi catholique, qui est le tout premier fondement de la filiation de l’homme à l’égard de Dieu ? Le Père Garrigues nous donne la réponse : « On ne peut pas restreindre la filiation divine aux seuls baptisés. Comme le rappelle le concile Vatican II en une phrase que saint Jean Paul II a souvent reprise dans divers documents de son magistère : Par son Incarnation, le Fils de Dieu s’est en quelque sorte uni lui-même à tout homme » (citation de Gaudium et spes, n° 22) »[9]. La même constitution pastorale Gaudium et spes disait d’ailleurs déjà dès son n° 3 : « En proclamant la très noble vocation de l’homme et en affirmant qu’un germe divin est déposé en lui, ce saint Synode offre au genre humain la collaboration sincère de l’Eglise pour l’instauration d’une fraternité universelle qui réponde à cette vocation ». La fraternité universelle dont rêve à présent le Pape François trouverait sa justification dans la présence d’un « germe divin » déposé par Dieu en l’homme, en tout homme, baptisé ou non. Avant François, Jean-Paul II l’avait déjà dit, dans l’Encyclique Evangelium vitae du 25 mars 1995 : « En outre, l’homme et sa vie ne nous apparaissent pas seulement comme un des plus grands prodiges de la création ; Dieu a conféré à l’homme une dignité quasi divine (cf. Ps VIII, 6–7). En tout enfant qui naît et en tout homme qui vit ou qui meurt, nous reconnaissons l’image de la gloire de Dieu ; nous célébrons cette gloire en tout homme, signe du Dieu vivant, icône de Jésus Christ ». Plus exactement que la confusion de la nature et de la grâce, ce présupposé est ici, tel qu’il apparaît dans les textes de Gaudium et spes et de Jean-Paul II, celui de la négation de la gratuité de la grâce : la grâce, ou le fameux « germe divin » dont parle le Concile, est déposé en tout homme, baptisé ou non, du fait même que le Christ s’est incarné. La grâce accompagne donc nécessairement la nature, en tout homme. Elle n’est plus gratuite – et elle n’est plus la grâce : elle en devient précisément un « germe divin ». L’humanité possède ainsi un être commun de grâce, en même temps qu’un être commun de nature, un même germe divin, dans le Christ, et ce serait la raison pour laquelle tous les hommes seraient frères, fils du même Père du Christ.
7. L’établissement de cette fraternité rendrait en tout état de cause nécessaire une communauté mondiale, au sein de laquelle les différents peuples seraient assurés de vivre en conformité avec ce « germe divin » déposé en eux. « Une meilleure politique, mise au service du vrai bien commun », dit le Pape, « est nécessaire pour permettre le développement d’une communauté mondiale, capable de réaliser la fraternité à partir des peuples et des nations qui vivent l’amitié sociale »[10]. En parfaite cohérence avec le présupposé initial de Vatican II, et au nom du « germe divin », le Pape actuel se fait, dans cette Encyclique, l’ouvrier d’un mondialisme naturaliste.
Abbé Jean-Michel Gleize
Source : Courrier de Rome n°636
- Laudato Si, n° 1.[↩]
- Fratelli Tutti, n° 1.[↩]
- Fratelli Tutti, n° 2[↩]
- Fratelli Tutti, n° 2.[↩]
- Fratelli Tutti, n° 5[↩]
- Fratelli Tutti, n° 4.[↩]
- Fratelli Tutti, n° 4.[↩]
- Jean-Michel Garrigues, « Fratelli tutti : une Encyclique à recevoir en catholique cohérent », page du 17 octobre 2020 publiée sur le site « fr.aleteia.org » (https://fr.aleteia.org/2020/10/17/fratelli-tutti-une-encyclique-a-recevoir-en-ca-tholique-coheren/).[↩]
- Jean-Michel Garrigues, ibidem.[↩]
- Fratelli Tutti, n° 154.[↩]