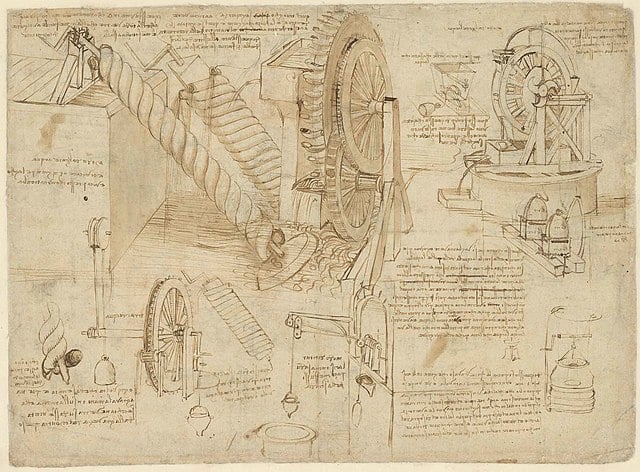Adoptée le 12 avril 2005 et promulguée dix jours plus tard, la loi dite Léonetti légifère sur les droits des malades et sur la fin de vie. Entre autres choses, elle évoque ces traitements qui, outre les bénéfices procurés, peuvent avoir pour effet indésirable d’abréger la vie.
« Si le médecin constate qu’il ne peut soulager la souffrance d’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qu’en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d’abréger sa vie, il doit en informer le malade… »
Loi Léonetti, 22 avril 2005, art. 2.
Une décennie plus tard, la loi Claeys-Leonetti revient à la charge en précisant la procédure à suivre en cas de traitement analgésique et sédatif ayant pour effet potentiel d’abréger la vie d’un patient en stade terminal :
« Le médecin met en place l’ensemble des traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou terminale, même s’ils peuvent avoir comme effet d’abréger la vie. Il doit en informer le malade, la personne de confiance, la famille ou, à défaut, un des proches du malade. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. »
Loi Claeys-Leonetti, 2 février 2016, art. 4.
D’aucuns ont cru voir dans ces dispositions législatives l’empreinte de saint Thomas d’Aquin et des règles du volontaire indirect. On peut en douter :
« Le principe thomiste de résolution des situations de double effet fait appel à (au moins) 3 conditions : la proportionnalité (rapport bénéfice/risque acceptable : la possibilité de soulager sans entraîner la mort est raisonnable), la non-conditionnalité de l’effet positif à la réalisation de l’effet négatif (l’obtention du soulagement n’est pas la conséquence obligatoire de la survenue de la mort) et l’intentionnalité (l’intention est d’obtenir l’effet positif —le soulagement— et pas l’effet négatif —la mort). […]
« La proposition de loi pose, elle, d’autres conditions pour autoriser la pratique d’un acte en situation de double effet : l’information du malade —ou de ses représentants— et l’inscription sur le dossier de la procédure suivie[1]. »
De fait, « si le principe du double effet s’est développé principalement dans le cadre de la théologie morale catholique, il n’est pas une doctrine religieuse mais un principe moral rationnellement justifié qui repose sur une solide théorie philosophique de l’acte humain[2] ». Le législateur français n’est d’ailleurs ni le premier ni le seul à s’en être inspiré.
1. Domaines d’application du principe du double effet
Élaborée par les moralistes catholiques, la distinction entre le volontaire direct — ce qui est voulu comme moyen ou comme fin — et le volontaire indirect — ce qui toléré à titre d’effet — a été invoquée par les pouvoirs séculiers dans trois domaines : le droit de la guerre, l’éthique médicale et la jurisprudence pénale.
1.1 Droit de la guerre
Le protocole additionnel I aux Conventions de Genève traite des attaques lancées au cours d’un conflit armé. Les règles qu’il formalise se réfèrent clairement, bien que de façon implicite, à la distinction entre volontaire direct et volontaire indirect.
Directement, « ni la population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne doivent être l’objet d’attaques. Sont interdits les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile[3] ».
Par ailleurs, des précautions doivent être prises pour réduire les dommages indirects infligés aux populations civiles lors d’une attaque lancée contre un objectif militaire :
« Ceux qui préparent ou décident une attaque doivent : […]
- prendre toutes les précautions pratiquement possibles quant au choix des moyens et méthodes d’attaque en vue d’éviter et, en tout cas, de réduire au minimum les pertes en vies humaines dans la population civile, les blessures aux personnes civiles et les dommages aux biens de caractère civil qui pourraient être causés incidemment ;
- s’abstenir de lancer une attaque dont on peut attendre qu’elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu[4]. »
D’où la différence fondamentale entre bombardement de terrorisation et le bombardement tactique :
« Lors d’un bombardement de terrorisation [terror bombing], le pilote déclenche une frappe ciblée sur un village très populeux afin de hâter l’issue favorable de la guerre en semant la terreur chez l’ennemi et en le démoralisant. En revanche, lors d’un bombardement tactique, le pilote procède à une frappe tactique sur une usine de munitions malgré les dommages prévisibles causés à une quantité équivalente de civils riverains (dommages qu’il s’efforce de réduire par des moyens raisonnables) en raison du bénéfice militaire lié à la destruction d’une usine d’armement et afin de hâter l’issue favorable de la guerre[5]. »
1.2 Éthique médicale
La mise en œuvre de la distinction entre volontaire direct et volontaire indirect est également commune dans le domaine médical :
« La doctrine du double effet pourrait être invoquée pour justifier toute décision médicale usuelle, comme prescrire un antibiotique pour traiter une infection urinaire nonobstant la réaction allergique qu’elle produit. […] De fait, cette logique s’applique à beaucoup (voire à la totalité) des décisions posées dans la pratique médicale quotidienne[6]. »
Aussi la Colombie compte-t-elle la cause à double effet parmi les principes éthiques propres aux questions de santé :
« Est éthiquement acceptable une action bonne ou indifférente en elle-même qui cause un effet bon et un effet mauvais si :
a) l’action en elle-même, c’est-à-dire indépendamment de ses circonstances, est bonne ou indifférente ;
b) l’intention porte sur l’effet bon ;
c) l’effet bon est au moins aussi immédiat que l’effet mauvais et ne résulte pas de l’effet mauvais ;
d) une raison urgente commande d’agir et le bien recherché est supérieur au mal toléré. Obtenir un bien moindre au prix d’un mal supérieur ne serait pas éthique ;
e) si l’effet bon pouvait résulter d’un autre moyen, l’obtenir par un moyen qui cause un effet mauvais ne serait pas éthique[7]. »
Cela dit, « la doctrine du double effet, rarement invoquée pour justifier les pratiques médicales usuelles, semble l’être massivement pour justifier la sédation palliative et les autres soins en fin de vie[8] ».
Plusieurs documents officiels viennent confirmer ce constat. D’abord le rapport de Lord Walton lors du débat sur l’euthanasie à la chambre des Lords en 1994 :
« Le jugement professionnel des personnels de santé peut s’exercer en autorisant l’administration de doses croissantes de médicaments (analgésiques ou sédatifs, ou les deux) pour procurer un certain soulagement, même si la vie en est abrégée. La question essentielle est ici celle du motif. S’il s’agit de soulager la souffrance et l’angoisse sans intention de tuer, nous considérons que cela est parfaitement acceptable en termes de pratique médicale comme du point de vue légal[9]. »
Ensuite, le Code d’éthique de l’association américaine des infirmières publié en 2001 :
« L’infirmière doit intervenir pour soulager la souffrance et les autres symptômes chez le patient en fin de vie, même si ses interventions présentent un risque de hâter la mort. Cependant, les infirmières ne sauraient agir dans la seule intention de mettre un terme à la vie du patient même si elles agissent par compassion, ainsi que par respect de l’autonomie du patient et de sa qualité de vie[10]. »
Enfin, le Code pénal du Queensland amendé en 2003 :
« Une personne n’est pas pénalement responsable lorsqu’elle procure des soins palliatifs à autrui si (a) elle le fait de bonne foi et mue par une diligence et une compétence raisonnables […] même si un effet accidentel de ces soins palliatifs a été de hâter la mort d’autrui. Cependant, rien dans cette section n’autorise, ne justifie ou n’excuse (a) ni un acte ou une omission ayant pour objet de tuer autrui, (b) ni l’aide procurée à autrui pour qu’il (ou elle) se tue[11]. »
1.3 Jurisprudence
Les discussions relatives à la fin de vie, aux soins palliatifs et au suicide assisté ont été l’occasion de plusieurs décisions judiciaires fondées sur la distinction entre volontaire direct et volontaire indirect.
Au Canada, Sue Rodriguez soutenait que l’article 241 (b) du Code criminel interdisant le suicide assisté était anticonstitutionnel. Dans sa réponse, la Cour Suprême a souligné que « la distinction établie ici est fondée sur l’intention — dans le cas des soins palliatifs, c’est l’intention d’atténuer la douleur qui a pour effet de précipiter la mort, alors que dans le cas de l’aide au suicide, l’intention est indubitablement de causer la mort. […] Les distinctions fondées sur l’intention sont importantes, et elles constituent en fait le fondement de notre droit criminel[12] ».
Aux États-Unis, des plaignants accusaient de discrimination la loi de New York qui interdit le suicide assisté tout en permettant certaines actions médicales — traitements palliatifs et cessation des traitements disproportionnés — dont résulte la mort du patient. Dans sa réponse, la Cour Suprême a confirmé la distinction établie par la loi en s’appuyant sur la différence entre causalité et intention :
« La loi prend depuis longtemps en compte l’intention ou le but de celui qui agit pour distinguer entre deux actions pouvant produire le même résultat. […] La loi distingue les actions posées “à cause” d’une certaine fin, des actions posées “malgré” leurs conséquences prévues mais non voulues[13]. »
2. Soins palliatifs, euthanasie et action à double effet
Le recours à la distinction entre volontaire direct et volontaire indirect lorsqu’il s’agit d’administrer des analgésiques et/ou de sédatifs n’est pas une nouveauté.
Dès la fin des années 50, Pie XII répondait aux inquiétudes morales des praticiens en distinguant ce qui est voulu directement —à titre de fin ou de moyen— et ce qui est voulu indirectement —au titre d’effet toléré :
« Si entre la narcose et l’abrègement de la vie n’existe aucun lien causal direct, posé par la volonté des intéressés ou par la nature des choses (ce qui serait le cas, si la suppression de la douleur ne pouvait être obtenue que par l’abrègement de la vie), et si au contraire l’administration de narcotiques entraîne par elle-même deux effets distincts, d’une part le soulagement des douleurs, et d’autre part l’abrègement de la vie, elle est licite ; encore faut-il voir s’il y a entre ces deux effets une proportion raisonnable, et si les avantages de l’un compensent les inconvénients de l’autre[14]. »
Le Catéchisme de l’Église catholique ne dit pas autre chose :
« L’usage des analgésiques pour alléger les souffrances du moribond, même au risque d’abréger ses jours, peut être moralement conforme à la dignité humaine si la mort n’est pas voulue, ni comme fin ni comme moyen, mais seulement prévue et tolérée comme inévitable. »
Catéchisme de l’Église catholique, 1992, n° 2279
Il est vrai que quelques chercheurs jugent cette distinction inutile en matière de sédation terminale. A les écouter, rien ne prouve que la sédation terminale accélère la mort du patient[15]). Plusieurs études scientifiques semblent même prouver le contraire[16].
En réalité, les choses sont moins simples qu’il n’y paraît :
« Les auteurs des différents articles eux-mêmes émett[e]nt des réserves sur leurs travaux, tant en termes de méthode que d’interprétation des résultats […]. Nous pensons pour notre part qu’il n’est pas possible à la lumière des données publiées jusqu’à présent de conclure quant au possible effet de la sédation sur la survie des patients. […] L’absence de preuve d’un effet de la sédation sur la survie ne constitue pas selon nous une preuve de l’absence d’effet de la sédation sur la survie.
« Sera-t-il possible d’obtenir à l’avenir une réponse définitive à la question de la survie des patients sous sédation ? Nous ne le pensons pas. En effet, la seule façon de conclure sur la question de l’effet de la sédation sur la survie des patients serait de mener une étude randomisée en double aveugle comparant la survie des patients chez qui une indication de la sédation est posée selon qu’ils reçoivent le médicament choisi pour la sédation ou un placebo. Inutile d’écrire qu’un large consensus existe pour affirmer que ce type d’étude est éthiquement inenvisageable[17]. »
Quoiqu’il en soit, la distinction entre volontaire direct et volontaire indirect reste pédagogiquement adaptée pour illustrer la différence morale entre ce qui est licite et ce qui est illicite en matière d’analgésie ou de sédation terminales :
« De nos jours, une des applications majeures du principe du double effet est le débat relatif à la régulation juridique de l’euthanasie. Le principe permet de distinguer l’euthanasie volontaire et le suicide médicalement assisté des actes tels que la sédation terminale ou les traitements palliatifs de la douleur dont résulte une diminution de l’espérance de vie. Ces actions, bien qu’extérieurement semblables aux premières, en diffèrent significativement quant à l’évaluation morale et juridique. L’action euthanasique (ou le suicide médicalement assisté) ont précisément pour objet de tuer le patient afin qu’il ne souffre plus. Autrement dit, la mort est voulue comme moyen de soulager la souffrance. Par contre, les deux autres actions ne se proposent pas d’ôter la vie au patient, mais seulement de soulager sa souffrance. C’est pourquoi, même si l’agent prévoit que la mort du patient pourrait être accélérée ou le sera effectivement à titre d’effet collatéral, sa disposition à l’égard de la vie humaine est tout à fait différente[18]. »
3. Une mise en œuvre délicate dans l’ordre juridique
L’intérêt des instances législatives, judiciaires et médicales pour la distinction entre volontaire direct et volontaire indirect n’est pas sans poser quelques difficultés.
Chaque science possède en effet un objet et une démarche propres. Si la morale envisage l’acte humain premièrement dans sa racine —la volonté libre de celui qui agit— et ensuite dans ses conséquences externes, juristes et législateurs abordent l’agir humain d’abord dans sa manifestation extérieure avant d’en inférer —si les éléments disponibles le permettent— l’intention qui a présidé à l’action.
Dans l’ordre juridique, seul l’acte externe peut être perçu, mesuré et jugé :
« Qu’il soit partisan de l’euthanasie ou qu’il soit mu par la haine, le médecin qui se complait dans la mort du malade a certes une volonté mauvaise, mais il agit correctement au regard du droit car de internis non iudicat prætor[19]. »
Ce qui est fondamental du point de vue moral est souvent hors d’atteinte du point de vue juridique :
« Ce qui meut l’agent est évidemment essentiel pour juger de la licéité de sa conduite. Mais l’importance primordiale de l’intention, qui caractérise l’ordre moral, s’amenuise en quelque sorte lorsqu’il s’agit d’une analyse juridique[20]. »
« Au final, il faut noter que l’analyse des intentions secondaires ne revêt pas la même importance en morale et en droit. […] La loi humaine n’a pas vocation à réprimer tous les actes mauvais. Que l’acte extérieur ne soit pas injuste suffit au droit. Aussi, lorsqu’une femme enceinte se soumet à une chimiothérapie pour stopper le cancer mais veut également la mort de l’enfant car sa grossesse n’était pas désirée, le droit doit considérer son action comme juste et ne pas la punir pour avortement, même si la morale réprouve le désordre de la volonté de la mère[21]. »
Est-ce à dire que la motivation interne échappe systématiquement au jugement externe ? Non, car certains indices la manifestent parfois au grand jour :
« Un signe clair de la rectitude d’intention de l’agent —qui ne porte alors que sur l’effet bon— est qu’il prend des mesures pour éviter l’effet mauvais ou pour réduire l’effet collatéral dommageable. Inversement, un signe clair que l’agent veut également l’effet mauvais est qu’ayant l’opportunité d’obtenir l’effet bon grâce à une action dépourvue d’effet mauvais, son choix se porte sur une action qui produise un tel effet[22]. »
S’agissant de la sédation terminale, certaines circonstances sont révélatrices du vouloir profond :
« Encore que dans certains cas la distinction entre les deux types d’action soit difficile, il ne faudrait pas en déduire qu’elle dépende exclusivement de la connaissance de l’intention insondable de l’agent. Il existe de nombreux facteurs qui permettent de les différencier. Par exemple, le type de médicament ou de narcotique utilisé ou les doses administrées sont des facteurs à prendre en compte. Si on utilise un médicament privé de vertus palliatives, c’est la preuve évidente que l’intention est homicide. Si la drogue utilisée sert pour soulager la douleur, il faudra alors confronter la dose administrée avec l’historique clinique du patient et de ses réactions antérieures au traitement. Il pourrait également s’avérer utile dans ce cas précis de relever l’ordre chronologique entre les effets. Si le soulagement de la douleur précède la mort, il y a moins de raison de penser que celle-ci a été un moyen pour celle-là que si la mort se produit immédiatement ou instantanément[23]. »
Outre le but que se propose l’agent, il faut également examiner de près les raisons proportionnellement graves qui autorisent à tolérer le mal. De fait, « les agents rationnels ont un devoir général d’éviter le mal pour eux-mêmes et pour autrui. En conséquence, s’ils le font sciemment, ce ne peut être sans un bon motif. C’est pourquoi, la deuxième condition du principe [de l’acte double] exige une raison proportionnellement grave pour poser l’acte et accepter, permettre ou tolérer l’effet mauvais. Du texte de saint Thomas sur la légitime défense, il ressort que l’accomplissement d’une action à double effet suppose une double proportionnalité : (i) une proportion entre l’action et sa fin, et (ii) une proportion entre l’effet bon et l’effet mauvais[24] ».
Pour mesurer la proportion de l’action à sa fin, il faut s’assurer que « l’action qui produit l’effet mauvais est nécessaire pour obtenir l’effet bon. Cela signifie qu’il n’existe aucun autre moyen d’y parvenir à moindre coût. S’il existait un autre type d’action permettant d’obtenir l’effet bon sans causer l’effet mauvais ou causant un effet mauvais moins grave, il faudrait le choisir. La possibilité de recourir à d’autres actions doit évidemment prendre en compte l’efficacité de chacune d’elles pour obtenir l’effet bon[25]».
Pour mesurer la proportion entre les deux effets, il faut que l’effet bon soit d’autant plus grand « que l’effet mauvais est (i) plus grave, (ii) plus prochain, (iii) plus certain et (iv) que l’obligation de l’empêcher est plus grande[26] ».
Conclusion
De prime abord, la référence au volontaire direct et au volontaire indirect dans l’ordre législatif, juridique ou éthique est plutôt une bonne nouvelle car elle signifie que les actes humains ne sont pas évalués à l’aune de leurs seuls effets :
« La doctrine du double effet est clairement un principe non-conséquentialiste. Elle affirme que les conséquences ne sont pas seules à déterminer le statut moral des actes comme licites ou illicites. En l’occurrence, qu’un dommage soit voulu ou seulement prévu peut constituer un critère crucial pour évaluer le statut moral d’un acte[27]. »
Mais, d’un autre côté, les règles formalisées par la tradition scolastique ne pouvant pas être intégralement mise en œuvre dans le cadre juridique, la distinction entre volontaire direct et volontaire indirect y perd de sa rigueur et de sa clarté.
Une lecture attentive des deux textes législatifs mentionnés en introduction le confirme à satiété. Le législateur n’entend pas se référer à saint Thomas d’Aquin et aux règles du volontaire indirect formalisée par les moralistes catholiques, mais il prétend harmoniser les actions à double effet avec le principe d’autonomie[28]. Pour ce faire, il faut et il suffit que le malade —ou de ses représentants— soit informé des effets secondaires potentiellement néfastes des sédatifs et/ou des analgésiques et que cela soit inscrit sur le dossier du patient. On retrouve là cette liberté individuelle qui, alpha de la vie morale, a fini par en devenir l’oméga[29].
Source : Cahiers Saint Raphaël n° 152, septembre 2023.
- Dr Bernard Devalois, « Lecture commentée de la loi relative aux droits des malades et à la fin de vie », Bulletin de la SFAP [Société française d’accompagnement et de soins palliatifs], n°48, juin 2005, Supplément, p. XI.[↩]
- Alejandro Miranda Montecinos, « El principio del doble efecto y su relevancia en el razonamiento juridico », dans Revista Chilena de Derecho, vol. 35, n° 3, p. 507.[↩]
- Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977, art. 51.2.[↩]
- Ibid., art. 57.3.[↩]
- William J. FitzPatrick, « The Doctrine of Double Effect : Intention and Permissibility », dans Philosophy Compass, vol. 7, n° 3, 2012, p. 183.[↩]
- Hannah Faris et alii, « Goods, causes and intentions : problems with applying the doctrine of double effect to palliative sedation », dans BMC Medical Ethics, 2021, n° 22, p. 141.[↩]
- Ley 1164 sur le facteur humain en matière de santé, Colombie, 3 octobre 2007, art. 35 : De los principios Eticos y Bioéticos.[↩]
- Hannah Faris et alii, « Goods, causes and intentions… », n° 22.[↩]
- Lord Walton, Medical Ethics : Select Committee Report, 9 mai 1994, n° 242.[↩]
- American Nurses Association, Code of Ethics for nurses with interpretive statements, 2001, n° 1.3.[↩]
- Criminal Code Act du Queensland, 1889, section 282A (modifiée en 2003).[↩]
- Cours Suprême du Canada, Décision Rodriguez c. British Columbia, 30 septembre 1993.[↩]
- Cours Suprême des États-Unis, Décision Vacco c. Quill, 26 juin 1997.[↩]
- Pie XII, Discours à des médecins sur les problèmes moraux de l’analgésie, 24 février 1957.[↩]
- « L’application de la doctrine à la sédation palliative semble reposer sur le présupposé que la sédation palliative accélère la mort. Or les éléments disponibles suggèrent que ni l’analgésie ni la sédation ne hâte la mort. » (Hannah Faris et alii, « Goods, causes and intention… », p. 141[↩]
- Takla A., Savulescu J., Wilkinson D.J.C., Pandit J.J., « General anaesthesia in end-of-life care : extending the indications for anaesthesia beyond surgery », dans Anaesthesia, October 2021, Vol. 76, n°10, p. 1308–1315 ; Sykes N., Thorns A., « The use of opioids and sedatives at the end of life », dans Lancet Oncology, May 2003, Vol. 4, n° 5, p. 312–318 ; Maltoni M., Pittureri C., Scarpi E., Piccinini L., Martini F., Turci P., et al., « Palliative sedation therapy does not hasten death : results from a prospective multicenter study », dans Annals of Oncology, July 2009, vol. 20, n° 7, p. 1163–1169 ; Maeda I., Morita T., Yamaguchi T., Inoue S., Ikenaga M., Matsumoto Y., et al., « Effect of continuous deep sedation on survival in patients with advanced cancer (J‑Proval): a propensity score-weighted analysis of a prospective cohort study », dans Lancet Oncolology, January 2016, vol. 17, n° 1, p. 115–122.[↩]
- Benoît F. Leheu, « Sédation pour détresse en phase terminale et survie des patients. Réflexions éthiques » dans Jusqu’à la mort accompagner la vie, Presses Universitaires de Grenoble, 2012/4, n° 111, p. 50.[↩]
- Alejandro Miranda Montecinos, « El principio del doble efecto… », p. 508–509.[↩]
- Alejandro Miranda Montecinos, « Eutanasia, suicidio asistido y principio del doble efecto. Réplica al profesor Rodolfo Figueroa », dans Revista médica de Chile, vol. 140, n°2, Febrero 2012, p. 263.[↩]
- M.M. Ossandon Widow, « La intención de dar muerte al feto y la relevancia para la imputación objetiva y subjetiva en el delito de aborto », dans Revista de Derecho – Universidad Católica del Norte, Année 18, n° 2 2011, p. 119.[↩]
- Alejandro Miranda Montecinos, « El principio del doble efecto… », p. 503–504.[↩]
- Ibid., p. 503.[↩]
- Ibid., p. 509.[↩]
- Ibid., p. 504.[↩]
- Ibid.[↩]
- Ibid., p. 505.[↩]
- William J. FitzPatrick, « The Doctrine of Double Effect… », p. 184–185.[↩]
- Le principe d’autonomie reconnaît à chacun la faculté d’avoir des opinions, de faire des choix et d’agir par soi-même en fonction de ses propres valeurs et croyances.[↩]
- Cf. Abbé François Knittel, « La liberté, alpha ou oméga ? », dans Cahiers de Saint-Raphaël, n° 146, juin 2022, p. 44–50.[↩]