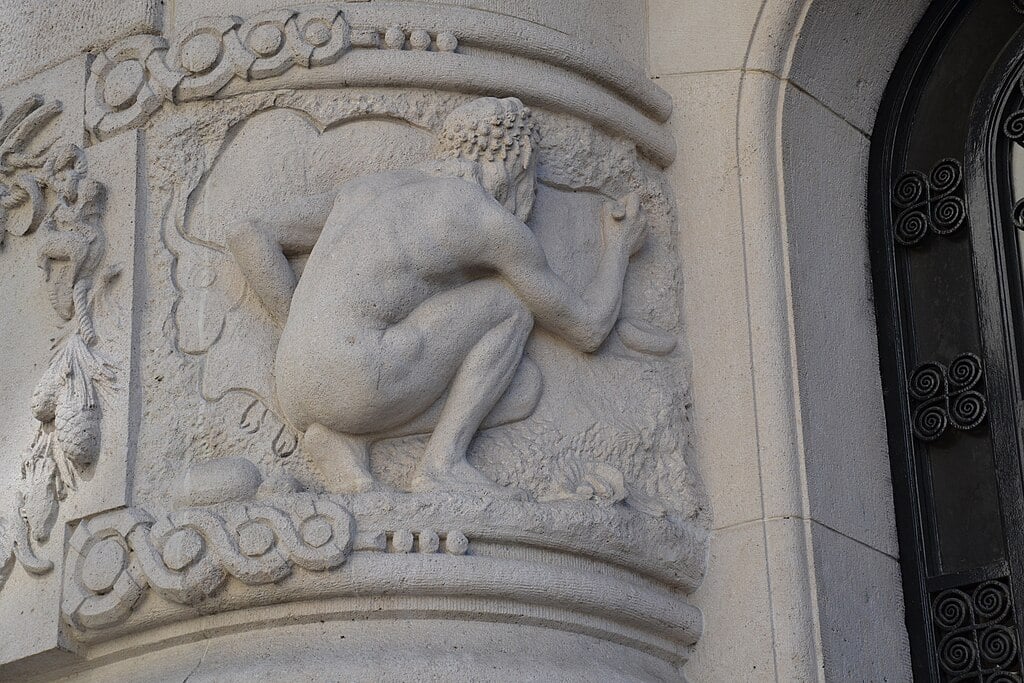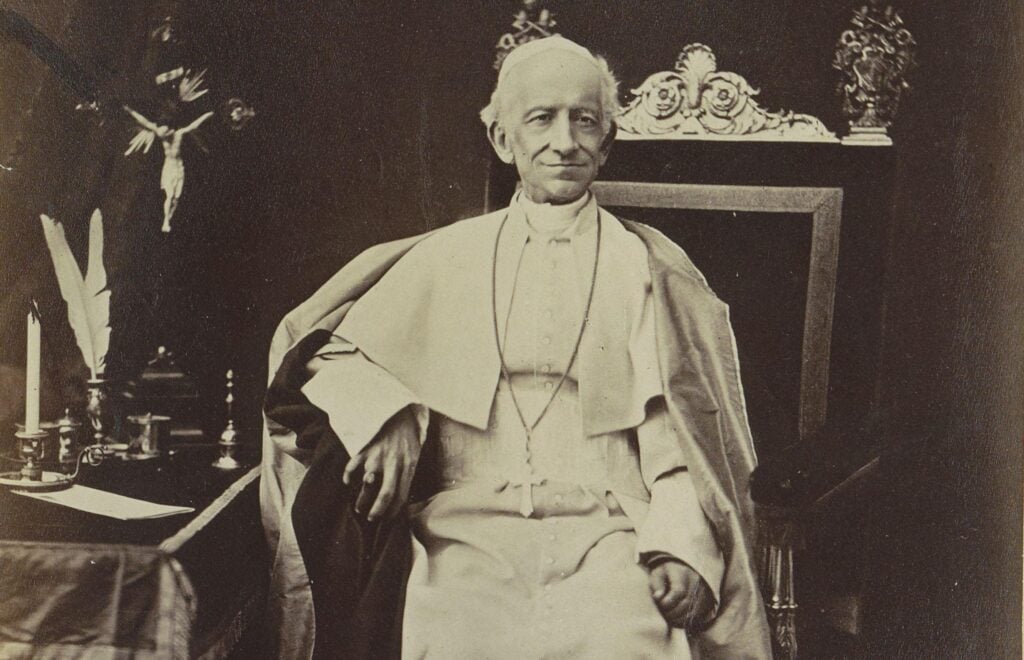Faut-il obéir Perinde ac cadaver, comme un cadavre ?
Lors du Procès de l’Ordinaire de Nevers, préparatoire à la béatification de sainte Bernadette Soubirous, une sœur raconta que la sainte, déjà malade et soignée dans l’infirmerie de son couvent de Nevers, s’était un jour vu interdire par la supérieure générale de venir à la messe le lendemain dimanche. La supérieure voulait épargner de la fatigue à la malade. Bernadette, en religion Sœur Marie-Bernard, s’y rendit tout de même ; il lui suffisait de se lever et traverser le couloir pour se retrouver à la tribune de la chapelle. La supérieure l’ayant vue lui fit de vifs reproches, devant lesquels la sœur s’humilia. Après quoi, elle dit : « Que voulez-vous ! j’ai satisfait au précepte[1]. »
Dans les Notes des Carmélites de Lisieux, préparatoires au Procès apostolique, Mère Agnès de Jésus, sœur de sang de sainte Thérèse de Lisieux (sa sœur Pauline), raconta le fait suivant : le père franciscain Alexis Prou vint prêcher la retraite de communauté du Carmel de Lisieux. Sa prédication et ses conseils privés firent beaucoup de bien à sœur Thérèse de l’Enfant-Jésus. Mère Marie de Gonzague, prieure, interdit cependant à la sœur de retourner le voir. Pourtant, à la fin de la retraite, elle vint se confesser à lui comme c’était la coutume. Cela se passa pendant le repas de 11h, et son absence fut remarquée de la prieure, qui fit part de sa colère à Mère Agnès de Jésus. « Celle-ci prit sur elle d’aller frapper à la porte du confessionnal. Thérèse sortit. « Elle me répondit avec calme et d’un ton résolu : « Non, je ne sortirai pas, le bon Dieu veut que je sois ici en ce moment, je dois profiter de ses grâces et de ses lumières. Je supporterai ensuite toutes les peines qu’il enverra. » Et elle rentra au confessionnal. Ce que j’avais prévu arriva[2]… » »
Dans l’un et l’autre cas, nous voyons une sainte désobéir à un ordre de sa supérieure. Ni l’une ni l’autre n’a cru peccamineux de réfléchir à la légitimité de l’ordre donné. Ni l’une ni l’autre n’a pensé devoir demander la permission d’y voir un abus de pouvoir, qui devait céder devant un devoir plus impérieux : en l’occurrence le précepte dominical dont la supérieure religieuse n’a pas le pouvoir de dispenser, et la règle de la liberté de se confier au confesseur, conséquence de la distinction des fors. Ni l’une ni l’autre n’a été tenue par l’autorité de l’Eglise pour une révoltée, une anarchiste, une protestante adepte du libre examen, etc. Au contraire les minutieux procès ecclésiastique ont conclu dans l’un et l’autre cas à l’héroïcité dans les vertus. Mais leur vertu héroïque leur a aussi fait accepter avec patience les pénitences injustes qui leur ont été infligées.
Dans le contexte de futures consécrations épiscopales dans la Fraternité Saint Pie X, avec ou sans mandat pontifical, alors que les argumentaires d’il y a presque 40 ans ressortent[3], des esprits chagrins se jetteront avec gourmandise sur de telles réflexions pour y voir un éloge de la désobéissance, à ajouter au lourd dossier de la Fraternité, à côté de l’excommunicationis laetitia…
Nous n’avons pas l’intention de couvrir toute la question, mais seulement de donner à réfléchir sur les exigences de l’obéissance. Cette vertu est nécessaire pour assurer le bien commun d’une société, elle permet en outre pour le chrétien de vivre en imitant Jésus-Christ, et de participer ainsi à l’œuvre divine de la Rédemption. Elle constitue un sacrifice de la volonté, le plus coûteux.
Pour autant, l’obéissance à un homme n’exige pas ordinairement la soumission selon le « mouvement intérieur de la volonté[4]», ce qui signifie qu’on peut estimer l’ordre donné moins judicieux[5], voire désastreux. Elle n’impose pas non plus, dans la soumission extérieure due au supérieur, de violer le précepte d’une autorité plus grande.
Il est étonnant qu’on puisse parler de la situation canonique de la Fraternité Saint-Pie X sans jamais mentionner la crise de l’Église, qui est sa seule explication : la motivation de ces ordinations interdites est de donner aux fidèles un cadre pour mener leur vie chrétienne traditionnelle de manière intégrale, et non seulement dans la mesquine parcimonie d’une messe pas toujours dominicale. Laissons le dernier mot au code de droit canonique promulgué par Jean-Paul II en 1983, qui se clôt sur cette parole : «(…) sans perdre de vue le salut des âmes qui doit toujours être dans l’Église la loi suprême ».
- R. Laurentin, Sr. M.-Th. Bourgeade, Logia de Bernadette – étude critique de ses paroles de 1866 à 1879, Apostolat des Editions et Lethielleux, Paris, Œuvre de la Grotte, Lourdes, 1971, t.3, n°705 p.101.[↩]
- Cité par Guy Gaucher, Thérèse de Lisieux (1873–1897), Cerf, 2010, p.347.[↩]
- A peu près inchangés, cf. La Nef, n°378, mars 2025. A ceci près que, contrairement au discours des années 1990 (et actuel dans certains media qui précisent complaisamment les nuances à gauche, mais bien peu à droite), il n’y est question que de schisme « non encore pleinement consommé », p.18.[↩]
- IIa IIae q.104 a.5.[↩]
- Cf. par exemple Henry Donneaud op, Les enjeux théologiques de l’obéissance dans la vie consacrée, in Vie consacrée, n°88 (2016/4), pp.33–42.[↩]