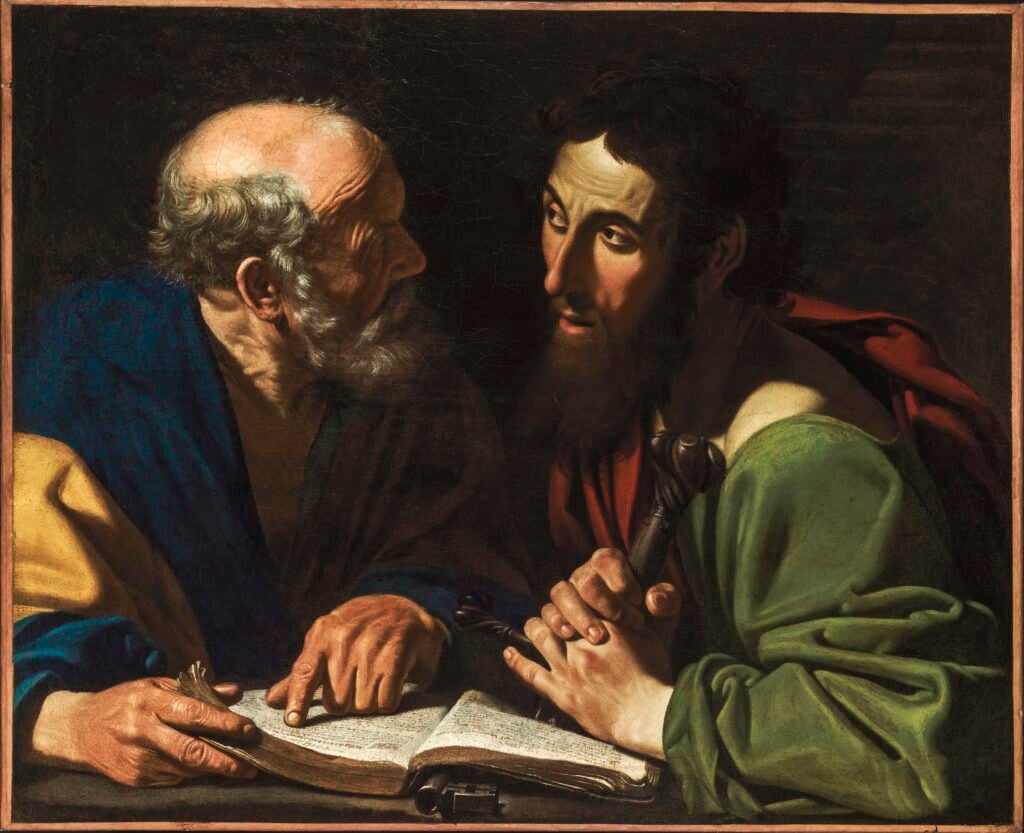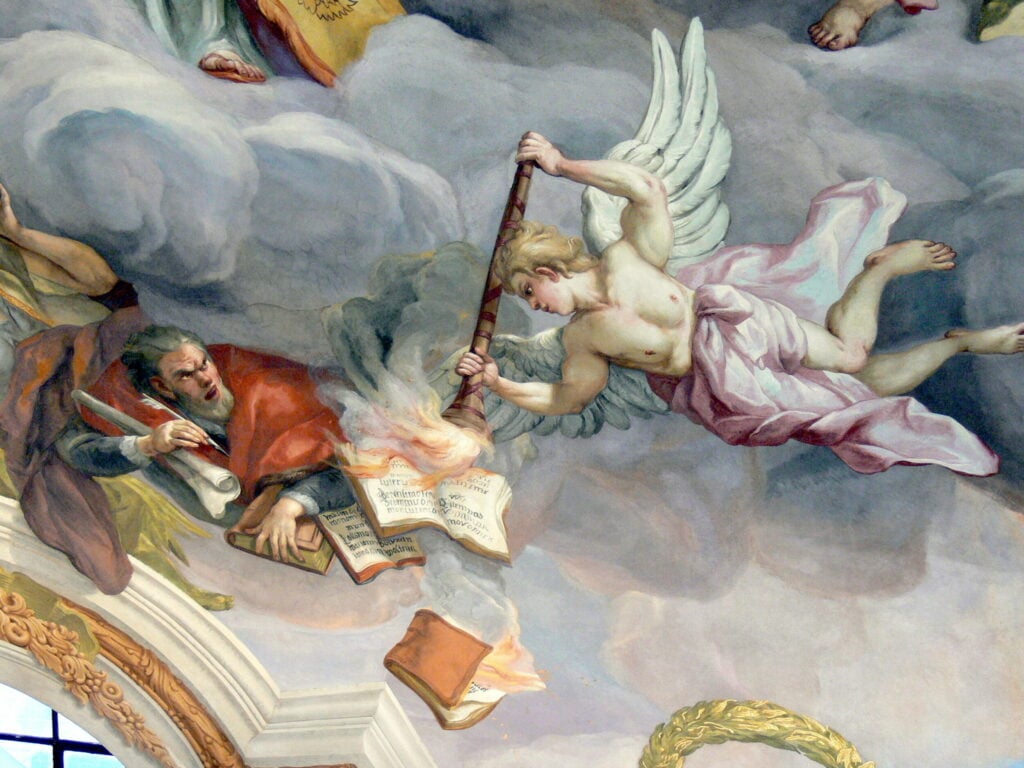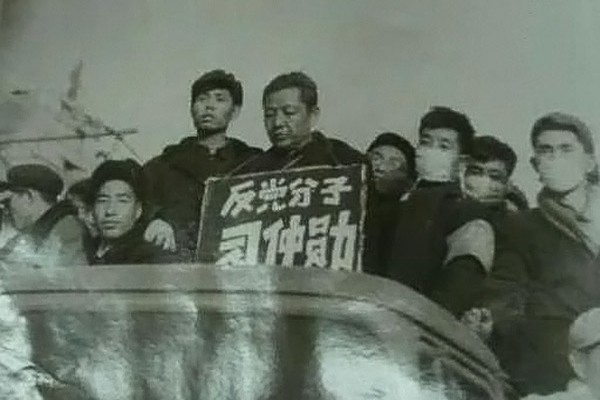Certaines polémiques contre la Fraternité Saint-Pie X se discréditent par leur simplisme.
Image : Voltaire par Houdon
A lire certaines critiques contre la Fraternité Saint-Pie X, surtout du côté sédévacantiste, on peut résumer l’argument ainsi : tout acte doctrinal d’un pape est du Magistère. Or tout acte du Magistère est infaillible. L’infaillibilité du Magistère requiert l’assentiment de foi divine, sous peine d’hérésie. Donc si un occupant du Siège de Pierre affirme quelque chose de faux, il n’est pas infaillible (et donc pas pape), et défendre sa légitimité revient à soutenir son hérésie.
Depuis le début des démêlés de Mgr Lefebvre avec Rome, l’attitude de la Fraternité dans l’Eglise associe une reconnaissance de la légitimité de l’autorité des papes à une contestation doctrinale de leurs décisions. D’où la sévère critique sédévacantiste.
Tout ce raisonnement a le mérite de la clarté et de la simplicité. C’est son seul mérite, parce qu’une telle simplicité est factice.
Lors de la discussion de l’infaillibilité pontificale au premier concile du Vatican, on souleva diverses difficultés historiques[1]. A cette occasion, la Députation de la Foi (la Commission conciliaire chargée des questions doctrinales) rappela les règles à suivre dans l’examen des questions historiques :
- « Quant au sujet qui pose l’acte, il faut se demander si le Pontife Romain a vraiment parlé en tant que Docteur universel et Pasteur Suprême en vertu de son autorité apostolique, ou s’il a plutôt parlé comme personne privée ou docteur particulier.
- Quant à l’objet, si la matière sur laquelle porte le jugement du Pontife Romain est affaire de foi et de mœurs, concernant l’Eglise universelle, ou si c’est une question de fait particulier ou de discipline et de droit partiel et local […[2]].
- Quant à la forme ou au mode de promulgation du jugement, il faut se demander si le décret du Pontife Romain a été conçu pour apparaître comme une vraie et propre définition, ou une sentence portée de manière définitive, et non comme une réponse de circonstance ou une disposition provisoire.
- A quoi il faut ajouter que c’est un principe reçu dans toutes les sciences, et à plus forte raison dans les causes de foi divine, que si une thèse est reçue en raison des principes mêmes de la science, il suffit d’une réponse probable ou d’une raison grave pour valider sa conciliation avec les difficultés ou hypothèses contraires[3]. »
Ces précisions techniques sur la méthode d’étude requise pour prendre les importantes décisions de Vatican I montrent que les décisions romaines problématiques demandent une interprétation, et que l’autorité des actes pontificaux admet des distinctions. Le raisonnement sommaire que nous avons rappelé plus haut est séduisant mais trompeur parce qu’il ignore :
- Que tout acte doctrinal accompli par une personne qui se trouve être le pape n’est pas à prendre comme du Magistère : le pape peut parler comme docteur privé.
- Que tout acte du Magistère, c’est-à-dire toute affirmation d’ordre doctrinal n’est pas une définition dogmatique. Il y a des enseignements communs, des considérants des décisions, des réponses de circonstances. Et aussi, possiblement, des à‑peu-près et des maladresses, voire des textes de compromis.
Il revient aux théologiens de préciser ces distinctions que les papes auxquels les sédévacantistes recourent ne se donnent pas toujours la peine de faire.
Seulement l’esprit contemporain veut aller vite. Aujourd’hui plus d’un journaliste, pour piéger son invité, pose innocemment des « petites questions toute simples » qui demanderaient des développements nuancés et circonstanciés. La victime n’aura de toute façon pas le temps de les donner avant de se faire interrompre par une autre « petite question toute simple ». Un personnage public contemporain s’est récemment contenté de répondre : « S’agit-il d’un talk show, ou pouvons-nous parler sérieusement ? »
Celui qui veut aborder la crise de l’Eglise « sérieusement » devra renoncer à envisager une situation simple. Comme le disait Voltaire : « Je suis clair comme les ruisseaux, parce que je suis peu profond[4]. »
- Les cas du pape Libère, qui excommunia saint Athanase en 357, d’Anastase II accusé d’avoir soutenu l’hérésie monophysite, celui de Vigile accusé d’avoir désavoué le Concile de Chalcédoine, enfin celui d’Honorius Ier accusé d’avoir soutenu l’hérésie monothélite.[↩]
- Le texte cite une lettre de saint Nicolas Ier à l’Empereur Michel en 865, qui remarque qu’une décision du Siège apostolique peut être améliorée , ou faire l’objet d’une dispense.[↩]
- Acta et decreta Sacrosancti Œcumenici Concilii Vaticani, Collectio lacensis, t.7, col.288, traduction nôtre.[↩]
- Texte exact : « Vous trouvez que je m’explique assez clairement ; je suis comme les petits ruisseaux : ils sont transparents parce qu’ils sont peu profonds. » Œuvres complètes, t.34, Garnier, 1880, p.280.[↩]