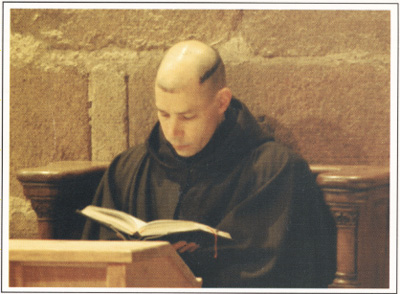|
Sauf avis contraire, les articles ou conférences qui n’émanent pas des
membres de la FSSPX ne peuvent être considérés comme reflétant la position officielle de la Fraternité Saint-Pie X |
Le Père Giovanni Scalese appartient à l’ordre des Clercs réguliers de Saint-Paul. Il a fait sa licence de théologie à l’Université Grégorienne Pontificale. Il a enseigné la Religion, l’Histoire et la Philosophie à Florence et à Bologne. Il est actuellement missionnaire en Asie. (voir ).
Dans ce très long article , il s’interroge pour commencer sur l’opportunité du Concile.
Etait-il vraiment nécessaire ? A‑t’il servi à quelque chose d’autre que le résultat qui est sous les yeux de chacun, à savoir des Eglises vides, surtout là où l’esprit a prévalu sur la lettre.
Il constate que ce qui au départ était un Concile pastoral,( donc, selon lui, contingent, c’est-à-dire « lié aux conditions de l’Église et du monde du temps dans lequel il s’est déroulé ») est devenu « plus contraignant qu’un concile dogmatique ».
La raison de cela ? Ce qu’il nomme, donc, « l’esprit du Concile », imposé par l’aile progressiste, qui s’est substitué à sa « lettre », c’est-à-dire des documents certes « fruits de compromis humains », mais peut-être réellement inspirés par l’Esprit, qui a empêché que l’irréparable ne soit accompli, et somme toute équilibrés ; cet esprit est devenu « comme un poison qui a pénétré l’Église dans toutes ses fibres. Si maintenant nous voulons assainir l’Église, nous ne devons pas annuler le Concile, mais le libérer du prétendu « esprit du Concile » ».
C’est ce qu’a voulu dire le Pape, dans son discours à la Curie Romaine du 22 décembre 2005.
Le concile et « l’esprit du concile » – Juin 2008
À plus de quarante ans de la conclusion du Vatican II (8 décembre 1965), et surtout après le désormais célèbre discours de Benoît XVI à la Curie Romaine (22 décembre 2005) et le motu Proprio « Summorum Pontificum » (7 Juillet 2007), il me semble qu’on peut considérer non seulement comme légitime, mais dans une certaine mesure naturel, de reconsidérer le Concile. Naturellement, les notes qui suivent n’ont aucune prétention à être définitives ; elles veulent seulement être une réflexion à haute voix, ouverte à n’importe quelle contribution ultérieure. La réflexion sera caractérisée par une extrême franchise, mais en même temps un profond attachement à l’Église. Pour des exigences de clarté, je diviserai le développement en quatre points : opportunité, valeur, interprétation et « esprit » du Concile.
1. L’opportunité du Concile
Jusqu’à il y a quelque temps j’étais fermement convaincu de l’utilité du Concile. Malgré les indéniables abus, je disais : « Il le fallait ». Ma conviction se basait sur l’expérience – directe (pour ce que peut valoir l’expérience d’un enfant) et indirecte (à travers les études et les témoignages de ceux qui étaient un peu plus vieux que moi) – de l’Église pré-conciliaire. Aujourd’hui, je dirais plutôt : « Il y avait le besoin d’un profond renouvellement de l’Église ». Le fait est qu’un tel renouvellement est encore nécessaire. Cela signifie que le renouvellement espéré n’a pas eu lieu. Donc, le Concile a échoué à atteindre son objectif. Le Concile, c’est vrai, a promu toute une série de réformes : parfois, selon les cas, profitables, opportunes ou nécessaires ; d’autres fois inutiles, sinon nuisibles (pensons à la bureaucratisation de l’Église avec l’institution des divers synodes, des conseils pastoraux, des commissions, etc..). Mais ces réformes structurelles n’ont pas produit ipso facto le renouvellement de l’Église, qui reste un fait éminemment spirituel et exclusivement dépendant de la grâce de l’Esprit Saint et de notre conversion personnelle. Ce fut une pieuse illusion de penser qu’il suffisait d’un concile pour rénover l’Église. Au contraire, il semblerait que les effets du Concile aient été opposés à ceux espérés : la réforme liturgique a rendu les églises désertes ; le renouvellement des catéchèses a répandu l’ignorance religieuse ; la réforme de la formation sacerdotale a vidé les séminaires ; la modernisation de la vie religieuse met en danger l’existence de beaucoup d’instituts ; l’ouverture de l’Église au monde, au lieu de favoriser la conversion du monde, a signifié la « mondanisation » de l’Église elle-même. Il est vrai que nous devons considérer ces choses avec un certain détachement et avec un sens historique : l’Église a affronté dans le passé bien d’autres difficultés et elle les a toujours heureusement dépassées. C’est pourquoi, si nous croyons, il n’y a pas de quoi s’inquiéter tant que ça. Mais un fait est certain : nous attendions la « nouvelle Pentecôte », et il est venu la semaine sainte ; nous attendions le « printemps de l’Esprit », et sont arrivées les brouillards de l’automne.
Je dirais plus. Habituellement, on regarde le Concile (que ce soit du côté traditionaliste, ou du côté progressiste) comme un champignon sorti pendant la nuit. En oubliant qu’il se situe dans le sillage d’un chemin de réforme de l’Église en cours depuis déjà quelques décennies : pensons au mouvement liturgique, au renouvellement des études bibliques, au mouvement œcuménique, etc, qui étaient déjà en cours de longue date. Les Papes habituellement les plus admirés par les conservateurs (Pie X et Pie XII) ont été parmi les acteurs majeurs de ces mouvements. Pour faire un exemple, la réforme liturgique n’a pas commencé avec Vatican II, mais elle était déjà en cours depuis plusieurs années. Pie XII avait apporté des contributions considérables à cette réforme (pensons à la révision des rites de la semaine sainte). Certes, elle était à peine entamée et aurait dû se poursuivre. Mais cela rend une question inévitable : un concile était-il vraiment nécessaire pour continuer une réforme déjà notoirement entamée, graduellement réalisée et, ce qui compte le plus, partagée par tous ? Il me semble très significatif que personne parmi les traditionalistes n’a jamais soulevé d’objection sur le Missel réformé par le Bienheureux Jean XXIII, en 1962, qui pourtant se différencie de celui promulgué par Saint Pie V. On pourrait tenir le même discours sur la réévaluation de la Sainte Écriture dans la vie de l’Église ou sur la promotion du dialogue œcuménique. Donc, y avait-il vraiment besoin d’un concile ? Les réformes promues par Vatican II n’auraient-elles pas pu être réalisées (peut-être mieux, car conduites avec plus de prudence et mieux tenues sous contrôle) par le Siège Apostolique, comme cela s’était produit jusqu’alors ? Je ne peux pas encore donner une réponse définitive à ces questions ; mais, de ce que j’ai dit jusqu’à présent, ma propension à donner une répondue négative à la première question et affirmative à la deuxième paraît évidente.
Il me reste seulement une perplexité. Peut-être était-il opportun, sinon vraiment nécessaire, de convoquer le concile pour continuer le travail commencé avec Vatican I. N’oublions pas que ce Concile avait été interrompu ; à plusieurs reprises, on avait pensé de le reprendre, sans finalement en faire rien. À ce qu’il semble, Pie XII laissa le projet dans un tiroir, parce qu’il se rendait compte de ce qui aurait pu arriver à l’Église en convoquant le Concile. Il fallut la sainte inconscience de Jean XXIII pour reprendre ce projet et le faire se réaliser (même si ensuite, je ne sais pour quel motif, il préféra convoquer un nouveau Concile Vatican II, plutôt que reprendre Vatican I). En tout cas, il était évident à quiconque que l’œuvre de Vatican I était restée inachevée : sa « Constitution dogmatique sur l’Église du Christ » Pastor æternus avait traité du primat et de l’infaillibilité du Souverain Pontife Romain, mais il n’avait pas eu temps (peut-être providentiellement) de considérer les autres aspects du mystère de l’Epouse du Christ. Là encore, la réflexion sur l’Église avait continué dans les décennies suivantes (qu’on voie l’encyclique Mystici Corporis de Pie XII) et avait abouti à Vatican II, qui cherchait à donner une vision plus complète et équilibrée de l’Église par rapport à celle exagérément déséquilibrée du précédent Concile. A juste titre Paul VI, dans son discours du 21 novembre 1964 (celui dans lequel il proclama Marie « Mère de l’Église »), dit qu’avec la promulgation de Lumen gentium avait été « accomplie l’œuvre du Concile Oecuménique Vatican I ». Il faut dire d’autre part qu’une telle œuvre ne peut pas encore se dire entièrement épuisée : après Vatican II la réflexion sur l’Église a continué, donnant des fruits ultérieurs appréciables. Qu’on pense à ce qu’on nomme « ecclésiologie de communion », qui peut réellement constituer un changement radical dans la manière de penser la théologie sur l’Église, permettant à tous les aspects (même à ceux apparemment opposés comme collégialité et primauté, Églises particulières et Église universelle) de trouver leur place.
2. La valeur du Concile
Venons-en au second aspect, celui de la valeur du Concile.
Vatican II a été convoqué et s’est présenté lui-même comme « Concile pastoral ». Que je sache, c’était la première fois dans l’histoire de l’Église qu’était convoqué un Concile pastoral. Tout au plus, il y avait eu des conciles disciplinaires, qui, comme par hasard avaient tous connu de retentissants échecs (comme cela se produisit pour le Concile Latran V, qui peu avant le Concile de Trente avait tenté en vain de réformer l’Église de l’époque) ; mais des conciles pastoraux, jamais. Habituellement les conciles étaient convoqués pour définir la doctrine en laquelle croire ; cette fois par contre cela était exclu ex professo : « Le but principal de ce Concile n’est pas la discussion de tel ou tel thème de la doctrine fondamentale de l’Église… Pour cela, il n’y a pas besoin de Concile… Il est nécessaire que cette doctrine certaine et immuable, qui doit être fidèlement respectée, soit approfondie et présentée de sorte qu’elle réponde aux exigences de notre temps… On devra recourir à une manière de présenter les choses qui correspondent le mieux au magistère, dont le caractère prioritairement pastoral » (Jean XIII, Discours d’ouverture du Concile, 11 octobre 1962).
Donc, le problème n’était pas de définir la doctrine (puisque déjà définie), mais de trouver une nouvelle manière de la présenter. Objectif plus que légitime pour l’Église, qui n’a pas seulement le devoir de définir et garder la vérité, mais aussi celui de la répandre.
Mais on pourrait objecter encore une fois, en employant les paroles mêmes du Pontife : Pour cela, fallait-il un Concile ? Ne réalisait-on pas que, s’agissant non pas de questions doctrinales, mais seulement de stratégies pastorales, on courait le risque de faire un effort immense, destiné à être très vite dépassé par le cours des évènements ? Ne se rendait-on pas compte qu’en faisant ainsi, on donnait à ce Concile un caractère résolument contingent, lié au caractère transitoire de ce moment historique ? Personne ne peut ignorer que le monde d’aujourd’hui est totalement différent de celui d’il y a quarante ans. Pouvons-nous considérer comme encore actuel dans le monde d’aujourd’hui, marqué par le désenchantement, sinon le pessimisme et par le désespoir, la Constitution Gaudium et spes, avec son optimisme naïf ?
Ici aussi, cependant, une perplexité. Une perplexité qui jaillit d’une observation sur l’Église d’aujourd’hui. Si nous faisons une comparaison entre les différentes Églises locales, nous nous apercevons que le Concile a été appliqué par elles de manière assez différente. Eh bien, dans les pays où, plus que le Concile, on a appliqué (nous verrons plus loin la distinction) l”« esprit du Concile » (on pense à la France ou la Hollande), le résultat a été… le désert. On ne peut cependant pas dire que la situation est meilleure dans les pays, comme la Pologne ou l’Irlande, où le Concile a été appliqué sans beaucoup de conviction et seulement de manière formelle. Seulement dans des pays, comme l’Italie, où, parmi mille limites et contradictions, on s’est efforcé de promouvoir le renouvellement pastoral voulu par le Concile, l’Église continue à enregistrer une certaine vitalité. Donc, peut-être un Concile pastoral n’a t’il pas été entièrement inutile.
3. L’interprétation du Concile
Il me semble particulièrement important de définir avec clarté la valeur du Concile, parce que d’elle dépend son interprétation correcte. Opportun ou inopportun qu’il était, Concile il y a eu. C’est une donnée de fait. Même si ce fut une erreur, il me semble assez impensable qu’aujourd’hui on puisse l’ignorer ou même, comme certains traditionalistes le souhaiteraient, l’abroger.
Il ne reste qu’à l’interpréter correctement. C’est la position assumée par le Pape Benoît XVI dans le discours à la Curie Romaine du 22 décembre 2005, peu après son élection, à l’occasion du 40ème anniversaire de la conclusion de Vatican II. La position du Pape est claire : une « herméneutique de la réforme » en opposition à une « herméneutique de la discontinuité et de la rupture ». Le Concile doit être interprété à la lumière de la tradition ininterrompue de l’Église. Rien à redire à cela. A moins d’indiquer d’autres critères d’herméneutique.
Premier parmi tous, justement, la considération du caractère spécifique du Concile : si nous voulons interpréter correctement Vatican II, nous devons toujours nous rappeler qu’il s’agit, comme nous le disions, d’un Concile pastoral : cela signifie qu’il a un caractère contingent, lié aux conditions de l’Église et du monde du temps dans lequel il s’est déroulé. Nous ne pouvons pas absolutiser Vatican II. Et au contraire, c’est exactement ce qui s’est passé : ce qu’il avait voulu être, et avait effectivement été, un Concile pastoral (et donc avec toutes les limites que cela comportait), à un certain point est devenu plus contraignant qu’un Concile dogmatique. On pouvait mettre en discussion tous les dogmes de la foi catholique, mais gare à mettre Vatican II en discussion. Un exemple de cette absurdité : la réconciliation avec les lefebvristes à ce jour, est subordonnée à une acceptation inconditionnelle du Concile. Mais ne se rend-on pas compte de l’absurdité ? [1] Dans le dialogue œcuménique, on s’efforce justement de déterminer l’essentiel sur lequel nous pouvons tous nous retrouver d’accord (in necessariis unitas), négligeant les diversités accidentelles (in dubiis libertas) ; à l’intérieur de l’Église catholique ce qui nous unit ne serait plus la même foi, mais l’acceptation d’un Concile qui s’était lui-même défini comme pastoral !
Second critère : le Concile a émané des documents variés, pas tous de même valeur (*) : il y a quatre constitutions, neuf décrets et trois déclarations. Il ne serait pas correct de mettre sur un même plan une déclaration et une constitution. Ces mêmes constitutions n’ont pas toutes la même valeur : une d’elles, celle sur la liturgie, n’est définie par aucun adjectif ; deux, celle sur l’Église et celle sur la divine révélation, se déclarent « dogmatiques » (quoiqu’elles ne définissent pas de nouveau dogme) ; la dernière, Gaudium et spes, se présente comme une constitution « pastorale ». Je crois qu’il est important de recourir à ces critères herméneutiques, parce qu’en fait, les principales contestations des traditionalistes au Concile portent, comme par hasard, sur des déclarations, et pas sur des constitutions dogmatiques : ce que les lefebvristes critiquent le plus dans le Concile, c’est la liberté religieuse (Déclaration Dignitatis humanæ) et le rapport avec les religions non-chrétiennes (Déclaration Nostra ætate). Il me semble que, sur la base des critères herméneutiques exposés plus haut, il est plus que légitime de maintenir sur de tels sujets des positions diversifiées.
4. L”« esprit du Concile »
Dernier point. Lorsqu’on interprète un texte, un des critères herméneutiques fondamentaux est d’établir l’intention de l’auteur ; si le texte est juridique, on recherche la mens du législateur (cf can. 17 CJC). Dans ce cas, les progressistes (parmi eux, in primis, ceux que l’on nomme l”« École de Bologne »), n’ont-ils pas raison de se référer à l”« esprit du Concile », qui se situerait au-delà de la lettre de ses documents et dont eux mêmes seraient les dépositaires ? Pour être franc, j’en suis arrivé à la conclusion que les « dossettiens » (appelons-les ainsi par commodité, sans pour autant exprimer un quelconque jugement sur Don Giuseppe Dossetti) n’ont pas tous les torts d’en appeler à l”« esprit de Concile ». Je veux dire : cet « esprit » n’est pas né de leur imagination ; c’était vraiment l’esprit d’une bonne partie des pères conciliaires ; je ne saurais dire si c’était celui de la majorité ou seulement d’une minorité aguerrie (aujourd’hui nous dirions : un puissant lobby). À lire les chroniques de Concile, il y a de quoi rester pantois (voir sur le site Una vox, le compte rendu « Le Concile jour après jour »). Je me souviens que Mgr Ettore Cunial nous confia un jour ne jamais avoir entendu de sa vie autant d’hérésies que pendant le Concile : s’il n’y avait pas eu l’assistance de l’Esprit Saint et si ces positions avaient prévalu, on aurait détruit l’Église en peu de jours.
Mais justement, il y avait l’Esprit Saint (Dieu sait écrire droit sur des lignes courbes) et, ajoutons-nous, il y avait aussi le bon Paul VI, qui tint la situation en main et sut mener le Concile à sa conclusion.
Même en considérant les choses d’un point de vue purement humain, les discussions parmi les différents groupes présents au Concile conduisirent à des compromis honorables, qui trouvèrent leur expression dans les documents conciliaires, équilibrés et fondamentalement partagés par tous (même Mgr Lefebvre signa tous les documents, y compris Dignitatis humanæ).
Mais précisément parce qu’il y avait les fruits de compromis humains, les dossettiani ont continué à en appeler à l”« esprit de Concile » (c’est-à-dire à l’esprit du lobby progressiste du Concile) comme à l’unique clé de lecture légitime du Concile. De leur point de vue, ils n’ont pas tous les torts : les documents conciliaires sont issus de compromis ; ils ne reflètent pas l’esprit de ceux qui avaient voulu le Concile et en auraient souhaité une issue bien différente. Le problème est : sommes-nous sûrs que cet « esprit » coïncide avec l’Esprit de Dieu ? Sommes-nous vraiment sûrs que l’Esprit Saint s’est exprimé à travers l”« esprit de Concile » et pas plutôt à travers la lettre des documents conciliaires, cette lettre, fruit de compromis humains ?
Le problème est d’autant plus grave, que cette mentalité (l”« esprit de Concile » identifié avec l’intentio auctoris ou mens du législateur) n’était pas répandue seulement dans les cercles progressistes de l’Église, mais influença dans une certaine mesure la réalisation même du Concile de la part des hiérarchies suprêmes.
Voici un exemple tiré de la réforme liturgique. Le Concile avait prévu la conservation de l’usage de la langue latine dans la liturgie en général (Sacrosanctum Concilium, n. 36), dans la célébration de la Messe (ibid., n. 54) et dans le texte de l’Office divin (ibid., n. 101). Eh bien, ce ne fut pas un quelconque prêtre rebelle qui transgressa cette règle, mais c’est le Souverain Pontife lui-même qui autorisa la traduction intégrale de la liturgie dans les langues vulgaires (avec comme conséquence, l’abandon inévitable de la langue latine). Pourquoi cela ? Parce que, bien que contre la lettre du Concile, cela semblait correspondre à sa mens.
Et c’est ce qui a ruiné l’Église. La faute de la crise de l’Église ne peut pas être attribuée au Concile en tant que tel, ou au moins aux documents qui en ont jailli, même pas au défaut d’application de la part de quelque irréductible contestataire, mais à la diffusion à tous les niveaux de ce qu’on croyait être le vrai « esprit du Concile », mais était en réalité, pour employer l’image de Paul VI, la « fumée de Satan » qui s’insinuait dans l’Église.
Il ne s’agit pas ici de criminaliser qui que ce soit, encore moins le pauvre Paul VI, qui fit tout pour s’opposer aux interprétations extrémistes du Concile. Mais tel était malheureusement le climat ; tous en furent dans d’une certaine façon contaminés et, peut-être en toute bonne foi, ils furent amenés à se détacher de la lettre de Concile.
L”« esprit du Concile » a été comme un poison qui a pénétré l’Église dans toutes ses fibres. Si maintenant nous voulons assainir l’Église, nous ne devons pas annuler le Concile, mais le libérer du prétendu « esprit du Concile ». Quel est l’antidote ? Revenir à la lettre du Concile, dans laquelle s’exprime le vrai esprit du Concile, qui est aussi l’esprit de la tradition ininterrompue de l’Église.
Ceci peut même comporter, si nécessaire, des révisions de plusieurs réformes, là où celles-ci se sont détachées de la volonté explicite du Concile. On parle avec toujours plus d’insistance d’une « réforme de la réforme » liturgique.
Pourquoi pas ? La solution actuelle (la coexistence de deux formes du même rite) peut être acceptée seulement comme solution transitoire, mais ne peut certes pas être considérée comme la solution idéale et définitive. Cette interaction réciproque des deux usages liturgiques, prévue par le Saint Père dans la lettre d’accompagnement du Motu Proprio aux Évêques, devient de plus en plus nécessaire : « Les deux formes de l’usage du Rite Romain peuvent s’enrichir mutuellement : dans le Missel ancien pourront et devront être insérés de nouveaux saints et quelques nouvelles préfaces… Dans la célébration de la Messe selon le Missel de Paul VI , pourra se manifester, de manière plus forte que ce qui a eu cours jusqu’à présent, cette sacralité qui attire beaucoup de gens vers l’ancien usage ».
La lettre du 23 juin 2003 du Cardinal Ratzinger à Heinz-Lothar Barth se révèle encore plus explicite : « Je crois qu’à long terme l’Église romaine doit avoir de nouveau un seul rite romain. L’existence de deux rites officiels pour les évêques et pour les prêtres est difficile « à gérer » en pratique. Le rite romain du futur devrait être un seul, célébré en latin ou en vernaculaire, mais complètement dans la tradition du rite qui a été transmis. Il pourrait assumer quelques nouveautés qui se sont avérés valides, comme les nouvelles fêtes, quelques nouvelles préfaces dans la Messe, un lectionnaire étendu avec plus de choix qu’avant, mais pas trop,… ». Plus ou moins ce qu’avait prévu le Concile.
Par conséquent, pour autant qu’il soit légitime de discuter sur le Concile, nous devons admettre que, si on veut trouver un point d’équilibre entre les différentes « âmes » de l’Église, on ne le trouvera probablement que dans la lettre du Concile lui-même, fruit des efforts des pères conciliaires, de la sage médiation de Paul VI et, surtout, de l’assistance de l’Esprit Saint.
Abbé Giovanni Scalese, traduit de l’italien par le site Benoît XVI et moi
[1] Surligné par LPL