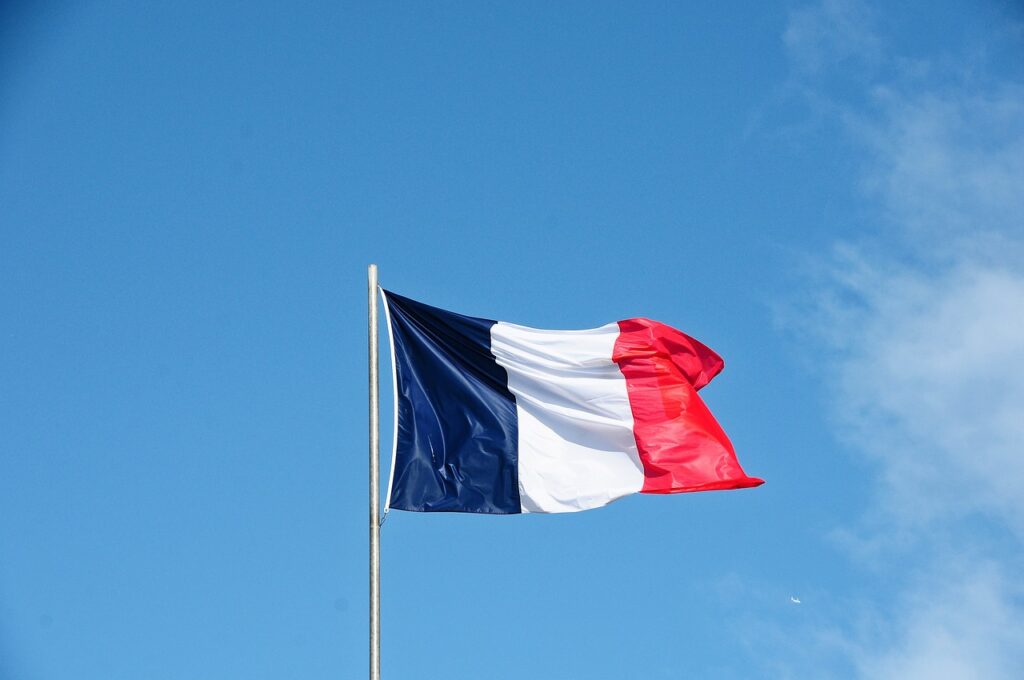Une société mondiale serait-elle encore possible, selon un modèle autre que celui de la Chrétienté de jadis ? Et, si la doctrine sociale du Christ Roi devient inapplicable en raison des circonstances, en quoi une organisation sinon mondiale du moins internationale des États devrait être réputée irréalisable, dans ces mêmes circonstances ?
1. Il devient de moins en moins facile à l’homme contemporain de concevoir ce qu’est une société, au sens précis qu’Aristote et saint Thomas ont donné à ce terme. Rien d’étonnant à cela. La société est en effet l’une de ces réalités fondamentales, qui sont exigées par la nature même de l’homme. Les notions abstraites moyennant lesquelles notre intelligence se donne le moyen de saisir l’essence de ce genre de réalités ne sauraient faire l’objet d’une démonstration. Elles sont le fruit d’une observation aussi attentive que possible du réel, et elles sont acquises dans le cadre de l’expérience immédiate. La difficulté sur laquelle butte alors l’homme contemporain est que ce champ de l’observation immédiate du réel est pour lui de plus en plus réduit. Entre les moyens d’appréhension qui lui sont propres, et que lui a donnés la nature (l’univers de ses cinq sens, disait Schiller en parlant de Goethe) et la réalité qui devrait s’imposer à lui s’interposent désormais les différents produits d’une activité qui n’imite plus, du moins plus suffisamment, la nature et qui, partant, établit une rupture toujours plus grande entre l’intelligence de l’homme et le réel. C’est pourquoi, ce que l’on désigne aujourd’hui comme la « société », ne recouvre plus exactement ce qu’entendaient les anciens.
La société selon Aristote et saint Thomas.
2. Ces derniers usaient de ce mot pour rendre compte des données fondamentales d’une nécessité inhérente à la nature humaine.
« L’homme », dit saint Thomas, « est naturellement un animal social, dans la mesure où il a besoin pour sa vie de beaucoup de choses qu’il ne peut seul s’assurer à lui-même. C’est pourquoi, l’homme fait naturellement partie d’un groupe qui lui apporte de l’aide pour bien vivre ».
Tel est le sens originel du mot« société ». Ce sens originel se diversifie ensuite en d’autres sens à la fois apparentés et différents, des sens analogues.
« L’homme », dit encore saint Thomas, « a besoin de cette aide du groupe sous deux rapports. D’abord, certes, pour ce qui est strictement nécessaire à la vie, et dont la vie présente ne peut se passer : c’est là l’aide qu’apporte à l’homme le groupe de la famille dont il fait partie. […] Il y a encore un autre rapport sous lequel l’homme reçoit l’aide d’un groupe dont il fait partie, c’est pour une suffisance parfaite de sa vie, à savoir, pour que non seulement il vive, mais aussi vive bien, disposant de tout le suffisant pour la vie : c’est ainsi que le groupe de la cité dont il fait partie aide l’homme » [1]
Distinction est ainsi faite entre une société imparfaite et la société parfaite. La famille est une société imparfaite car l’homme qui en fait déjà partie a besoin de s’intégrer, à travers elle, dans une autre société qui lui apportera l’aide totale et définitive sans laquelle il lui serait impossible d’atteindre la perfection de sa nature.
« La cité », dit encore le docteur commun, « est le dernier degré des groupes humains, car elle est ordonnée à procurer à l’homme ce qui est par soi suffisant à toute la vie humaine et c’est pourquoi elle est le groupement le plus parfait de tous ». [2]
3. La vie en société n’est donc pas un phénomène qui s’expliquerait en raison des circonstances accidentelles à la nature humaine ; l’homme est par nature un être qui a besoin de vivre en société. La société au sens strict (ou la cité) se définit alors comme une activité commune auto-suffisante, ou autarcique, c’est-à-dire qui n’a pas besoin d’une autre pour assurer la perfection de l’espèce humaine. La société au sens moins strict (ou la famille) se définit comme la toute première activité commune, nécessaire mais non encore suffisante et qui a besoin d’être assumée par une autre. Retenons seulement et surtout l’idée qui suffira ici : la société se définit en fonction du bien qu’elle est censée procurer à l’homme, pour qu’il puisse atteindre sa perfection et la société parfaite, au sens le plus approprié du terme, c’est à dire la cité, est celle qui donne à l’homme tout ce qui lui est pleinement suffisant pour atteindre sa perfection entière.
4. La société parfaite, ou la cité, est donc une réalité d’ordre moral, puisque donnée en vue de la félicité de l’homme, que représente ici-bas le bien honnête, c’est-à-dire le bien conforme à la droite raison, le bien de l’exercice de la vertu, spécialement dans la justice. Bien sûr, le bien honnête présuppose et entraîne d’autres biens qui relèvent d’un ordre différent, les biens utiles et les biens délectables [3], et la vie sociale parfaite de la cité en assume la réalisation. Néanmoins, le bien commun qui définit selon son espèce propre la société parfaite d’ici-bas est formellement le bien honnête de la vertu, conforme à la raison, avec l’ordre de justice qu’il implique. La société est ainsi ordonnée à rendre l’homme moralement bon, et pas seulement riche, puissant, bien nourri et en bonne santé : la fin de l’homme est le bien vivre et pas seulement (ni même toujours aussi) le bien-être.
Le bien commun de la société
5. Cette bonté morale convenablement ordonnée dans le cadre d’un agir collectif représente le bien achevé de l’homme et ce bien est dit commun dans la mesure où la cité s’y ordonne, comme à sa fin. Mais l’expression est ambivalente. L’on peut en effet désigner un bien comme étant « commun » tantôt du point de vue de l’exercice ou de l’acquisition de ce bien ; tantôt du point de vue de la spécification ou de la définition de ce bien.
6. Du point de vue de la définition du bien, est dit « commun » le bien qui est la perfection propre à plusieurs. Il se distingue adéquatement du bien particulier comme de ce qui est la perfection propre à un seul. En ce sens, le bien commun auquel s’ordonne la société est le bien de la nature humaine, et donc le bien de tous les hommes. Du point de vue de l’acquisition du bien, est dit « commun » le bien qui ne peut être recherché et dont on ne peut jouir qu’à la condition d’être plusieurs réunis. Par exemple, une partie de tennis ou une messe pontificale. En ce sens, le bien commun de la société est le bien de tous ceux qui travaillent ensemble à l’obtenir et seulement de ceux-là. Il est indéniable que tous les hommes, doivent rechercher le bien de la nature humaine, mais il n’est pas dit pour autant qu’ils doivent le rechercher tous ensemble par l’exercice de la même activité commune et dans le cadre d’une même société.
Unité de la société et diversité des sociétés.
7. Il y a d’ailleurs, c’est un fait, plusieurs sociétés parfaites, plusieurs cités. Cela s’explique du fait que les principes communs de la loi naturelle ne peuvent pas être appliqués selon un mode uniforme à tous les hommes, en raison de la grande variété des réalités humaines, au niveau même des facteurs individuants tels que la géographie et le climat, le tempérament et ce que l’on a pu appeler « l’âme des peuples », la langue et la mentalité [4]. De même que dans l’ordre des choses de la nature, la cause propre de l’individualité réside dans la matière, ainsi, en politique, la cause propre des modalités individuelles des sociétés réside dans le matériel à façonner. Car la politique ne créée pas les hommes [5], ni leurs liens de solidarité ni la forme primitive du commerce social. Elle les suppose et elle les reçoit de la nature. Et celle-ci apporte avec elle toute la multiplicité des éléments concrets et individuants [6] . La politique est pour une part essentielle l’œuvre de la raison de l’homme, œuvre d’une volonté libre. Mais cette volonté libre ne peut œuvrer que dans le prolongement du donné initial et nécessaire de la nature et la raison de l’homme y retrouve en permanence ses racines. Ici comme ailleurs, l’ordre moral découle de l’ordre des nécessités de nature et toutes les déterminations de plus en plus parti-culières du droit positif humain procèdent de l’unique et même loi naturelle. Mais il reste avec cela que la nature de l’homme est uniment spécifique et individuelle. En dehors d’une pure considération de l’esprit, l’Humanité ou le genre humain n’existent jamais à part des hommes individuels concrets. Et le bien de l’Homme n’existe jamais à part du bien des hommes, tel que les hommes le recherchent et l’atteignent dans le cadre des différentes sociétés parfaites concrètes. Ainsi le veut la nature proprement humaine, qui est autre que la nature angélique. A la différence de ce qui se passe chez les anges, chez les hommes, la multiplicité n’est pas seulement formelle ou transcendantale ; elle est aussi numérique et fondée sur des facteurs matériels et quantitatifs.
9. Ce point a toute son importance, et il faut la souligner ici. Car on ne peut pas changer la nature et la nature humaine reste toujours en tant que telle individuée, qu’il s’agisse de l’homme isolé ou de la société. Et d’autre part, on ne peut pas non plus nier ce que Dieu a voulu nous révéler. Or, nous le savons, la multiplicité des sociétés, pour être un fait de nature, s’explique aussi en raison d’une intervention positive de Dieu dans l’histoire, qui a voulu comme donner plus de nécessité au donné de la nature. Le livre de la Genèse nous le relate au chapitre XI, en insistant sur le fait de la différenciation des langues, qui est présentée par l’écrivain sacré comme la cause prochaine et immédiate de la distinction de l’humanité en différents peuples et sociétés. Certes, le récit de la Bible présente cette dispersion comme un châtiment et saint Augustin renchérit sur cette idée [7]. Mais le mal de peine consiste précisément non dans la diversité des langues ni dans la multiplicité des sociétés, mais dans le fait que les échanges et la communication de nation à nation deviennent difficiles. Par nature, dit saint Augustin, la multiplicité des sociétés était virtuellement antérieure à la diversité des langues et celle-ci n’a fait que renforcer la nécessité de celle-là, en lui ajoutant seulement un caractère pénible.
Quelle unité mondiale ?
10. La question du mondialisme réapparaît ici. Précisément posée, elle porte comme sur son sujet sur la société parfaite, telle que nous venons de la définir, c’est-à-dire sur la cité, au sens que saint Thomas et Aristote ont donné à ce terme. Que peut-on en dire, en lui attribuant autant de prédicats possibles ? La société est-elle « mondiale » ? Ce terme peut lui-même s’entendre en des sens fort différents : premièrement, au sens d’une société populeuse ou composée de la plus grande multitude ; deuxièmement, au sens d’une société pandémique ou comprenant la totalité de la population mondiale ; troisièmement, au sens d’une société partout présente selon le lieu ou géographiquement répandue sur toute la terre.
11. Aristote et saint Thomas pensent que la société naturelle ne saurait être « mondiale » aux deux premiers sens. En effet, l’unité réelle de la société civile parfaite ou de la cité réclame une multitude déterminée, qui évite pareillement les deux excès contraires d’un trop petit nombre de citoyens ou d’un trop grand nombre [8]. Car l’un et l’autre de ces deux excès rendraient trop difficile, voire impossible, l’obtention ici-bas de la félicité naturelle, qui est la raison d’ être de la cité. Celle-ci n’ est réalisable ici-bas que dans le cadre d’une société qui fait l’unité d’ une multitude déterminée selon le nombre.
12. Entendue au troisième sens, l’unité mondiale d’une société parfaite se vérifie rarement et difficilement dans les faits. Historiquement parlant, cette unité mondiale fut celle du monde connu et se limita, avec l’Empire romain, au pourtour méditerranéen. L’unité mondiale, s’il en fut, se limita toujours plus ou moins à une unité européenne. Dans le principe, une telle unité géographiquement mondiale serait difficilement compatible avec la diversité des facteurs individuants dont nous avons parlé plus haut. S’y opposeraient toujours plus ou moins les différents particularismes, qui sont inhérents à la nature humaine. L’unité mondiale n’en serait que plus précaire ou provisoire.
13. Le mondialisme, entendu au sens strict d’une société parfaite, recouvrant l’ensemble de la population mondiale, même répartie dans les multiples régions de la terre, semble donc difficilement réalisable, si l’on se place au point de vue d’une causalité matérielle, relativement à la quantité des citoyens. Mais il semble qu’il ne soit guère plus facile de l’envisager du point de vue de la définition même de la société parfaite, qui correspondrait au point de vue d’une cause formelle. Le prédicat « mondial », attribué au sujet « société » pourrait-il s’entendre alors dans un quatrième et dernier sens, celui d’une société internationale ou de nations, c’est-à-dire d’une société de sociétés ?
Pour une société internationale ?
14. Le vingtième siècle, avec les lendemains des deux guerres mondiales et le souci d’éviter désormais des conflits généralisés, puis le développement accru et le perfectionnement des moyens de communication, semble avoir donné une certaine consistance à ce que les Papes eux-mêmes en sont venus à désigner comme une«société des nations »[9]. Certains auteurs s’y sont intéressés de près pour fonder sur le bien commun du genre humain tout entier non seulement la légitimité mais même la nécessité d’une société internationale. Ce bien commun se justifierait à son tour sur l’unité spécifique du genre humain. A tel point que « tous ceux qui nient l’unité spécifique du genre humain nient par le fait même la légitimité et la possibilité d’une société internationale »[10]. Le mondialisme (qui n’est nullement, en tant que tel, d’inspiration maçonnique ou anti-catholique) pourrait tirer de là ses lettres de noblesse. Mais peut-être ne serait-il pas inutile de dissiper ici quelques équivoques.
15. Nous ne nions pas l’unité spécifique du genre humain. Nous nions seulement qu’elle soit ce qu’elle n’est pas, c’est-à-dire autre chose que le fruit d’une considération de notre esprit, puisque dans la réalité existent non pas l’humanité, mais des hommes [11]. L’unité de ces hommes existe quant à elle en dehors de la considération de notre esprit, mais loin d’être l’unité spécifique du genre humain, elle est l’unité politique de la société, qui est une unité d’ordre [12] . D’autre part, le bien et ce qui lui est ordonné comme à sa perfection doivent se correspondre sur le même plan. Or, le bien du genre humain et le genre humain sont des notions abstraites et ils se correspondent sur le plan de la considération de notre esprit. Tandis que le bien commun et la société qui s’y rattache comme à sa cause finale existent et se correspondent sur le plan de l’action concrète des hommes, en dehors de la considération de notre esprit. Le bien commun est certes le bien du genre humain, mais il l’est dans sa définition et selon la considération de notre esprit, en tant que bien et en tant que commun selon la spécification. En dehors de cette considération de notre esprit, le bien est commun selon l’exercice et comme tel, il n’est pas nécessairement le bien de tous les hommes, assimilés à un « genre humain » qui serait hypostasié ou entendu dans un sens ontologique. Ce n’est pas parce que le bien commun selon la spécification (ou d’un point de vue logique) est celui du genre humain, qu’il doit correspondre selon l’exercice (ou d’un point de vue ontologique) au bien commun de tous les êtres humains, et par rapport à ce qui serait une société mondiale. Cela reste à vérifier, car l’on ne saurait passer sans faute de la spécification à l’exercice, ni du point de vue logique au point de vue ontologique, et ce qui se vérifie d’ailleurs plutôt, c’est, sur le plan de l’acquisition concrète ou selon l’exercice, la diversité des sociétés et la multiplicité des biens communs concrets, dans la dépendance des facteurs individuants de la nature humaine. Car, à la différence de ce qui se passe chez les anges, le genre humain ou plus exactement l’espèce humaine n’est pas un individu. Il est vrai que la nécessité d’une société se fonde sur celle du bien commun à l’obtention duquel elle est ordonnée. Mais il n’est pas prouvé que le bien de la nature humaine, pour être concrètement obtenu comme un bien commun, dans toute sa perfection nécessaire et suffisante, rende nécessaire une société mondiale, à moins de présupposer l’existence initiale d’un « genre humain » conçu comme la communauté concrète et pas seulement abstraite de tous les hommes, ce qui est précisément à démontrer.
16. Une vérité reste toujours incontestable, lorsqu’elle équivaut à une application particulière du principe de non contradiction. Et cela se vérifie ici. Car des réalités diverses et multiples ne peuvent (sous peine de contradiction) constituer une unité dans la mesure même où elles sont diverses et multiples. Ainsi, plusieurs hommes ne feront jamais un seul homme, même s’ils peuvent constituer une seule famille ; plusieurs familles n’en feront jamais une seule, même si elles peuvent constituer une seule ville ; plusieurs villes n’en feront jamais une seule, même si elles peuvent former un seul royaume et si plu-sieurs gouvernements peuvent former une confédération, ils ne sauraient constituer un même gouvernement ni une même organisation sociale [13]. Si nous prenons en compte ce principe, nous ne voyons pas comment plusieurs sociétés parfaites, dans l’exacte mesure où elles sont et sociétés et parfaites, pourraient faire une société parfaite de sociétés ou de nations. La possibilité même d’une « société » mondiale ou internationale devrait trouver ici ses limites. Car de deux choses l’une. Soit cette « société » mondiale est parfaite en son genre, et alors elle ne peut l’être dans le même genre de société que les sociétés parfaites dont elles se constitue : elle ne saurait être en ce cas ni plus ni moins qu’une fédération de sociétés ou de gouvernements, à l’exemple de ce qu’a voulu être l’Organisation des Nations Unies. Soit cette « société » mondiale est une société à part entière et pas seulement une fédération de sociétés, et alors elle ne peut se composer que de sociétés imparfaites ou de gouvernements subordonnée à un gouvernement suprême : elle serait alors un nouvel État plus grand dans lequel se dilueraient les États anciens et l’avenir nous dira si l’Europe n’est pas en train d’y aboutir. Mais si cette hypothèse se trouvait vérifiée, quel bien commun se trouverait au fondement de ces « États-Unis » de l’Europe ? La sainteté ? La vertu morale ? La richesse financière ? L’hygiène sanitaire ? L’Europe deviendrait-elle un jour plus ou moins proche une association de vaccinés, après avoir été, sous la forme d’une Chrétienté, la société des baptisés ?
De Pie XII à Vatican II
17. Il resterait aussi à vérifier si, même dans l’esprit des Papes qui en parlaient déjà avant Vatican II, le bien commun des nations correspond au bien de l’homme, tel qu’il définit la société politique naturelle. Il semblerait plutôt qu’il s’agisse là du bien des nations, non pas le bien nécessaire et suffisant à la perfection de la nature humaine en tant que telle, mais quelque bien relatif à des circonstances, et qui concerne directement les pays, non les individus : bien d’une entente pacifique, en prévention des conflits armés, bien d’ordre commercial, économique ou financier, bien même d’ordre culturel ou humanitaire. De tels biens peuvent exister et rendre légitime certaines formes internationales d’association, des alliances et des traités, voire des institutions supranationales, ou des confédérations, destinées à regrouper pour un but occasionnel les différentes sociétés naturelles ; mais quand bien même elles seraient appelées à durer, ces institutions ne peuvent relever immédiatement que d’un droit positif humain [14] et, loin de constituer l’unité politique de la cité, elles la supposent. C’est ici que s’imposerait une distinction foncière entre une société mondiale respectueuse de la cité politique, et une société mondialiste, qui voudrait supplanter les nations au nom d’une supposée « fraternité humaine », ou d’une quelconque « maison commune », dont le concile Vatican II s’est fait jadis l’apologiste et dont le Pape François se fait aujourd’hui l’ouvrier.
18. La constitution pastorale Gaudium et spes affirme en effet : « Dieu qui veille paternellement sur tous, a voulu que tous les hommes constituent une seule famille et se traitent mutuellement comme des frères. Tous, en effet, ont été créés à l’image de Dieu…et tous sont appelés à une seule et même fin, qui est Dieu lui-même »[15] . Sous prétexte que les hommes ont tous été créés par le même Dieu, le Concile voudrait enseigner qu’ils doivent constituer une seule famille. Or seule la grâce permet cette réalisation, car c’est la grâce qui fait des hommes les fils adoptifs de Dieu, membres d’une seule et même famille surnaturelle, la communion des saints, laquelle est l’aboutissement de l’Église hiérarchique, elle-même société du même ordre surnaturel. Du point de vue de la nature, l’homme doit vivre dans une société qui est l’aboutissement nécessaire de la famille, et cette société de l’ordre naturel ne peut, en tant que telle, être de dimension universelle.
19. La constitution Gaudium et spes ne cesse pourtant d’entretenir et de reprendre cette confusion initiale. Par exemple : « Parce que les liens humains s’intensifient et s’étendent peu à peu à l’univers entier, le bien commun, c’est-à-dire cet ensemble de conditions sociales qui permettent, tant aux groupes qu’à chacun de leurs membres, d’atteindre leur perfection d’une façon plus totale et plus aisée, prend aujourd’hui une extension de plus en plus universelle, et par suite recouvre de droits et des devoirs qui concernent tout le genre humain. Tout groupe doit tenir compte des besoins et des légitimes aspirations des autres groupes, et plus encore du bien commun de l’ensemble de la famille humaine »[16]. Dans ce paragraphe, la constitution dit que les différentes as-sociations humaines (ou sociétés) sont des parties de l’humanité, laquelle constitue d’ores et déjà une famille. Ainsi : « Plus le monde s’unifie et plus il est manifeste que les obligations des hommes dépassent les groupes particuliers pour s’étendre peu à peu à l’univers entier » [17]. Ou encore : « la liberté se fortifie lorsque l’homme accepte les inévitables contraintes de la vie sociale, assume les exigences multiples de la solidarité humaine et s’engage au service de la communauté des hommes » [18].
20. L’universalité de l’association humaine est alors nécessaire : la société ne peut pas ne pas être mondialiste. La constitution pastorale le dit : « Du moment où se développent des liens d’une étroite dépendance entre tous les citoyens et tous les peuples de la terre, une recherche adéquate et une réalisation plus efficace du bien commun universel exigent dès maintenant que la communauté des nations s’organise selon un ordre qui corresponde aux tâches actuelles »[19] . Et un peu plus loin : « Les institutions internationales déjà existantes, tant mondiales que régionales, ont certes bien mérité du genre humain. Elles apparaissent comme les premières esquisses des bases internationales de la communauté humaine tout entière pour résoudre les questions les plus importantes de notre époque : promouvoir le progrès en tout lieu de la terre … » [20] .
21. Sur ce point comme sur d’autres, l’Encyclique Laudato si ne représente pas une nouveauté. « Créés par le même Père », affirme-t-elle, « nous et tous les êtres de l’univers, sommes unis par des liens invisibles, et formons une sorte de famille universelle, une communion sublime qui nous pousse à un respect sacré, tendre et humble »[21]. Le Pape François ne fait que tirer ici les conséquences pratiques des enseignements du Concile. Car si l’humanité est une Fraternité universelle, elle réclame sa Maison commune. Dans une pareille optique, l’écologie est en tant que telle mondialiste.
22. En définitive, on peut bien se demander si cet idéal de la « société » mondiale ne serait pas une déformation de l’aspiration humaine à la paix. La paix est toujours la tranquillité de l’ordre, mais l’unité d’ordre peut se réaliser de bien des manières. L’ordre proprement politique est une exigence première de la nature, concrétisée par l’effort patient et réaliste de la raison, qui procure déjà suffisamment cette parfaite tranquillité, à l’échelle proportionnée et différenciée des différentes parties du monde, en chaque nation. L’ordre international doit s’y superposer tout en le respectant. S’il ambitionne davantage qu’une union relative, occasionnelle et circonstanciée, il doit viser pour cela un bien d’ordre vraiment supérieur à celui de la cité politique, bien d’ordre supérieur qui ne saurait être qu’un bien surnaturel. Dans son commentaire sur la deuxième Épitre de saint Paul aux Thessaloniciens[22], saint Thomas fait cette réflexion qui peut éclairer notre propos.
« Les hommes », dit-il, « ne sont pas unis entre eux, sauf s’ils s’unissent dans ce qu’ils ont de commun ; et ce que les hommes ont de plus commun, c’est Dieu. Et c’est pourquoi saint Paul dit : Que le Dieu de paix vous donne la paix, en précisant qu’il s’agit non pas de la paix temporelle mais de la paix éternelle, c’est-à-dire de la paix surnaturelle qui commence ici-bas et qui trouvera son achèvement dans l’au-delà. Et il précise que Dieu donne cette paix en tout lieu, et dans le monde entier, parmi ceux qui ont la foi ».
L’unité universelle et mondiale de l’Église est la seule possible dans la dépendance de la grâce surnaturelle, qui transcende tous les facteurs individuants et tous les particularismes. C’est pourquoi elle est précisément une unité « catholique », ce dernier terme donnant à l’idée d’universalité toute sa densité, non seulement matérielle mais même formelle. Si l’on réduit la paix surnaturelle de ce que fut la Chrétienté à une paix mondiale purement temporelle, l’unité catholique de l’Église en viendrait à se confondre avec l’unité mondialiste de la communauté humaine. Le projet de Laudato si n’en serait-il pas l’expression frappante ? Projet d’une utopie de plus, pour le malheur d’une espèce humaine abandonnée à sa blessure originelle.
Abbé Jean-Michel Gleize, professeur au Séminaire Saint-Pie X d’Ecône
Source : Courrier de Rome n°632
- Commentaire sur l’Ethique d’Aristote, livre I, leçon 1, n° 4.[↩]
- Commentaire sur la Politique d’Aristote, Proème, n° 4.[↩]
- Somme théologique, 1a2ae, question 2, articles 1 à 8.[↩]
- Somme théologique, 1a2ae, question 95, article 2, ad 3.[↩]
- Commentaire sur la Politique d’Aristote, livre I, leçon 8, n° 131.[↩]
- Cf. Louis Lachance, L’Humanisme politique de saint Thomas d’Aquin. Individu et Etat, Editions du Lévrier, 1964, chapitre XVII, § 4 : « Valeurs politiques et valeurs nationales ».[↩]
- Saint Augustin, De la cité de Dieu, livre XVI, chapitre 4 : « per linguas divisae sunt gentes ».[↩]
- Commentaire de saint Thomas sur le livre des Ethiques d’Aristote, livre 1, leçon 9, n° 112 et 113 et Commentaire sur le livre des Politiques d’Aristote, livre 7, leçon 3, n° 1095–1096.[↩]
- Cf. le recueil de Mgr Guerry, L’Eglise et la communauté des peuples. La doctrine de l’Eglise sur les relations internationales : l’enseignement de Pie XII, Maison de la Bonne Presse, 1958.[↩]
- C’est le mérite de Mgr Henri Grenier d’avoir envisagé ce point, dans son Cours de philosophie, t. II, n° 570 (« La société internationale »), Québec, 1942, p. 435.[↩]
- Somme théologique, 1a pars, q 39, art 4, ad 3 : « L’unité ou communauté de la nature humaine n’existe pas dans la réalité, mais seulement dans la pensée [Unitas autem sive communitas humanae naturae non est secundum rem sed solum secundum considerationem] ».[↩]
- Somme théologique, 1a pars, q 31, art 1, ad 2 : « Dans sa signification, le nom collectif implique deux choses : une pluralité de suppôts, et une certaine unité entre eux, qui est l’unité d’un ordre. Un peuple, par exemple, est une multitude d’hommes soumis à un certain ordre [Nomen collectivum duo importat, scilicet pluralitatem suppo-sitorum et unitatem quandam, scilicet odinis alicujus. Populus enim est multitudo hominum sub aliquo ordine comprehensorum] ».[↩]
- Louis Billot, sj, L’Eglise. II – Sa constitution intime,Courrier de Rome, 2010, n° 210, p. 193.[↩]
- Somme théologique, 2a2ae, question 57, article 2[↩]
- Gaudium et spes, n° 24 § 1[↩]
- Gaudium et spes, n° 26, § 1[↩]
- Gaudium et spes, n° 30, § 2[↩]
- Gaudium et spes, n° 31 § 2.[↩]
- Gaudium et spes, n° 84 § 1[↩]
- Gaudium et spes, n° 84 § 3[↩]
- Au n° 89.[↩]
- Sur II Thess, III, 16, n° 89.[↩]