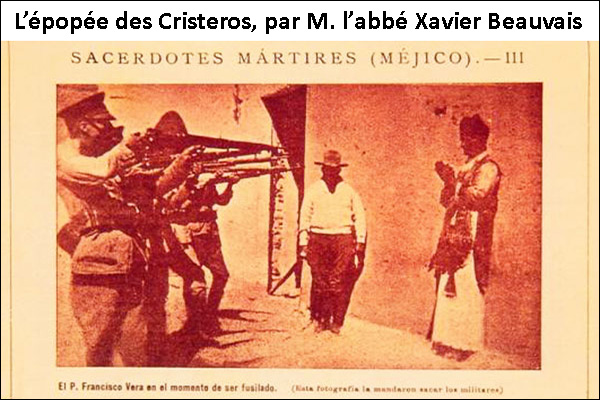« Il importe peu d’agiter subtilement de multiple questions et de disserter avec éloquence sur droits et devoirs, si tout cela n’aboutit pas à l’action. » Saint Pie X, le 4 octobre 1903
Que voulons-nous ?
Ce qui est en question… c’est de savoir si quelque chose d’efficace peut encore être tenté pour enrayer les progrès de la Révolution. C’est de savoir si nous sommes réduits à combattre sans espoir de vaincre. Ce qui est en question… c’est de savoir ce que nous pensons de nous-mêmes. Sommes-nous une arrière-garde chargée de permettre au gros de la troupe, déjà repliée, de démobiliser aux moindres frais ? Cherchons-nous à ne conserver que le droit de proclamer d’énergiques refus, de solennelles exhortations ?
Notre ambition se borne-t-elle qu’à ne cultiver un souvenir ; à constituer un certain nombre de groupes où seront conservés et transmis, pour la consolation d’une minorité, les éléments d’une doctrine dont personne ne veut plus ? Quelque chose d’analogue à ce que sont tant d’associations : amis du « vieux Nice », fidèles du tir à l’arc, fervents de Mozart ou de Pergolèse. Actions, occupations fort honorables… sans doute ! Mais très éloignées d’une entreprise de reconquête sociale. […]
Ce qui est en question c’est de savoir ce que nous voulons. Ou nous contenter d’être une secte uniquement réconfortée par un jeu de congratulations réciproques ; ou travailler avec efficacité au triomphe, universellement sauveur, de la Vérité.
La lutte, certes, dure depuis longtemps. Et le manque d’ardeur, le repli sur soi, le découragement sont faciles quand l’armée dont on a mission d’assurer la relève n’a cessé de battre en retraite. Et c’est là, finalement ce qui est en question.
Comment se peut-il que tant de travaux, tant d’efforts, n’aient pas abouti à un meilleur résultat ? Nous nous évertuons ; et nous reculons sans cesse. Nous ramons ; et le courant nous emporte. Pourquoi ? D’où cela peut-il venir ? Sont-ce là, au moins, questions que nous tendons à nous poser ? Sinon, comment justifier que des êtres, par ailleurs scrupuleux, consciencieux, raisonnables puissent à ce point négliger de se pencher, comme il faut, sur le problème du devoir et des conditions d’efficacité, au service de la plus sainte cause au temporel ?
Le souci d’efficacité
Très suspecte, il est vrai, la notion d’efficacité. Certains se font une vertu de l’écarter. […] Certes, les desseins de Dieu sont impénétrables. Et ses voies ne sont pas nos voies.
Mais sous prétexte que Dieu peut triompher avec RIEN, c’est en ne faisant RIEN nous-mêmes (RIEN de convenable, RIEN de suffisant) qu’au nom du surnaturel, curieusement interprété, nous attendons souvent une victoire, dont on peut dire, cette fois, que Dieu ne l’accordera jamais tant que nous l’attendrons ainsi. Il y a dans cette évasion surnaturelle (apparemment édifiante) une façon inadmissible de nous dispenser du plus élémentaire devoir d’auto-critique. Et serait-il normal que la vérité soit si continuellement stérile, le mensonge si continuellement triomphant ?
Disons plus : il est dans l’ordre, il est dans la sagesse de l’action d’être convenablement référée à la notion d’efficacité. Action temporelle, comment ne pourrait-elle être conçue sans souci du résultat également temporel qui la spécifie ? […]
Certes, Dieu peut permettre que le travail le plus consciencieux, l’effort le plus prudent, le courage le plus généreux soient vaincus. Il importe même de savoir supporter ces épreuves. Mais sans que celles-ci, pour durables, pour douloureuses qu’elles soient, puissent devenir un argument d’indifférence aux résultats, de mépris envers l’efficacité temporelle qu’une action pareille ne peut pas ne pas chercher à avoir. S’il est des désastres prestigieux – Sidi Brahim, Camerone – il est une façon déshonorante de s’évertuer qui consiste à ne point s’inquiéter assez de la victoire, qui consiste à prendre trop allègrement son parti de l’échec, qui consiste à trouver normale la stérilité de notre action.
Penser l’action
Le mensonge est odieux de ce piétisme qui se croit surnaturel parce que désincarné, et où la prière devient un argument de négligence et de passivité. Attitude qui n’a tant de succès que parce qu’elle favorise un penchant naturel à la paresse, un effort court, violent peut-être, sans résultats durables et sérieux. Surnaturalisme borné à ce qui est « extraordinaire » dans la piété. Attente d’un miracle. Réalisation d’une prophétie, selon laquelle tout s’arrangera quelque jour par simple intervention divine, sans qu’on ait besoin de s’en mêler.
Mais qui prendra cette caricature pour la piété vraie dont les saints ont brûlé ? Cette piété qui valut au docteur de Poitiers la réponse de Jeanne :
- Vous dites que Dieu veut délivrer le peuple de France de ses calamités ; mais s’il le veut, il ne lui est pas nécessaire de mettre en mouvement les hommes d’armes.
- En nom Dieu, répondit l’enfant, les hommes d’armes batailleront et Dieu donnera la victoire.
Telle est en effet la réponse orthodoxe, au naturel comme au surnaturel. Prier comme si notre action devait être inutile, et agir comme si notre prière l’était aussi. Sans quoi il est normal de se heurter à ce double péril :
- Celui d’un providentialisme béat, quiétisme de l’action, indifférentisme pratique. ON NE PENSE PAS A L’ACTION. On improvise en comptant sur l’aide de Dieu. Mais on oublie qu’il ne saurait bénir n’importe quoi fait n’importe comment. Dieu ne s’est pas engagé à suppléer à nos négligences coupables. Ce faux esprit surnaturel ne mérite que l’échec.
- Second péril : celui du naturalisme pratique ou activisme. ON NE PENSE PAS BIEN L’ACTION. Sûr de soi et de ses moyens on ne compte pas sur Dieu, on ne compte plus avec Dieu. Que ces moyens, dès lors, viennent à manquer, c’est le découragement, l’abandon. Dieu n’ayant point béni, c’est la stérilité absolue, le prétendu remède s’étant montré pire que le mal.
Est-il perversion plus subtile et plus grave qu’une orthodoxie de pensée, satisfaite d’elle seule, mais indifférente à la fécondité du vrai, au triomphe du mal ? Une orthodoxie toute cérébrale et spéculative ne suffit pas. Il faut pour être réellement, vitalement orthodoxe, non seulement l’orthodoxie de l’intelligence, mais si l’on peut dire, l’orthodoxie de la volonté. Laquelle se manifeste, avant tout, par une faculté normale d’enthousiasme et d’indignation.
« La fréquence, la puissance du crime, écrit le cardinal Ottaviani, ont hélas émoussé la sensibilité chrétienne, même chez les chrétiens. Non seulement comme hommes, mais comme chrétiens ils ne réagissent plus, ne bondissent plus. Comment peuvent-ils se sentir chrétiens s’ils sont insensibles aux blessures faites au christianisme ? […] La vie se prouve par la sensation de la douleur, par la vivacité (le mot est suggestif) avec laquelle on réagit à la blessure, par la promptitude et la puissance de la réaction. Dans la pourriture et la décomposition on ne réagit plus. »
Devoir d’état envers la Cité
Dieu sait pourtant l’attention, le soin l’ingéniosité, le zèle que chacun sait consacrer au plus grand succès de ses affaires. Qui ne se forme et ne s’informe en ce domaine ? Qui ne se documente ? Qui n’a recours à des techniciens avertis ? Jours et nuits s’écoulent parfois à la recherche de la formule qui permettra d’augmenter mes bénéfices, de surclasser un concurrent. Mais qu’il s’agisse du sort de la société (dont dépend cependant le bonheur durable des affaires privées), la routine, la négligence, l’irréflexion, l’inconséquence, la paresse deviennent la loi de ces hommes dont on admire ailleurs la sagesse et l’initiative. Passagers qui épongent l’humidité de leur cabine, mais qui refusent de s’intéresser au fait que leur navire sombre dans l’instant.
La vérité est que nous perdons du temps à des riens, que nous accordons à des « tabous » mondains plus de temps qu’il n’e faudrait pour travailler victorieusement au salut de la Cité. Un souci obsessionnel du confort parvient à constituer même parmi nous un climat de matérialisme inexpugnable. Matérialisme qui ne s’affiche plus comme autrefois, en maximes viles, provocantes. Ce qui avait l’avantage d’alerter les meilleurs. Mais un matérialisme de fait, tout implicite, qui sans empêcher d’aller à la messe n’en réalise pas moins le plus grand phénomène d’absentéisme politique depuis la décadence de l’Empire Romain. Lequel en mourut. Chrétiens qui se veulent excellents époux, excellents pères de famille, excellents employés, excellents paroissiens. Le monde peut compter sur eux. Sauf leur Cité. Sauf leur patrie !
« A d’autres plus brillants que nous, disent-ils, le soin de ces hautes et graves questions. Notre devoir ne saurait dépasser le plan de la vie domestique. On ne peut pas tout faire. Tant de choses nous sollicitent déjà. »
Ce qui paraît sage réponse. Ce qui pourtant ne parvient pas à légitimer le mépris d’un devoir certain. La vérité étant qu’il faut tout faire de ce que par état nous devons faire.
Quel mari oserait dire qu’il refuse d’accomplir ses devoirs de père, pour s’en tenir à ses devoirs d’époux, sous prétexte qu’il ne saurait tout faire ? Quel fils, pour la même raison, oserait justifier l’abandon de son père infirme pour se consacrer au seul apostolat paroissial ?
Il est trop facile de choisir celui de nos devoirs d’état qui nous plaît davantage et d’écarter les autres. L’ordonnance d’une vie vertueuse et sainte n’est rien d’autre que l’heureuse solution apportée à ce problème de la coexistence de multiples et irréductibles devoirs d’état.
Devoirs d’état envers Dieu ; puisque nous sommes par état ses créatures. Devoirs d’état envers nos parents ; puisque, par état, nous sommes leurs enfants. Devoirs d’état envers notre conjoint ; si, par état, nous sommes mariés. Devois d’état envers nos fils et nos filles ; si, par état, nous sommes père ou mère. Devoirs d’état envers la Cité, la patrie : puisque par état, nous sommes membres de ces communautés. Devois d’état professionnels. Devoirs d’état amicaux. Devoirs d’état de bon voisinage, etc. Aucun devoir d’état ne peut être récusé tant que nous restons dans l’état qui, précisément, nous l’impose. […]
Jamais, peut-être, le salut de la société n’a tenu à l’effort d’un aussi petit nombre de gens. Encore faut-il que ce petit nombre veuille et sache vouloir. Quelques sursauts, quelques mouvements de colère tardive n’y feront rien. Prenons garde de ne pas mériter de nous entendre dire ce que la mère du dernier roi maure de Grenade put lancer à son fils quand il dut quitter sa capitale :
« Il est inconvenant de pleurer et de trépigner comme une femme quand on est en train de perdre ce qu’on n’a pas eu la volonté de défendre comme un homme ».
Source : Pour qu’Il Règne, Jean Ousset