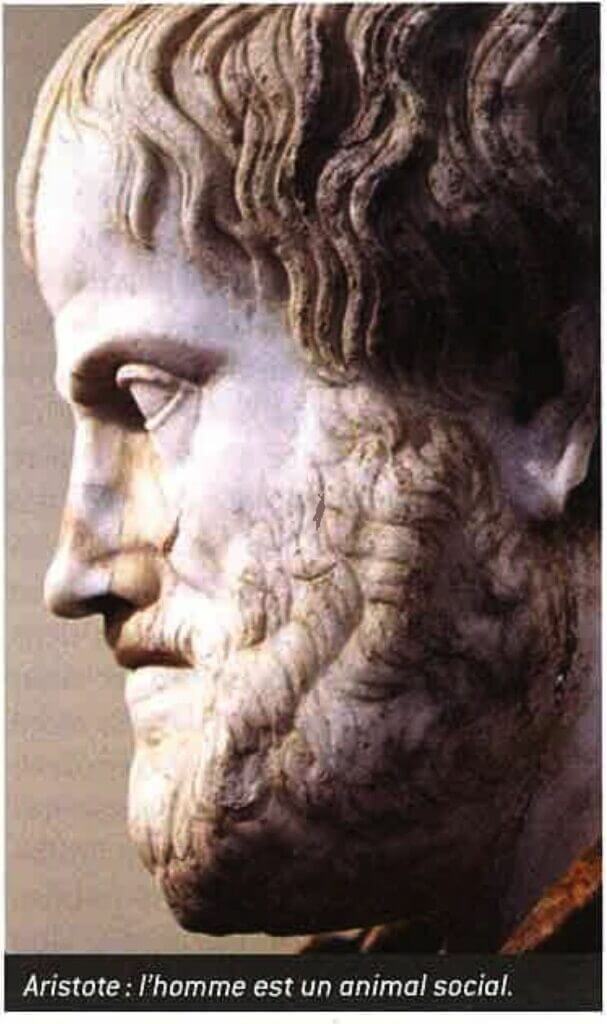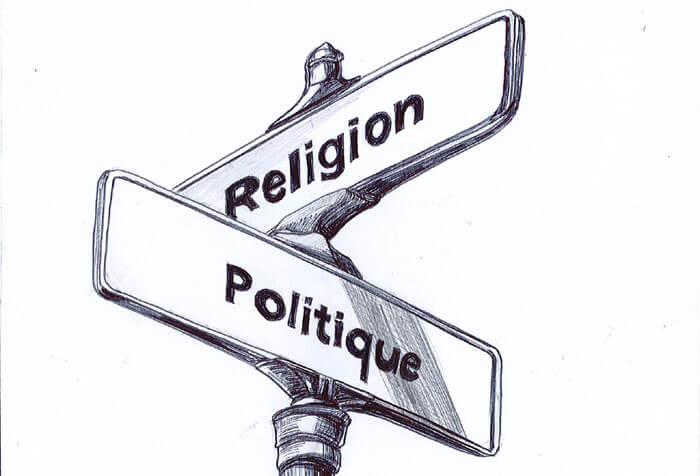La reconnaissance, par le concile Vatican II, du droit à la liberté religieuse fut un événement considérable car il rompait avec l’enseignement traditionnel, notamment les écrits des Pères de l’Église, et parce qu’il heurtait le bon sens.
La veille de sa clôture, le 7 décembre 1965, Vatican II reconnaissait le droit à la liberté religieuse dans la déclaration Dignitatis Humante. La discussion avait été difficile car la liberté religieuse bousculait la conception catholique des rapports Église-Etat et de la tolérance des erreurs religieuses. Le dogme du Christ-Roi réaffirmé dans l’encyclique Quas Primas de Pie XI en 1925 et la condamnation de la liberté religieuse, par Pie IX dans l’encyclique Quanta Cura en 1854, étaient revus et corrigés : désormais l’Église ne réclamerait plus la protection publique pour elle et l’interdiction des autres cultes par les États catholiques.
En conséquence, après le concile, le Saint-Siège fit modifier les concordats, par exemple, en 1967, celui qui liait l’Espagne de Franco à l’Église et qui avait été adopté sous Pie XII en 1953. « La profession et la pratique, tant publique que privée, de toute religion seront garanties par l’État » remplaça « Personne ne sera inquiété pour ses croyances religieuses ni pour l’exercice privé de son culte. On n’autorisera pas d’autres cérémonies ni d’autres manifestations extérieures que celles de la religion catholique. »
Était-ce un progrès ? C ’est le contraire qui est vrai. Loin d’être un acquis de la civilisation chrétienne, la liberté religieuse est un « délire » (selon l’expression de Grégoire XVI condamnant par l’encyclique Mirari vos du 16 août 1832 l”« Église libre dans État libre » de Lamennais). Ce « délire » est inséparable du laïcisme qui se fonde sur le rationalisme : à la raison humaine souveraine dans l’ordre de la pensée correspond une liberté souveraine de la volonté humaine dans l’ordre de l’agir, ce qui mène au rejet de toute autorité et et de la morale. Au bout du compte, cela revient à l’anarchisme du « ni Dieu, ni maître ». Avec les autres libertés contemporaines, de conscience, de presse ou d’expression, la liberté religieuse rend les peuples ingouvernables. Elle s’impose comme l’une des plus graves « libertés de perdition » dénoncées par Léon XIII dans l’encyclique Libertas præstantissimum.
Si l’on y regarde bien, donc, la liberté religieuse s’oppose non seulement au dogme catholique, mais aussi aux principes de l’ordre politique naturel. C’est pourquoi, dans l’article qui suit, la question sera examinée de ces deux façons : d’abord par la raison naturelle, puis sous la lumière de la foi surnaturelle.
Un « délire » au yeux de la raison
Selon la doctrine moderne, la liberté religieuse est une liberté subjective. Elle constitue l’apanage de chaque personne, qui ne peut être forcée en matière de croyance et de pratique religieuse. Cette liberté doit être reconnue dans les législations des pays : les États n’ont pas le droit de contraindre l’exercice des cultes, sauf si cet exercice cause de l’immoralité et du désordre dans le domaine public. Ce droit est naturel et donc permanent, absolu et universel (pour toute personne, dans toute société et pour toutes les époques). C’est, en un mot, un droit de l’homme qui doit être garanti par l’État.
La conséquence de cette doctrine est que la liberté de la personne humaine, en matière religieuse, ne peut ployer sous rien : la personne garde son indépendance totale de choix et d’action religieuse dans la société.
Cette conception de la liberté oublie que l’homme-individu (ou singulier) est aussi social – « animal politique », dit Aristote – et fait naturellement partie d’un tout, d’une société. En premier, l’homme voit le jour dans une famille ; c’est la société familiale. Puis, à chaque étape de sa vie, l’homme est naturellement porté à s’agréger à de multiples sociétés qui le lient avec autrui. Il y a d’abord la cité ou société politique dirigée par un État ; il y a ensuite l’unité constituée par tous les hommes de la terre, cette communauté universelle qu’on pourra appeler une société divine naturelle. Enfin, s’il est catholique, il est en outre membre de l’Église qui est, elle aussi, une société, cette fois surnaturelle. Élargissant ainsi son regard, Julio Meinvielle écrit au bout du compte que « dans la personne singulière nous devons distinguer cinq aspects, spécifiés par cinq biens différents : l’aspect proprement singulier, le familial, le politique, le divin naturel et le divin surnaturel » (Critique de la conception de Maritain sur la personne humaine). Que signifie d’ailleurs l’expression « spécifiés par cinq biens » ? Tout simplement que chaque société se distingue d’une autre par la collection des bienfaits spécifiques qu’elle apporte à chacun de ses membres. Lorsqu’un homme est agrégé à l’une ou l’autre de ces sociétés, il accède à cette collection qu’on nomme aussi « bien commun ». Le bien commun procuré par la famille à chaque personne singulière, par exemple, n’est pas le même que celui que lui procure l’Église.
Or, ces biens sont obtenus par une action commune qui oblige à suivre la volonté de la société : l’unité d’action entre les divers membres l’exige. De la vie en société naissent les lois qui contraignent l’indépendance des hommes : bienheureuse contrainte pour le plus grand bien de tous ! Or « chacun de ces aspects ou de ces biens est subordonné à celui qui lui est immédiatement supérieur, ainsi le bien singulier proprement dit se subordonne au bien de la personne singulière en tant que membre de la famille ; l’un et l’autre au bien de la personne singulière en tant que membre de la société politique, (…) de la communauté universelle, (…) de la communauté surnaturelle qu’est l’Église ». Plus les biens sont supérieurs, plus ils sont œuvres d’une société parfaite et exigent de plier sa liberté aux nécessités du bien commun. Si l’État exige parfois le sacrifice de sa vie, le Christ l’exige en quelque sorte continuellement en aimant Dieu par-dessus tout, soi-même compris. L’homme en société immole sa liberté personnelle pour adhérer à l’ordre social (ordre aux deux sens du terme : commandement et orientation vers le bien à obtenir). Après monition, la volonté individuelle qui refuserait de tenir sa place au sein du tout serait ôtée de cette société : les déserteurs sont fusillés.
Ainsi voit-on que, loin de ne pouvoir être soumise, la liberté personnelle doit s’incliner pour permettre à des êtres inférieurs d’obtenir les biens supérieurs qui les transcendent (saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, I, q. 65, a. 2). Personne n’emporte seul la victoire de Verdun mais tous la conquièrent, chacun à sa mesure.
La religion à part ?
Cependant, une objection vient naturellement : la nécessité de l’obéissance de la liberté personnelle, si elle vaut dans la famille ou dans la cité, concerne-t-elle aussi la religion ? En effet, l’homme a un destin transcendant la famille et la cité : membre de l’univers (communauté universelle), il reçoit des biens divins naturels du ciel et de la terre ; en outre, l’ordre surnaturel le fait jouir de Dieu face à face. Ces biens lui sont propres et dépassent la société politique : comment pourrait-elle le contraindre alors ? D’autant plus que la religion est du ressort de l’Église, et non de l’État, et ce, pour éviter la confusion entre les pouvoirs. Il semblerait donc que l’État ne puisse discerner entre vraie et fausse religion, qu’il n’ait pas le droit de favoriser l’une et de contraindre les autres. Incompétent en matière spirituelle, ne doit-il pas laisser les hommes libres de choisir et pratiquer leur culte ?
Répondons à cette objection. Il est vrai que le bienfait ultime de la religion rend bienheureux l’esprit humain, mais il n’y parvient que dans la vie éternelle ; ici bas, la religion regarde l’homme tout de même, qu’on le considère dans l’ordre privé {singulier ou familial) et public {cite). Or, si les actes du citoyen concernent le domaine public, l’autorité politique peut les juger, corriger et diriger en fonction du bien commun. Ainsi la religion a un double but :
- Elle honore Dieu comme chef et providence de toutes choses – première cause et ordonnateur universel, dirait Aristote. L’autorité divine s’étend donc sur les hommes et sur les sociétés, sommets des œuvres humaines : Dieu s intéresse aux hommes vivants en groupe ; en retour ceux-ci lui manifestent soumission et gratitude.
- La religion est aussi une œuvre de justice de chaque humain rendant un culte à Dieu par la louange et par tous ses actes : la morale entre dans la religion – les sanctions et les récompenses éternelles qu’elle promet ne font pas peu pour le respect des lois et les bonnes mœurs. Cela autorise l’État à légiférer pour que le citoyen soit bon fidèle de Dieu. La religion est, en un mot, une partie du bien commun de la cité.
Ainsi la liberté religieuse est cause d’injustice dans le domaine politique car elle retire à l’État un domaine légitime d’action et elle ampute gravement ce bien commun [1].

Une impiété aux yeux de la Foi
Après avoir réfuté la liberté religieuse grâce à la simple raison naturelle, il nous faut rappeler ce qu’en dit la foi catholique, et par conséquent l’Église.
La liberté religieuse est parfois présentée comme une invention chrétienne : les Pères de l’Église l’auraient demandée d’abord aux empereurs persécuteurs des premiers siècles de notre ère, puis aux empereurs chrétiens suivants. Ils auraient désapprouvé l’interdiction des cultes païens, hérétiques et juifs prononcée par les autorités civiles. L’union de l’Église et des États, surtout à l’époque médiévale, comme dans l’empire de Charlemagne, serait abusive, s’écartant de l’Évangile et de la Tradition chrétienne primitive. Que penser de cette théorie ?
Conformément aux prophéties – « sur le trône de David » (Is 9, 6–7), « il régnera sur la terre » (Jr 23, 5)… – Jésus-Christ a affirmé son pouvoir royal dans la cité : « Je suis roi » (Jn 18, 37), ayant tout pouvoir sur terre (Mt 28, 18)… Les Apôtres confirment : « Il doit régner sur ses ennemis » (1 Co 15, 25), « Roi des rois et Seigneur des seigneurs » (Ap 1, 5). Que tirent les Pères de l’Église de telles affirmations ?
Ceux des premiers siècles insistent certes sur la liberté de l’acte de foi, « spontané et venu du fond du cœur » (Origène, Contre Celse, V, 20,7) mais reconnaissent à l’État le droit de forcer extérieurement la profession de telle croyance ou d’empêcher tel culte : il peut orienter le choix religieux des âmes.
Avant la paix de l’Église (313), les Pères ont prôné la coaction en matière religieuse : saint Cyprien et Origène jettent les dissidents hors de « la maison de Dieu [qui] est une », car « le salut ne peut être à personne sauf en l’Église » (épître, IV, 4, 2–3 ; Contre Celse, VIl, 22). Pour leur culte, les apologistes du deuxième siècle réclament la reconnaissance officielle de l’État (Tertullien, Apologétique, XLIX, 3 ; Arnobe de Sicca, Advenus nationes, I, 65…) à l’instar des cultes païens.
En effet, la liberté religieuse n’existe pas en ce temps-là : il faut honorer les dit propre (« dieux propres ») de sa ville et les dii communes (« dieux communs ») de l’empire (Jupiter, Junon, Minerve). Si les dieux sont multiples, ils ne sont pas pour autant en « libre accès » car l’État décide de la licéité des cultes publics et « à titre privé » (Cicéron, De Legibus, II, 8, 19- 22). Cette autorité cultuelle de l’État veillant sur les religions garantit la pax deorum, « paix avec les dieux ». Ainsi les lois civiles répriment l’athéisme impie et interdisent les sanctuaires « sauvages », c’est- à‑dire érigés sans permission (Platon, Lois, X, 908–910). « Nul ne devait avoir ses dieux propres, ou des dieux étrangers, s’ils n’étaient reconnus par l’État » explique Cicéron {Des lois, Il, 8,19).
Les apologètes catholiques ont même exposé les liens entre l’Église et l’empire qui est ministre de Dieu car fondé par lui. Il s’ensuit que les chrétiens honorent l’empereur (Clément de Rome, Aux Corinthiens, LXX-LXII ; Origène, Sur les Romains, IX, 23–26 et Contre Celse, VIII, 68) et collaborent avec lui au nom du « rendez à César, rendez à Dieu » (Mt 22,21). Cette collaboration facilite l’évangélisation du monde (Origène, Contre Celse, III, 29 et VIII, 68) ; aussi Rome durera toujours pour soutenir l’Église (Tertullien, Ad Scapulam, Il). Les chrétiens ignorent donc la liberté de conscience religieuse, de même que toute l’Antiquité.
Dès la fin des persécutions, les rapports Église-État sont précisés : deux des plus prestigieux docteurs de l’Église refusent une quelconque liberté religieuse.
Saint Ambroise et saint Augustin
Après 313, les empereurs Constantin et Licinius inaugurent une politique si favorable au christianisme que l’arsenal législatif qui s’ensuit est unique dans l’histoire des relations de l’Église et des États. Certes, la théologie politique de Constantin – Pontifex maximus ( « pontife souverain ») de tous les cultes – ressemble à la théocratie de l’Ancien Testament et se fonde sur le droit romain : « Le pouvoir public [s’exerce] sur les choses sacrées, les prêtres, les magistrats » (Ulpien, Institutes, I, 1, § 2). Il intervient à contretemps en matière d’arianisme. Cependant, l’empereur supplée heureusement aux structures ecclésiastiques insuffisantes face aux dangers hérétiques et païens.
La transformation en empire chrétien se fait par Gratien (paganisme d’État supprimé en 383), « rempart de la foi catholique qui en vous est vivante » (Ambroise, De fide ad Gratianum, XVI, 139). Théodose reconnaît la foi du pape Damase (édit de Thessalonique en 380, concile de Constantinople en mai 381), les réunions hérétiques sont interdites (édits de 382 à 384), le paganisme proscrit (édit de Milan, 24 février 391) ainsi que les cultes privés des dieux-lares, le 8 novembre 392 (Code Théodosien, XVI, 10,10–12).
Saint Ambroise pose alors les deux conditions d’une Église d’État : la vérité religieuse révélée est le principe supérieur de la cité ; l’indépendance du clergé en est la garantie indispensable.
En conséquence, la loi de l’Église est intégrée à la législation civile (canons des conciles de Nicée, Rimini, Constantinople, Éphèse, condamnation d’Eutychès sous Marcien) et l’empereur est soumis à l’Église – Imperator intra Ecclesiam, non supra Ecclesiam ( « L’empereur est dans l’Église et pas au-dessus d’elle », Contre Auxence, 36) – comme le pouvoir temporel l’est au pouvoir spirituel ratione peccati ( « en raison du péché originel » ). C’est une révolution juridique. Ambroise va jusqu’à imposer une pénitence à Théodose pour les graves fautes publiques de « l’empereur très chrétien » (Epistolæ, I, 1).
En même temps, on pratique la tolérance permettant aux Goths d’être homéistes (sorte d’arianisme atténué), acceptant les églises ariennes hors les murs des cités. Ambroise demande la grâce de l’hérétique Priscillien… Ce n’est pas liberté religieuse cependant, car le principe du païen Gaudentius – « Les hommes ne doivent pas être amenés malgré eux à la vérité » (Augustin, Contra Gaudentium, I, 25) – est condamné par Ambroise : il a compris que la pérennité de la civilisation romaine dépendrait de l’exclusivisme accordé à la religion catholique par l’État impérial.
Après Ambroise, Augustin témoigne de l’usage de la force pour résoudre le schisme donatiste d’Afrique. A la fin du IIIe siècle, les donatistes avaient quitté l’Église au nom de la pureté de la foi. Vers 400, ils sont trois cents évêques en Afrique. Malgré cela, par peur de faire des « catholiques faux et simulés », saint Augustin réprouve la coaction, sauf en cas de désordres publics (épître 185 au comte Boniface, vu, 25). Sa position est très proche de Vatican II. Cependant, au concile de Carthage de juin 407, il demande la police contre eux. Pourquoi ?
D’une part, car la révélation divine a permis aux rois Ezéchias et Joas de détruire des sanctuaires idolâtres, à Darius de livrer aux lions les ennemis de Daniel, à Nabuchodonosor de légiférer contre les blasphémateurs (ibidem, V, 19), au roi de Ninive de faire faire pénitence à tous. Jésus oblige à entrer au banquet des noces : « Quand il vous semble qu’on ne doit pas contraindre les hommes à recevoir la vérité malgré eux, vous êtes dans l’erreur et vous ne connaissez pas les Écritures ni la vertu de Dieu qui les fait vouloir après les avoir contraints. » (Contra. Gaudentium, I, 25, n° 28)
Augustin a constaté d’autre part « tout ce qu’une sage rigueur pouvait faire pour leur conversion » (Retractationes II, 5). Ceux qui étaient empêchés de rejoindre l’Église par peur des violences ou de leurs proches « passèrent immédiatement à l’Église de Jésus-Christ ». Ceux qui étaient retenus dans le schisme par tradition familiale purent étudier le donatisme et n’y trouvèrent rien « qui pût compenser les dommages et les peines auxquelles ils s’exposaient » en y demeurant : ils se firent chrétiens. Ces exemples en attirèrent beaucoup qui, incapables de juger par eux-mêmes, les imitèrent. Une quatrième catégorie, hérétiques endurcis, feignit la conversion puis, « s’accoutumant peu à peu à nos salutaires pratiques, et à force d’entendre prêcher la parole de vérité », se convertit sincèrement. La coercition fut favorable aux catholiques car « la foi était solidement établie lorsque les lois des empereurs forçaient tous les hommes à suivre la religion catholique » : ils rendirent grâce pour les conversions opérées. Quant aux irréductibles, d’autant plus violents, la ferveur des catholiques se fit intense pour les gagner (épître 185, VI, 25 et 31).
Pour Augustin, l’argument fondamental est le salut éternel de l’hérétique (Contra litteræ Petiliani, II, 43). A Faune d’une éternité de châtiments, les peines temporelles sont infimes et la coercition relativisée. Il y a nombre d’avantages : « La crainte des peines [temporelles]… renferme du moins les mauvais désirs dans les barrières de la pensée » (ibidem, 83, n° 184) ; « la contrainte extérieure fera naître la volonté à l’intérieur » (sermon exil, 7, n° 8), « on commence par la crainte et l’on progresse jusqu’à l’amour, et le Seigneur accorde la paix » (Contra Gaudentium, I, 12, n° 13).
Augustin est donc forcé de reconnaître « la miséricorde de Dieu qui savait que la terreur des lois et quelques châtiments étaient un remède nécessaire pour guérir la perversité ou la tiédeur de beaucoup, et que la dureté de cœur résistant aux exhortations cède à une juste et sévère discipline » (épître 185, VI, 26).
Il achève donc ainsi : « Pourquoi donc de même que les très bonnes mœurs sont choisies par la libre volonté, les mauvaises ne seraient-elles pas punies par l’intégrité de la loi ?… Si donc il fut fait quelques lois contre vous, elles ne vous forcent point de bien faire, mais elles vous empêchent de mal faire ; car on ne peut bien faire que par choix, que par amour… » {Contra litteræ Petiliani, Il, 83, n° 184) Saint Augustin a posé les fondements de la cité de Dieu dont la coercition religieuse fut un vecteur essentiel.
Ainsi et pour conclure, dès l’Antiquité chrétienne la plus ancienne, le Christ put régner sur les sociétés politiques selon le mot de Théodose II au concile d’Éphèse en 431 : « L’Église et l’État ne forment qu’un tout et, sur notre ordre et avec l’aide de notre Dieu et Sauveur, ils seront sans cesse plus unis. »
Source : Fideliter n°230 de mars-avril 2016
- On insiste parfois en proposant une nouvelle formule à la même objection : la hiérarchie des biens subordonne le politique à la théodicée car le monastique (vie de l’homme comme individu), le domestique et le politique – tous trois domaines de l’État – dépendent de l’éthique, alors que la dimension religieuse ressort de la théologie naturelle (une partie de la métaphysique) et surnaturelle. L’État n’y est pas compétent. Mais saint Thomas remarque que seuls les sages, déjà parfaits en cette vie par la contemplation de Dieu, sont au-dessus du politique : ils sont très rares, dans une vie solitaire quasi-divine, car se vouer totalement aux choses de Dieu « est au-dessus de l’homme » [Somme théologique II-II, q. 188, a. 8). Même saint Bruno, fondateur des chartreux, n’a rien trouvé de mieux pour sauvegarder leur vie érémitique qu’une règle religieuse de vie commune… Ainsi l’homme en sa dimension religieuse ne peut échapper à la société politique dont il est toujours membre par nécessité humblement humaine. La doctrine de la liberté religieuse est d’une folle prétention : elle fait croire que tout homme est en état de perfection religieuse par nature… avant même d’avoir choisi le moindre exercice spirituel. Finalement, elle amplifie le péché d’origine et mènera à la même issue les sociétés qui la préconisent…[↩]