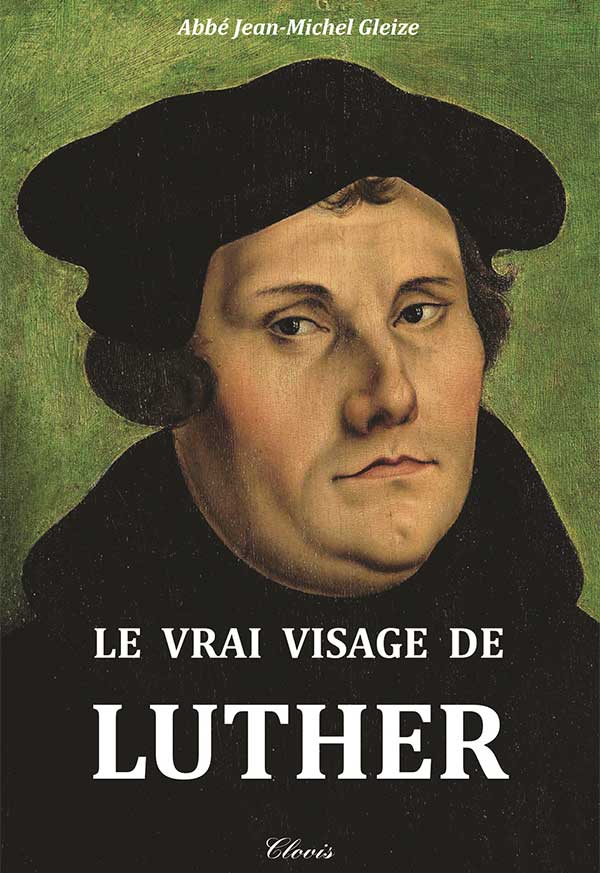IV – Catholiques et protestants depuis Vatican II
1. La Toussaint est l’une des grandes fêtes catholiques, par excellence, c’est à dire une fête que seuls les membres de la sainte Eglise romaine, dûment instruits du dogme révélé par Dieu, sont en mesure de célébrer dignement et sans conteste. Car cette fête exprime l’un des points essentiels de la foi catholique : la valeur méritoire des bonnes œuvres non seulement pour le propre salut de celui qui les accomplit, mais aussi pour le salut de son prochain. Cette vérité est au fondement du dogme de la communion des saints, et saint Augustin la résume en disant que « Dieu qui nous a créé sans nous ne nous sauvera pas sans nous » [1]. Le protestant, lui, qui n’est ni catholique ni chrétien, dans la mesure même où il n’est pas romain parce qu’il refuse l’autorité suprême du vicaire du Christ, l’évêque de Rome, ne peut pas s’associer à une pareille célébration. A la suite de Luther et de Calvin, en effet, il nie la valeur méritoire des bonnes œuvres pour le salut. Il nie donc le dogme de la communion des saints. Le 1er novembre est donc une journée foncièrement anti-œcuménique, une journée que les catholiques et les protestants ne pourront jamais fêter ensemble.
2. Cette célébration commune est pourtant l’un des principaux objectifs visés par le Pape François, dans le droit fil du concile Vatican II. Et c’est pourquoi, en cette vigile de la Toussaint, ce Pape a voulu se faire « le témoin volontaire et participatif » de la démarche entreprise par les luthériens de Suède, pour célébrer le cinq-centième anniversaire de la contestation entreprise par Luther. S’adressant aux successeurs attitrés de l’hérésiarque, il leur dit : « Ce qui nous unit est beaucoup plus que ce qui nous divise » [2]. C’est ce qu’ont dit avant lui Jean-Paul II [3] et Benoît XVI [4], afin de promouvoir un œcuménisme qui va contre l’enseignement du Magistère antérieur au funeste Concile Vatican II.
3. Qu’est ce qui divise les catholiques et les protestants, en effet ? Luther l’a dit une fois pour toutes, dans un texte décisif, le Manifeste à la noblesse chrétienne de la Nation allemande (août 1520). Ce texte est une déclaration de guerre totale et sans merci à l’Eglise catholique romaine, qui est comparée à la ville de Jéricho. Luther appelle les chrétiens à marcher sur elle, pour en reverser les trois murailles, qui sont : le sacrement de l’ordre, le magistère infaillible du Pape et le primat de juridiction de l’évêque de Rome. Voilà, de l’aveu même de Luther, ce qui sépare les protestants et les catholiques : le sacerdoce (et avec le sacerdoce, le saint sacrifice de la messe) ; la Tradition du magistère ; le pouvoir de la papauté. Et ce sont là les trois pivots sur lesquels repose l’unité de l’Eglise, voulue par le Christ : unité de sacrements et de culte qui dépend du sacerdoce ; unité de foi qui dépend du Magistère et de la Tradition ; unité de gouvernement qui dépend du primat du pape. En définitive, ce qui sépare les catholiques et les protestants, c’est la définition même de l’unité de l’Eglise, prise dans ses trois fondements. Ce sont justement ces trois fondements que la nouvelle théologie du concile Vatican II a sérieusement ébranlés : pour autant, ce concile a accompli une véritable « protestantisation » du catholicisme, au sens où il a introduit dans la pensée des hommes d’Eglise les germes de la révolte luthérienne.
4. Le concile a ébranlé la doctrine traditionnelle du sacerdoce : le chapitre II de la constitution Lumen gentium sur l’Eglise ne fait plus la distinction entre le sacerdoce des membres de la hiérarchie, qui est un sacerdoce au sens propre, et le sacerdoce commun des fidèles, qui est un sacerdoce au sens impropre. Pie XII affirme que, si l’on peut parler d’un certain « sacerdoce » des fidèles, cette expression équivaut à un titre simplement honorifique et qu’il se distingue comme tel du sacerdoce vraiment et proprement dit [5]. Cette dernière précision a disparu dans le n° 10 de Lumen gentium : le sacerdoce commun des fidèles y est présenté comme essentiellement différent du sacerdoce ministériel des membres de la hiérarchie, mais cette différence n’est plus désignée comme celle qui existe entre un sacerdoce spirituel et un sacerdoce vraiment et proprement dit. Cette omission autorise à définir le sacerdoce commun des fidèles comme un sacerdoce au sens propre du terme. Et c’est ce que voulait Luther : tous les fidèles chrétiens baptisés sont pour lui des prêtres au sens propre de ce terme, parce que leur foi les met en relation directe avec Dieu. Après le concile, mais dans la logique de celui-ci, le pape Paul VI modifia le rite de la messe, de façon à y introduire cette nouvelle conception du sacerdoce, où le rôle du célébrant est occulté au profit de l’action commune des fidèles. De plus, à cause des ambiguïtés de ce nouveau rite, la messe apparaît beaucoup plus comme le mémorial de la Cène du Jeudi Saint que comme le renouvellement et la réactualisation du sacrifice du Vendredi Saint. C’est encore ce que voulait Luther : faire de la messe le simple souvenir du repas du Jeudi Saint, afin de stimuler la foi des fidèles.
5. Le concile a ébranlé la doctrine traditionnelle du magistère et de la Tradition : le n° 12 de la constitution Lumen gentium sur l’Eglise met l’accent sur le « sens de la foi » des fidèles et donc sur le rôle de l’Eglise enseignée, au détriment du magistère et de l’Eglise enseignante. Les fidèles sont inspirés par le Saint-Esprit et pour autant premiers dépositaires de la vérité révélée par Dieu, et la hiérarchie enseignante a seulement pour mission de mettre au point la formule dogmatique requise à la conservation de cette intuition originelle. La Tradition devient donc la continuité d’une expérience vécue en communion et le magistère ne fait que la traduire en termes intelligibles. C’est encore ce que voulait Luther : selon lui, chaque fidèle reçoit directement les lumières du Saint Esprit, qui font de lui un prophète inspiré.
6. Enfin, dans le chapitre III de la constitution Lumen gentium, le concile fait du collège des évêques un deuxième sujet du pouvoir suprême, en plus du pape. Et dans ce collège, le pape n’est plus que le chef des évêques, tandis que c’est le collège qui est chef de l’Eglise. Ce principe de la collégialité porte atteinte à la papauté et à la nature monarchique du gouvernement de l’Eglise. Il va dans le sens d’un gouvernement représentatif, où le pape est le porte-parole d’une assemblée elle-même représentative du Peuple. C’est toujours ce que voulait Luther : non pas une Eglise société mais une communion démocratique.
7. Il y a plus. Le principe fondamental du protestantisme est en effet le principe du libre examen. Ce principe équivaut à établir la primauté de la conscience sur tout le reste. La règle de la croyance et de l’agir moral est non pas ce qui est vrai et bien, mais ce que la conscience présente comme vrai et bien. Ce présupposé subjectiviste et relativiste est à la racine de la déclaration Dignitatis humanae sur la liberté religieuse. En découle l’autonomie de l’ordre temporel posée également en principe par la constitution Gaudium et spes (n° 36), qui fait écho au principe protestant du « cujus regio ejus religio » : il n’y a pas de religion d’Etat, mais il y a seulement autant de religions que de citoyens. En découle aussi l’œcuménisme : si la religion est une affaire de conscience, l’unité religieuse, dans et par l’Eglise, est un idéal vers lequel convergent toutes les consciences, sans jamais l’atteindre. Et c’est bien la démarche qui inspire le décret Unitatis redintegratio du concile.
8. Le concile a donc contribué à cette guerre sans merci par laquelle le protestantisme a voulu mettre à bas le triple pouvoir de la sainte Eglise, pouvoir de son sacerdoce, de son magistère et de son gouvernement monarchique. Il s’est donc fait le complice de Luther. Et il donne à présent aux papes imbus de ses enseignements le moyen de faire cause commune avec les protestants, en leur disant : « Ce qui nous unit est beaucoup plus que ce qui nous divise ». Certes, oui, mais à quel prix ? Au prix du salut éternel des âmes, qui sont ballottées au vent de ces nouvelles doctrines protestantisées. Le salut éternel des âmes est pourtant la loi suprême, la loi qui doit inspirer toute la foi et tout l’apostolat de la sainte Eglise : il représente une exigence qui rend impossible et vaine la démarche entreprise par François et ses prédécesseurs.
Abbé Jean-Michel Gleize, prêtre de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X
- Commentaire sur le Psaume 70, n° 2.[↩]
- Discours à Malmö, lors de l’événement œcuménique, le 31 octobre 2016.[↩]
- Discours au Docteur Christian Krause, président de la Fédération luthérienne mondiale, le 9 décembre 1999.[↩]
- Discours lors de la rencontre avec les représentants du Conseil de l’église évangélique d’Allemagne à Erfurt, le 23 septembre 2011.[↩]
- Pie XII, « Discours du 2 novembre 1954 » dans Acta apostolicae sedis, 1954, p. 669.[↩]