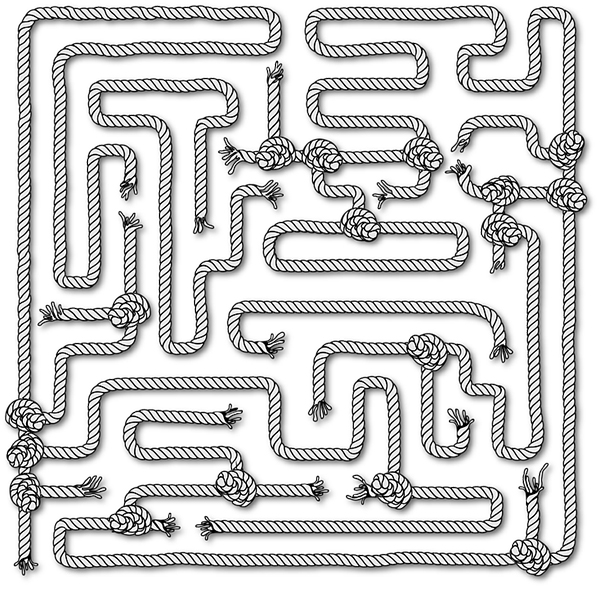1. Ce qu’est la chrétienté
1. La chrétienté est l’ordre social chrétien, c’est-à-dire l’union, conforme au dessein de Dieu, de l’Église et de la société civile, celle-ci se situant dans la dépendance de celle-là dès qu’il s’agit de faire parvenir les âmes à leur fin dernière. Cette union représente un mystère d’ordre surnaturel, c’est-à-dire une réalité nécessaire, qui ne saurait être connue autrement que par le moyen d’une révélation divine, et que la raison naturelle de l’homme, laissée à ses propres forces, ne saurait ni découvrir (quant à son existence) ni comprendre (quant à sa nature intime) [1]. Le fait de la chrétienté s’impose sans doute à la considération de l’histoire, de la philosophie politique ou de la sociologie, mais ce n’est alors ni plus ni moins qu’un fait d’ordre historique, politique ou sociologique, selon différents aspects qui, pour être réels, ne correspondent pas proprement à la nature intime de cette chrétienté. Seul le Magistère de l’Église est en mesure de nous en donner l’intelligence exacte, que la théologie se donne ensuite pour tâche d’approfondir.
2. Le grand texte de référence par lequel l’Église affirme cette doctrine, avec l’autorité de son Magistère ordinaire, est l’Encyclique Immortale Dei du Pape Léon XIII, en date du 1er novembre 1885. « Il est donc nécessaire », dit le Pape, « qu’il y ait entre les deux puissances un système de rapports bien ordonné, non sans analogie avec celui qui, dans l’homme, constitue l’union de l’âme et du corps [2]. » Saint Thomas disait déjà auparavant que « la puissance séculière est soumise à la puissance spirituelle comme le corps à l’âme » [3]. Que signifient exactement ces descriptifs empruntés à l’ordre physique ? Léon XIII l’explique dans les termes suivants : « Ainsi, tout ce qui, dans les choses humaines, est sacré à un titre quelconque, tout ce qui touche au salut des âmes et au culte de Dieu, soit par sa nature, soit par rapport à son but, tout cela est du ressort de l’autorité de l’Église. Quant aux autres choses qu’embrasse l’ordre civil et politique, il est juste qu’elles soient soumises à l’autorité civile, puisque Jésus-Christ a commandé de rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu [4].»
3. La définition de la chrétienté se décompose donc en trois grandes vérités. Première vérité : l’Église a juridiction sur les matières ordinairement spirituelles, puisque « tout ce qui touche au salut des âmes et au culte de Dieu par sa nature est du ressort de l’autorité de l’Église ». Deuxième vérité : l’Église n’a pas juridiction sur les matières ordinairement temporelles, puisque « les choses qu’embrasse l’ordre civil et politique sont soumises à l’autorité civile ». Troisième vérité : l’Église a juridiction sur les matières temporelles en tant qu’elles se trouvent ordonnées aux matières spirituelles, puisque « tout ce qui touche au salut des âmes et au culte de Dieu par son but est du ressort de l’autorité de l’Église ». Ce propos du Pape nous indique plus précisément en quoi les matières temporelles peuvent devenir spirituelles et tomber pour autant sous la juridiction de l’Église : c’est en raison de leur but. Dans son Apologie pour le Traité sur le pape et le concile [5], Cajetan dit lui aussi que le Pape possède le pouvoir suprême en matière temporelle, « dans la mesure où il y a un ordre du temporel au spirituel ». On dira donc, selon l’expression consacrée par saint Robert Bellarmin, que le Pape possède un pouvoir indirect en matière temporelle. Cela signifie que le Pape possède ce pouvoir non sur le temporel en tant que tel, mais dans la mesure où celui qui agit en matière temporelle se propose par là d’atteindre le bien spirituel, qui s’identifie avec la fin dernière de l’homme. Cette fin dernière restant toujours le motif der- nier de toute entreprise humaine ici-bas, l’Église ne peut jamais se désintéresser de l’ordre temporel et c’est pour- quoi l’union de l’Église et de l’État reste toujours nécessaire, union qui doit prendre la forme de la subordination réelle, quoiqu’indirecte, de l’État à l’Église. Le Pape saint Pie X exprimait cette conséquence en ces termes : « Quoiqu’il fasse, même dans l’ordre des choses temporelles, le chrétien n’a pas le droit de mettre au second rang les intérêts surnaturels ; toutes ses actions, en tant que moralement bonnes ou mauvaises, c’est-à-dire en accord ou en désaccord avec le droit naturel ou divin, tombent sous le jugement et la juridiction de l’Église [6]. » C’est justement pourquoi, disait encore le même Pape, « l’on n’édifiera pas la société, si l’Église n’en jette les bases et ne dirige les travaux » [7].
4. La chrétienté ne saurait donc se définir, dans sa nature intime, telle que Dieu nous l’a révélée et telle que le Magistère nous la fait connaître, ni comme l’absorption de l’État par l’Église ou de l’Église par l’État, ni comme la séparation de l’Église et de l’État. L’absorption de l’Église par l’État ainsi que la séparation de l’Église et de l’État sont deux erreurs directement condamnées par le Magistère ordinaire de l’Église, la première dans la constitution Licet juxta doctrinam du Pape Jean XXII en 1327 [8], dans la Constitution Auctorem fidei du Pape Pie VI en 1794 [9] ainsi que dans le Syllabus de Pie IX en 1864 [10], la seconde dans la Lettre Encyclique Vehementer nos du Pape saint Pie X en 1906 [11]. L’absorption de l’État dans l’Église est une erreur indirectement condamnée par le Magistère ordinaire de l’Église, du fait que celui-ci enseigne que la société civile est une société parfaite [12].
2. La juridiction de l’Eglise
5. Dans la dépendance de ces enseignements du Magistère, tous les théologiens admettent que l’Église possède de droit divin un pouvoir de juridiction propre et véritable et que celui-ci porte sur les matières spirituelles, c’est-à-dire ordonnées comme à leur fin prochaine au bien commun de l’ordre surnaturel). Tous les théologiens admettent aussi que sur les matières temporelles, c’est-à-dire ordonnées comme à leur fin prochaine au bien commun de l’ordre naturel, l’Église ne possède aucune juridiction et qu’en ce domaine elle peut tout au plus conseiller, mais non prescrire. La question se pose au sujet des matières temporelles envisagées non plus en tant que telles, mais en tant qu’elles entrent en connexion morale- ment nécessaire avec le bien spirituel dont l’Église a la charge. Elles ne cessent pas d’être pour autant des matières temporelles ; doit-on admettre que l’Église exerce sur elles une véritable juridiction en raison de ce lien ? La tradition théologique [13] la plus authentique répond que oui.
6. Le point essentiel qui doit commander toute l’intelligence de cette question est que l’Église a juridiction sur les États dans la mesure précise où elle est la seule à avoir reçu de Dieu la charge du bien commun de l’ordre surnaturel, en vue duquel le bien commun naturel se trouve de fait engagé. Et cela signifie deux choses très importantes. Premièrement, l’Église a en tant que telle juridiction sur les États, c’est-à-dire en raison ce qu’elle est essentiellement, dans sa nature intime d’unique société d’ordre surnaturel, chargée de faire appliquer le droit divin positif, c’est-à-dire la loi surnaturelle révélée par Dieu, en plus de la loi naturelle. Deuxièmement, le motif profond pour lequel l’Église a en tant que telle juridiction sur les États est le motif d’une cause finale : l’Église a juridiction sur les États parce qu’elle est la seule société qui possède tous les moyens nécessaires et suffisants pour faire parvenir les individus et les sociétés à la fin véritablement ultime, qui est une fin d’ordre surnaturel. Bref, la juridiction de l’Église sur les États n’est que la suite logique de la royauté sociale du Christ.
3. Depuis Vatican II
7. Tout autre est le discours tenu par les membres de la hiérarchie ecclésiastique, depuis le concile Vatican II. Ce concile enseigne en effet ce qu’il appelle « l’autonomie » des États à l’égard de l’Église. L’explication s’en trouve au numéro 36 (§ 1–2‑3) de la constitution pastorale Gaudium et spes. Partant du fait qu’un grand nombre de nos contemporains semblent redouter un lien étroit entre l’activité concrète et la religion, y voyant un danger pour l’autonomie des hommes, des sociétés et des sciences (§ 1), le concile entend dissiper cette inquiétude en proposant une distinction, au niveau même de la notion d’autonomie (§ 2–3). Premièrement, si, par autonomie des réalités terrestres, on veut dire que les choses créées et les sociétés elles-mêmes ont leurs lois et leurs valeurs propres, que l’homme doit peu à peu apprendre à connaître, à utiliser et à organiser, une telle exigence d’autonomie est pleinement légitime, car c’est en vertu de la création même que toutes choses sont établies selon leur ordonnance et leurs lois et leurs valeurs propres, que l’homme doit peu à peu apprendre à connaître, à utiliser et à organiser (§ 2). En revanche, si, par « autonomie du temporel », on entend que les choses créées ne dépendent pas de Dieu et que l’homme peut en disposer sans référence au Créateur, la notion n’est plus légitime, d’autant moins que « tous les croyants, à quelque religion qu’ils appartiennent, ont toujours entendu la voix de Dieu et sa manifestation, dans le langage des créatures ». L’autonomie se distingue comme telle de la dépendance ou de la subordination. Le concile affirme simultanément ici l’indépendance des sociétés temporelles, c’est-à-dire des États, à l’égard des différentes sociétés religieuses, dont l’Église catholique et la dépendance de ces mêmes sociétés à l’égard de Dieu, envisagé comme Créateur, c’est-à-dire principe de l’ordre naturel. Et tout cela est dit dans un chapitre II, qui traite précisément de « la communauté humaine », c’est-à-dire de l’ordre concrètement existant, sur le plan de l’activité communautaire. Autant dire que l’ordre des sociétés humaines est un ordre exclusivement naturel, qui doit se définir dans sa relation au Créateur, auteur de la nature, et non au Dieu trinitaire, auteur de la vie surnaturelle de la grâce, non au Christ et à son Église.
8. La raison profonde de cette situation est enseignée par la Déclaration Dignitatis humanæ sur la liberté religieuse. Celle-ci affirme en effet en son n° 2 que tous les hommes doivent être soustraits à toute contrainte de la part de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu’en matière religieuse nul ne soit empêché d’agir, dans de justes limites, selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d’autres. Et ce fait s’explique lui-même en raison de la dignité de la personne humaine, douée de liberté : la vérité ne saurait s’imposer à elle que « par la force de la vérité elle-même, qui pénètre l’esprit avec autant de douceur que de puissance ». La religion oblige bien l’homme, pris comme une personne, mais indépendamment de l’ordre social temporel, qui reste quant à lui autonome, c’est-à-dire indifférent, à l’égard de toute religion, y compris la religion divinement révélée de l’ordre surnaturel. Cet ordre temporel est donc naturaliste en raison même de son autonomie. Dans l’un des derniers actes de son pontificat, le Pape Benoît XVI se faisait encore l’écho de ce principe : « La liberté religieuse est le sommet de toutes les libertés. Elle est un droit sacré et inaliénable. Elle comprend à la fois, au niveau individuel et collectif, la liberté de suivre sa conscience en matière religieuse, et la liberté de culte. Elle inclut la liberté de choisir la religion que l’on juge être vraie et de manifester publiquement sa propre croyance. Il doit être possible de professer et de manifester librement sa religion et ses symboles, sans mettre en danger sa vie et sa liberté personnelle [14]. » La liberté doit s’entendre ici à l’égard de « quelque pouvoir humain que ce soit ». L’État ne doit pas imposer la religion aux membres de la société, et cela explique que l’Église n’ait pas de juridiction sur lui.
4. L’explication de Benoît XVI
9. Est-ce à dire que l’Église ne doit nullement intervenir dans le cadre de l’ordre temporel ? Benoît XVI a précisé ce point, dans son discours à l’union des juristes catholiques italiens, le 9 décembre 2006 [15]. L’idée de l’autonomie du temporel, posée en principe par le concile, dans la constitution Gaudium et spes, signifie, dit le Pape, « l’autonomie effective des réalités terrestres, non pas de l’ordre moral, mais du domaine ecclésiastique ». Le domaine temporel échappe donc nécessairement comme tel à la juridiction de l’Église, toujours et partout. Le principe énoncé par Vatican II et revendiqué par Benoît XVI autorise tout au plus dans le domaine temporel une intervention des religions, vraies ou fausses (et pas seulement de l’Église) en faveur de l’ordre moral naturel, et seulement par mode de conseil ou de libre témoignage. Et Benoît XVI précise que cette affirmation conciliaire de l’autonomie ainsi comprise « constitue la base doctrinale de la « saine laïcité » ». Il vaut la peine de nous y arrêter, puisque c’est précisément cette laïcité là que revendique – en s’appuyant explicitement sur ce discours de Benoît XVI – le livret de préparation donné en pâture aux chefs de chapitre du pèlerinage de Pentecôte, organisé en cette année 2019 pour marcher de Paris à Chartres.
10. D’après cette explication de Benoît XVI, la saine laïcité doit s’entendre au sens où la séparation de l’Église et de l’État n’implique pas la séparation de l’État et de la loi morale naturelle. Le pape réprouve donc une conception de la laïcité qui, en excluant toute intervention de l’Église et des religions dans le domaine social, voudrait exclure par là toute vision religieuse de la vie, de la pensée et de la morale. Cette exclusion est inacceptable aux yeux de Benoît XVI, parce que justement la religion est selon lui le fondement même qui donne à la loi morale son caractère absolu. Et par religion, le pape désigne, à la suite de la constitution Gaudium et spes du concile Vatican II, l’attitude de « quiconque croit en Dieu et à sa présence transcendante dans le monde créé ». C’est donc la religion réduite à son plus petit dénominateur commun, la simple religion naturelle, religion trop théorique pour ne pas en devenir naturaliste. Le Pape poursuit d’ailleurs son propos en indiquant les limites à l’intérieur desquelles l’État doit reconnaître la religion (non seulement l’Église, mais les différentes religions) comme une organisation d’utilité publique, ayant le droit d’intervenir sur le terrain propre- ment social. « La « saine laïcité » implique que l’État ne considère pas la religion comme un simple sentiment individuel, qui pourrait être limité au seul domaine privé. Au contraire, la religion, étant également organisée en structures visibles, comme cela a lieu pour l’Église, doit être reconnue comme présence communautaire publique. Cela comporte en outre qu’à chaque confession religieuse (à condition qu’elle ne soit pas opposée à l’ordre moral et qu’elle ne soit pas dangereuse pour l’ordre public), soit garanti le libre exercice des activités de culte – spirituelles, culturelles, éducatives et caritatives – de la communauté des croyants. À la lumière de ces considérations, l’hostilité à toute forme d’importance politique et culturelle accordée à la religion, et à la présence, en particulier, de tout symbole religieux dans les institutions publiques, n’est certainement pas une expression de la laïcité, mais de sa dégénérescence en laïcisme. De même que nier à la communauté chrétienne et à ceux qui la représentent de façon légitime, le droit de se prononcer sur les problèmes moraux qui interpellent aujourd’hui la conscience de tous les êtres humains, en particulier des législateurs et des juristes, n’est pas non plus le signe d’une saine laïcité. »
11. Le Pape fait ici la différence – et les organisateurs du pèlerinage de Paris-Chartres la font avec lui – entre la bonne et la mauvaise laïcité, comme entre la laïcité proprement dite et le laïcisme. Le laïcisme n’est pas légitime, dans la mesure où il exclut absolument toute expression religieuse dans le domaine public. La laïcité en revanche reconnaît à la religion son importance publique et sociale, à condition qu’elle ne soit pas opposée à l’ordre moral et qu’elle ne soit pas dangereuse pour l’ordre public. Le régime de la saine laïcité est donc celui où l’État fait reposer l’ordre moral de la société sur ses véritables bases. Ces bases sont celles de la religion, dans la mesure où la religion est l’expression de la loi du Créateur – et donc dans la mesure aussi où la religion s’exprime à travers toutes les religions, dont l’Église, mais pas seulement. Et Benoît XVI termine en faisant remarquer que l’Église elle-même ne désire intervenir dans le domaine social que pour assurer la promotion de cet ordre moral, et coopérer ainsi avec l’État à la promotion de la dignité de la personne humaine et de ses droits. « Il ne s’agit pas d’une ingérence indue de l’Église dans l’activité législative, propre et exclusive de l’État, mais de l’affirmation et de la défense des grandes valeurs qui donnent un sens à la vie des personnes et qui en préservent la dignité. Ces valeurs, avant d’être chrétiennes, sont humaines, c’est-à-dire qu’elles ne laissent pas indifférente et silencieuse l’Église, qui a le devoir de proclamer avec fermeté la vérité sur l’homme et sur son destin. » Bref, c’est toujours le même principe : l’Église conciliaire de Vatican II, par la bouche de Benoît XVI renonce ici à la juridiction de l’Église sur les États, pour s’en tenir à un régime de liberté d’expression religieuse, en faveur de la morale naturelle.
12. La même idée se retrouve encore un an plus tard, dans ce discours d’octobre 2007 : « De cette façon se réalise, en effet, le principe énoncé par le Concile Vatican II, selon lequel « la communauté politique et l’Église sont indépendantes l’une de l’autre et autonomes. Mais toutes deux, quoique à des titres divers, sont au service de la vocation personnelle et sociale des mêmes hommes » (Gaudium et spes, n. 75). Ce principe, présenté avec autorité également par la Constitution de la République italienne (cf. art. 7), fonde les relations entre le Saint-Siège et l’État italien, comme il est rappelé également dans l’Accord qui, en 1984, a apporté des modifications au Concordat du Latran. Dans celui-ci sont ainsi réaffirmées tant l’indépendance et la souveraineté de l’État et de l’Église, que la collaboration réciproque pour la promotion de l’homme et du bien de la communauté nationale tout entière. En poursuivant ce but, l’Église ne se propose pas des objectifs de pouvoir ni ne prétend de privilèges, ou aspire à des situations d’avantages économique et social. Son unique objectif est de servir l’homme, en puisant, comme norme suprême de conduite, aux paroles et à l’exemple de Jésus Christ qui « a passé en faisant le bien et en guérissant tous » » (Ac 10, 38). C’est pourquoi, l’Église catholique demande à être considérée en vertu de sa nature spécifique et de pouvoir accomplir librement sa mission particulière pour le bien non seulement des fidèles, mais de tous les Italiens. C’est précisément pour cela, comme je l’ai affirmé l’an dernier à l’occasion du Congrès ecclésial de Vérone, que l’« Église n’est pas et n’entend pas être un agent politique. Dans le même temps, elle a un intérêt profond pour le bien de la communauté politique, dont l’âme est la justice et elle lui offre à un double niveau sa contribution spécifique » (Insegnamenti de Benoît XVI, II, 2, [2006], p. 475). Je forme de tout cœur le vœu que la collaboration entre toutes les composantes de la bien-aimé nation que vous représentez, contribue non seulement à préserver jalousement l’héritage culturel et spirituel qui vous caractérise et qui est une partie intégrante de votre histoire, mais soit encore plus un encouragement à rechercher des voies nouvelles pour affronter de façon adéquate les grands défis qui caractérisent l’époque post-moderne. Parmi ceux-ci, je me limite à citer la défense des droits de la personne et de la famille, la construction d’un monde solidaire, le respect de la création, le dialogue interculturel et interreligieux [16].»
5. Un pèlerinage « de saine laïcité »
13. Il est alors bien difficile de parler encore de chrétienté. C’est pourtant ce qu’ambitionne le livret du pèlerinage des communautés Ecclesia Dei, lorsqu’il prétend que « Benoît XVI, en fait, redéfinit ce qu’est la vraie laïcité, base de la chrétienté : une distinction entre les deux pouvoirs, tout en demandant que le pouvoir temporel soit irrigué par le pouvoir spirituel ». À ceci près que le pouvoir spirituel, ici, dans la pensée du prédécesseur de François, ce n’est pas seulement l’Église, mais c’est toute religion, libre de s’exprimer au profit d’un ordre social naturaliste. La nouvelle chrétienté, basée sur la saine laïcité de Benoît XVI, n’est autre que la société pluraliste de Lamennais, déjà condamnée par le Pape Grégoire XVI dans l’Encyclique Mirari vos de 1830 et proposée comme idéal au Pape Paul VI, lors du concile Vatican II, par Jacques Maritain. Le Père Julio Meinvielle en a dressé la critique théologique définitive dans son maître livre De Lamennais à Maritain, un ouvrage classique et fondamental, dont Mgr Lefebvre recommandait la lecture à ses prêtres et à ses séminaristes.
14. Mais c’était avant les sacres du 30 juin 1988. Depuis, les bénédictins du Barroux et les dominicains de Chéméré-le-Roi se sont fait les apologistes de la liberté religieuse, et ce sont eux qui diffusent la nouvelle doctrine sociale de l’Église auprès des chefs de chapitre d’un pèlerinage de « nouvelle chrétienté », qui pourrait désormais se revendiquer tout autant comme un pèlerinage « de saine laïcité ». Voilà bien la preuve de ce que nous remarquions [17] : la dualité de pèlerinage n’est pas seulement une dualité de parcours ; elle est beaucoup plus une dualité de doctrines.
Abbé Jean-Michel Gleize
Source : Courrier de Rome n°622
- Cf. GARRIGOU-LAGRANGE, De revelatione, T. I, 3e édition de 1926, p. 76–78[↩]
- LÉON XIII, Immortale Dei dans Acta sanctæ Sedis, T. XVIII (1885), p. 166.[↩]
- SAINT THOMAS D’AQUIN, Somme théologique, 2a2æ pars, question 60, article 6, 3e objection et ad 3.[↩]
- LÉON XIII, Immortale Dei dans Acta sanctæ Sedis, T. XVIII (1885), p. 166–167.[↩]
- Au chapitre XI, n° 639–640 de l’édition Pollet.[↩]
- SAINT PIE X, Lettre Encyclique Singulari quadam du 24 septembre 1912 dans Acta apostolicæ Sedis, T. IV (1912), p. 658.[↩]
- ID., Lettre aux archevêques et évêques français Notre charge apostolique du 25 août 1910 dans Acta apostolicæ Sedis, T. II (1910), p. 612.[↩]
- Proposition condamnée n° 3, DS 943.[↩]
- Proposition condamnée n° 5, DS 2605.[↩]
- Proposition condamnée n ° 19, DS 2919.[↩]
- SAINT PIE X, Lettre encyclique Vehementer nos du 11 février 1906 dans Acta sanctæ Sedis, T. XXXIX (1906), p. 12–13.[↩]
- LÉON XIII, Immortale Dei dans Acta sanctæ Sedis, T. XVIII (1885), p. 166–167 ; PIE XI, Divini illius magistri du 31 décembre 1930 dans Acta apostolicæ Sedis, T. XXII, p. 53.[↩]
- CHARLES JOURNET, La Juridiction de l’Église sur la cité, ch. VI, p. 145–171.[↩]
- BENOÎT XVI, « Exhortation apostolique Ecclesia in Medio Oriente du 14 septembre 2012 », § 26 dans DC n° 2497, p. 846.[↩]
- DC n° 2375, p. 214–215.[↩]
- BENOÎT XVI, « Discours à M. Antonio Zanardi, nouvel ambassadeur d’Italie, le 4 octobre 2007 » dans DC n° 2389, p. 935–936.[↩]
- Cf. l’article « Face à face » dans le présent numéro du Courrier de Rome.[↩]