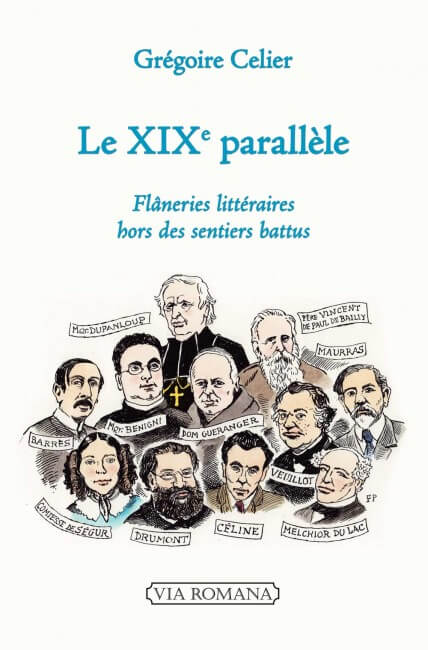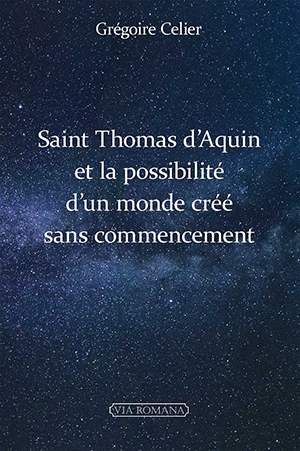L’abbé Grégoire Celier, de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X a accordé un entretien au site Internet Le Rouge et le Noir. Qu’est-ce que le droit canonique ? Quel jugement porter sur ses évolutions récentes ? Comment la Fraternité Saint-Pie X est-elle juridiquement organisée ? Entretien reproduit avec l’aimable autorisation du site Le Rouge et le Noir.
Pourquoi les questions d’ordre canonique ne semblent-elles pas intéresser les laïcs catholiques ? Sont-ce des débats qui passionnent uniquement les clercs ?
Tout simplement parce qu’il s’agit de droit, et que cette matière n’attire spontanément qu’une fraction de l’humanité. Ne soyez d’ailleurs pas dans l’illusion : une partie des clercs se met également à bailler dès que l’on aborde des questions canoniques.
Pourtant, comme le disait l’abbé Louis Coache (1920–1994), docteur en droit canonique et grand combattant de la Tradition catholique, le droit canonique a vocation à être « aimable », en d’autres termes digne d’être aimé. Tout simplement parce qu’il s’agit du recueil des lois qui, dans l’ordre externe (le droit ne porte pas en soi sur les dispositions internes), sont établies pour favoriser le salut éternel des âmes, donc pour procurer leur vrai bonheur.
C’est en ce sens que le Code de Droit canonique promulgué en 1983, que nous contestons par ailleurs en plusieurs de ses dispositions (nous nous référons plutôt au Code promulgué en 1917), se termine, en son ultime canon (ou article de loi, si vous préférez), par cette belle et opportune formule : « …sans perdre de vue le salut des âmes, qui doit être dans l’Église la loi suprême ».
Le droit canonique (ou ecclésiastique) est également intéressant dans la mesure où il est l’héritier d’une longue tradition d’étude, de réflexion et de confrontation avec une réalité complexe : à ce titre, il est d’une rare subtilité, et promet à celui qui l’étudie les plaisirs toujours renouvelés de la découverte de règles puissamment efficaces et cohérentes, sous une enveloppe à certains égards un peu austère.
Quelles sont les principales évolutions du droit canonique depuis les débuts de l’Église ? Les mutations récentes et à venir vous semblent-elles problématiques ?
Pour résumer, il s’est constitué au fil du temps un ensemble de recueils de lois ecclésiastiques, promulguées par diverses instances (les papes, les conciles, etc.), qui ont été rassemblés dans un ouvrage appelé Corpus Juris canonici. Ce document complexe, d’une autorité législative non clairement définie, a servi de base durant des siècles à la vie juridique de l’Église latine (les Églises catholiques d’Orient possèdent des formes juridiques en partie différentes), et il a été enseigné et commenté par les professeurs de droit canonique dans les universités.
Mais on se plaignait de ses défauts et, au XIXe siècle, le Code civil napoléonien est devenu un modèle et un standard tant pour les États que pour l’Église, en raison de sa clarté, de sa simplicité et de sa commodité. On désirait arriver à un tel résultat pour le droit canonique, mais l’entreprise était colossale car, comme pour la France post-révolutionnaire, il s’agissait de conserver le meilleur de la tradition juridique tout en la réécrivant complètement. C’est finalement le pape Pie X qui a pris le problème à bras-le-corps, trouvant l’homme de la situation, à savoir Mgr Gasparri, un canoniste érudit, doué d’une grande puissance de travail, de la capacité de faire travailler ensemble des personnes très différentes, et d’un sens étonnant de la synthèse. Toutefois, le saint pontife est mort en 1914 avant d’avoir vu l’achèvement complet de son projet, qui a finalement été publié en 1917 par son successeur, le pape Benoît XV, sous le titre Codex Juris canonici : c’est pourquoi on l’appelle usuellement le Code pio-bénédictin.
A l’occasion du concile Vatican II, il a été décidé de réviser et de refondre ce Code de 1917. Cela a abouti, vingt ans plus tard, à la promulgation en 1983 d’un nouveau Codex Juris canonici. Comme l’écrivait le pape Jean-Paul II, dans la Constitution par laquelle il le promulguait, « ce Code a mis en acte l’esprit du concile Vatican II ». Il est donc justiciable des mêmes critiques que celles que nous adressons au Concile lui-même. Beaucoup de canons, certes, sont identiques à ceux du Code de 1917, ou ne constituent qu’une intégration de la jurisprudence élaborée jusqu’à Pie XII. Mais certains canons sont assez nettement déviants, et l’esprit général de ce nouveau Code est plutôt mauvais.
Quel est le rôle des nonces apostoliques ? Ont-ils plus de pouvoirs que les évêques et les cardinaux ?
Un nonce apostolique est au premier chef « l’ambassadeur » du Saint-Siège auprès d’un pays. Contrairement à ce que croient certains, il ne représente pas l’État du Vatican (qui, dans sa forme actuelle, ne date que de 1929, alors que les nonces existent depuis quinze siècles), mais bel et bien l’Autorité suprême de l’Église catholique, à savoir la Papauté. A ce titre, il assure les relations diplomatiques entre le Siège apostolique et l’État auprès duquel il est accrédité, pour toutes les questions qui peuvent se poser (l’ambassadeur dudit État auprès du Vatican faisant le travail inverse).
A titre secondaire, le nonce est le représentant du Saint-Siège auprès de l’Église locale, principalement les évêques du pays. Mais il n’a pas, au sens propre, d’autorité sur les chrétiens du pays et sur la hiérarchie ecclésiastique : il écoute, il transmet des rapports, il informe qui de droit au Vatican comme dans le pays où il réside, mais il ne peut donner d’ordre ni prendre lui-même quelque sanction que ce soit. C’est donc un rôle en bonne partie informel, qui possède néanmoins une grande importance dans le « jeu » ecclésiastique.
Par exemple, Mgr Roncalli (futur Jean XXIII) fut nommé nonce à Paris en 1944, avec pour mission principale de gérer la question de l’épiscopat français, puisque le Gouvernement provisoire exigeait le départ d’un grand nombre de prélats jugés trop compromis avec le régime du maréchal Pétain. Par son habileté, le nonce obtint du gouvernement que l’épuration ne touche que six évêques (au lieu d’une trentaine), et réussit à convaincre ces « sacrifiés » de donner leur démission plutôt que d’être relevés de leurs fonctions par le Vatican. Pourtant, à aucun moment, ces décisions ne furent prises directement et officiellement par lui.
Le droit canonique permet une bonne organisation au sein de l’Église. Mais existe-t-il des règles qui régissent les rapports avec l’extérieur, notamment avec les autres États ? Comment l’Église doit-elle concevoir sa politique étrangère ?
Le Code de Droit canonique est la partie la plus visible et la plus usuelle du droit ecclésiastique. Mais il existe de nombreuses autres lois dans l’Église, qui statuent sur des matières particulières : par exemple, le processus d’élection du Souverain Pontife n’est pas contenu dans le Code, mais fait l’objet de documents juridiques spécifiques.
Dans ses relations avec les États (non pas avec les « autres États » car, comme il a été dit, c’est le Siège apostolique qui agit, non pas l’État du Vatican), l’Église use de divers instruments juridiques, dont le plus connu est le concordat. Le canon 3 du Code précise d’ailleurs que les dispositions d’un concordat priment sur les canons du Code. Ainsi, en France, les quatre fêtes d’obligation (Ascension, Assomption, Toussaint et Noël) ne correspondent pas à celles du Code (qui compte dix fêtes d’obligation), mais sont issues des dispositions concordataires de 1801–1802.
Toutefois, les diverses conventions juridiques ne sont qu’une faible partie de ce que vous appelez la « politique étrangère » de l’Église. En vérité, c’est chaque jour qu’à divers niveaux, par le biais du Pape lui-même, de la Curie romaine, des nonces, des évêques, des prêtres, des organisations catholiques, des fidèles, l’Église prend contact avec les institutions civiles pour informer, discuter, réclamer, protester, négocier, expliquer, contester, répondre aussi quelquefois en justice, etc.
Le but de cette « politique étrangère », en soi, est de rendre plus facile le salut des âmes. Mais les circonstances sont si infiniment variées que tout ce qu’on peut imaginer comme situations a déjà été mis en œuvre ou le sera demain. Par ailleurs, les gens d’Église sont des hommes qui s’adressent à d’autres hommes : et parce que les êtres humains sont faibles, les moyens employés pour faire « avancer le Royaume de Dieu » peuvent quelquefois être discutables, contre-productifs, inefficaces, scabreux, louches, voire immoraux. Comme l’écrivait Dom Guéranger (1805–1875), le restaurateur de Solesmes, en une formule que j’aime beaucoup, « l’histoire ecclésiastique est belle en perspective, mais les détails vus de trop près ne sont pas toujours attrayants ».
La Fraternité sacerdotale Saint-Pie X ne possède pas de statut canonique. Pour autant, les sacrements célébrés par les prêtres de ladite Fraternité, comme la confession ou les mariages, sont proclamés licites par le Pape. N’est-ce pas là une contradiction ?
La Fraternité Saint-Pie X ne possède pas de statut canonique pleinement reconnu par Rome, c’est vrai. Mais elle possède évidemment en soi un statut canonique, c’est-à-dire une structure juridique ecclésiastique, sinon elle n’existerait tout simplement pas. Par ailleurs, Rome lui reconnaît au moins un statut juridique de fait, sans quoi toute discussion serait impossible et absurde. Enfin, nous avons toujours contesté de la façon la plus vigoureuse la prétendue et illégale « suppression » de la Fraternité Saint-Pie X en 1975 : à ce titre, la Fraternité Saint-Pie X continue à exister dans l’Église selon le statut qu’elle possédait à l’époque, et ceci sera un jour reconnu officiellement par Rome, comme a été reconnue en 2007 la pleine licéité de la messe traditionnelle, après quatre décennies de négationnisme.
Ce qui est vrai, c’est que durant cet « entre-deux juridique », le Siège apostolique agit en certaines circonstances vis-à-vis de la Fraternité Saint-Pie X comme si elle était une congrégation normale, voire plus qu’une congrégation puisque, dans le cas de la juridiction pour les confessions et l’onction des malades, par exemple, le Pape est carrément passé au-dessus de la tête des évêques diocésains, comme si la Fraternité Saint-Pie X était une sorte « d’Église rituelle » ou de « diocèse mondial ».
Il faut dire que le Souverain Pontife actuel ne s’embarrasse pas de subtilités juridiques : du moment qu’il veut quelque chose, il le décide, estimant que « l’intendance suivra ». Ce qui, d’un point de vue strictement canonique, aboutit à des situations plutôt baroques.
Même l’affaire des mariages, où il a respecté cette fois l’autorité des évêques diocésains, est étonnante : les évêques peuvent donner la délégation pour marier selon les normes ordinaires du droit, à des prêtres auxquels, par ailleurs, ils ne donnent, ni ne veulent donner, ni ne peuvent donner (selon leurs fausses conceptions) aucune juridiction.
Comment la Fraternité Saint-Pie X est-elle organisée en interne du point de vue juridique ?
Aux termes du Code de 1983, qui a opéré une clarification fondée sur la jurisprudence élaborée jusqu’à Pie XII, nous sommes une « société de vie apostolique », que le droit définit comme une société « dont les membres, sans les vœux religieux, poursuivent la fin apostolique propre de leur société et, menant la vie fraternelle en commun, tendent, selon leur mode de vie propre, à la perfection de la charité par l’observation des constitutions ».
Nous ne sommes donc pas des religieux ayant fait les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance. Mais par notre état sacerdotal, nous sommes tenus à la chasteté. Et par notre état de membres d’une société de vie commune, nous sommes tenus à l’obéissance à nos supérieurs (bien que ce ne soit pas sous forme de vœu). C’est donc la question de la pauvreté qui nous distingue réellement des religieux, même si, comme prêtres configurés au Christ, nous devons avoir l’esprit de pauvreté. Mgr Marcel Lefebvre (1905–1991), le fondateur de la Fraternité Saint-Pie X, qui était lui-même religieux spiritain missionnaire, s’était en effet aperçu, dans les missions, de la difficulté de respecter le vœu de pauvreté lorsqu’on gère un apostolat complexe loin des supérieurs. C’est pourquoi il a volontairement choisi de ne pas nous constituer en société religieuse.
D’un autre côté, nous ne sommes pas des prêtres diocésains, alors pourtant que nous accomplissons un apostolat semblable au leur. En effet, statutairement, nous vivons en communauté et sous la direction de supérieurs immédiats, qui nous commandent à la fois dans notre vie personnelle et dans notre apostolat. Un curé de paroisse peut vivre seul dans son presbytère en ne dépendant que de l’évêque (qui parfois est bien loin) ; un membre de la Fraternité Saint-Pie X vit dans un prieuré avec d’autres confrères, en étant soumis à l’autorité du prieur, lui-même soumis à l’autorité du Supérieur de District (c’est-à-dire, habituellement, du pays), lui-même soumis à l’autorité du Supérieur général.
Ce qui fait la spécificité d’une société de vie apostolique comme la Fraternité Saint-Pie X, c’est qu’elle constitue un corps organisé, où chaque membre agit selon le commandement des supérieurs, desquels il reçoit en retour les impulsions pour se sanctifier, afin d’atteindre la fin propre de l’institut, que l’on pourrait résumer en notre cas comme le règne du Christ-Roi par le saint sacrifice de la messe.
Source : Le Rouge et le Noir