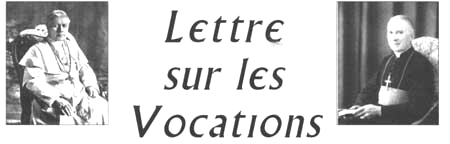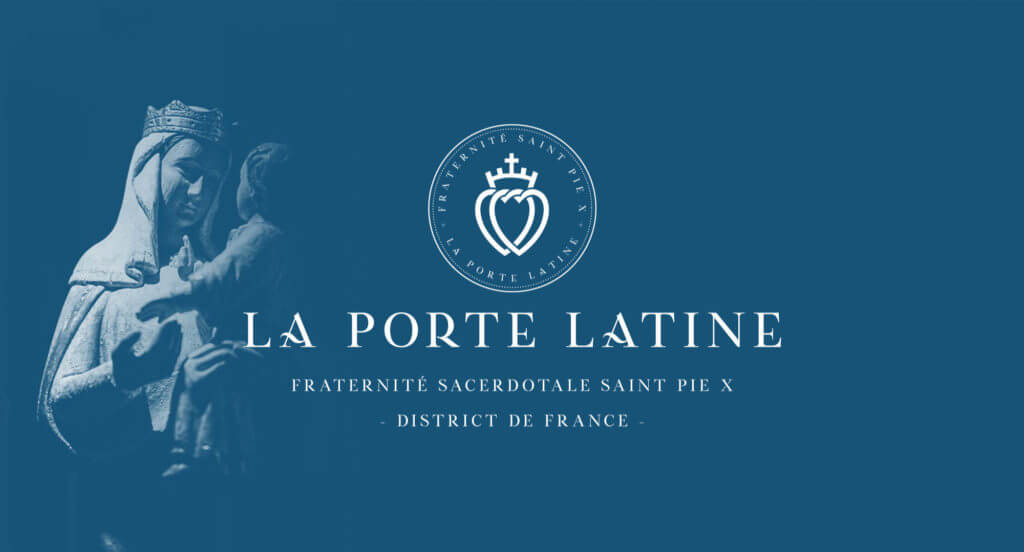Au cours de sa longue vie de missionnaire, Monseigneur Lefebvre eut l’occasion d’expérimenter toute la difficulté pratique de son vœu de pauvreté exposé à des situations souvent déroutantes. Partagé entre son désir de toujours demeurer fidèle aux exigences de son vœu et la nécessité de prendre des décisions rapides, il garda de ce dilemme un souvenir qui contribua à lui faire écarter de l’état religieux les prêtres de la Fraternité.
L’apostolat moderne expose constamment les religieux de vie active à contrevenir à leur vœu de pauvreté.
Ce choix décisif de notre fondateur, s’il tient certainement à ce premier motif, repose surtout sur une profonde conviction intérieure ainsi résumée par son biographe :
Monseigneur Lefebvre explique souvent à ses prêtres pourquoi il n’éprouve pas le besoin de faire d’eux des religieux : comme saint Jean Eudes, il est convaincu que, mieux que des religieux, les prêtres trouvent dans la seule dignité dont ils sont revêtus la raison et les moyens de s’élever à la plus éminente perfection.
Marcel Lefebvre, Une vie, p. 461
Un tel jugement s’enracine en particulier dans cette question où saint Thomas d’Aquin traite de « l’entrée en religion ». Il y écrit en effet que :
Les Ordres sacrés exigent au préalable la sainteté tandis que l’état religieux n’est qu’un exercice en vue de l’acquérir.
S.T. Ia IIae q.189 a1 ad3
Si nous pouvons utilement relire cette conclusion pour notre confusion, nous la voyons également comme un excellent stimulant propre à nous rappeler les exigences de sanctification requises par notre état sacerdotal.
Non seulement un prêtre n’a pas besoin d’être religieux pour devoir tendre à la perfection, mais il doit s’y appliquer davantage qu’un religieux en raison des Ordres qu’il reçoit. Quant au prêtre qui est également religieux, il sait bien que son appel à la perfection tient davantage à son identité sacerdotale qu’à sa consécration religieuse. Aussi ce serait le signe d’un singulier obscurcissement de l’esprit que les prêtres séculiers se sentissent moins contraints à la sainteté au motif qu’ils ne seraient pas religieux.
Notre fondateur, puisqu’il n’a pas fait de nous des religieux tout en désirant ardemment notre sainteté, veut donc que nous découvrions toute la nécessité de celle-ci dans la seule méditation des grandeurs sacerdotales. Voilà qui ne doit pas nous étonner chez celui qui reçut précisément la mission de sauvegarder le sacerdoce et d’en restaurer la sainteté. C’est donc encore la mission de la Fraternité de démontrer au reste de l’Église que la contemplation des grandeurs sacerdotales doit surabondamment suffire au prêtre pour l’entraîner vers les sommets de la perfection.
Cette confiance en la puissance de l’idéal sacerdotal ne nous émeut pas moins que celle qu’il nous fit, à nous autres, en croyant que nous aussi, nous ne serions pas infidèles à la sublime dignité de notre vocation. La fécondité missionnaire de la Fraternité découle certainement de cette conscience sans cesse rajeunie que nous en conservons :
Tel est en effet, l’objet principal de nos pensées et de nos sollicitudes ; les yeux levés au ciel, nous renouvelons souvent, pour tout le clergé, la supplication même de Jésus-Christ : « Pater Sancte… sanctifica eos ».
Saint Pie X dans Haerent animo
Abbé Régis de Cacqueray-Valménier †
Supérieur du District de France