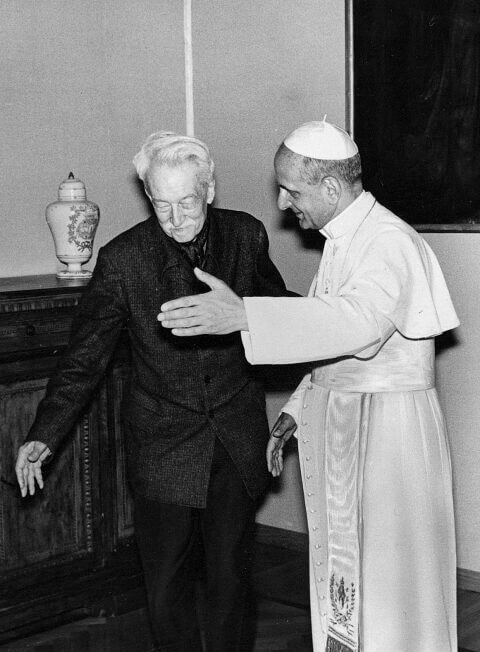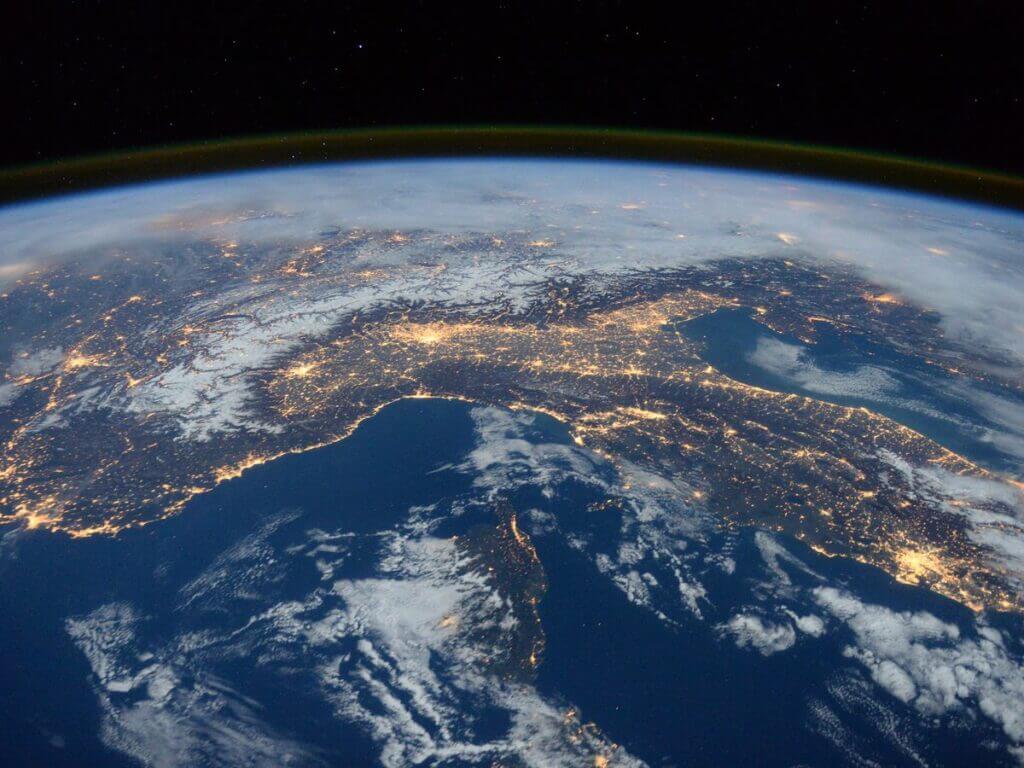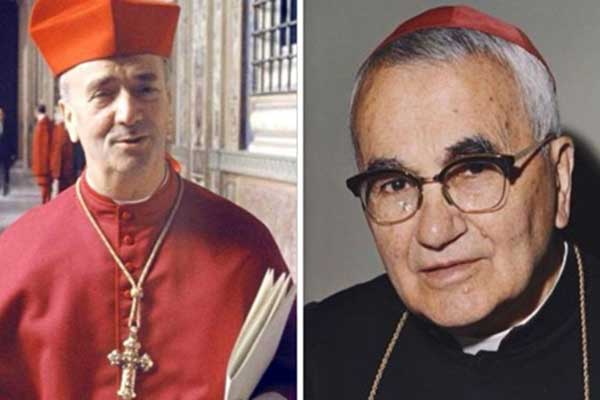Peut-on déduire des décisions de l’Index une condamnation par l’Eglise de la doctrine de l’évolution ? 2. L’étude des cas soumis à l’Index montre une Congrégation prudente et circonspecte dans ses jugements
L’histoire, la structure, les procédures et l’autorité de la congrégation de l’Index ayant été rappelées dans l’article précédent, passons à l’examen des 6 auteurs suspectés de vouloir concilier foi catholique et évolution.
2. Raffaello Caverni (1837–1900)
2.1 Prodromes
Né à San Quiricio di Montelupo le 12 mars 1837, Raffaello Caverni est ordonné prêtre à Firenzuola le 2 juin 1860. D’abord professeur de physique et de mathématique pendant dix ans, il devient curé de Quarate près de Florence en 1870.
Entre 1875 et 1876, il publie dans Rivista Universale une série d’articles consacrés à la philosophie des sciences naturelles, réunis en un seul volume publié l’année suivante : Nouvelles études de philosophie. Discours à un jeune étudiant. Le prêtre y dit sa conviction qu’évolutionnisme et doctrine catholique sont conciliables. A ses yeux, l’évolution —qui n’affecte pas l’être humain— est nécessairement guidée et finalisée par la Providence. Don Caverni propose de distinguer dans la Bible une partie divine —qui est infaillible car elle a pour objet les vérités de foi— et une partie humaine —qui est faillible car elle rapporte les notions acquises par la science. Persuadé que les croyants n’ont rien à craindre de la vraie science, il enjoint aux scientifiques de s’en tenir à l’étude des réalités matérielles.
Le P. Francisco Salis-Seewis publie une recension critique de l’ouvrage dans La Civiltà Cattolica[1]. Dans la première partie, le jésuite reproche à don Caverni sa présentation réductrice de l’inspiration biblique. Dans la seconde, il fait deux objections majeures à l’évolution. D’abord, le caractère athée et matérialiste de l’évolutionnisme qui prétend expliquer la nature sans faire référence à Dieu. Ensuite, le matérialisme qui résulte de l’inclusion de l’homme dans le phénomène de l’évolution. Don Caverni a certes tâché d’éviter ces deux écueils, mais le P. Salis-Seewis juge ses efforts insuffisants.
2.2 Procédure
L’ouvrage de don Caverni est examiné par la congrégation de l’Index selon la procédure habituelle :
[A] A l’automne 1877, l’ouvrage de don Caverni est dénoncé à l’Index par son propre archevêque, Mgr Eugenio Cecconi, qui joint au dossier deux études critiques faites par son clergé.
[B] Le secrétaire de l’Index —le P. Girolamo Pio Saccheri— demande au P. Thomas Marie Zigliara d’examiner l’ouvrage. Le 25 mai 1878, le dominicain rend un rapport de 19 pages dans lequel il examine successivement le darwinisme, l’interprétation de la Genèse et l’origine de l’homme[2]. Pour finir, le P. Zigliara propose de mettre l’ouvrage à l’Index et d’exiger de l’auteur sa soumission et l’assurance qu’il renonce à publier sur le même thème.
[C] La Congrégation Préparatoire se réunit le 27 juin en présence du secrétaire, du maître du Sacré Palais et de 13 consulteurs. Les participants émettent le vœu que l’ouvrage soit mis à l’Index et que le décret soit publié après avoir obtenu la soumission de l’auteur.
[D] La Congrégation Générale se déroule le 1er juillet en présence du secrétaire, du maître du Sacré Palais et de 9 cardinaux. Il est décidé de mettre l’ouvrage à l’Index, de publier le décret après avoir obtenu la soumission de l’auteur et d’obtenir qu’il renonce à publier dans ce domaine[3].
[E] Le décret est approuvé par Léon XIII le 10 juillet. Deux jours plus tard, Mgr Amerigo Barsi —vicaire général du diocèse de Florence— en communique la teneur à l’auteur qui envoie dès le lendemain une lettre de soumission à son archevêque. Le décret est publié le 31 juillet par la congrégation de l’Index[4].
3. Marie-Dalmace Leroy (1828–1905)
3.1 Prodromes
Né à Marseille en 1928, François-Marie Leroy est ordonné prêtre le 21 décembre 1850. Entré dans l’Ordre dominicain le 28 août 1851, il y reçoit le nom de Dalmace et prononce ses vœux solennels un an plus tard. Il exercera entre autres les fonctions de sous-maître des novices et de prieur du couvent de Flavigny (1864–1867).
Publié initialement en 1887, l’ouvrage L’évolution des espèces organiques est réédité, corrigé et augmenté, en 1891 sous le titre L’évolution restreinte aux espèces organiques. Le P. Leroy y dit sa conviction que foi et science ne sauraient se contredire, que l’évolutionnisme est compatible avec le christianisme pourvu qu’il reste dans le domaine de la science et ne se mue pas en une philosophie matérialiste et athée, que l’évolution restreinte n’est contredite ni par l’Écriture, ni par la Tradition, ni par le magistère de l’Église, ni par les théologiens.
Contrairement à l’intention affichée dans le titre de l’ouvrage et au chapitre 2 —intitulé « L’évolution restreinte et la foi »—, le P. Leroy finit par aborder les rapports entre évolution et corps humain au chapitre 10. A ses yeux, une fois établie l’existence d’une âme spirituelle et immortelle, peu importe l’origine du corps humain. Celui-ci n’est pas le produit de l’évolution mais de l’infusion de l’âme par Dieu. Reste à savoir si la matière unie à l’âme vient directement de Dieu ou résulte de l’évolution. Sans adopter la 2e option, le P. Leroy en examine la compatibilité avec la foi[5]).
Nonobstant les louanges reçues[6], la première édition de l’ouvrage déclenche un tir de barrage de la part des PP. Joseph de Bonniot[7] et Joseph Bruckner[8]. Le P. Leroy profite de la réédition de son livre en 1891 pour répondre aux objections du second jésuite Bruckner, lequel s’empresse de publier une recension de cette réédition dans les Études[9].
A peine fondée, la Revue Thomiste publie en 1893–1894 une série d’articles consacrés à l’évolution[10]. Le P. Ambroise Gardeil y cite favorablement les livres du P. Leroy. Les Études manifestent sans tarder leur réprobation sous la plume du P. Eugène Portalié[11]. La Revue Thomiste publie alors une lettre du P. Leroy dans laquelle celui-ci réitère sa conviction qu’évolution du substrat et évolution de l’organisme humain sont deux choses distinctes[12].
3.2 Procédure
L’ouvrage du P. Leroy va être examiné par la congrégation de l’Index selon la procédure habituelle mais avec plusieurs va-et-vient :
[A] Le 20 juin 1894, l’officier d’académie Ch. Chalmel dénonce l’ouvrage du P. Leroy dans une lettre adressée à l’Index.
[B1] Le secrétaire de l’Index —le P. Marcolino Cicognani— demande au P. Teofilo Dominichelli. de rédiger un rapport préliminaire. Le 30 août, le franciscain rend un rapport de 27 pages dans lequel il examine la réédition de 1891[13]. Plutôt bénin, le rapport admet qu’une interprétation métaphorique des premiers chapitres de la Genèse est possible et suggère de condamner les erreurs avant les livres qui les propage. Au final, le franciscain suggère de ne rien faire.
[C1] La Congrégation Préparatoire se réunit le 13 septembre en présence du secrétaire, du maître du Sacré Palais et de 7 consulteurs. Tous sont d’avis qu’il faut solliciter l’avis d’un consulteur supplémentaire.
[D1] La Congrégation Générale se déroule le 19 septembre en présence du cardinal préfet Serafino Vannutelli, du secrétaire, du maître du Sacré Palais et de 4 cardinaux. Ils décident de demander l’avis de deux nouveaux consulteurs. Le 3 octobre, le secrétaire s’adresse à Mgr Ernesto Fontana et à don Luigi Tripepi dont l’examen devra porter sur 3 points : les critères exégétiques d’interprétation de la Genèse, la théorie de l’évolution des espèces organiques soutenue par Leroy et sa vision de la formation du premier homme.
[B2] Le 24 octobre, Mgr Fontana —récemment nommé évêque de Crema— rend un bref rapport de 5 pages. A son avis, l’ouvrage quoique dangereux ne devrait pas être condamné (car il ne contient rien contre la foi et les mœurs) et l’auteur devrait être admonesté (car il interprète l’Écriture contre le sens communément reçu).
[B3] Le 8 décembre, don Tripepi remet un long rapport de 54 pages. Du point de vue scientifique, il estime que l’évolutionnisme est une hypothèse sans fondement sérieux. Du point de vue doctrinal, il reproduit le manuel De Deo creante du cardinal Mazzella, lequel distingue une triple action créatrice visant à la formation de la matière, d’Adam et d’Eve. Le consulteur s’attache également à montrer que les théologiens, le magistère, les Pères de l’Église et l’Écriture rejettent l’évolutionnisme. Du point de vue exégétique, il note que le sens métaphorique des premiers chapitres de la Genèse n’étant requis par aucun passage de l’Écriture, on doit s’en tenir au sens littéral.
Certains excès fragilisent toutefois sa démonstration. Il n’hésite pas en effet à affirmer : a) que St George Mivart a été mis à l’Index en raison de son évolutionnisme[14] ; b) que le magistère aurait toujours et partout enseigné la formation du corps humain par une action immédiate de Dieu, mais sans citer aucun texte, hormis un canon du concile provincial de Cologne de 1860 ; c) que le consensus des théologiens jouit de la même valeur magistérielle que le magistère ordinaire et universel de l’Église,
Au final, don Trepepi propose soit de prohiber l’ouvrage, soit d’admonester l’auteur et d’exiger qu’il retire son livre de la vente.
[C2] La seconde Congrégation Préparatoire se réunit le 17 janvier 1895 en présence du secrétaire, du maître du Sacré Palais et de 15 consulteurs. Décision est prise de proscrire le livre et d’inviter l’auteur à se rétracter.
[B4] Sollicité de mettre par écrit les arguments développés lors de cette réunion, le P. Enrico Buonpensiere rédige un 4e rapport le 21 janvier dans lequel le dominicain oppose deux arguments au P. Leroy : l’impossibilité de l’évolution du point de vue empirique et ontologique ; le cas des hybrides qui seraient stériles ou engendreraient des stériles.
[D2] La seconde Congrégation Générale se déroule le 25 janvier en présence du préfet, du secrétaire, du maître du Sacré Palais et de 9 cardinaux. Il est décidé, d’une part, que l’ouvrage doit être proscrit mais sans que le décret soit publié et, d’autre part, que l’auteur doit se rétracter et retirer le livre de la vente[15].
[E] Le décret est approuvé par Léon XIII le 26 janvier. A la demande du Maître de l’Ordre, le P. Leroy publie dans Le Monde du 4 mars une lettre de rétractation rédigée à Rome le 26 février. L’autorité qui lui ordonne cette rétractation n’est pas identifiée. En revanche, le motif est clair : ce qu’il a écrit de la création du corps de l’homme est incompatible avec l’Écriture et la saine philosophie. Le 21 mars, le secrétaire de l’Index enregistre la rétractation de Leroy et sa louable soumission au décret de la Congrégation.
3.3 Prolongements
Le 7 mars, le P. Leroy adresse un courrier de 14 pages au préfet de l’Index dans lequel il soutient que la philosophie ne saurait statuer sur une question de fait qui regarde la science.
[B5] Le 2 février 1897, le P. Leroy sollicite du préfet de l’Index la faveur de pouvoir réimprimer une version amendée de son livre. Il envoie la version amendée de certains passages au secrétaire de l’Index le 13 mars. L’examen du manuscrit est confié au P. Angelo Ferrata. Dans son rapport de 8 pages daté du 16 juin, l’augustin confirme le décret de 1895.
[B6] Le préfet de l’Index demande alors un second examen de la version amendée. Le P. Buonpensiere —déjà auteur d’un jugement négatif le 21 janvier 1895— est désigné pour cette tâche le 19 juin. Dans son rapport de 56 pages remis le 12 août, il se concentre sur les implications théologiques des positions du P. Leroy[16]. Six jours plus tard, l’avis négatif du P. Buonpensiere est communiqué au P. Leroy.
Celui-ci dépose une nouvelle demande de réédition de l’ouvrage amendé en novembre 1901, mais essuie un nouveau refus le 7 janvier 1902. Ce dont il en prend acte le 13 janvier.
4. John A. Zahm (1851–1921)
4.1 Prodromes
Né en 1851 à New Lexington (Ohio), John Augustin Zahm entre en 1871 dans la Congrégation de Sainte-Croix (fondée en France par l’abbé Basile Moreau). Ordonné le 4 juin 1875, il devient professeur de physique à l’Université Notre-Dame (Indiana).
En février 1896, le P. Zahm publie Evolution and Dogma. La première partie du livre esquisse l’origine et l’essor de la théorie de l’évolution ainsi que les arguments pour et contre l’évolution. La deuxième partie examine les rapports entre la théorie de l’évolution et la doctrine catholique. Le P. Zahm y critique les versions matérialiste et agnostique de l’évolution, propose d’y substituer une perspective théiste et réfléchit sur l’origine et la finalité de la vie et de l’homme.
L’évolution n’est pas incompatible avec l’action divine mais al présuppose :
« Pour que l’Évolution fût seulement possible, il fallait que fût survenue au préalable non seulement une création ex nihilo, mais aussi une involution, c’est-à-dire une création in potentia. Supposer que la simple matière brute, par son propre mouvement ou par une capacité inhérente à la matière, puisse avoir été la seule cause efficiente de l’évolution de la matière organique à partir de l’inorganique, des formes supérieures de la vie à partir des formes inférieures, de la créature rationnelle à partir de l’irrationnelle, ce serait supposer qu’une chose est capable de communiquer ce qu’elle ne possède pas, que le plus est contenu dans le moins, le supérieur dans l’inférieur, le tout dans la partie[17]. »
Le P. Zahm évoque quelques anciens dont les principes seraient compatibles avec l’évolution : Aristote[18], saint Thomas (qui distingue Cause Première et causes secondes) et saint Augustin (qui parle de raisons séminales). Il en appelle également à des autorités plus récentes comme Mgr Maurice d’Hulst, le chanoine François Duilhé de Saint-Projet, le P. Marie-Dalmace Leroy[19], le cardinal Zeferino Gonzalez et St George Mivart. Quant aux Pères de l’Église, il n’en attend rien car, la théorie de l’évolution étant récente, ils n’en ont rien dit.
Là où Darwin remplace la finalité par la sélection naturelle (qui est aveugle par définition), le P. Zahm voit dans l’évolution la manifestation d’une forme éminente de finalité. En actualisant sur des millions d’années les potentialités de la matière, l’évolution témoignerait d’un dessein divin bien plus grandiose que si les espèces étaient fixes.
Au final, le P. Zahm alterne remarques intéressantes —sur l’équivocité des termes « genre » et « espèce » selon le contexte, par exemple[20]— et confusions malheureuses —il est incapable de distinguer clairement évolutionnisme et création spécifique, par exemple.
Une première recension élogieuse mais critique de l’ouvrage du P. Zahm paraît dans la Revue des Questions Scientifiques sous la plume du marquis de Nadaillac[21]. Celui-ci reproche au religieux américain de confondre certitude et hypothèse en matière d’évolution.
Nommé procurateur de sa congrégation à Rome en mars 1896, le P. Zahm profite de son séjour européen pour préciser ses vues dans une conférence sur téléologie et évolution prononcée lors du 4e congrès international scientifique des catholiques (Fribourg, 16–20 août 1896)[22].
Les recensions d’Evolution and Dogma se multiplient. Certaines sont favorables comme celle du franciscain David Fleming dans The Dublin Review[23]. D’autres sont plus critiques, comme celle du P. Salis-Seewis dans La Civiltà Cattolica[24].
4.2 Procédure
L’ouvrage Evolution and Dogma du P. Zahm est initialement dénoncé au Saint-Office, mais aucune procédure n’est enclenchée. En témoigne l’exemplaire du livre retrouvé au Saint-Office : seules les 14 premières pages et celles de l’index final ont été découpées[25].
Le libelle du P. Zahm va en revanche être examiné par la congrégation de l’Index selon la procédure habituelle :
[A] Le 5 novembre 1897, l’archevêque Otto Zardetti —ancien évêque de Bucarest, alors résident à Rome— dénonce l’ouvrage du P. Zahm par un courrier de 8 pages adressé à l’Index. Peu après, le P. Zahm —ignorant du fait— quitte Rome pour les Etats-Unis où il vient d’être élu provincial, charge qu’il exercera de janvier 1898 jusqu’en 1906.
[B] Le 25 novembre, le secrétaire de l’Index confie l’étude préliminaire au P. Enrico Buonpensiere, lequel rend un rapport de 53 pages le 15 avril 1898. Pour le dominicain, le P. Zahm se trompe en présentant Aristote, saint Albert le Grand et saint Thomas comme précurseurs de la notion moderne d’évolutionnisme. A ses yeux, la formation du premier homme à partir du limon de la terre par l’action directe et immédiate de Dieu est une thèse théologique fondée sur les conciles provinciaux de Braga I (vers 562–563)[26] et de Cologne (1860)[27].
L’étude du consulteur n’est pas exempte de faiblesse. Familier du raisonnement métaphysique, le P. Buonpensiere reste hermétique à la méthode hypothético-déductive d’un usage pourtant fréquent dans les sciences de la nature. Par ailleurs, il ne saisit pas la distinction opérée par le P. Zahm entre le fait de l’évolution —que ce dernier juge incontestable— et les théories explicatives —qui lui semblent discutables.
Au final, le dominicain recommande d’interdire le livre sans publier le décret de l’Index, d’admonester l’auteur et d’obtenir sa rétractation, et de retirer le livre de la vente. Il propose aussi que l’origine évolutive du corps d’Adam soit une opinion officiellement et explicitement condamnée par les autorités de l’Église.
Le cardinal Andreas Steinhuber —préfet de l’Index— demande au P. Bernhard Döbbing de s’assurer que la traduction italienne est bien conforme à l’original anglais. Dans son rapport du 10 juin, le franciscain atteste de la conformité substantielle des deux manuscrits tout en notant quelques erreurs de traduction ainsi que des gloses ajoutées au texte par le traducteur.
[C] La Congrégation Préparatoire se réunit le 5 août en présence du secrétaire, du maître du Sacré Palais et de 11 consulteurs. Les esprits sont divisés. Certains consulteurs pensent que l’évolutionnisme ne s’oppose à aucun dogme défini et que l’auteur ne devrait qu’être admonesté. D’autres, convaincus que l’Écriture, la Tradition, les théologiens et le Magistère s’opposent à l’évolution, suggèrent que le livre soit versé à l’Index et que le décret soit publié après avertissement de l’auteur. Un dernier consulteur souhaite que l’évolutionnisme soit d’abord condamné doctrinalement.
[D] La Congrégation Générale se déroule le 1er septembre en présence du secrétaire, du maître du Sacré Palais, préfet et de 5 cardinaux. Ils décident de mettre le livre à l’Index, de ne publier le décret après soumission préalable de l’auteur, d’avertir le traducteur de la version italienne de l’interdiction du livre et d’interdire à l’auteur de publier en matière religieuse et théologique sans la censure préalable de l’Ordinaire et du Supérieur Général.
[E] Le décret est approuvé par Léon XIII le 3 septembre. Quinze jours plus tard, le secrétaire de l’Index envoie au P. Gilbert Français —supérieur général de la Congrégation de Sainte-Croix— le décret pour qu’il en communique la teneur au P. Zahm et obtienne sa soumission. Le 4 novembre, le P. Français envoie au préfet de l’Index la soumission du P. Zahm et sollicite la grâce que le décret ne soit pas publié.
4.3 Prolongements
La demande de grâce est transmise à Léon XIII par le cardinal Serafino Vannutelli —ancien préfet de l’Index et ami du P. Zahm— lors d’une audience accordée par le pape le 7 novembre.
Le 3 février 1899, Léon XIII décide que le décret ne sera pas publié avant que le P. Zahm ne soit entendu. Le même jour, on lit dans la chronique de l’Index :
« Durant la même audience, le pape a décidé de suspendre la publication du décret du 1er septembre 1898, qui interdisait le l’ouvrage Evolution and Dogma du P. Zahm, bien que l’auteur se soit louablement soumis et ait réprouvé son livre, jusqu’à ce que le P. Zahm —qui doit arriver prochainement d’Amérique— soit entendu. »
En mars 1899, les Annales de Philosophie Chrétienne publient une recension de la version française du livre parue en 1897. Dans un courrier du 25 avril 1899, le P. Cicognani —secrétaire de l’Index— s’en étonne auprès du P. Français. A la demande de celui-ci, le P. Zahm s’adresse le 16 mai 1899, d’une part, à l’abbé Flageolet —traducteur de la version française— pour qu’il fasse retirer l’édition française du commerce et, d’autre part, au P. Cicognani pour lui certifier qu’il ignorait tout de l’édition française depuis 3 ans. L’éditeur Lethielleux procède sans délai au retrait du livre en échange d’une compensation pécuniaire de l’auteur.
Le P. Zahm adresse un message similaire à Alfonso M. Galea —traducteur de la version italienne. Or cette missive —de caractère privé— est publiée le 31 mai dans Gazzetta di Malta accompagnée d’une lettre de A. Galea. Les deux documents sont reproduits sans commentaire dans La Civiltà Cattolica du 22 juin et dans le Daily Tribune de New York du 2 juillet.
Au final, le P. Zahm ne viendra jamais à Rome pour s’expliquer de vive voix et la lettre privée publiée à Malte sera désormais considérée comme équivalente à la rétractation imposée par l’Index.
A suivre
Source : Courrier de Rome n° 683 – février 2025
- Francisco Salis-Seewis, « Rivista de la stampa italiana : “De’ nuovi studi della Filosofia. Discorsi di Raffaello Caverni a un giovane studente” », La Civiltà Cattolica, série 10, vol. 4, 1877, p. 570–580 et vol. 5, 1878, p. 65–76.[↩]
- Il critique au passage la réduction des animaux à des automates opérée par don Caverni.[↩]
- Cela n’empêchera pas don Caverni de publier en 1881 Dell’antichità dell’uomo secondo la scienza moderna sur l’origine de l’homme.[↩]
- A la fin du décret, on peut lire la mention suivante : « Auctor laudabiliter se subjecit et opus reprobavit — L’auteur s’est louablement soumis et a réprouvé son œuvre » (Acta Santæ Sedis, n° 11, 1878, p. 204).[↩]
- « D’une part, [Leroy] niait que le corps humain résulte d’une évolution à partir des animaux inférieurs et, d’autre part, il soutenait que l’évolution avait pu fournir le substrat qui, grâce à l’infusion de l’âme rationnelle, deviendrait un authentique corps humain. » (Artigas, Glick et Martinez, Seis católicos evolucionistas, p. 76–77[↩]
- Deux lettres de louange sont reproduites au début de l’ouvrage : la première du géologue Albert Auguste Cochon de Lapparent, la seconde du dominicain Jacques-Marie-Louis Monsabré.[↩]
- Joseph de Bonniot, La bête comparée à l’homme, Retaux-Bret éditeur, Paris, 1889.[↩]
- Joseph Bruckner, « Les jours de la création et le transformisme », Études, avril 1889, p. 567–592 ; « L’origine de l’homme d’après la Bible et le transformisme », Études, mai 1889, p. 28–50.[↩]
- Joseph Bruckner, « Bulletin Scripturaire », Études, novembre 1891, p. 488–497.[↩]
- Ambroise Gardeil, « L’évolutionnisme et les principes de S. Thomas », Revue thomiste, 1893, p. 27–45, 316–327, 725–737 ; 1894, p. 29–42 ; 1895, p. 61–84 ; 1896, p. 64–86, 215–247.[↩]
- Eugène Portalié, « Le R.P. Frins et la “Revue Thomiste” », Études, mai 1893, p. 58–59.[↩]
- Marie-Dalmace Leroy, « Correspondance au R.P. directeur de la “Revue Thomiste” », Revue Thomiste, 1893, p. 532–535.[↩]
- La dénonciation portait en effet sur la version de 1887.[↩]
- Ce qui est faux, comme on le verra ci-après au n° 7.1.[↩]
- Le vote n’a pas été unanime puisque le cardinal Segna inclinait plutôt pour l’admonestation de l’auteur sans condamnation du livre.[↩]
- Dans son rapport, le P. Buonpensiere affirme que les œuvres de Darwin sont à l’Index, ce qui est inexact. Seul Erasmus Darwin, grand-père de Charles, se trouve à l’Index pour Zoonomia or the law of organic life publié en 1794–1796 (cf. décret de l’Index du 22 décembre 1817).[↩]
- John Zahm, Evolution and Dogma, D.H. McBride & Co, Chicago, 1896, p. 431–432.[↩]
- En réalité, le texte cité (Physiques, lib. 2, ch. 8) rapporte l’opinion d’Empédocle qu’Aristote réfute par la suite.[↩]
- Le P. Zahm n’a visiblement rien su de la rétractation du P. Leroy publiée dans Le Monde du 4 mars 1895.[↩]
- [1] « C’est une erreur de supposer que saint Thomas attache toujours aux termes de genre et d’espèce le même sens qui leur est donné par les naturalistes modernes. » (John Zahm, Evolution and Dogma, p. 316).[↩]
- Albert de Nadaillac, « L’évolution et le dogme », Revue des questions scientifiques, t. 40, 1896, p. 229–246.[↩]
- John Zahm, « Téléologie et évolution », Revue des questions scientifiques, t. 43, 1898, p. 403–419.[↩]
- David Fleming, « Evolution and Dogma », The Dublin Review, 1896, p. 245–255.[↩]
- Francisco Salis-Seewis, « “Evoluzione e Dogma” del Padre J.A. Zahm csc », La Civiltà Cattolica, série 16, vol.10, 1897, p. 201–204.[↩]
- Cf. Artigas, Glick et Martinez, Seis católicos evolucionistas, p. 192–195.[↩]
- Canon 13 : « Si quelqu’un, loin de rapporter à Dieu la création de la chair, l’attribue aux mauvais anges, qu’il soit anathème. »[↩]
- Pars I, tit. IV, canon 14 : « Nos premiers parents ont été créés directement par Dieu. C’est pourquoi nous déclarons en contradiction avec la Sainte Écriture et avec la foi l’opinion de ceux qui n’hésitent pas à affirmer l’évolution spontanée d’une nature imparfaite vers une forme connexe plus parfaite d’où enfin serait issu l’homme au moins dans son corps. »[↩]