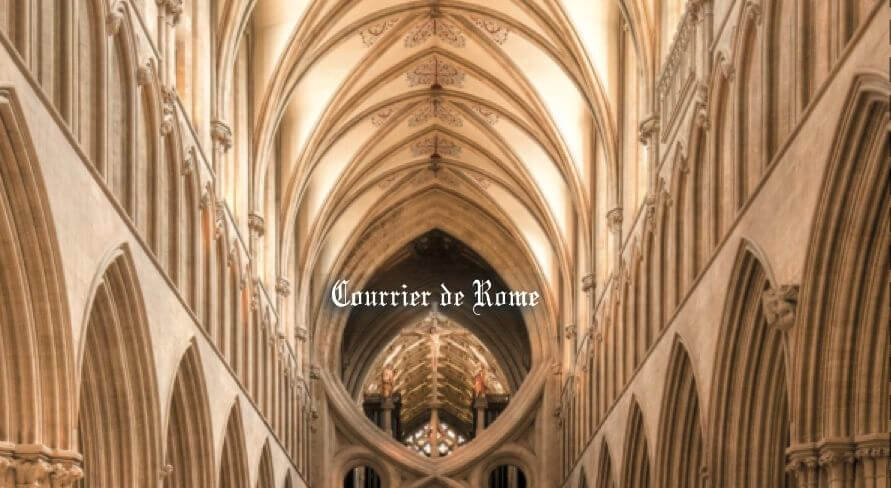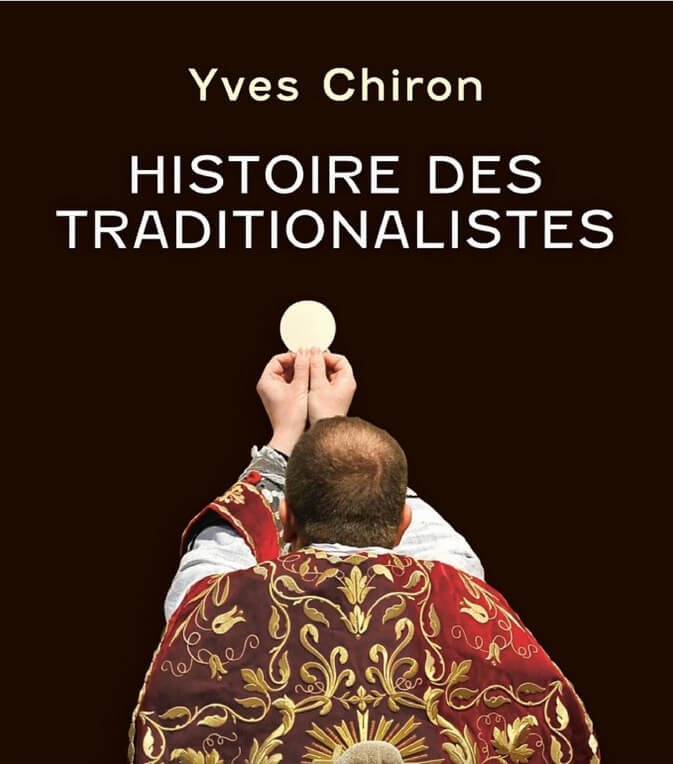Certains reprochent à la Fraternité Saint-Pie X son refus par principe du Novus Ordo Missae de Paul VI – même célébré avec dignité. Qui n’est pas rationnel ?
Lors de l’homélie qu’il prononça à l’occasion du jubilé de ses soixante ans de sacerdoce, près de Paris au Bourget, devant près de 23 000 fidèles, Mgr Lefebvre fit mention de « la prière d’oblation de l’hostie que le prêtre récite tous les jours au saint Autel ». Belle prière, dont il souligna toute l’importance, puisqu’elle indique la nature exacte du saint sacrifice de la messe et aussi la nature exacte du sacerdoce, en raison duquel celui qui est consacré prêtre est tout entier voué à la célébration de ce sacrifice.
« Recevez, Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant, cette hostie immaculée que je vous offre, bien indigne serviteur, à vous mon Dieu, vivant et véritable pour mes innombrables péchés, offenses et négligences, pour tous ceux qui sont ici présents, pour les fidèles chrétiens vivants et morts, que cette oblation serve à mon salut et au leur, pour la vie éternelle. Ainsi soit-il ».
2. La messe est un sacrifice propitiatoire, c’est-à-dire l’offrande du Corps et du Sang de Jésus Christ, immolé pour le rachat des âmes des fidèles vivants et morts, immolation d’une victime offerte à Dieu pour satisfaire tant au péché originel de tout le genre humain qu’aux péchés personnels de tous les hommes. Comme tout sacrement, la messe est d’abord un signe : elle cause ce qu’elle signifie, dans la mesure exacte où elle le signifie. Or, cette nature profonde de la messe, qui est le sacrement de l’unique sacrifice rédempteur, accompli par le Verbe Incarné, est beaucoup plus clairement signifiée par les prières de l’offertoire que par les paroles de la consécration et c’est pourquoi l’on a pu dire que « dans ses caractéristiques spécifiques, l’offertoire de la messe de saint Pie V a toujours constitué un des principaux éléments pour distinguer la messe catholique de la cène protestante »[1]
3. Redisons ces évidences[2]. C’est précisément en tant qu’elle est explicitement déclarée comme l’offrande de l’immolation du Christ, faite à la Trinité Sainte, que la messe apparaît pour ce qu’elle est, c’est-à- dire à la fois pour ce qu’elle signifie et ce qu’elle cause, étant référée à l’oblation et à l’immolation mêmes du Christ. Les paroles de la double consécration, expriment certes l’immolation que Jésus-Christ fait de Lui-même. Celle-ci est alors réalisée d’une manière mystérieuse, qui est la manière propre au sacrement. Les paroles de la forme signifient ce qu’elles causent et causent ce qu’elles signifient, c’est-à-dire la présence réelle sacramentelle et du Corps et du Sang du Christ. L’immolation est réalisée, elle aussi, selon ce mode sacramentel, du fait que la consécration est double et que le pain est transsubstantié au Corps du Christ séparément de la transsubstantiation du vin au Sang du Christ. Cela est, en toute réalité, dans la mesure où cela est signifié. Enfin, le Christ ainsi sacramentellement immolé, du fait de la séparation sacramentelle de son Corps et de son Sang, est offert à la Trinité Sainte, en victime de propitiation. Cependant, cette offrande n’est pas exprimée en ce moment du rite, qui est celui de la prononciation des paroles de la consécration. Voilà pourquoi il est nécessaire qu’une autre partie du rite soit consacrée à exprimer ce qui ne l’est pas au moment de la consécration, à savoir ce fait de l’offrande du Christ immolé. Et c’est précisément le rôle de l’offertoire de donner cette expression distincte. Moyennant quoi, le signe sacramentel acquiert toute son intégrité, les paroles de la consécration obtenant leur valeur signifiante et sacramentelle en dépendance des prières de l’offertoire, comme de tout le reste du rite.
4. Tout cela est d’une importance extrême, et a d’ailleurs été clairement reconnu par les protestants, comme l’on peut s’en rendre compte à partir de l’ouvrage du pasteur luthérien Luther D. Reed, paru en 1959 et intitulé The Lutheran liturgy. Luther D. Reed a enseigné la liturgie pendant trente-quatre ans au séminaire luthérien de Philadelphie. Il fut l’un des promoteurs du mouvement qui tente d’uniformiser la liturgie luthérienne aux Etats-Unis [3]. Il écrit sans ambages que « la prière centrale de l’offertoire Suscipe sancte Pater est une parfaite exposition de la doctrine catholique romaine sur le sacrifice de la messe ». Il ajoute : « Tous les réformateurs rejetèrent l’offertoire romain et son idée d’une offrande pour les péchés faite par le prêtre, au lieu d’une offrande de reconnaissance faite par le peuple. Luther […] appelait l’offertoire romain une abomination où l’on entend et sent partout l’oblation ».
5. Voilà pourquoi la suppression de ces prières de l’offertoire, dans le Novus Ordo du Pape Paul VI, est si lourde de conséquences. Sans ces prières de l’offertoire, les paroles de la consécration ne sont plus les mêmes, car leur signification profonde n’est plus suffisamment explicitée par le rite. Sans l’offertoire de l’Ordo Missae de saint Pie V, ou avec le nouvel offertoire du Novus Ordo Missae de Paul VI, le rite de la messe ne signifie plus ce qu’EST le sacrifice de la Croix offert par l’Eglise ; le nouveau rite de Paul VI n’en apparaît donc que plus facilement comme le simple mémorial, mémoire d’un sacrifice et non plus sacrifice actuellement offert.
6. Cette suppression de l’offertoire est l’une des nombreuses raisons mises en lumière et avancées par le Bref examen critique du Novus Ordo missae pour conclure que le nouveau rite « s’éloigne de manière impressionnante, dans l’ensemble comme dans le détail, de la théologie catholique de la Sainte Messe, telle qu’elle a été formulée à la XXe session du Concile de Trente, lequel, en fixant définitivement les canons du rite, éleva une barrière infranchissable contre toute hérésie qui pourrait porter atteinte à l’intégrité du Mystère » [4].
Ceux qui ont la prétention de dénoncer comme déraisonnable et indu le refus de la Fraternité devraient sinon prouver que le Novus Ordo Missae de Paul VI ne s’éloigne pas « de manière impressionnante, dans l’ensemble comme dans le détail, de la théologie catholique de la sainte messe », du moins établir de manière convaincante que cet éloignement n’est pas prouvé de manière décisive par le Bref examen critique des cardinaux Ottaviani et Bacci.
7. Le refus de principe du Novus Ordo Missae de Paul VI s’impose logiquement à la suite de ce constat et il vaut ce que valent les raisons avancées par l’étude remise au Pape par les deux cardinaux Ottaviani et Bacci. Ceux qui voudraient, d’une manière ou d’une autre, refuser catégoriquement à la Fraternité Saint Pie X le droit ou le devoir légitime d’un tel refus se devraient, en conséquence, de commencer par argumenter pour établir tout aussi catégoriquement que les raisons avancées par le Bref examen critique ne suffisent pas à motiver la conclusion signalée. Ceux qui ont la prétention de dénoncer comme déraisonnable et indu le refus de la Fraternité devraient sinon prouver que le Novus Ordo Missae de Paul VI ne s’éloigne pas « de manière impressionnante, dans l’ensemble comme dans le détail, de la théologie catholique de la sainte messe », du moins établir de manière convaincante que cet éloignement n’est pas prouvé de manière décisive par le Bref examen critique. Autrement dit, il serait nécessaire de leur part de réfuter scientifiquement la valeur démonstrative de l’étude théologique présentée au Pape Paul VI et sur laquelle s’appuie la Fraternité pour refuser la réforme liturgique du nouvel Novus Ordo Missae.
8. Or, du moins à notre connaissance, cette réfutation n’apparaît quasiment jamais sous la plume et dans la bouche de tous ceux qui contestent à la Fraternité Saint Pie X (et parfois avec une sévérité extrême) le bien-fondé de son attitude. Une telle contestation entend se motiver de façon pratiquement exclusive par le recours à un argument d’autorité, dont on peut raisonnablement nier, au moins en grande partie, la pertinence. Certes, oui, l’autorité suprême dans l’Eglise, telle qu’elle bénéficie des promesses du Christ et de l’assistance du Saint Esprit, ne saurait imposer à ses fidèles par voie de promulgation juridique un rite intrinsèquement mauvais, du fait même qu’il s’éloigne de manière impressionnante de la définition catholique de la messe et occasionne une diminution grave, voire une perte généralisée, de la foi. Mais il y a là un principe d’ordre général, qui doit se vérifier au milieu de circonstances variables. Peut-on l’appliquer tel quel dans le contexte des réformes entreprises lors du concile Vatican II et après ? Doit-on considérer (même si l’on reconnaît à ce Pape sa légitimité entière) que Paul VI a véritablement imposé le Novus Ordo Missae par la voie d’une promulgation juridique valide et légitime ? En d’autres termes, une telle réforme liturgique, à ce point déficiente, peut-elle constituer l’objet et la matière d’un acte de l’autorité ? Autant de questions qui doivent se poser – et qui se sont posées[5]- si l’on veut envisager honnêtement les difficultés soulevées par la réforme liturgique de Paul VI. Le recours à un argument d’autorité basé essentiellement sur l’indéfectibilité de l’Eglise s’en trouve relativisé d’autant[6].
9. Ce que l’on serait en droit d’attendre, de la part de tous ceux qui entendent refuser à la Fraternité Saint Pie X la légitimité de sa position, c’est une étude serrée du Bref examen critique, étude reprenant un à un, pour les passer au crible, et les réduire à néant, tous les arguments avancés à l’appui de la conclusion présentée au Pape Paul VI par les cardinaux Ottaviani et Bacci, dans leur Préface. L’obéissance à une réforme liturgique doit être réglée par la foi, et, celle-ci n’étant pas un assentiment aveugle mais une adhésion intellectuelle de la droite raison, raison qui reste droite même lorsqu’elle est motivée, dépassée et confortée par la grâce, il s’agit ici de vérifier en tout premier lieu si la critique du Novus Ordo Missae est rationnelle ou non. Le refus ou même la simple négligence de cette vérification ne peut que rendre irrationnelle, et à tout le moins dépourvue de crédibilité, toute démarche entreprise pour dénoncer l’attitude de Mgr Lefebvre et de la Fraternité par lui fondée.
Source : Courrier de Rome n° 682 – janvier 2025
- Arnaldo Xavier Da Silveira, La Nouvelle Messe de Paul VI, qu’en penser ? Editions de Chiré, Diffusion de la Pensée Française, 1975, chapitre III, § B, p. 64.[↩]
- Voir à ce sujet le numéro de septembre 2021 du Courrier de Rome, spécialement l’article intitulé « La Nouvelle Messe de Paul VI est-elle un sacrifice (II) ? »[↩]
- Arnaldo Xavier Da Silveira, La Nouvelle Messe de Paul VI, qu’en penser ? Editions de Chiré, Diffusion de la Pensée Française, 1975, chapitre V, surtout au § C, p. 141 et sv[↩]
- Cardinaux Ottaviani et Bacci, « Préface au pape Paul VI » dans Bref examen critique du Novus ordo missae, Iris, p. 6. Sur ce point, voir aussi les articles parus dans le numéro de septembre 2021 du Courrier de Rome.[↩]
- En témoignent, entre autres, le livre de Louis Salleron, La Nouvelle Messe, paru aux Nouvelles Editions Latines en 1970 ainsi que ses études réunies sous le titre La Nouvelle Messe, cinquante ans après. Chronique de l’après-Concile, Dominique Martin Morin, 2020. Voir aussi le livre de l’abbé Claude Barthe, La Messe de Vatican II. Dossier historique, Via Romana, 2018[↩]
- Voir l’article intitulé « L’Eglise est indéfectible » dans le numéro de septembre 2024 du Courrier de Rome.[↩]