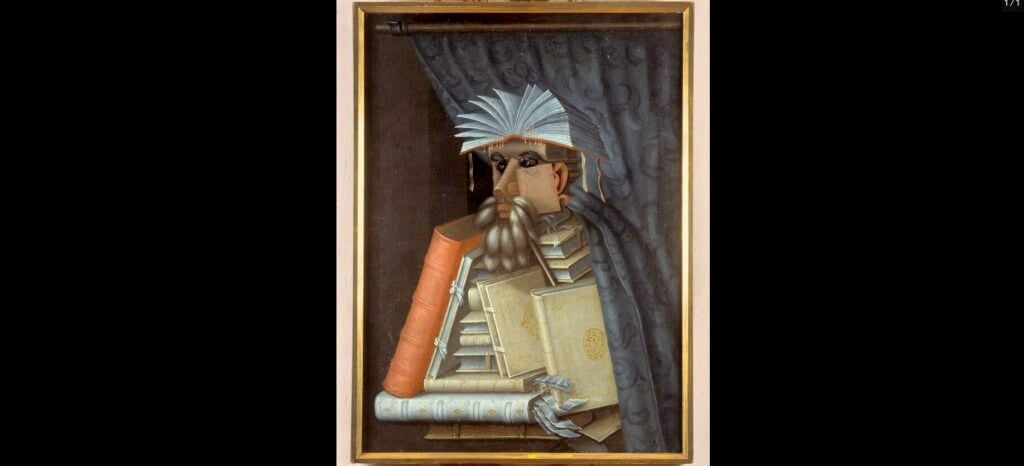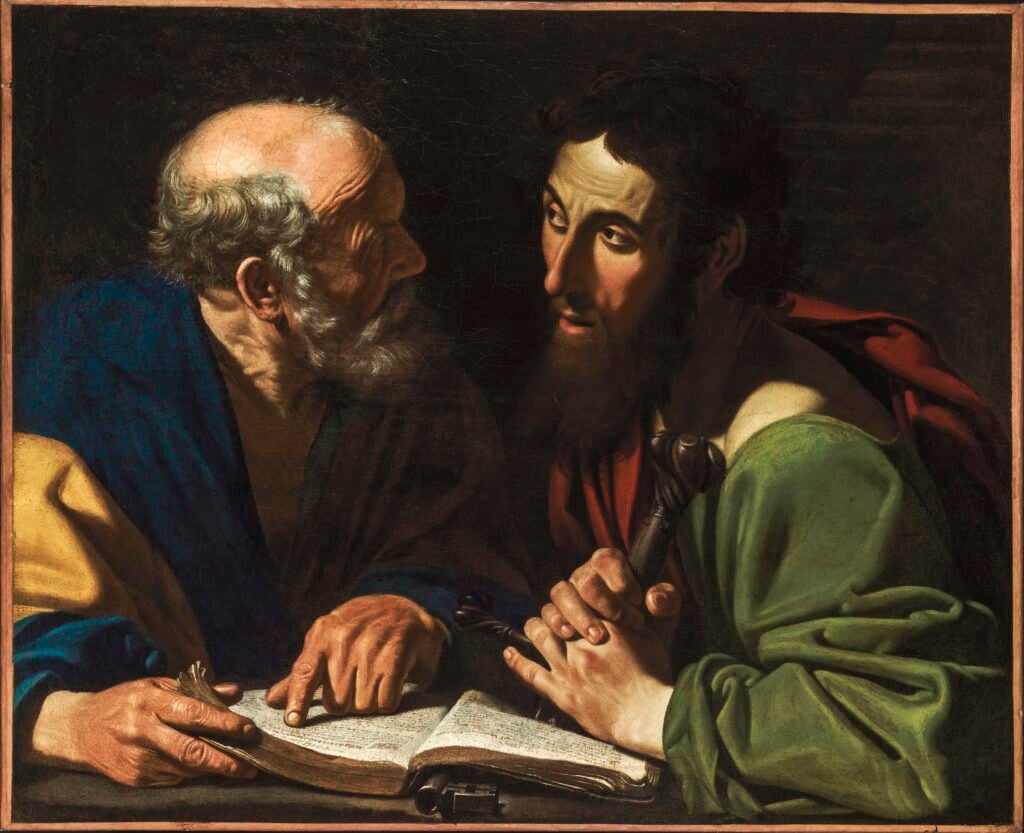Du nouveau rite de la messe à la négation du sacrifice
Dans une tribune publiée par La Croix[1], le père Martin Pochon S.J. affirme délibérément le contraire du Concile de Trente : Jésus « a offert son corps et son sang, non pas à Dieu, mais à ses disciples, au nom de son Père », estimant que la doctrine tridentine ne fait pas droit au vrai sens évangélique de la Cène pascale, et que le rite de Paul VI a contribué à le retrouver.
Rappelons ce que le concile de Trente affirme : « Si quelqu’un dit que, dans la messe, n’est pas offert à Dieu un véritable et authentique sacrifice ou qu” « être offert » ne signifie pas autre chose que le fait que le Christ nous est donné en nourriture : qu’il soit anathème[2]. »
Jésus a annoncé qu’il offrait sa vie lui-même (Jn 10, 17–18), et à la Cène même il affirme que son sang est répandu pour la rémission des péchés (Mt 26, 28), allusion évidente aux sacrifices sanglants de la loi de Moïse, censés procurer le pardon des fautes. Les épîtres de saint Paul explicitent le caractère sacrificiel de cette acte :
« le Christ notre Pâque a été immolé » (I Cor 5, 7),
Il « s’est livré pour nous, s’offrant à Dieu en sacrifice d’agréable odeur » (Eph 5, 2), et c’est en lui que « nous avons la rédemption, la rémission des péchés » (Col 1, 14).
L’épître aux Hébreux explicite comment ce sacrifice vaut mieux que ceux de l’ancienne Loi de sorte qu’il est réellement efficace et n’a pas besoin d’être renouvelé : Jésus « est capable de sauver de façon définitive ceux qui par lui s’avancent vers Dieu, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Oui, tel est précisément le grand prêtre qu’il nous fallait, saint, innocent, immaculé, séparé désormais des pécheurs, élevé plus haut que les cieux, qui ne soit pas journellement dans la nécessité, comme les grands prêtres, d’offrir des victimes d’abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il l’a fait une fois pour toutes en s’offrant lui-même. » [3]
Dans les sacrifices antiques, la manducation de la victime immolée par les offrants signifiait leur union d’intention au sacrifice et la réception des dons divins. Le Sauveur institue le sacrement de l’Eucharistie à la manière de ce repas sacrificiel qui nous permet de nous unir à Lui après l’offrande du sacrifice. En ce sens il y a un don fait aux fidèles, mais comme fruit du sacrifice.
Ce sacrifice, le Père jésuite le nie. Comment expliquer l’abandon explicite d’un dogme de foi clairement connu – il en donne la référence dans son article – au profit d’une interprétation détournée de l’Évangile [4] ? Comment peut-on s’expliquer la relativisation aussi assumée d’une déclaration dogmatique prononcée par un Concile œcuménique[5] ?
On peut proposer l’explication suivante : la liturgie a un sens, et elle forme les esprits. Or l’auteur de l’article affirme : « Quatre siècles plus tard [après le Concile de Trente], la réforme liturgique qui a suivi le concile Vatican II a cherché à se rapprocher du sens de la Cène, telle qu’elle nous est présentée par les Évangiles et l’apôtre Paul dans sa première Lettre aux Corinthiens. La commission chargée de revoir le rituel percevait que l’affirmation tridentine était infondée, car Jésus n’a jamais voulu dire par quelle autorité il parlait et agissait, et surtout, il a offert son corps et son sang, non pas à Dieu, mais à ses disciples, au nom de son Père. »
L’opinion publiée par La Croix, qu’il faut bien, si les mots ont encore un sens, qualifier d’hérétique, est peut-être bien un fruit direct du Concile et de la nouvelle liturgie.
- Martin Pochon sj, « Comment rétablir l’unité de l’Église si elle n’est pas fondée sur les Évangiles ?», La Croix, 24 octobre 2025, https://www.la-croix.com/a‑vif/comment-retablir-l-unite-ecclesiale-si-elle-nest-pas-fondee-sur-les-evangiles-20251024. L’auteur y résume son ouvrage L’Eucharistie, don ou sacrifice ?, Vie chrétienne, 2025.[↩]
- Concile de Trente, doctrine et canons sur le sacrifice de la messe, 17 septembre 1562, canon 1. Cette formulation avec la menace d’anathème (excommunication) exprime clairement l’intention du Concile de définir une vérité de foi.[↩]
- Heb 7, 26–27[↩]
- A l’issue d’un long travail, car l’auteur a publié un long ouvrage d’exégèse sur L’épître aux Hébreux au regard des Évangiles, Cerf, 2020.[↩]
- Et rappelée par Jean-Paul II dans l’encyclique Ecclesia de Eucharistia en 2003.[↩]