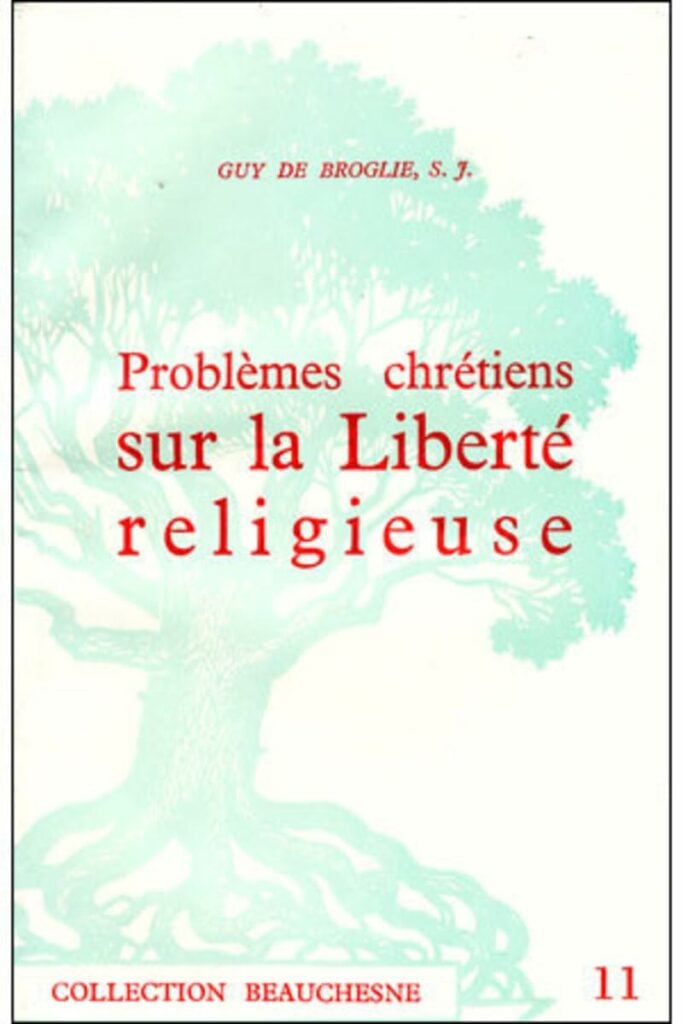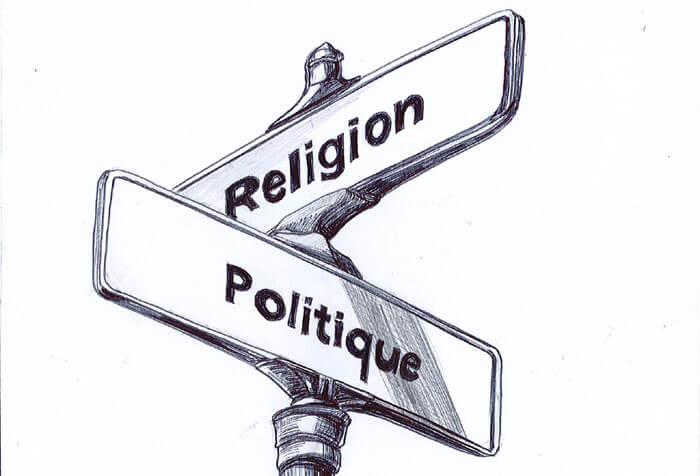Un siècle après l’encyclique Quas Primas, que dit l’épiscopat de la Loi de 1905 ?
L’encyclique Quas primas, en affirmant la souveraineté du Fils de Dieu sur tout homme et toute société, condamnait par là-même le laïcisme comme « peste de notre époque » :
Comme vous le savez, Vénérables Frères, ce fléau n’est pas apparu brusquement ; depuis longtemps, il couvait au sein des États. On commença, en effet, par nier la souveraineté du Christ sur toutes les nations ; on refusa à l’Église le droit – conséquence du droit même du Christ – d’enseigner le genre humain, de porter des lois, de gouverner les peuples en vue de leur béatitude éternelle. Puis, peu à peu, on assimila la religion du Christ aux fausses religions et, sans la moindre honte, on la plaça au même niveau. On la soumit, ensuite, à l’autorité civile et on la livra pour ainsi dire au bon plaisir des princes et des gouvernants. Certains allèrent jusqu’à vouloir substituer à la religion divine une religion naturelle ou un simple sentiment de religiosité. Il se trouva même des États qui crurent pouvoir se passer de Dieu et firent consister leur religion dans l’irréligion et l’oubli conscient et volontaire de Dieu.
Cette description est celle de la politique religieuse de la France à partir de la Révolution, en particulier par la loi de séparation des Églises et de l’État, promulguée le 9 décembre 1905 : la loi « assure la liberté de conscience » et « garantit le libre exercice des cultes » (article 1), mais « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte » (article 2). Désormais le culte catholique est régi par le droit privé, il est censé relever de l’opinion personnelle sans pouvoir revendiquer de place particulière dans l’espace public. Par la même occasion, la République dénonce unilatéralement le Concordat conclu par Rome avec Napoléon.
Cette séparation correspondait à une tenace revendication de la gauche. « Détacher de l’Église la nation, les familles et les individus, proclame Ferdinand Buisson, la démocratie, poussée par un merveilleux instinct de ses besoins et de ses devoirs prochains, s’y prépare. » « Ce qu’il faut qu’on sache, confirme Arthur Ranc, c’est que la Séparation n’a jamais été pour nous qu’un moyen, et que le but, c’est la sécularisation complète, c’est la fin du pouvoir de l’Église[1]. »
Bien sûr la majorité du clergé s’était opposée à cette laïcisation de la société. Quelques voix cependant donnaient un autre ton : certains y voyaient une évolution inéluctable de la société dont la sécularisation était déjà lancée, d’autres déploraient le statut d’un « épiscopat de valets » établi par les dispositions tatillonnes du Concordat et des articles organiques (Mgr d’Hulst, recteur de l’Institut catholique de Paris), exprimant le désir de « secouer le joug d’asservissement » que le clergé devait subir (Mgr Le Camus, évêque de La Rochelle), tant leur pesaient la situation et l’esprit de fonctionnaire caractéristiques du clergé concordataire[2].
Saint Pie X protesta contre la loi, non pas seulement en raison de la spoliation des biens ecclésiastiques et du mode de leur dévolution, mais surtout en raison des droits de Dieu :
Qu’il faille séparer l’État de l’Église, c’est une thèse absolument fausse, une très pernicieuse erreur. Basée, en effet, sur ce principe que l’État ne doit reconnaître aucun culte religieux, elle est tout d’abord très gravement injurieuse pour Dieu, car le créateur de l’homme est aussi le fondateur des sociétés humaines et il les conserve dans l’existence comme il nous soutient. Nous lui devons donc, non seulement un culte privé, mais un culte public et social, pour l’honorer.
Saint Pie X, encyclique Vehementer nos, 11 février 1906
Quelques évêques, regrettant l’intransigeance du Pontife dans le refus du système des associations cultuelles, lui remirent leur démission. Le reste du clergé relaya au contraire les consignes et les enseignements du pontife.
Après la guerre de 1914–1918 et l’apaisement qui s’ensuivit, lors de la nouvelle offensive anticléricale de 1924, l’assemblée des cardinaux et archevêques de France rappela les principes :
Les lois de laïcité sont injustes d’abord parce qu’elles sont contraires aux droits formels de Dieu. Elles procèdent de l’athéisme et y conduisent dans l’ordre individuel, familial, social, politique, national, international. Elles supposent la méconnaissance totale de Notre-Seigneur Jésus- Christ et de son Évangile.
Déclaration de l’Assemblée des Cardinaux et Archevêques de France sur les lois dites de laïcité et sur les mesures à prendre pour les combattre, 10 mars 1925[3].
Quatre-vingts ans plus tard, le Concile étant passé par là, quel est le discours des évêques de France à l’occasion du centenaire de la loi ?
Plusieurs documents donnent la teneur du discours officiel de la hiérarchie de l’Église sur la séparation de l’Église et de l’État : une lettre de Jean-Paul II au Cardinal Ricard, président de la Conférence des évêques de France (CEF), datée du 11 février 2005 (date anniversaire de l’encyclique Vehementer nos), une déclaration de la même Conférence datée du 15 juin de la même année[4], et la déclaration commune de Mgr de Moulins-Beaufort et de représentants des cultes protestant et orthodoxe datée du 10 mars 2021 à l’occasion de la discussion de la loi « séparatisme » destinée à contrôler plus étroitement les cultes en France[5]. Le fond du discours est toujours plus ou moins le même.
En premier lieu, on rappelle le caractère traumatisant de la violence faite à l’Église par la République française sans aucune concertation avec Rome en 1905, à l’issue d’une série de mesures persécutrices. Mais seul Jean-Paul II remarque que le nouveau régime des cultes, qui les relègue dans la sphère privée, ne fait plus droit à « la nature profonde de l’homme, être à la fois personnel et social dans toutes ses dimensions, y compris dans sa dimension spirituelle » (n°2). Manière de déplorer que la religion soit chassée du domaine public, non du point de vue des droits de Dieu mais du côté des droits de la personne.
Ensuite les textes remarquent que la jurisprudence qui a suivi la promulgation de la loi de 1905 et les diverses péripéties de la politique religieuse française ont conduit à un modus vivendi apaisé, dans lequel « tous nous avons appris à vivre et à nous y trouver bien[6] ». C’est au point que Mgr de Moulins-Beaufort peut dire, devant une commission du Sénat en 2021, que les évêques étaient très heureux après le vote de la loi car ils pouvaient enfin se réunir sans avoir à demander la permission au gouvernement, de sorte que la loi de 1905 fut une « loi de liberté[7] » !
Le pape, comme les évêques de France, admet le principe de la laïcité comme base de travail pour décrire les rapports des religions avec l’État. Mais ils livrent un discours qui entretient l’ambiguïté sur le sens du mot. La « saine et juste laïcité » qu’ils revendiquent, censée appartenir à la doctrine sociale de l’Église (Jean-Paul II, n°3), explicite la parole du Sauveur : « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » (Lc 20, 25) Il s’agit donc de la distinction des autorités temporelle et spirituelle, et on comprend alors qu’il soit question de « la non-compétence de l’État en matière de foi religieuse et d’organisation interne des communautés religieuses »[8]. Mais le discours officiel reste silencieux sur le droit souverain de Dieu sur les individus comme sur les sociétés, avec le devoir corrélatif des sociétés de lui rendre un culte. Or si un individu est compétent pour trouver le vrai Dieu et se tourner vers Lui, pourquoi cela lui deviendrait-il impossible lorsqu’il vit en société ? La seule distinction apportée sur la laïcité par les textes épiscopaux consiste à l’opposer au laïcisme agressif, celui des radicaux de la IIIe République comme de la Ve aujourd’hui, celui qui veut éradiquer l’Église de la société, en particulier des écoles.
Enfin les évêques revendiquent non seulement le zèle des catholiques à participer à titre de citoyens comme les autres à la vie publique de la France, mais aussi la liberté d’évangéliser, et protestent de ne pas réclamer une place spéciale pour l’Église catholique sur la place publique[9], comme s’ils redoutaient l’accusation de tricherie dans la libre concurrence sur le marché des opinions privées.
On pourrait voir dans ce discours une posture surtout diplomatique face à un gouvernement dont l’hostilité est toujours plus ou moins larvée. Pourtant les évêques admettent sans discussion le cadre intellectuel des droits de l’homme et de la laïcité, tout en cherchant timidement à leur donner des sens acceptables. C’est l’assimilation des valeurs de deux siècles de culture libérale opérée par le Concile, dont parlait le Cardinal Ratzinger dans les années 1980.
On ne pourra pas trouver dans la prédication des évêques une formation satisfaisante pour des esprits catholiques, tant les mots portent avec eux d’ambiguïtés. C’est pourquoi il est normal qu’à l’attachement à la liturgie traditionnelle soit associé le désir de se former à la doctrine traditionnelle de l’Église. C’est ce que relèvent à leur manière les évêques, en accusant les fidèles attachés à la liturgie traditionnelle de poursuivre des projets politiques[10].
En août 1976, Mgr Lefebvre protestant contre la laïcisation des constitutions de plusieurs États sur demande du Vatican, entendit le nonce de Berne lui dire que le pape n’écrirait plus l’encyclique Quas primas. Cinquante ans plus tard, ce n’est toujours pas d’actualité.
Source : Le Saint Vincent, bulletin du Prieuré de Villepreux.
- Cités par Jean Sévillia, Quand les catholiques étaient hors la loi, Perrin, 2005, c.5.[↩]
- Ibidem.[↩]
- Texte disponible sur https://laportelatine.org/formation/morale/doctrine-sociale/quand-les-eveques-de-france-declaraient-les-lois-laiques-ne-sont-pas-des-lois[↩]
- Documents rassemblés dans https://droit.cairn.info/revue-l-annee-canonique-2005–1‑page-277?lang=fr[↩]
- « La République et les cultes : un équilibre, résultat de l’histoire », 10 mars 2021, disponible sur https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/laicite/513979-les-chretiens-inquiets-du-projet-de-loi-separatisme/[↩]
- Ibidem.[↩]
- https://laportelatine.org/formation/morale/doctrine-sociale/loi-de-1905-la-conference-des-eveques-de-france-reecrit-lhistoire[↩]
- Conférence des évêques, 2005, n°7[↩]
- déclaration de la CEF, 2025, n°16[↩]
- Cf. Mgr Lebrun, archevêque de Rouen : « Nous avons renoncé à un État confessionnel. Eux non. » Entretien du 26 mars 2024 reproduit dans https://riposte-catholique.fr/archives/187936 ; Mgr de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims et ancien président de la Conférence des évêques de France, au sujet du pèlerinage de la Pentecôte : « Le Christ n’a pas fondé l’Église catholique pour créer des États catholiques, ni même une société catholique », cité dans https:// riposte-catholique.fr/archives/201114.[↩]