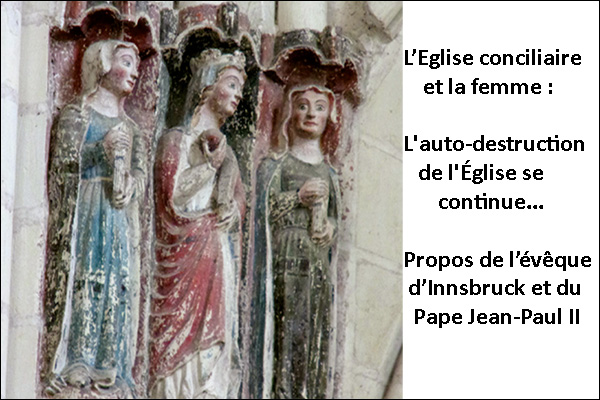Tout comme lors de la Révolution française, les autorités nouvelles et communistes de l’État, en Chine, se sont employées à la fois à soumettre et à persécuter les disciples de Notre-Seigneur.
C’est en 1912 que le dernier empire de Chine, jusqu’alors dominé par la dynastie mandchoue des Qing, s’effondre sous le choc de deux forces nationalistes conjointes : au nord, celles des « Seigneurs de la guerre » dirigées par Yuan Shikai, ancien ministre du dernier empereur, au sud celles de Sun Yat-sen, fondateur du parti républicain Kuomintang. Elles ne tarderont pas à se diviser, permettant ainsi aux Japonais de s’emparer d’importantes possessions allemandes de Chine en août 1914. Entrée en guerre aux côtés des alliés en 1917, la Chine n’obtient pas pour autant, en 1919, la renégociation des traités inégaux qui lui avaient été imposés à la fin du siècle précédent, organisant son démembrement partiel. D’où, en mai 1919, de violentes manifestations anti-occidentales et anti-japonaises dans les villes chinoises.
Mao Tse-Toung
Né, dans les faits, en 1918, et constitué officiellement à Shanghaï au mois de septembre 1920, le parti communiste chinois (premier parti communiste créé à l’extérieur de la Russie) est poussé par la Troisième internationale à collaborer avec l’armée du Kuomintang commandée par Tchang Kaï-shek, dans sa lutte contre les Seigneurs de la guerre. Mais celui-ci supporte mal la rivalité politique montante de Mao. Entre septembre 1926 et mars 1927 son armée s’empare de Hangzhou, puis de Nankin, enfin de Shanghaï le 26 mars. Là s’achève la coopération avec les communistes, que Tchang Kaï-shek fait massacrer ainsi que des milliers d’ouvriers dans toute la ville le 12 avril, récidivant en novembre à Wuhan, puis en décembre à Nankin, et contraignant ainsi le parti communiste à la clandestinité jusqu’en 1949 (Malraux évoquera les massacres de Shanghaï dans son roman La condition humaine, et ceux de Canton dans Les Conquérants). Tchang reprend alors l’offensive contre les Seigneurs de la guerre et s’empare de Beijing (Pékin) en juin 1928. La Chine est de nouveau réunifiée.
Jusqu’en 1927, le parti communiste était principalement d’essence urbaine dans le recrutement de ses militants, dans la composition de ses élites (dominées par des intellectuels) et dans ses actions insurrectionnelles (grèves d’ouvriers de 1925). Chassé de l’appareil du parti, qu’il considérait comme trop embourgeoisé, mais désormais rendu libre par le massacre de ses dirigeants à Shanghaï, Mao Tse-toung s’appliquera, par la suite, à faire, des paysans vivant dans la misère (les trois quarts des Chinois), le prolétariat de la révolution chinoise, au contraire de ce que Lénine puis Staline préconisaient. Et d’ailleurs, la plus grande patrie de l’industrie (90 % de la métallurgie, 80 % du textile, 70 % de la houille) était encore aux mains des étrangers.
C’est à Juichin, dans la province lointaine du Kiangsi « libérée » en 1931 par ses troupes que dirige Chou En-laï, que le futur « Grand Timonier » lancera les bases de sa politique à venir. Les grands domaines de la province sont confisqués, morcelés et les terres distribuées aux petits paysans. Les dettes et l’usure, plaies traditionnelles des campagnes, sont annulées. Au plan religieux, la Constitution promulguée par le « Gouvernement central démocratique des ouvriers et des paysans » prétend garantir « une vraie liberté religieuse aux ouvriers et paysans et à la population laborieuse », mais « adhère au principe de la séparation totale de la religion et de l’État » et prévoit déjà que tous les citoyens bénéficieront du droit de propagande antireligieuse. Elle annonce aussi qu”« aucune des institutions religieuses des impérialistes ne sera autorisée à subsister à moins qu’elle ne se range sous la loi soviétique ». Cette disposition visait, bien entendu, toutes les confessions chrétiennes. De fait, la population catholique du Kiangsi fut tout simplement liquidée et de modestes paysans confessèrent leur foi sous la torture, premiers martyrs du régime communiste. Mais en 1934, Mao est chassé du Kiangsi par l’armée du Kuomintang et doit opérer une retraite de 12 000 kms célèbre sous le nom de « Longue Marche » (près d’un an), jusqu’à la lointaine province du Shaanxi.
De 1931 à 1949, l’évolution du continent chinois est fortement marquée par l’implantation japonaise dans la majorité du pays. La guerre sino-japonaise se soldera par la mort de plus de 3 millions de soldats chinois et de plus de 9 millions de civils, et les Japonais auront contraint à des travaux de force plus de 10 millions de Chinois. Cela dit, les victoires du Japon (1937, 1938) ne sont pas sans lien avec l’absence d’unité entre ses adversaires. La trêve qu’ils signent en 1936 permet seulement à chacun de guerroyer dans ses terres. En 1941, l’armée du Kuomintang et une partie des troupes communistes finissent par s’affronter, soulignant la fragilité du front uni. Malgré tout, usée par une guerre de harcèlements incessants, l’armée japonaise finit par capituler le 9 septembre 1945.
Le départ des Japonais laisse les deux camps chinois face à face. Dans les trois premières années, le Kuomintang, qui dispose d’une armée nombreuse et bien équipée, a le dessus, mais peu à peu le vent tourne. De septembre 1948 à janvier 1949, la bataille de Huei oppose un million d’hommes. Les armées communistes, conduites par Deng Xiaoping, écrasent les divisions nationalistes. L’une après l’autre, les villes tombent entre leurs mains. Le Kuomintang, avec près d’un million de soldats et de civils, quitte alors la Chine continentale et s’installe à Taïwan. La Chine est passée sous le contrôle des communistes. Ceux-ci avaient déjà proclamé, le 1er octobre 1949, au balcon de la place Tian An-men de Pékin, la fondation de la République populaire de Chine.
L’Église en Chine en 1949
À la naissance de la République populaire, l’Église de Chine comptait environ 4 millions de fidèles pour une population de 463 500 000 habitants. Il y avait 20 archidiocèses, 85 diocèses et 39 préfectures apostoliques avec 27 Ordinaires chinois. Les missionnaires étrangers étaient 3 080 pour 2 557 prêtres autochtones. L’Église s’était dotée, en outre, d’innombrables écoles en tous genres et de tous degrés, spécialement de trois universités à Pékin, Tien-Tsin et Shanghaï (la célèbre université Aurore).
Au contraire de ce qui s’était passé dans les anciennes possessions françaises, les premiers missionnaires – et leurs successeurs – ne s’étaient pas introduits en Chine dans « les bottes » d’un quelconque occupant colonisateur, mais étaient arrivés par leurs propres moyens. Ils n’ont dû, par conséquent, à convertir des Chinois que par leurs seuls mérites et, parfois, par le sacrifice de leur vie. Il n’y avait donc rien de « colonialiste » ou d”« impérialiste » dans leur évangélisation.
C’est en 1294 que fut établie la première église catholique en Chine, par le frère franciscain italien Giovanni da Montecorvino. Il en fut le premier évêque catholique et il construit sa cathédrale en 1299 à Khanbaliq, connue aujourd’hui sous le nom de Pékin. Mais en 1368 la dynastie Yuan (1271–1368) s’effondre et la dynastie Ming qui lui succède interdit le catholicisme (saint François- Xavier est mort le 3 décembre 1552 dans une île au large de Canton). Elle disparaît à son tour en 1644. Vers la fin de son règne, en 1583, Matteo Ricci – le missionnaire le plus célèbre de la Chine – parvient à inaugurer la mission jésuite. Il a publié plusieurs livres en chinois pour promouvoir le catholicisme, dont le plus célèbre était son Tianzhu Shiyi, ou le Vrai sens du Seigneur des Cieux (1603). Après lui, un autre jésuite, Adam Schall von Bell, savant astronome, fait sa place à la cour de l’empereur Sun Shi qui le nommera « Maître des secrets du ciel » et, suprême honneur, unique pour un étranger, mandarin de première classe. Avec lui, la population catholique va passer de 3 000 à 200 000 âmes. En 1685, le premier prêtre chinois, Gregory Luo Wenzao, dominicain (1616–1691), est consacré évêque catholique romain. En 1926 (année du début de la conquête du pouvoir communiste), le pape sacre à Rome les six premiers évêques chinois de la période contemporaine. L’Église catholique n’a donc pas attendu Mao pour donner à la Chine les moyens de « siniser » son clergé.
Premières persécutions (1945–1950)
Dès après la fin de la guerre avec le Japon (1945), l’Église subit les premières persécutions dans les territoires conquis par les troupes de Mao Tse-toung, lequel, dans son Rapport présenté le 22 janvier 1934 au deuxième Congrès national des soviets de la Chine, déclarait déjà : « Dans les territoires soviétiques chinois, les prêtres catholiques et les pasteurs protestants ont été expulsés par les masses populaires. Les propriétés saisies par les missionnaires impérialistes ont été rendues au peuple. Les écoles missionnaires ont été transformées en écoles soviétiques. Bref, les districts soviétiques chinois ont été les seuls à être libérés du joug impérialiste. » (Albert Galter, Le communisme et l’Eglise catholique, Fleurus, 1956, p. 143) Il y eut bien d’autres mesures de rétorsion : incendies d’églises, violences sur des prêtres, assassinats de fidèles, rançons exorbitantes pour la libération d’otages, occupation de constructions scolaires et d’œuvres sociales, etc.
Mais c’est à partir de 1945 qu’on peut parler d’une persécution orchestrée, méthodique et généralisée. Comme partout ailleurs dans le monde communiste, on proclama la liberté et la tolérance religieuses. Comme partout ailleurs, l’agression contre les institutions ecclésiales débuta par une violente campagne de dénigrement, incessante et multiforme dans ses procédés, omniprésente dans les écoles, les usines, les bureaux, débitant les mêmes arguments éculés sur la prétendue absurdité de la foi en Dieu, les mêmes poncifs diffamatoires sur la chasteté des prêtres et des religieuses, les mêmes énormités sur la richesse du clergé et sur sa complicité avec les classes dominantes. Il s’y ajoutait la dénonciation des éléments étrangers et vassaux de l’impérialisme que constituaient les missionnaires.
Puis vint, sans beaucoup tarder, la phase également traditionnelle de « campagne pour la rééducation » nécessaire à la création de « l’homme nouveau » : bien que répétés à satiété, les « bons » messages ne suffisent pas à transformer les mentalités en profondeur ; il faut, pour que les individus s’en imprègnent en profondeur, les amener à en discuter, à se situer personnellement eux-mêmes par rapport aux « vérités » que ces messages délivrent, analyser leurs propres réactions (sous l’oeil du rééducateur) pour finir par procéder à leur autocritique publique. Au besoin, les fortes têtes feront l’objet de séances spécifiques en d’autres lieux, aidés en cela par quelques techniques physico-chimiques et autres gracieusetés plus musclées, sort réservé particulièrement aux catholiques rétifs. Les communistes chinois sont passés maîtres dans cette entreprise de « lavage de cerveau » collectif.
La société est alors prête à accepter, voire à soutenir les premières mesures d’autorité : transfert aux mains du Parti des écoles confessionnelles, transformation d’églises en lieux de conférences, salles de bal, étables, entraves à la circulation des consacrés, confiscation de tous les biens fonciers des missions, déjà grevés de taxes d’une valeur supérieure aux biens eux-mêmes.
Les esprits ont été si bien matés et disciplinés que l’étape suivante n’a pas grand mal à se réaliser. Il s’agit cette fois de la mise en place de « tribunaux populaires ».
Cela commence par des manifestations contre les missions, provoquées en sous-main par le Parti, pour convaincre les missionnaires de partir. Leur refus provoque des troubles « spontanés » de plus en plus violents en sorte que le Parti se trouve obligé « au nom du Peuple » d’arrêter l’évêque, les prêtres, les religieuses, les laïcs les plus en vue, et d’ouvrir leur procès en présence de milliers de personnes et sans droit de défense.
Assortis de « témoignages » invérifiés, les actes d’accusation, des plus extravagants, sont alors lus au milieu des vociférations de la foule :
- conversion des enfants au catholicisme par la force ;
- tortures infligées aux malades dans les hôpitaux ;
- refus de nourriture aux enfants des orphelinats ;
- énucléation des yeux à des fins de recherche scientifique en Occident ;
- recel d’énormes quantités d’or dans les églises ;
- espionnage au profit du Kuomintang et de l’Amérique impérialiste.
Des procès de cette sorte, il y en eut par centaines, s’accompagnant parfois d’actes de barbarie, comme celui de faire parcourir au condamné les rues du village sous les insultes et les coups de la populace excitée par des agents du Parti. Les condamnations variaient selon la nationalité de l’accusé et la gravité de ses prétendus méfaits. Cela pouvait aller de la mort ignominieuse (voir encadré page suivante) à des amendes exorbitantes pour certains missionnaires (évêques ou prêtres) contraints ainsi à se rendre en zone étrangère pour aller y chercher de l’argent, ce qui était un moyen aisé de les expulser. Lorsqu’ils n’étaient pas torturés avec une particulière cruauté, les prêtres chinois plus souvent condamnés aux travaux forcés, y étaient soumis jusqu’à huit heures par jour à des cours de marxisme qui finissaient par détraquer leur cerveau.
Le « mouvement de la triple autonomie » (1951–1953)
C’est à partir de membres de groupes protestants, comptant 700 000 âmes au moins, que va s’édifier la « refonte de la pensée » religieuse en Chine, ainsi définie, début février 1949, par le pasteur Chao Tzu-che’n, doyen de la Faculté de théologie de l’université d’Etat Yenching, réclamant une « révolution » dans les Églises : « Les Credo des diverses Églises ont une origine humaine marquée par des conditions sociales et politiques. Les chrétiens de Chine doivent se désolidariser de tous ces apports de l’histoire (…). Il est grand temps pour la Chine de se donner une théologie chinoise, avec une théorie de la Création, une philosophie de l’histoire, une interprétation de la vie humaine et de la rédemption du Christ. Cette théologie (…) devra s’harmoniser avec la culture chinoise et l’immanentisme dynamique marxiste. Le christianisme devra être « repensé » pour que le témoignage chrétien puisse être porté devant les communistes. » (Jean Lefeuvre, Les enfants dans la ville, Témoignage chrétien-Casterman, p. 17)
Dans son approche liminaire des catholiques, le gouvernement populaire saura utiliser ce discours et, surtout, la collaboration d’un protestant gagné au marxisme depuis dix ans et très tôt soutenu par M. Chou En-lai, M. Wu Yao-tsung. Celui-ci avait rédigé, en juillet 1950, un Manifeste cosigné par quarante personnalités protestantes, qu’il publia le 25 septembre quand il eut recueilli 1 527 autres signatures. Ce Manifeste reprenait à son compte la formule d’une « Triple autonomie » dont le principe avait été déjà émis par des milieux protestants en 1940. Wu Yao-tsung le précisa dans une déclaration à l’agence Chine Nouvelle le 14 janvier 1951, mettant l’accent sur la nécessité, pour les chrétiens chinois, de cesser d’être les « chiens courants de l’impérialisme religieux étranger » en réinventant dans leur culture propre la théologie occidentale. Il est juste de dire que la majorité des Églises protestantes ne partageait pas les excès du discours de ce notable antérieurement gradué de l’université Columbia de New York, et que nombre de ses hiérarques – dont un évêque méthodiste –, dénoncés comme de « tristes intrigants vendus aux impérialistes », en subirent les fâcheuses répercussions personnelles. Mais l’ambitieux M. Wu avait su utiliser les techniques marxistes de manipulation et arracher, non sans mal, quelques milliers de signatures. Il finit même par substituer, au Conseil national protestant, représentatif de 70 % des diverses confessions, son propre Conseil, lequel parvint à assurer progressivement sa domination.
L’idée maîtresse du Manifeste fut récupérée par le gouvernement. Dans son Dictionnaire des termes nouveaux, il lui donna une définition officielle sous le terme de « Mouvement de la triple autonomie », qu’il lança en janvier 1951 et qui devint la référence permanente du degré d’intégration marxiste des communautés chrétiennes, singulièrement catholiques, et de l”« Église patriotique » naissante – schismatique en dépit de quelques déclarations illusoires sur ses rapports avec le pape. Par « Triple autonomie », il fallait entendre :
- une « autonomie de gouvernement » : l’Église administrée exclusivement par des Chinois devait recruter elle-même son personnel avec ses propres moyens et sans le contrôle du pape ;
- une « autonomie économique » : l’Église de Chine ne devait recevoir aucun subside de l’étranger, même pour ses œuvres de bienfaisance ;
- une « autonomie d’extension » : plus aucun missionnaire et, surtout élaboration d’une nouvelle théologie fondée sur la culture chinoise conforme (laquelle était désormais soumise à l’idéologie communiste) ; exprimé plus subtilement : « Les chrétiens chinois doivent découvrir les trésors de l’Évangile du Christ par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Ils doivent se libérer de la théologie occidentale et créer un nouveau système théologique à leur mesure. C’est là le seul moyen de mettre en pratique l’esprit (révolutionnaire) du Christ dans notre « nouvelle Chine ». » (Agence nationale Hsin Hwa du 14 janvier 1951)
L’application de la stratégie communiste visant, à travers le Mouvement de la triple autonomie, à disloquer les communautés chrétiennes et à « récupérer » (voir encadré page 37) le clergé, fut confiée à un « Bureau des Affaires religieuses » créé le 12 janvier 1951 et chargé, notamment, de promouvoir une « Église patriotique ». Les Églises protestantes avaient eu leur Wu Yao-tsung. Il fallait que l’Église catholique ait le sien. Le Bureau des Affaires religieuses le recruta en la personne du directeur de l’université catholique L’Aurore, M. Hu Wen-yao, qui apostasia publiquement, le 18 janvier 1951 à Pékin, au cours d’une réunion des représentants d’une vingtaine d’établissements de l’enseignement supérieur subventionnés par l’étranger, réunion présidée par le ministre de l’Enseignement supérieur. Nous le retrouverons plus tard. Dans l’immédiat, il fut remplacé, à la tête de l’université L’Aurore, par un autre apostat, M. Ma Hsü-lun.
Le Gouvernement tenta, à deux reprises – d’abord à Tien-Tsin, puis, le 17 janvier, à Pékin, dans une réunion nationale où intervint M. Chou En-lai lui-même –, d’amener les catholiques à souscrire officiellement au Mouvement de triple autonomie, mais les évêques présents n’ayant pas obtenu par la suite, du Bureau des affaires re- Ma Hsü-lun ligieuses, des éclaircissements sur certaines formulations ambiguës relatives à l’autorité du pape, la tentative se solda par un échec. L’action destructrice des communistes rencontra sur son chemin deux forces inattendues sur lesquelles l’épiscopat sut vite qu’il pouvait s’appuyer : la jeunesse catholique et la Légion de Marie.
La jeunesse catholique chinoise
Nous n’avons que peu d’ouvrages pour savoir ce qu’il en était de l’état mental des catholiques chinois face aux forces communistes déferlant sur « l’Empire du Milieu ». Il en est un, cependant, intitulé Les Enfants dans la Ville, datant de 1954, qui décrit avec forces détails et une grande sensibilité le comportement de la jeunesse catholique de Shanghaï, ville du pays comptant le plus grand nombre de chrétiens, face à la stratégie de désintégration de l’Église qu’a déployée le gouvernement populaire proclamé par Mao Tse-toung.
Quand « l’Armée populaire de Libération » pénétra dans Shanghaï le 24 mai 1949, la jeunesse catholique de cette métropole de 6 millions d’habitants était formée essentiellement dans des établissements catholiques de renom dont les plus importants étaient le collège Saint-Ignace et la prestigieuse université L’Aurore. L’attitude ouverte et constructive de cette jeunesse lui avait certes valu bien des sympathies dans la population, mais, face au dogmatisme du mouvement cryptomarxiste de la « Jeunesse néodémocratique » – qui s’était constitué dans le sillage de l’armée révolutionnaire et, exigeant de ses membres une profession d’athéisme militant bénéficiait auprès des nouvelles autorités politiques d’un poids énorme –, il devenait prévisible que les associations catholiques auraient à user, volens nolens, d’une stratégie relationnelle à la fois plus prudente et plus incisive.
Le recteur du collège Saint-Ignace, le père jésuite Béda Tsang, dont il sera question à plusieurs reprises, en avait bien conscience : « Il est clair, expliquait-il, que l’asservissement de l’Église est le but que poursuit notre gouvernement, à l’instar des autres gouvernements populaires. Mais la situation concrète de notre Église est différente de celle des pays d’Europe centrale : nos catholiques ne sont qu’une très faible minorité, dirigée par des évêques étrangers pour la plupart. Dans sa lutte pour la foi et la défense du lien avec Rome, l’Église chinoise doit éviter de passer devant l’opinion nationale pour une faction réactionnaire au service de « l’impérialisme étranger ». » Ainsi convenait-il de rejeter aussi bien la résistance butée et provocante dans des questions n’engageant pas la foi que la collaboration inconditionnée des faibles cédant peu à peu sur tout ce qu’on leur demande. Fidélité absolue, donc, quand la foi est en jeu, et concessions sur des points secondaires, ce qui nécessitait aussi bien de l’intelligence que du courage. L’Église se devait de ne pas apparaître comme l’ennemie du gouvernement sur ce qui touchait essentiellement à la vie nationale. Plutôt que de défendre ses biens, et même ses œuvres, il importait qu’elle réservât le meilleur de ses forces pour garder vivante la communauté de foi de ses membres.
Il fallait armer d’urgence une jeunesse certes bien formée intellectuellement, mais peu préparée à affronter un registre d’endoctrinement communiste pernicieux utilisant une dialectique de groupe inhabituelle et parfaitement rodée et alternant les pressions collectives avec des séquences individuelles de conditionnement. Il fallait la rendre apte à confronter, le moment venu, aux déductions piégées de l’idéologie marxiste, des arguments théologiques solides appuyés sur une apologétique rénovée (en particulier en matière de science et foi). Mais il fallait, aussi, forger son âme profonde de manière qu’elle disposât de toute la force nécessaire face aux menaces et chantages plus ou moins voilés, et de la vertu chrétienne d’héroïsme devant l’épreuve éventuelle du martyre. Doctrinale et spirituelle à la fois, la formation spécifique donnée en quelques mois par un groupe de prêtres chinois à près de trois mille étudiants et collégiens, mêlant cours, temps de silence, de prière commune et d’adoration – un peu sur le modèle des retraites spirituelles ignaciennes – permit à l’Église chinoise de se doter d’une cohorte de militants chevronnés qui allaient constituer le fer de lance de la résistance de la communauté catholique de Shanghaï, puis finalement du pays. De son côté, le Bureau central catholique coordonna l’effort apostolique sur le plan national.
Mais le groupe des Pères chinois estima souhaitable de ne pas constituer une organisation nouvelle, pressentant que les structures ecclésiales visibles seraient parmi les premières cibles du pouvoir communiste ; il s’attacha, en conséquence, à édifier une Action catholique diffuse à partir de plus de 900 élèves, garçons et filles, qui se succédèrent pour des retraites fermées de trois jours et constituèrent des « groupes de catéchismes » (les fameux Yaoli Hsiaotsu) qui se réunissaient une fois par semaine, le soir après les cours et jusque tard dans la nuit. Ils constituèrent ainsi l’armature invisible d’un apostolat de proximité (notamment au sein de la Légion de Marie) n’offrant aucune prise aux autorités publiques.
Au mois de décembre 1950 avait été lancée, dans tous les établissements scolaires du pays, une vaste campagne d’enrôlement des Volontaires de Corée confiée à la Jeunesse néodémocratique et s’inscrivant dans le cadre d’une Convention patriotique que tous les Chinois devaient signer. Cette convention comportait malheureusement une phrase inacceptable pour les catholiques : « J’approuve et soutiens le Parti communiste chinois. » À L’Aurore, dont la nouvelle direction « patriotique » ambitionnait de faire le modèle national de la coopération catholique aux objectifs gouvernementaux, les étudiants catholiques s’opposèrent si hardiment qu’ils obtinrent la modification de la phrase contestée, laquelle fut remplacée par l’engagement de soutenir le président Mao et le gouvernement dans la mobilisation patriotique, mais non plus le Parti communiste. Ils durent cependant souscrire à la reconnaissance de la nouvelle direction de l’université, mais refusèrent catégoriquement toute discussion sur la Triple autonomie. Dans ce bras de fer disproportionné, 80 % d’entre eux restèrent fidèles jusqu’au bout aux recommandations de l’abbé Beda Tsang, chef moral de la résistance estudiantine.
Le 20 février 1951, un congrès des directeurs et préfets des études des collèges secondaires privés donna l’occasion à un chrétien apostat de proposer que fût ajoutée à la déclaration commune finale une clause par laquelle les catholiques s’engageraient à promouvoir le Mouvement de triple autonomie dans leurs écoles.
Le père Béda Tsang se leva et, avec lui, six autres directeurs, tous refusant de souscrire à cet amendement. Un protestant accusa les catholiques de manque de patriotisme. Le père Béda Tsang répondit en soulignant la différence foncière entre les catholiques, fidèles indéfectiblement à leur foi et à l’Église du Christ, et les protestants, sortis d’une réforme initiale, qui leur permettait de se réformer à nouveau selon leur propre désir. Le président interrompit la séance. À la reprise, les protestataires furent priés de donner les raisons de leur refus. L’un d’eux, le père Fu, salésien, intervint avec courage et déclara que l’adhésion à la Triple autonomie était impossible, entraînant immanquablement un schisme. Peu après, son directeur, le frère Ye Ming-yen, était arrêté. Il mourut en prison le 19 mai 1952. Les six autres directeurs chinois furent relevés de leurs fonctions peu avant la fin de l’année scolaire.
Alain Toulza
Sources : Fideliter n° 243