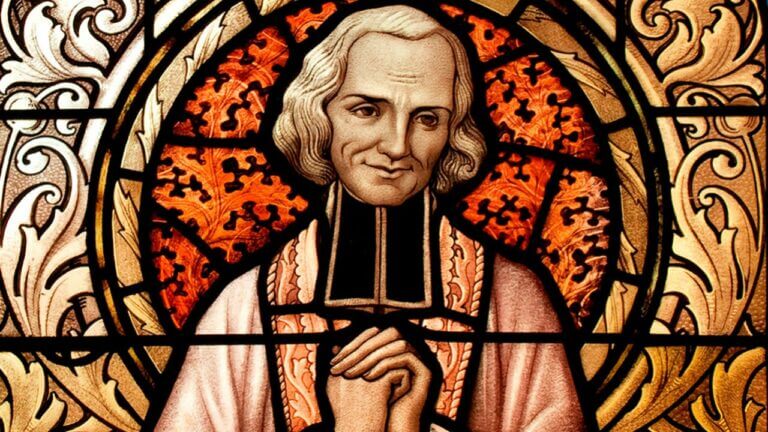Roi et Empereur (973‑1024)
Fête le 15 juillet.

Version courte
Saint Henri, surnommé le Pieux, appartenait à la famille impériale des Othons d’Allemagne, qui joua un si grand rôle au moyen âge. Touché d’une grâce spéciale de Dieu, il fit, jeune encore, un acte de hardiesse que lui eût dissuadé la prudence humaine, en promettant à Dieu de ne s’attacher qu’à Lui et en Lui vouant la continence perpétuelle. Héritier du royaume de Bavière par la mort de son père, il se vit obligé de prendre une épouse, pour ne pas s’exposer à la révolte de son royaume ; le choix du peuple et le sien se porta sur la noble Cunégonde, digne en tous points de cet honneur. Elle avait fait, dès son adolescence, le même vœu que son mari.
Henri, devenu plus tard empereur d’Allemagne, justifia la haute idée qu’on avait conçue de lui par la sagesse de son gouvernement ainsi que par la pratique de toutes les vertus qui font les grands rois, les héros et les Saints. Il s’appliquait à bien connaître toute l’étendue de ses devoirs, pour les remplir fidèlement, il priait, méditait la loi divine, remédiait aux abus et aux désordres, prévenait les injustices et protégeait le peuple contre les excès de pouvoirs et ne passait dans aucun lieu sans assister les pauvres par d’abondantes aumônes. Il regardait comme ses meilleurs amis ceux qui le reprenaient librement de ses fautes, et s’empressait de réparer les torts qu’il croyait avoir causés.
Cependant son âme si élevée gémissait sous le poids du fardeau de la dignité royale. Un jour, comme il visitait le cloître de Vannes, il s’écria : « C’est ici le lieu de mon repos ; voilà la demeure que j’ai choisie ! » Et il demanda à l’abbé de le recevoir sur-le-champ. Le religieux lui répondit qu’il était plus utile sur le trône que dans un couvent ; mais, sur les instances du prince, l’abbé se servit d’un moyen terme :
« Voulez-vous, lui dit-il, pratiquer l’obéissance jusqu’à la mort ?
– Je le veux, répondit Henri.
– Et moi, dit l’abbé, je vous reçois au nombre de mes religieux ; j’accepte la responsabilité de votre salut, si vous voulez m’obéir.
– Je vous obéirai.
– Eh bien ! Je vous commande, au nom de l’obéissance, de reprendre le gouvernement de votre empire et de travailler plus que jamais à la gloire de Dieu et au salut de vos sujets. » Henri se soumit en gémissant.
Sa carrière devait être, du reste, bientôt achevée. Près de mourir, prenant la main de Cunégonde, il dit à sa famille présente :
« Vous m’aviez confié cette vierge, je la rends vierge au Seigneur et à vous. »
Abbé L. Jaud, Vie des Saints pour tous les jours de l’année, Tours, Mame, 1950
Version longue
Du point de vue chronologique, saint Henri est le treizième des vingt rois inscrits par l’Eglise au Martyrologe Romain. Mais, comme l’observe finement un de ses biographes, l’abbé Lesêtre, telles ont été pour ces hommes les difficultés à surmonter afin de devenir des saints dans la place qu’ils occupaient, que leur nombre, si faible qu’il paraisse, est encore un titre de gloire pour l’humanité.
A l’ombre du cloître.
Henri vit le jour le 6 mai 973, probablement à Ratisbonne. Il était le premier-né d’Henri II le Querelleur, duc de Bavière et cousin de l’empereur Othon II. Sa mère, Gisèle, fille d’un roi de Bourgogne, eut à se préoccuper de bonne heure de l’éducation de son fils, car celui-ci atteignait à peine sa deuxième année quand son père fut jeté en prison par ordre de son puissant cousin. Pour désarmer le courroux du monarque, elle mena l’enfant au monastère d’Hildesheim, en Saxe, et promit de le vouer à la vie des Chanoines réguliers. Ainsi dirigé officiellement vers la carrière religieuse, le jeune Henri ne risquerait pas, pensait-elle, de porter ombrage à Othon II.
Au contact quotidien avec les auteurs sacrés, les biographes des Saints, les littérateurs et les philosophes de marque, le futur empereur commença d’acquérir ce tour d’esprit, ce sens des choses de l’Eglise, cette largeur et cette modération d’idées qui lui seront plus tard d’un si grand secours dans le gouvernement des hommes.
Il importait toutefois à la popularité du jeune prince que son éducation s’achevât en Bavière, dans le duché que son père avait gouverné et à la tête duquel on espérait bien malgré tout le voir lui-même un jour. C’est pourquoi ses parents le confièrent à saint Wolfgang, religieux Bénédictin devenu évêque de Ratisbonne.
Le duc de Bavière.
Henri avait vingt-deux ans quand les seigneurs de Bavière le désignèrent pour succéder, comme duc de Bavière, à son père, Henri II, mort le 28 août 995. Le défunt avait tout fait pour préparer cette élection ; elle s’accomplit avec d’autant moins de difficulté que la tendance à reconnaître les droits héréditaires s’accusait de plus en plus dans un pays où jusqu’alors toutes les dignités, au moins en droit, étaient électives. L’empereur Othon III, qui venait de succéder à Othon II, ratifia sans peine le choix de la noblesse bavaroise.
Vers cette époque, le nouveau duc, cédant aux instances de son peuple, contracta mariage. Il rencontra une épouse digne de lui dans la personne de sainte Cunégonde, fille de Siegfried, comte de Luxembourg. Ainsi que devait le déclarer Eugène III, en 1145, dans la Bulle de canonisation, leur union fut sanctifiée par une chasteté conservée intacte jusqu’à la mort.
Pendant les sept années qu’il gouverna son duché, Henri III de Bavière se montra seigneur loyal et dévoué, s’efforçant d’apaiser la turbulence des féodaux. Il accompagna l’empereur en 996 et en 998 dans ses deux expéditions en Italie. Les rapports les plus cordiaux existaient entre lui et Othon III, qui se plaisait à le nommer son « très cher cousin » et son « aimable duc ».
Ils furent de courte durée. Le 23 janvier 1002, Othon III mourait sans postérité à Paterno, près de Capoue, âgé seulement de vingt et un ans. Sa royale descendance comme aussi la faveur marquée d’un bon nombre de seigneurs influents autorisaient le duc de Bavière à briguer la succession de l’empereur défunt. Dans une Diète tenue à Werla, en 1002, l’assemblée reconnut qu’Henri devait régner « avec l’aide du Christ et en vertu de son droit héréditaire ». Ses rivaux essayèrent de lui opposer d’autres Diètes ; mais l’un d’eux, Eckhard de Meissen, fut assassiné. Un autre, Hermann, duc de Souabe, était désavantagé par son grand âge ; Henri se fit élire, sacrer et couronner le dimanche 7 juin 1002, à Mayence. Le duc de Bavière Henri III devenait ainsi Henri II, roi de Germanie. Sa royauté fut reconnue au cours des mois suivants.
Le roi de Germanie.
A l’avènement d’Henri II, l’Allemagne, outre les cinq duchés de Saxe, de Franconie, de Souabe, de Bavière et de Lorraine, comprenait encore la Belgique, les Pays-Bas, presque toute la Suisse, quelques provinces de l’Italie et de la France. Cette trop vaste agglomération manquait de l’homogénéité nécessaire pour durer. Aussi le nouveau monarque fut-il constamment aux prises avec les difficultés. Au sein de l’empire s’agitait une féodalité orgueilleuse, brutale, impatiente du joug commun, toujours prête à la révolte et parfois à la trahison. A son propre foyer, les cinq frères de sa femme remplissaient le palais d’intrigues. Enfin, l’Italie et surtout la Pologne constituaient de grosses menaces.
Dès l’année 1003, la lutte s’engagea entre l’Allemagne et Boleslas Chobry, le chef redoutable des Polonais. Après trois guerres indécises, un compromis intervint enfin le 30 janvier 1018 entre les deux rois : en échange de la Lusace, Boleslas renonçait à la couronne germanique.
En même temps qu’il faisait face à l’ennemi de l’Est, Henri avait à se défendre au Sud, où le roi Arduin d’Ivrée cherchait à soulever contre l’empire le sentiment national. La nécessité de le combattre et aussi de repousser les Sarrasins et les Grecs obligea le monarque allemand à trois expéditions en Italie. Au cours de la première, en 1004, il reçut à Pavie la couronne de Lombardie.
En prince imbu de l’esprit chrétien, Henri s’était proposé le règne de Dieu sur la terre. Fidèle à cet idéal, sa politique chercha toujours à concilier, par des combinaisons sagement étudiées, les intérêts de l’Eglise et ceux de l’Etat. Un de ses premiers actes fut de doter de nombreux monastères en Bavière et d’en fonder de nouveaux. C’est qu’à cette époque l’Ordre monastique se présentait comme un organisme merveilleusement adapté à l’œuvre de la civilisation, soit qu’il assurât le bien-être des populations par le travail ; soit encore que ses domaines intercalés entre ceux des grands vassaux du royaume empêchassent les seigneurs d’acquérir une prépondérance territoriale menaçante pour le souverain ; soit enfin parce que chaque centre monastique constituait un foyer exemplaire de prière et d’étude.
Au cours de ses pérégrinations, Henri aimait à séjourner dans les couvents, au milieu des moines. Il s’édifiait de la régularité des bons, mais ne craignait pas d’intervenir hardiment pour faire cesser les abus.
Par amour de la popularité, Bernard, abbé du monastère de Hersfeld, au nord de Fulda, laissait ses moines vivre à leur guise. Lui-même, sous prétexte de santé, se retira avec sa suite dans une demeure bâtie sur la montagne. Il y vivait fort largement, si bien que les moines se plaignirent qu’il employât à son usage les biens du monastère et leur refusât à eux-mêmes le nécessaire. Henri, à qui la plainte fut adressée, appela aussitôt à Hersfeld, en qualité d’Abbé, un saint religieux, Godehard, avec mission d’y introduire la réforme. « Ce n’est pas un monastère qu’on me donne, se serait écrié le nouveau venu, à la vue de tant de biens, c’est un royaume ! » Puis, sans tarder, l’abbé signifia aux religieux qu’il venait pour appliquer à la rigueur la règle de saint Benoît, mais que la porte restait ouverte à ceux qui ne se sentaient pas le courage de s’y soumettre. Quelques vieillards et quelques jeunes moines demeurèrent seuls. La désertion du grand nombre ne découragea ni Henri ni Godehard. Les moines fugitifs revinrent peu à peu, les trésors amassés furent distribués aux pauvres, la simplicité monastique fut remise en honneur et bientôt à Hersfeld refleurit dans toute son austérité la règle bénédictine.
Ce qui se fît à Hersfeld se renouvela dans beaucoup d’autres monastères, sous l’impulsion du pieux souverain, qui entretenait les plus intimes relations avec les grands réformateurs de son époque, en particulier avec saint Odilon, abbé de Cluny. Ils se comprenaient merveilleusement l’un l’autre, et l’on peut dire, écrit M. Lesêtre, que « si, dans l’œuvre de la réforme monastique, Odilon fut la tête, en Allemagne Henri fut le bras droit ».
Les intrigues des seigneurs soutenus par ses propres beaux-frères et plusieurs autres membres de sa famille étaient pour le roi de Germanie une source de soucis. D’accord avec l’évêque de Wurtzbourg, ces ambitieux avaient habilement combiné le plan d’une répartition des diocèses qui arracherait à l’archevêque de Mayence la suprématie sur les régions frontières de la Bohême. Cette mesure n’était pas seulement la ruine de l’œuvre de saint Boniface : elle était, dans l’esprit de ses auteurs, le prélude d’un morcellement de l’empire à leur profit.
Pour déjouer ces calculs, et aussi pour « détruire le paganisme des Slaves », le roi négocia avec le Pape Jean XIX l’érection de l’évêché de Bamberg (1006), qui fut placé sous la protection directe du Saint-Siège, mais sans être soustrait à la juridiction de la métropole de Mayence. D’autre part, la concession du titre et de la puissance de duc à l’évêque de Wurtzbourg, en 1017, finit par apaiser le prélat.
L’empereur d’Allemagne.
Par ses brutalités et ses maladresses, Arduin d’Ivrée, le prétendu « roi national », avait mécontenté ses sujets italiens qui commençaient à tourner les yeux vers le monarque allemand ; mais celui-ci attendait, pour intervenir à coup sûr, une occasion favorable. Elle lui fut fournie en 1012 par l’élection de Benoît VIII en faveur duquel Henri II se prononça contre l’antipape Grégoire dont il rendit l’usurpation éphémère.
L’apparition de l’armée allemande en Italie, à la fin de 1013, eut son rapide contre-coup dans la péninsule. Arduin, se voyant perdu, renonça à la couronne pour se retirer ensuite dans un monastère. A Rome, les partisans de Grégoire jugèrent leur cause désespérée, abandonnèrent leur créature et attendirent en silence les événements, pendant que Benoît VIII reprenait possession de la ville et des palais apostoliques.
Le roi y arriva à son tour dans les premiers jours de février. Le Pape, entouré d’un nombreux cortège de prélats, se porta à sa rencontre, tenant un globe d’or, enrichi de pierres précieuses et surmonté d’une croix, symbole du pouvoir que le souverain devait exercer sur le monde en loyal soldat du Christ. Henri reçut le présent avec joie, l’examina et dit au Pape : « Saint Père, ce que vous m’avez fait préparer là est très expressif ; vous me donnez une excellente leçon en me montrant, par ce symbole de mon empire, d’après quels principes j’ai à gouverner. » Puis retournant le globe à plusieurs reprises, il ajouta : « Personne n’est plus digne de posséder un tel présent que ceux qui, loin de l’éclat du monde, s’appliquent à suivre la croix de Jésus-Christ. » Et le globe d’or prit la route de Cluny.
Le couronnement eut lieu le 14 février 1014. Le matin de ce jour, le roi se rendit avec son épouse Cunégonde à la basilique de Saint-Pierre. Le Pape l’attendait sur les marches du péristyle, où il lui posa les questions accoutumées, s’il consentait à être le zélé patron et défenseur de l’Eglise romaine et s’il promettait fidélité en toutes choses à lui et à ses successeurs. Sur sa réponse affirmative, Henri fut introduit dans la basilique et sacré empereur, puis couronné solennellement avec l’impératrice Cunégonde. Il fit aussitôt don de sa couronne, pour qu’elle fût placée sur l’autel du Prince des apôtres.
A l’occasion de son couronnement, le nouvel empereur délivra au Pape une charte de privilèges. Il lui garantissait la Toscane, Parme, Mantoue, la Vénétie, l’Istrie, les duchés de Spolète et de Bénévent, et même éventuellement les territoires de Naples et de Gaëte, encore aux mains des Byzantins. Une autre clause stipulait que « tout le clergé et toute la noblesse de Rome s’engageraient par serment à ne procéder à l’élection des Papes qu’en observant les règles canoniques, et que le nouvel élu, avant d’être sacré, s’engagerait lui-même, en présence des envoyés de l’empereur ou en présence de tout le peuple, à conserver les droits de tous ». C’était, en somme, la confirmation d’un droit reconnu par serment à Louis le Débonnaire par Eugène II (824–827) et qu’expliquaient, en cette période de troubles et d’anarchie, les difficultés de l’élection pontificale. Toutefois, cette tutelle impériale exercée sur l’Eglise lui réservait les plus graves périls, car les empereurs d’Allemagne s’en réclamèrent ensuite pour justifier leurs interventions intolérables dans les affaires de la Papauté.
La bonne entente, ainsi scellée entre Benoît VIII et Henri II, ne se démentit pas un instant pendant toute la durée de leur commun gouvernement. Elle leur permit de travailler efficacement au bien de la chrétienté, en particulier à l’observation de la Trêve de Dieu, dont le Concile de Poitiers avait, en l’an 1000, proclamé le principe et qui, pour entrer dans les mœurs, avait besoin du bras séculier.
Dès les premières années du xie siècle, on vit Henri II parcourir les provinces d’Allemagne, proclamant la paix locale, Landfrieden, dans les grandes assemblées, comme à Zurich en 1005, à Mersebourg en 1012, où tous, depuis le plus humble jusqu’au plus puissant, jurèrent « qu’ils maintiendraient la paix, qu’ils ne seraient point complices de brigandages ». Beaucoup de seigneurs et d’évêques suivirent cet exemple. Burkhard, évêque de Worms, publia un édit de paix afin de soumettre ses sujets « riches et pauvres » à la même loi. Contre ceux qui s’opposèrent au mouvement, l’empereur n’hésita pas à sévir et à dépouiller même des margraves de leur charge.
C’est également le désir de réaliser la pensée pontificale d’une paix universelle qui détermina Henri II à se rencontrer à Mouzon, près Sedan, les 10 et 11 août 1023, avec le roi de France Robert le Pieux. Ensemble les deux monarques y étudièrent les moyens de remédier aux maux de la chrétienté. Ils convinrent qu’un Concile général serait demandé au Pape pour remédier aux abus.
L’empereur grec de Constantinople conservait encore une certaine prétention d’autorité sur les Etats pontificaux. Les quelques villes de la Basse-Italie demeurées sous sa domination étaient administrées par un gouverneur. Celui-ci, obéissant aux ordres de son maître, envahit plusieurs villes de la Pouille qui relevaient du Saint-Siège et il ne dissimulait point son intention de rétablir l’influence byzantine dans toute l’étendue de la péninsule. Le Pape envoya contre lui Raoul, prince de Normandie, qui força les Grecs à se retirer de la Pouille.
Mais pour assurer d’une manière plus durable l’indépendance de l’Italie, Benoît VIII passa les Alpes et vint exposer à l’empereur l’état des affaires. L’entrevue eut lieu à Bamberg (avril 1020). Des questions de la plus haute importance y furent examinées tant au point de vue social qu’au point de vue religieux. Il s’agissait de repousser la domination byzantine, hostile à l’Eglise et ennemie de son unité. Saint Henri renouvela donc au Pape ses engagements de fidélité, et lui promit de voler à la défense du Saint-Siège dès qu’il le verrait menacé dans ses droits. Diverses questions de discipline furent également examinées relativement à la réforme du clergé.
Dans le milieu de novembre 1021, l’empereur quittait Augsbourg pour une troisième expédition dans l’Italie qu’avaient envahie à nouveau les Grecs. Cette fois, leur défaite fut complète. Henri leur enleva toutes les places qu’ils avaient conservées jusqu’alors et en fit don au Saint-Siège ; puis, après avoir ainsi pacifié la péninsule, il songea à retourner dans ses Etats. Il s’arrêta quelque temps au Mont-Cassin, où il régla avec le Pape diverses affaires concernant l’administration de la célèbre abbaye.
La couronne éternelle.
Un jour qu’Henri visitait les bâtiments de l’abbaye de Saint-Vanne, en Lorraine, que venait de restaurer Richard, Abbé de ce monastère, il proféra, en entrant dans le cloître, ces paroles du psalmiste : « Voici le lieu de mon repos pour toujours, c’est là que j’habiterai, dans le séjour de mon choix. » Haimon, évêque de Verdun, qui accompagnait le souverain, connaissait son goût de la vie monastique. Il avertit l’Abbé de ce qui allait probablement se passer. En effet, Henri ne tarda pas à manifester le désir de quitter la vie séculière pour devenir moine. Richard comprit que la vocation de l’impérial visiteur n’était pas celle d’un pauvre et modeste religieux ; il trouva un expédient pour satisfaire la piété du prince sans nuire à l’Etat. Il assembla sa communauté et pria l’empereur de s’expliquer devant tous ses religieux. Henri protesta qu’il avait résolu de quitter les vanités du siècle, pour se consacrer au service de Dieu dans le monastère où il se trouvait.
— Voulez-vous, dit l’Abbé, pratiquer l’obéissance jusqu’à la mort, suivant la règle et l’exemple de Jésus-Christ ?
— Je le veux, répond Henri.
— Et moi, reprend l’Abbé, dès ce moment je vous reçois au nombre de mes religieux. J’accepte la responsabilité du salut de votre âme, si de votre côté vous promettez de suivre, en vue du Seigneur, tout ce que je vous ordonnerai.
— Je jure de vous obéir ponctuellement en tout ce que vous me commanderez.
— Je veux donc, conclut Richard, et je vous ordonne, en vertu de la sainte obéissance, de reprendre le gouvernement de l’empire confié à vos soins par la Providence divine. Je veux que vous procuriez, autant qu’il dépendra de vous, le salut de vos sujets, par votre vigilance et votre fermeté à rendre la justice.
L’empereur, étonné, regretta sans doute de ne pouvoir secouer le joug qui pesait sur ses épaules ; il se soumit pourtant, et continua de faire briller sur le trône les vertus qu’il eût voulu ensevelir dans la solitude.
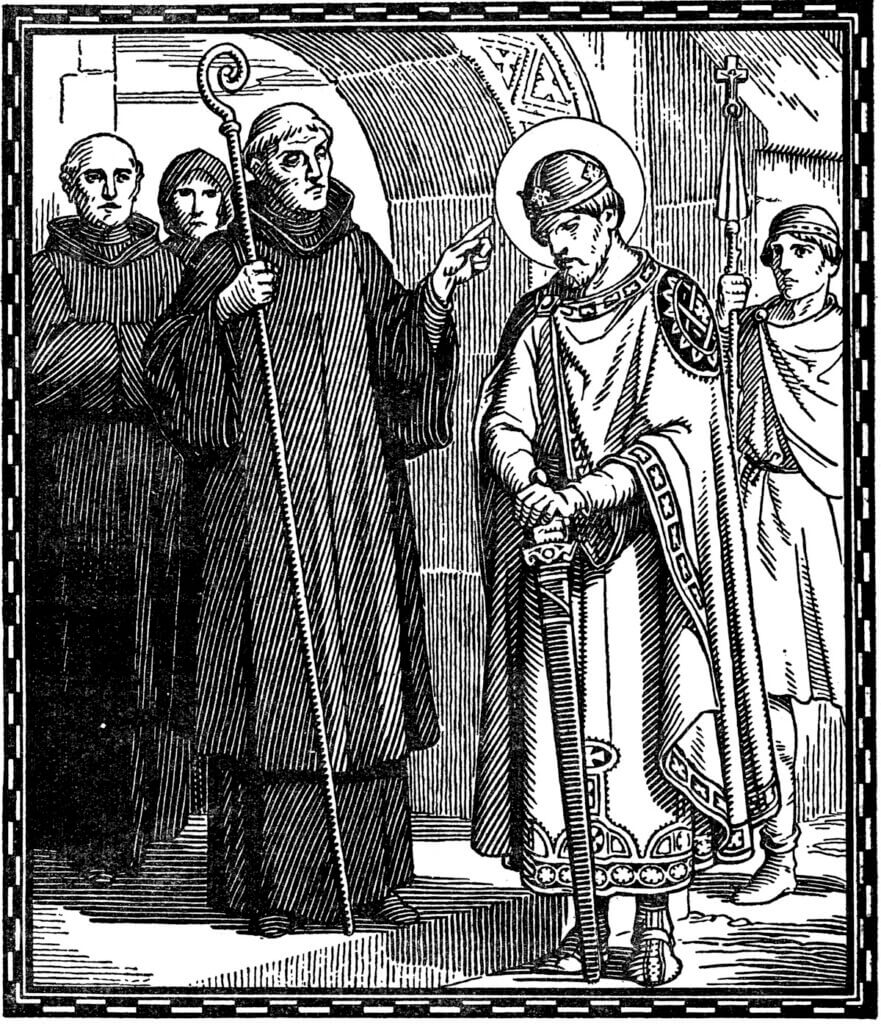
Cependant sa vie, si remplie de saintes œuvres, touchait à sa fin. Sa santé avait toujours été chancelante. Ses voyages incessants, ses nombreuses campagnes, les soucis de toute nature et surtout son dernier séjour en Italie minèrent ses forces. Au commencement de 1024, il devint évident que sa fin approchait. Un repos de trois mois à Bamberg lui ayant procuré quelque soulagement, il se remit aux affaires et ce fut sa perte. La mort le terrassa dans l’exercice des devoirs de sa charge, le 13 juillet 1024, au château de Grona, non loin de Goslar. Avec lui s’éteignait la maison de Saxe. Par son fondateur, Henri le Grand, elle avait puissamment travaillé à grouper autour d’elle les peuples germaniques ; par son dernier représentant, Henri le Saint, elle avait noblement servi l’Eglise.
Un peu plus d’un siècle après sa mort, le Pape Eugène III fit instruire le procès de canonisation et proclama, le 12 mars 1146, la sainteté du souverain. Au milieu de la nef centrale de la cathédrale de Bamberg se dresse encore le monument élevé à la mémoire de l’empereur Henri et de l’impératrice sainte Cunégonde. Ce tombeau, déplacé en 1658, fut rétabli en son lieu primitif en 1833. Des deux époux il ne conserve plus aujourd’hui qu’un peu de poussière. Ce qui reste de leurs ossements à Bamberg, principalement le crâne et le fémur de saint Henri, le crâne de sainte Cunégonde, est gardé dans le trésor de la cathédrale, avec différents objets leur ayant appartenu. Le tombeau porte cette inscription : « Aux saints Henri et Cunégonde, associés dans une impériale et virginale union, fondateurs, défenseurs, patrons de cette église. »
Le Pape Pie XI, le 4 décembre 1923, a amplifié le culte de saint Henri en élevant sa fête au rite double pour toute l’Allemagne.
H. L.
Sources consultées. — Abbé Henri Lesêtre, Saint Henri (Collection Les Saints). — Abbé Fernand Mourret, Histoire générale de l’Eglise, t. IV, La Chrétienté. — (V. S. B. P., n° 85.)