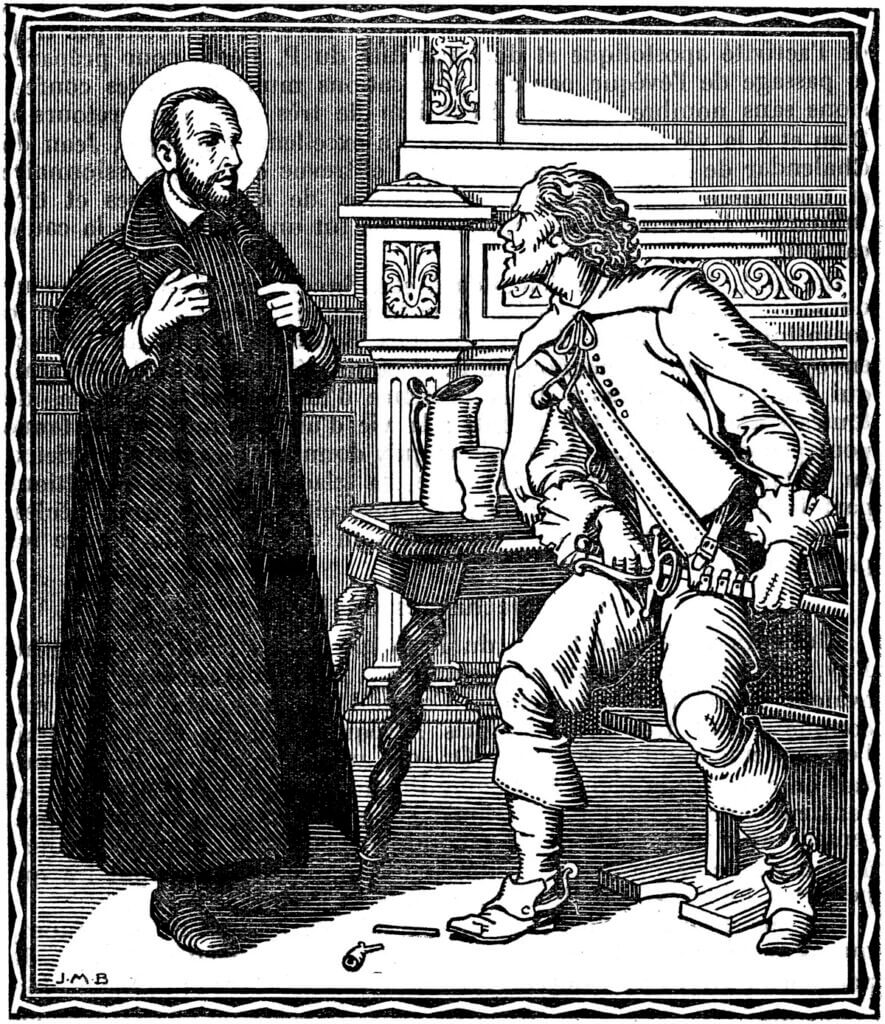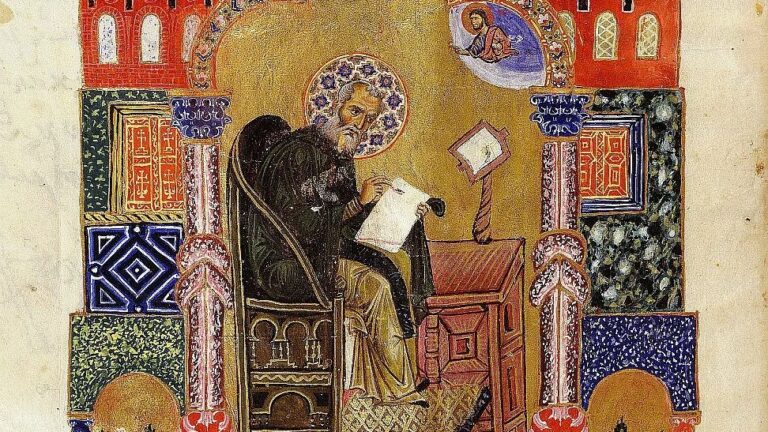Jésuite, apôtre du Vivarais et du Velay (1597–1640)
Fête le 16 juin.
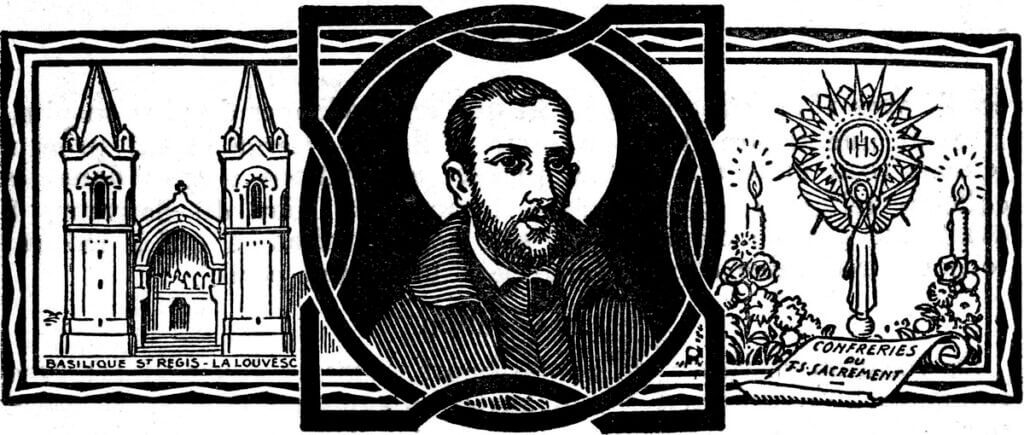
Parmi les nombreux Saints que la Compagnie de Jésus a donnés à l’Eglise, Jean-François Régis est un des plus illustres. Sa voie fut assez différente de celle des religieux de son Ordre ; certains traits d’audace de sa carrière, qui sont aussi racontés d’autres Saints, pourraient nous choquer, mais, dans les circonstances de temps et de lieux où Dieu le plaça, il eut une mission particulière à remplir ; il devait s’en acquitter avec un zèle admirable, une parfaite abnégation et une obéissance sans limites.
Jean-François Régis naquit le 31 janvier 1597 à Fontcouverte, diocèse actuel de Carcassonne. Ses parents étaient gens de petite noblesse, possédant une situation aisée, et jouissant de la considération. Sa famille se distingua par sa fidélité à la foi catholique dans ce pays bouleversé par les luttes contre les huguenots, et lui-même perdit un frère au diocèse de Villemur, au diocèse actuel de Toulouse.
Premières années.
Dès sa plus tendre enfance, il connut les douceurs de la piété et de l’amour de Dieu. A Page de cinq ans, il fut si vivement frappé en envisageant les peines de l’enfer qu’il exprimait à sa mère avec terreur la pensée de la damnation. Il ne prenait pas de goût aux amusements des enfants de son âge, préférant les choses sérieuses et ne s’occupant que d’exercices de piété. Souvent, il se renfermait dans une chapelle, et là, se laissant aller aux douceurs de la contemplation, il s’oubliait dans la présence de Notre-Seigneur.
Ses parents lui avaient donné un précepteur à l’humeur brusque et chagrine ; l’enfant timide et modeste eut beaucoup à souffrir de cette direction, mais le jour où le maître sut trouver le chemin du cœur de l’enfant, celui-ci fit de rapides progrès.
Bientôt, les Jésuites ayant ouvert des classes à Béziers, il leur fut confié vers 1611, et sa piété ne fit que se développer de plus en plus. Il avait une tendre dévotion pour la Sainte Vierge et fut promptement reçu dans une de ces pieuses associations érigées dans les collèges religieux, et destinés à honorer la Mère du Sauveur. Il avait une grande confiance en son ange gardien, à qui il se crut toujours redevable d’avoir échappé à un grand péril.
La vocation.
Sa vocation se révéla de bonne heure, dans la douce et salutaire influence qu’il sut prendre sur ses compagnons d’études, dispersés par petits groupes, selon la coutume, en des maisons particulières où ils prenaient pension. Dans les premiers moments, quelques railleurs tournaient en ridicule ses pratiques religieuses ; bientôt, ils reconnurent la puissance de sa vertu, et loin de s’éloigner de leur pieux compagnon, ils s’en rapprochèrent si bien que Jean-François gagna leurs âmes. Pour les cinq ou six écoliers avec qui il habitait, il composa une règle écrite, où les heures d’études étaient fixées, les conversations inutiles interdites ; on lisait un livre de piété pendant les repas, on faisait l’examen de conscience le soir, et le dimanche tous recevaient la sainte Communion.
Le pieux jeune homme fut à ce moment, semble-t-il, éprouvé par une maladie grave. Ayant recouvré la santé, il songea à se donner à Dieu d’une manière plus entière et fit une retraite pour connaître sa vocation. Il se sentit pressé d’entrer dans la Compagnie de Jésus. Son confesseur l’ayant engagé à suivre son inspiration, Jean-François entra au noviciat de Toulouse le 8 décembre 1616.
Le noviciat.
Dès les premiers jours, il se fît admirer des plus fervents. Rien ne venant plus troubler son désir d’une union constante avec Notre-Seigneur, il n’abandonnait pas la pensée de sa présence. Il s’appliqua à pratiquer tout particulièrement l’humilité, la haine de lui-même, le mépris du monde et le plaisir de procurer la gloire de Dieu, une très grande charité envers le prochain.
Les plus bas emplois étaient ceux qu’il chérissait davantage ; rien ne lui paraissait plus agréable que de balayer la maison et de servir à table. Son occupation préférée était certainement le service des malades.
Il aimait aller dans les hôpitaux, exercer sa charité envers les pauvres infirmes, choisissant les plus rebutants, car il savait considérer Jésus-Christ lui-même dans la personne de ceux qui souffrent. Il traitait son corps très durement, tout en usant de ménagements et de douceur pour les autres ; aussi, ses compagnons disaient-ils qu’il était son propre persécuteur.
Après deux ans de noviciat, Jean-François fut envoyé à Cahors, où il prononça ses premiers vœux, puis à Billom, où il fut professeur de grammaire, et de là à Tournon pour étudier la philosophie. Le goût des études n’affaiblit en rien sa piété et son goût pour l’oraison.
Premier apostolat.
Pendant son séjour à Tournon, il commença à évangéliser les pauvres et les serviteurs de la ville. Cette prédication aux petits et aux faibles convenait à sa nature humble et dévouée. Le dimanche, il accompagnait un religieux prêtre du collège et parcourait les villages et les bourgs d’alentour ; il se faisait précéder d’une clochette ; il réunissait les enfants, leur faisait le catéchisme et leur apprenait à aimer le Sauveur Jésus. Puis, ayant de même préparé les chrétiens plus ou moins délaissés, il les amenait au Père qui entendait leur confession.
Son goût pour l’apostolat acheva de se montrer d’une façon définitive dans la sanctification du bourg d’Andance, où son souvenir est resté très vivace. Là, il opéra des merveilles ; l’ivrognerie, les jurements, l’impiété, y régnaient en maîtres ; à la place, le Fr. Régis établit la pratique des sacrements, la réception fréquente et le culte de l’Eucharistie, il eut la gloire et le bonheur d’y instituer une confrérie du Saint-Sacrement, comme avant lui d’autres Jésuites avaient fait dans la région ; il était alors âgé seulement de vingt-deux ans.
Cependant, l’heure des grands travaux n’était pas encore venue, et ses supérieurs jugèrent à propos, en 1625, de l’envoyer dans la ville du Puy enseigner les belles-lettres.
L’enseignement.
Au Puy, comme précédemment à Cahors, Jean-François Régis songea non seulement à instruire ses élèves, mais encore à les diriger dans le bien. Il préparait ses classes avec le plus grand soin et ne trouvait pas de moyen plus sûr de professer avec fruit que d’aller prier avant l’heure de la classe devant le Saint Sacrement ; on remarqua que, malgré le grand froid, par esprit de mortification, il ne cachait même pas ses mains dans ses manches. Il guérit l’un de ses élèves malade en faisant sur lui le signe de la croix et en lui recommandant d’être désormais plus fervent dans le service de Dieu. Les jours de fête, il courait exercer son zèle apostolique près des gens des campagnes.
Professeur à Auch en 1627, le P. Régis fut envoyé l’année suivante à Toulouse pour y étudier la théologie. La nuit il se levait pour aller à la chapelle ; on en avertit le supérieur qui, comme inspiré, répondit :
– Ne troublez pas les entretiens de cet ange avec son Dieu ; je suis bien trompé si on ne célèbre pas sa fête quelque jour dans l’Eglise.
Ordination.
Au commencement de 1630, Jean-François reçut l’ordre de se préparer à la prêtrise ; un combat s’éleva alors dans son cœur ; le zèle pour la gloire de Dieu et le désir de gagner des âmes lui faisaient désirer cet honneur, tandis que son humilité le remplissait d’une sainte frayeur. Ses hésitations tombèrent et il demanda même, contrairement à l’usage, que son ordination fût avancée d’un an, ce qui lui enlevait pour toujours le droit d’être, à proprement parler, un religieux profès, sans toutefois, pour cela, cesser d’appartenir à la Compagnie de Jésus ; ce sacrifice fut accepté, et le P. Jean-François Régis fut ordonné prêtre à la Trinité de 1631. Il se prépara à sa première messe par le jeûne, les prières et les mortifications.
Apostolat des pauvres.
Quelques mois plus tard, le jeune prêtre dut faire un voyage à Fontcouverte, lieu de sa naissance. Il y allait pour affaire de famille, mais les choses de Dieu l’occupèrent bien plus que les intérêts de ce monde.
Voici comment il passait son temps : le matin, il faisait le catéchisme aux enfants, puis il prêchait, il entendait ensuite les confessions, et, vers la nuit, il faisait une nouvelle instruction. Dans le milieu du jour, il s’occupait de la visite des pauvres, mendiait pour eux chez les riches et portait ensuite ses aumônes aux vieillards et aux malades.
Il gardera ce programme en beaucoup d’endroits où le conduira sa carrière de missionnaire.
Un jour qu’il traversait les rues, portant sur ses épaules une paillasse, il fut hué par des soldats. Le P. Régis fut comblé de joie en se voyant assimilé à son divin Maître, et comme lui injurié. Ses frères crurent devoir lui faire des observations sur sa conduite si éloignée des maximes du monde, et qui ne pouvait être admise que par ceux qui comprennent la folie de la croix :
– Exercez, lui dirent-ils, les œuvres de miséricorde, mais faites-le sans nous couvrir de confusion et de ridicule.
– Ce n’est pas en s’humiliant, répondit Jean-François, que les ministres de l’Evangile perdent leur caractère ; et pourvu que Dieu ne soit pas offensé, qu’importent les jugements des hommes !
En effet, cette charité sans bornes lui conciliait les cœurs, et il eut la consolation de ramener beaucoup d’âmes à Dieu, laissant dans le pays, écrivait son provincial, une grande odeur de sainteté.
Ces succès si consolants décidèrent ses supérieurs à lui confier exclusivement la mission de l’apostolat. Il débuta en mai 1632, dans la ville de Montpellier, très éprouvée par les guerres civiles de religion au cours du règne de Louis XIII, et il y fit de nombreuses conversions, non par de brillants sermons, mais par son exemple et l’explication du catéchisme.
Il avait pour les pauvres une véritable préférence ; souvent il restait dans son confessionnal jusqu’au soir, sans prendre de nourriture, afin d’entendre les confessions des malheureux, disant : « Les gens de qualité ne manqueront pas de confesseurs ; les pauvres, cette portion la plus abandonnée du troupeau de Jésus-Christ, tel doit être mon partage. » Il ne se contentait pas de leur donner de bonnes paroles, il les secourait, comme nous l’avons déjà vu faire ailleurs, des aumônes qu’il recueillait.
Dans cette ville aussi, il s’exerça à la conversion des madeleines, qui, à l’exemple de leur sainte Patronne, voulaient arroser de leurs larmes les pieds du Sauveur et renoncer à leurs péchés. Il excellera dans cette tâche, ne reculant pour cela devant aucun danger, pas même celui de se couvrir de ridicule ou de honte.
Missions dans le midi de la France parmi les protestants.
En 1633, Mgr de la Baume de La Suze, évêque de Viviers, qui avait demandé un missionnaire Jésuite pour l’accompagner à travers son diocèse, se vit donner le P. Régis ; le pays avait beaucoup souffert des luttes de religion, et le souvenir des deux Jésuites martyrisés en 1593, les bienheureux Jacques Salés et Guillaume Saultemouche, n’était pas près de disparaître. Il est vrai que déjà des religieux de divers Ordres avaient efficacement travaillé au relèvement religieux de la région. Il restait, hélas ! beaucoup à faire, et ce n’était pas trop de l’activité apostolique et de l’humilité du P. Régis pour préparer le passage de l’évêque par des prédications multipliées, des confessions sans nombre, qui représentaient de très nombreux retours à Dieu et à la vie chrétienne. A Uzer, un excellent catholique, Jean de Chalendar de La Motte, ménagea une entrevue entre le missionnaire et une dame noble, protestante obstinée, de mœurs pures et très influente ; l’abjuration de cette personne fut un succès pour la cause catholique.
En 1634, le P. Régis demanda à son Supérieur général la faveur de partir comme missionnaire pour le Canada ; mais l’obéissance le maintint à son poste. La région des Routières où il fut bientôt envoyé avec un compagnon, le P. Broquin, était le coin du Vivarais qui avait le plus besoin de la présence d’un apôtre ; les crimes de toutes sortes y étaient fréquents ; la vie d’un homme y était tenue pour peu de chose. Or, les missions qu’y donnèrent les deux religieux, en luttant contre le vent, la neige, la glace, dans des conditions parfois héroïques, accomplirent des merveilles : après trois siècles. Le Cheylard, en particulier, est resté l’un des points de France les plus fervents.
Les catéchismes du Puy.
Plusieurs années de la vie du P. Régis vont s’écouler ensuite au Puy, où riches et pauvres, souffrant de l’ignorance religieuse, avaient oublié le droit chemin. Ce qu’il fallait à cette population, comme l’avait très bien compris l’évêque, Just de Cerres, c’était l’enseignement du catéchisme. Or, qui mieux que le P. Régis pouvait en assumer la tâche ? Chaque dimanche, de 4 à 5 000 personnes venaient entendre ses instructions, simples, imagées, vivantes, présentées avec beaucoup de la faconde méridionale ; pas de recours à la mythologie ou à l’antiquité, mais une éloquence populaire qui pénétrait toutes les intelligences et tous les cœurs.
Ces succès du prédicateur importunèrent un orateur de renom, qui crut devoir le dénoncer au supérieur provincial ; celui-ci, de passage au Puy, tint à se rendre compte par lui-même ; par deux fois il alla entendre le cours de religion du P. Régis et ne put s’empêcher de pleurer : l’épreuve tournait ainsi à l’avantage de ce merveilleux catéchiste.
Au surplus, qu’on ne s’imagine pas cet apôtre passant dans les rues fermant les yeux et les oreilles ; ayant entendu un homme masqué blasphémer dans la rue, il alla le souffleter ; il mit de la boue dans la bouche d’une femme qui avait commis le même péché ; le premier s’agenouilla aussitôt sous la bénédiction du Père ; la seconde s’en alla tête basse : car tel était le prestige de sa sainteté.
Mais aussi, quelles mortifications il imposait à son corps pour tenir son âme plus près de Dieu et acheter les conversions ! Sa discipline était un instrument de « carnage », et malgré sa vie rude et son origine méridionale, il ne buvait jamais de vin, offrant à Dieu ce sacrifice héroïque, vu les circonstances, afin d’obtenir une chasteté parfaite, sans aucun trouble. Cette grâce lui fut accordée, comme elle le fut à saint Thomas d’Aquin et à sainte Thérèse.
Les luttes contre le libertinage lui valurent des moqueries, des insultes, des menaces de mort ; il ne recula jamais. Plus d’une jeune fille lui dut la conservation de sa vertu ; de mainte femme tombée il fît une pénitente, grâce à une maison de refuge qu’il avait fondée.
Des hommes contrariés dans leurs passions impures projetèrent de le tuer : il allait au-devant d’eux et les incitait lui-même à renoncer à leur secret dessein et à changer de vie. En effet, il lisait parfois dans les consciences, annonçait l’avenir ; c’est ainsi qu’il prédit aux dentellières du Puy, qui devaient plus tard le prendre pour Patron, que leur industrie, menacée par des ordonnances, se développerait au contraire avec la protection royale : il en fut bientôt ainsi.
Dernière maladie et mort.
La dernière partie de sa vie se passa dans les missions d’hiver ; seuls les lecteurs qui connaissent la rigueur des hivers montagnards peuvent comprendre les difficultés et les souffrances que supporta le missionnaire. Il devait d’ailleurs mourir au champ d’honneur, pendant une mission qu’il donnait à La Louvesc, au moment de Noël 1640. Avant de s’y rendre, ayant le pressentiment de sa fin prochaine, il alla au Puy, mit ordre à ses affaires de conscience, régla quelques dettes contractées pour les pauvres et gagna son poste de travail. En route, par un temps affreux, il s’égara pendant la nuit, et, malgré une pneumonie qui s’était déclarée, eut le courage de se rendre à La Louvesc, celui de prêcher cinq ou six fois et de confesser pendant trois jours entiers. Le soir du lendemain de Noël, il tomba en défaillance, fut porté à la cure où il confessa encore. Mais les médecins jugèrent son état désespéré.
Le missionnaire reçut le Viatique et les derniers sacrements avec une grande ferveur ; il ne trouvait de soulagement à ses souffrances que dans la vue du Crucifix. Le 31 décembre, il dit à son compagnon : « Ah ! mon Frère, je vois Notre-Seigneur et Notre-Dame qui m’ouvrent le paradis ! » Puis il s’écria : « In manus tuas… Seigneur, je remets mon âme entre vos mains. » Ce furent ses dernières paroles.
On le proclama saint d’une voix commune ; la terre de son tombeau fut enlevée plusieurs fois comme une relique précieuse. Les gens de La Louvesc, ayant appris que le corps du Père serait transporté à Tournon ou au Puy, l’enfoncèrent dans la terre et mirent au-dessus des barres de fer croisées. Trente-six ans après sa mort, les démarches officielles furent faites en vue de sa béatification, qui eut lieu sous le pontificat de Clément XI, le 8 mai 1716 ; enfin, il fut canonisé sous celui de Clément XII, le 8 mai 1737.
Assez fréquemment on entend dire qu’au moment de sa mort, saint Jean-François Régis n’appartenait plus à la Compagnie de Jésus, ou qu’il était sur le point d’en être rayé ; c’est là une méchanceté lancée, vers 1716, par les revues jansénistes et que l’histoire dément, avec preuves à l’appui.
Son culte.
Sous la Révolution, les reliques du Saint furent mises en lieu sûr, remplacées à l’église par une caisse d’ossements. Elles reprirent leur place en 1802. Une magnifique basilique, construite à La Louvesc par l’architecte Bossan, de 1865 à 1871, voit accourir chaque année des milliers de pèlerins.
Une association pieuse, destinée à régulariser les unions illégitimes, a été placée sous l’invocation de saint Jean-François Régis. Ce grand Saint, qui rendit la santé à un pieux magistrat, M. Gossin, vice-président du tribunal de la Seine, lui inspira cette bonne pensée et perpétua ainsi, au-delà du tombeau, le bien qu’il ne cessa de faire pendant son pèlerinage sur la terre.
Encore sous les auspices du zélé missionnaire ont pris naissance le double Institut des Sœurs de Saint-Régis et des Dames du Cénacle, et celui des Sœurs de la Présentation de Bourg-Saint-Andéol ; la Vén. Mère Duchesne, qui propagea en Amérique l’Institut des Dames du Sacré-Cœur, lui dut sa vocation, et c’est à lui que recourut le futur saint Jean-Baptiste Vianney, incapable d’avancer dans ses études, et qui devait par la suite, tout en adaptant sa vie aux circonstances et aux nécessités de son ministère, le prendre pour modèle.
A. D.
Sources consultées. – Les Petits Bollandistes. – Joseph Vianet, Saint François Régis (Collection Les Saints). – R. P. Daubenton, S. J., Vie de saint Jean-François Régis (1855). – R. P. Frédéric de Curley, S. J., Saint Jean-François Régis (1893). – Abbé Blancard, curé de Fontcouverte, Saint François Régis, sa vie, ses miracles (1916). – (V. S. B. P., nos 227 et 644.)