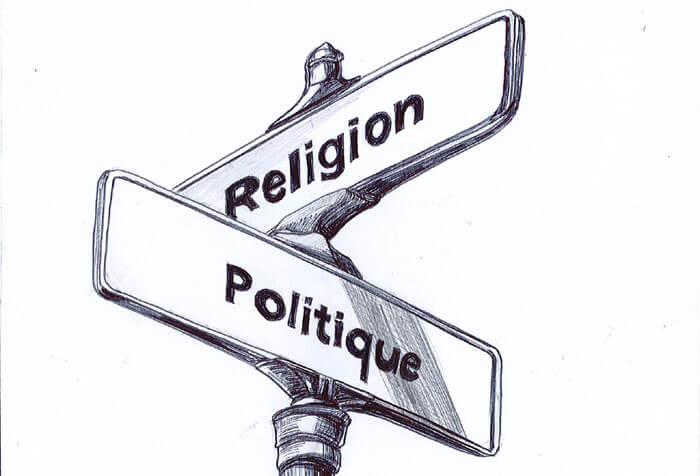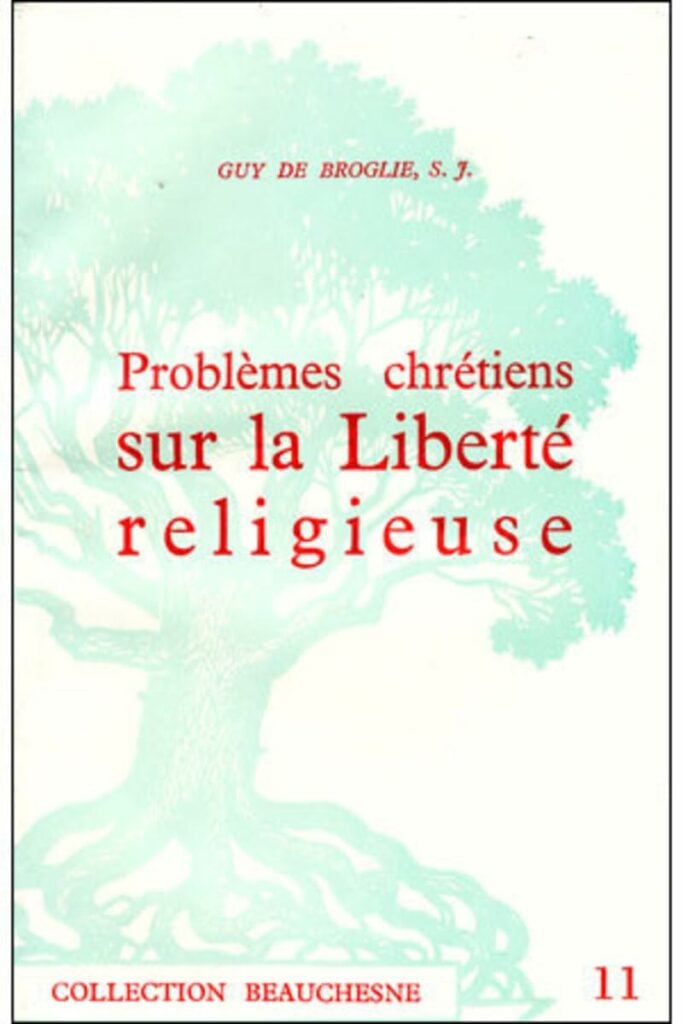Les profonds changements juridiques qu’opéra cet État catholique pour s’adapter à la déclaration conciliaire Dignitatis Humanæ manifestent la rupture qu’elle constitua.
Ancien professeur de droit canonique, l’évêque (aujourd’hui émérite) de Dijon a fourni dans un livre publié en 2012 l’analyse précise d’une situation exemplaire à cet égard, celle de l’Espagne : situation exemplaire dans le sens où le processus d’une quinzaine d’année qui fit passer l’Espagne d’un État catholique réprimant (dans une certaine mesure) les autres religions à un État neutre, fut initié par les décisions du Concile. « C’est sans aucun doute en Espagne que la déclaration conciliaire Dignitatis humanæ a eu les répercussions les plus spectaculaires ». « L’Espagne offre l’exemple le plus abrupt d’une mutation complète en quelques années » [1].
La situation avant Dignitatis humanæ
En 1965, l’Espagne était l’un des deux seuls pays confessionnels dont les lois constitutionnelles contenaient des restrictions légales à la liberté des cultes non catholiques, en conformité d’ailleurs avec ce qu’exigeait le droit public ecclésiastique. À côté de la religion officielle de l’État, les autres cultes n’étaient que tolérés. Le Fuero de los Espanoles, Loi fondamentale de l’État adoptée le 17 juillet 1945, n’autorisait que leur exercice privé et leur interdisait aussi toute action de propagande [2].
Au fondement de cette législation, la reconnaissance des devoirs envers Dieu de la société en tant que société. Dans un message aux Cortès, Franco rappelait non seulement que le concordat de 1953 rendait justice à la tradition séculaire de l’Espagne, mais qu’il ne faisait que reconnaître la Loi divine, au respect de laquelle sont tenues les personnes comme la nation. Commentaire de Mgr Minnerath : « affirmation centrale que l’on dirait tirée d’un manuel de droit public ecclésiastique ». « Rien ne semble plus justifié que l’affirmation d’Ottaviani selon laquelle le concordat de 1953 « est huius generis concordatorum in tota Ecclesiae historia perfectissimum »»[3], le plus parfait de toute l’histoire de l’Eglise.
Les premières adaptations suite au Concile Vatican II
Avec une législation mettant en œuvre de tels principes, notre éminent canoniste ne peut que constater : « Le droit public espagnol se trouvait donc, au lendemain de la promulgation de la déclaration conciliaire, en contradiction avec les nouvelles orientations de l’Église. Or, dans une autre Loi fondamentale, celle de 1958, l’Espagne avait déclaré qu’elle s’inspirerait pour sa législation de la doctrine de l’Église catholique[4]. Pour rester cohérente avec cette norme constitutionnelle supérieure, l’Espagne adopte le 10 janvier 1967 une nouvelle Loi organique de l’État, ratifiée par référendum, modifiant les dispositions de l’alinéa 20 de l’article 6 du Fuero de 1945 qui stipule maintenant que « l’État assumera la protection de la liberté religieuse, qui sera garantie par une tutelle juridique efficace sauvegardant à la fois la morale et l’ordre publics » [5]. Le champ était ainsi libre pour une révision globale de la législation antérieure. Ce qui fut fait la même année, par la loi du 27 juin 1967 réglementant « l’exercice du droit civil à la liberté religieuse » [6] ». Elle reconnaissait le droit à la liberté religieuse « fondé sur la dignité de la personne humaine » et lui assurait « l’immunité de toute contrainte dans l’exercice légitime de ce droit » (art. 1). Les confessions non catholiques étaient invitées à former des associations, régies selon leurs propres statuts, auxquelles était reconnue la personnalité juridique (art. 13, § 14). Désormais, elles pourraient pratiquer librement le culte public (art. 21). Elles auraient aussi la faculté de créer des centres pour l’enseignement de leurs adeptes et la formation de leurs ministres, si leur nombre le justifie (art. 29, § 30) [7].
Les mesures ultérieures
La loi de 1967 maintenait un État confessionnel. Cet aspect disparaîtra dans les lois ultérieures dont voici les grandes étapes. L’initiative vient de l’État espagnol qui consulte l’Église. Les évêques donnent leur avis dans un document officiel de 1973, « L’Église et la communauté politique ». Voici le résumé qu’en donne Mgr Minnerath : « Le plus important, aux yeux des évêques, est que la loi sur la liberté religieuse continue d’être appliquée. On sent même une réticence nuancée quant au maintien de la confessionnalité[8] », les évêques mettant en avant le risque d’un manque de cohérence : « se proclamer État catholique » et « voter une loi autorisant l’avortement ». Un juriste espagnol « résume ainsi la pensée de la majorité des évêques, interprètes du concile : La thèse est maintenant la liberté religieuse ; l’hypothèse est la confessionnalité de l’État. C’est-à-dire l’Église demande la liberté religieuse pour elle et pour les autres groupes religieux ; elle admet qu’il peut y avoir des situations spéciales créées par l’histoire et la sociologie, mais elle ne les considère pas comme désirables, et encore moins comme l’idéal, même si c’est elle qui est privilégiée » [9]. On ne s’étonnera pas de la suite des événements.
Une série d’accords est signée entre le Saint-Siège et l’État espagnol pour remplacer le Concordat de 1953. Celui de 1976 « se présente comme une volonté d’adaptation aux changements profonds intervenus non seulement dans l’enseignement de l’Église, mais aussi dans la législation espagnole ». Référence explicite est faite à la nécessité de s’adapter à la nouveauté introduite par le concile : « considérant que le concile Vatican II, quant à lui, a établi comme principes fondamentaux auxquels doivent se conformer les relations entre la communauté politique et l’Église, à la fois l’indépendance mutuelle des deux parties, dans son ordre respectif, et une saine collaboration entre elles, a affirmé la liberté religieuse comme droit de la personne humaine, droit qui doit être reconnu dans l’organisation juridique de la société … [le Saint-Siège et le gouvernement espagnol] jugent nécessaire de réviser le concordat de 1953 » [10]. Le concordat de 1953 définissait l’Église comme « société parfaite, avec tout ce que la notion implique en droit public ecclésiastique » : dans l’accord signé en 1979, « la première chose qui frappe dans cette rédaction est que la relation Église-État ne semble plus se situer sur un pied d’égalité juridique. Le mouvement est unilatéral. L’État ne déclare plus explicitement que l’Église a la qualité d’une société souveraine, il lui « reconnaît » seulement le droit d’exercer sa mission, sans qu’il apparaisse clairement s’il s’agit d’une reconnaissance constitutive ou déclarative » [11].
Entre temps, la constitution de 1978 « ne contient plus aucune trace de religion d’État, ni de protection spéciale accordée à la religion de la majorité. L’Église catholique n’y est nommée qu’une fois, à côté des autres confessions religieuses, dans l’article consacré au droit à la liberté religieuse. (…) La nouvelle constitution instituait en Espagne « l’État de droit », incompétent au point de vue religieux » [12]. Aucune opposition fondamentale des évêques alors que dans les rapports de l’Église avec l’État, « par rapport à l’Espagne de 1953, c’est une révolution copernicienne » [13].
En 1980, une loi organique sur la liberté religieuse abroge et remplace celle de juin 1967 pour s’adapter à la nouvelle constitution. « Ce texte législatif est en pleine cohérence avec la neutralité religieuse de l’État respectueux du droit fondamental des personnes et des associations à la liberté religieuse. (…) Rien, dans ce texte, ne donne à penser que l’Espagne n’ait jamais été, et reste, massivement catholique. Il n’y est question que d’anonymes « Églises, confessions et communautés religieuses », libres de professer leurs « croyances » dans les limites du respect de l’ordre public ». Elles peuvent œuvrer en Espagne « à condition de demander leur inscription sur le Registre public créé à cet effet auprès du Ministère de la justice » [14].
La synthèse de cette évolution initiée par le document conciliaire est édifiante : « On peut mesurer le chemin parcouru. Jusqu’en 1967, l’Espagne était un État confessionnel catholique qui pratiquait la « tolérance » des autres cultes. En 1967, elle renonçait à toute discrimination juridique des non-catholiques, tout en restant un État confessionnel. Depuis la Constitution de 1978, l’État ne se déclare plus lié à aucun culte et ne mentionne plus la position particulière que la religion catholique occupe dans l’identité de la nation. En 1980 enfin, l’Église catholique est presque priée d’aller s’inscrire sur un registre, à côté de n’importe quelle secte, pour avoir droit à une existence légale » [15].
La déclaration conciliaire Dignitatis Humanæ fut donc reçue par toutes les parties concernées par la mise en œuvre concrète du droit public ecclésiastique (Saint-Siège, évêques, État) comme une nouveauté radicale nécessitant une refonte complète de leurs relations. « L’Église se trouve réduite au droit commun reconnu par l’État à toutes les religions ; par une impiété sans nom, elle se trouve sur le même pied d’égalité que l’hérésie, la perfidie et l’idolâtrie [16]». C’est contre cette apostasie légale de la société que se dressa Mgr Lefebvre.
- MINNERATH, L’Eglise catholique face aux Etats, Cerf, 2012, p. 184 et 231.[↩]
- Fuero de los Espanoles, 17 juillet 1945, art. 66, § 1 : « La profession et la pratique de la Religion catholique, qui est celle de l’État espagnol, jouira de la protection officielle. » § 2 : « Personne ne sera inquiété pour ses croyances religieuses, ni pour l’exercice privé de son culte. Il ne sera permis d’autres cérémonies ni d’autres manifestations extérieures que celles de la Religion catholique » (Peaslee, III, p. 282). On peut rappeler qu’en 1945 comme par la suite, les confessions non catholiques en Espagne ne regroupaient qu’une minorité infime de résidents. Selon les statistiques de 1965, seuls trente-cinq mille Espagnols ne seraient pas baptisés catholiques. Voir Guia de la Iglesia en Espana, Madrid, 1965–1966.[↩]
- MINNERATH, Ibid. p. 145.[↩]
- Loi des principes du Mouvement national, Principe II : « La Nation espagnole considère comme une marque d’honneur son attachement à la Loi de Dieu, selon la doctrine de la Sainte Église catholique, apostolique et romaine, unique véritable, et foi inséparable de la conscience nationale, qui inspire sa législation. »[↩]
- Loi organique de l’État 10 janvier 1967.[↩]
- Ley 44/1967 du 28 juin 1967. MINNERATH, Ibid. p. 185.[↩]
- cf. Dignitatis Humanæ 4 : « Dès lors, donc, que les justes exigences de l’ordre public ne sont pas violées, ces communautés sont en droit de jouir de cette absence de contrainte afin de pouvoir se régir selon leurs propres normes, honorer d’un culte public la divinité suprême, aider leurs membres dans la pratique de leur vie religieuse et les sustenter par un enseignement, promouvoir enfin les institutions au sein desquelles leurs membres coopèrent à orienter leur vie propre selon leurs principes religieux. Les communautés religieuses ont également le droit de ne pas être empêchées, par les moyens législatifs ou par une action administrative du pouvoir civil, de choisir leurs propres ministres, de les former, de les nommer et de les déplacer, de communiquer avec les autorités ou communautés religieuses résidant dans d’autres parties du monde, de construire des édifices religieux ainsi que d’acquérir et de gérer les biens dont ils ont besoin. Les communautés religieuses ont aussi le droit de ne pas être empêchées d’enseigner et de manifester leur foi publiquement, de vive voix et par écrit. Mais, dans la propagation de la foi et l’introduction des pratiques religieuses, on doit toujours s’abstenir de toute forme d’agissements ayant un relent de coercition, de persuasion malhonnête ou peu loyale, surtout s’il s’agit de gens sans culture ou sans ressources. Une telle manière d’agir doit être regardée comme un abus de son propre droit et une atteinte au droit des autres. La liberté religieuse demande, en outre, que les communautés ne soient pas empêchées de manifester librement l’efficacité singulière de leur doctrine pour organiser la société et vivifier toute l’activité humaine. La nature sociale de l’homme, enfin, ainsi que le caractère même de la religion, fondent le droit qu’ont les hommes, mus par leur sentiment religieux, de tenir librement des réunions ou de constituer des associations éducatives, culturelles, caritatives et sociales ». Avec de tels principes, on voit mal au nom de quoi restreindre la possibilité pour des salafistes vivant en Europe de choisir leur imam, de le faire venir du Proche Orient, de construire des minarets, d’enseigner la charia, d’organiser des prières de rue, d’investir les clubs de sport … – sauf pour des raisons d’ordre public. C’est cela, Vatican II dans ses œuvres.[↩]
- Réticence qui se trouve déjà dans Dignitatis humanæ : « Si, en raison des circonstances particulières dans lesquelles se trouvent certains peuples, une reconnaissance civile spéciale est accordée dans l’ordre juridique de la cité à une communauté religieuse donnée, il est nécessaire qu’en même temps, pour tous les citoyens et toutes les communautés religieuses, le droit à la liberté en matière religieuse soit reconnu et sauvegardé. »[↩]
- MINNERATH, Ibid. p. 235–236.[↩]
- Texte dans AAS 68 (1976), p. 509–512.[↩]
- MINNERATH, Ibid. p. 192. Le concordat de 1953 définissait lui l’Eglise comme « société parfaite[↩]
- MINNERATH, Ibid. p. 190.[↩]
- MINNERATH, Ibid. p. 191. « Les réserves des évêques portèrent sur deux points particuliers : les droits à l’éducation religieuse n’étaient pas suffisamment garantis et la porte était ouverte au divorce civil. De plus, l’avortement n’était pas expressément condamné ».[↩]
- MINNERATH, Ibid. p. 193–194.[↩]
- MINNERATH, Ibid. p. 194.[↩]
- Mgr Lefebvre, Ils l’ont découronné, éd. Fideliter, 1987, p. 207[↩]