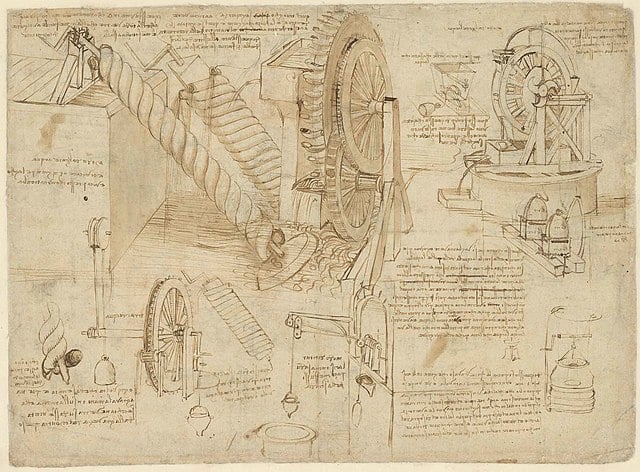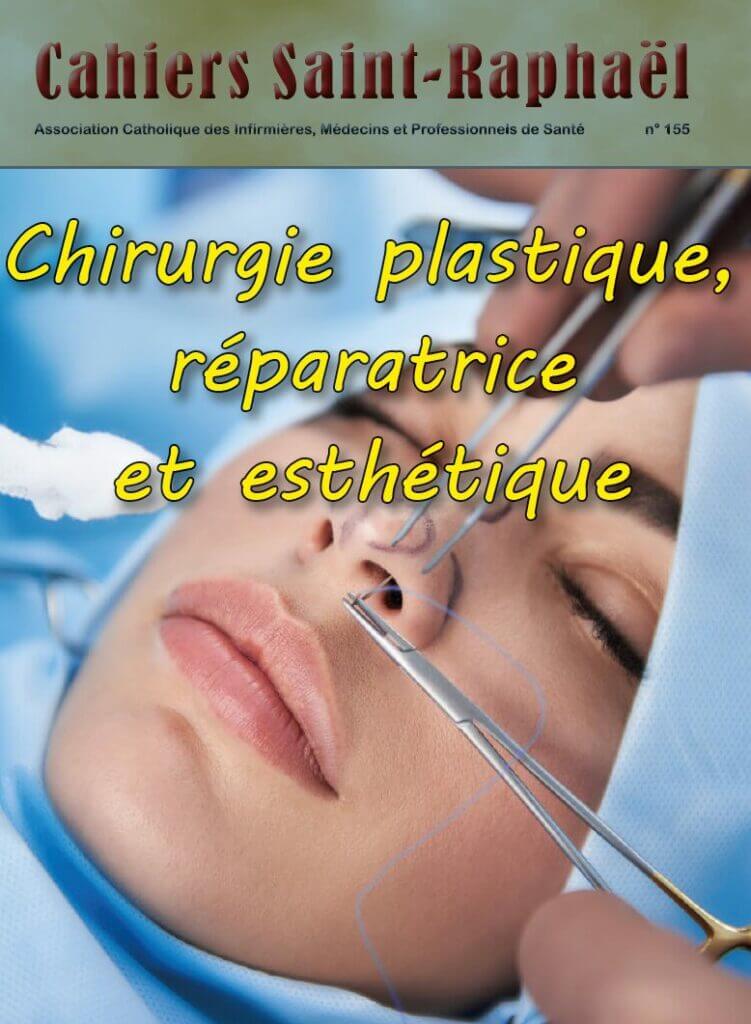Peut-on recourir sans mesure aux méthodes naturelles de régulation des naissances ?
Il y a tout juste un siècle, Kyusaku Ogino découvrait comment calculer le jour d’ovulation au cours du cycle menstruel. Fort de cette avancée, Hermann Knaus met au point quatre années plus tard la méthode du calendrier qui, fondée sur les statistiques, détermine la période d’infécondité post-ovulatoire du cycle menstruel. Dans les années 50, Michel Charrier élabore la méthode des températures qui, grâce à ce signe biologique, situe le moment de l’ovulation et les jours d’infécondité subséquents. Une décennie plus tard, John et Evelyn Billings conçoivent la méthode de la glaire cervicale. Grâce à l’observation de ce facteur de fécondité, la femme peut connaître ses périodes infécondes avant comme après l’ovulation. De nos jours, les pharmacies vendent des tests d’ovulation et de fertilité qui permettent de mesurer les variations hormonales au fil du cycle menstruel et d’en discerner les différentes phases.
Longtemps méconnues du grand public et ostracisées par les instances médicales et sanitaires, ces méthodes bénéficient ces derniers temps de la vague verte et des inquiétudes suscitées par les contraceptifs oraux et les perturbateurs endocriniens[1]. D’un point de vue proprement moral, il s’avère qu’à l’inverse des contraceptifs hormonaux ou mécaniques et du retrait, « la mise à profit de la stérilité temporaire naturelle […] ne viole pas l’ordre naturel […] puisque les relations conjugales répondent à la volonté du Créateur[2]». Loin de manipuler l’ordre naturel comme la contraception[3], les méthodes naturelles s’inscrivent dans cet ordre de finalité.
Pour autant, peut-on recourir sans mesure aux méthodes naturelles « de régulation des naissances[4] » ? Sont-elles compatibles avec l’engagement pris par les époux lors de leur mariage ? Ne s’apparentent-elles pas parfois à une version catholique de la contraception ? Pie XII s’est penché sur toutes ces questions et sur beaucoup d’autres dans son Discours aux sages-femmes italiennes du 29 octobre 1951. Lisons-le attentivement[5].
1. Un dilemme apparent
Le Pasteur Angélique expose d’abord ce qui a les apparences d’un dilemme :
« De nos jours, se présente le grave problème de savoir si et dans quelle mesure l’obligation de disponibilité au service de la maternité est conciliable avec ce recours toujours plus fréquent aux périodes de stérilité naturelle (périodes agénésiques chez la femme), recours qui semble être une claire expression de la volonté contraire à cette disponibilité. »
En contractant mariage, les époux ont assumé librement la mission de transmettre la vie. Ce faisant, ils se sont mis au service du bien commun de la cité[6]. Aussi l’usage des méthodes naturelles pour réguler leur fécondité semble-t-il entrer en conflit avec la mission qu’ils ont embrassée. Le pape se propose donc de « mettre fin aux inquiétudes de conscience de beaucoup de chrétiens, qui utilis[ent] [la méthode Ogino-Knaus] dans leur vie conjugale[7] ».
2. La compétence des sages-femmes
Le pape précise dans la foulée le rôle des sages-femmes :
« On attend précisément de vous que vous soyez bien informées, au point de vue médical, de cette théorie connue et des progrès qu’en cette matière on peut encore prévoir, et, d’autre part, que vos conseils et votre assistance ne s’appuient pas sur de simples publications populaires, mais soient basées sur l’objectivité scientifique et sur le jugement autorisé de consciencieux spécialistes en médecine et en biologie. C’est votre rôle, non celui du prêtre, d’instruire les époux, soit dans des consultations privées, soit au moyen de sérieuses publications, de l’aspect biologique et technique de la théorie, sans cependant vous laisser entraîner à une propagande qui ne serait ni juste ni convenable. Mais, dans ce domaine encore, votre apostolat réclame de vous, comme femmes et comme chrétiennes, que vous connaissiez et défendiez les règles de la morale auxquelles est soumise l’application de cette théorie. Et, ici, l’Église est compétente. […] »
Se faisant l’écho des attentes du public, le pape attend des sages-femmes qui sont des professionnelles de santé :
• un savoir théorique et un savoir-faire pratique en matière de méthodes naturelles,
• une promotion prudente et mesurée de ces méthodes,
• un sens moral éclairé et docile.
Si les prêtres n’ont pas vocation à instruire les époux des aspects biologique et technique de ces méthodes, l’Église, elle, a compétence pour évaluer la licéité morale de leur utilisation.
Au final, l’usage du mariage en période agénésique pose trois questions distinctes qui seront traitées dans l’ordre :
- Est-il licite d’avoir des rapports conjugaux même aux jours d’infécondité naturelle ?
- Est-il licite de restreindre le droit conjugal aux jours d’infécondité naturelle ?
- Est-il licite de pratiquer systématiquement l’abstinence aux jours de fécondité ?
3. L’usage du mariage aux jours d’infécondité naturelle
Pie XII commence par examiner les relations conjugales qu’ont les époux alors que l’épouse est naturellement inféconde :
« Si l’application de cette théorie ne veut signifier rien d’autre que la possibilité pour les époux de faire usage de leur droit conjugal même aux jours de stérilité naturelle, il n’y a rien à redire. De cette façon, en effet, ils n’empêchent ni ne gênent en aucune manière la consommation de l’acte naturel et de ses conséquences naturelles ultérieures. C’est précisément en cela que l’application de la théorie dont nous parlons se distingue essentiellement de l’abus déjà signalé, qui consiste dans la perversion de cet acte. […] »
Si « tout acte matrimonial doit rester ouvert à la transmission de la vie[8] », « chaque rencontre conjugale n’engendre pas une nouvelle vie. Dieu a sagement fixé des lois et des rythmes naturels de fécondité qui espacent déjà par eux-mêmes la succession des naissances[9] ».
Que la stérilité soit pathologique ou naturelle, l’usage du mariage reste légitime :
« Il ne faut pas […] accuser d’actes contre nature les époux qui usent de leur droit suivant la saine et naturelle raison, si, pour des causes naturelles, dues soit à des circonstances temporaires, soit à certaines défectuosités physiques, une nouvelle vie n’en peut pas sortir. Il y à, en effet, tant dans le mariage lui-même que dans l’usage du droit matrimonial, des fins secondaires — comme sont l’aide mutuelle, l’amour réciproque à entretenir, et le remède à la concupiscence — qu’il n’est pas du tout interdit aux époux d’avoir en vue, pourvu que la nature intrinsèque de cet acte soit sauvegardée, et sauvegardée du même coup sa subordination à la fin première[10]. »
4. Le droit conjugal restreint aux périodes d’infécondité
Le pape scrute ensuite l’attitude des fiancés qui, à l’heure de consentir au mariage, restreignent le droit conjugal aux seules périodes d’infécondité :
« Si déjà, au moment de la conclusion du mariage, au moins l’un des deux époux avait eu l’intention de restreindre aux moments de stérilité le droit conjugal lui-même, et pas seulement l’usage de ce droit, de telle sorte que, aux autres jours, l’autre époux n’aurait pas non plus le droit de réclamer l’acte, cela impliquerait un défaut essentiel du consentement matrimonial, qui comporterait de soi l’invalidité du mariage, pour la raison que le droit dérivant du contrat matrimonial est un droit permanent, ininterrompu et non pas intermittent de chacun des époux vis-à-vis de l’autre. »
Par le consentement matrimonial donné et reçu, les époux s’engagent mutuellement à devenir père et mère l’un par l’autre. Le droit qu’il se confèrent est exclusif, irrévocable et permanent. Ce que le droit conjugal réduit aux seules périodes d’infécondité ne serait évidemment pas.
D’un point de vue juridique, « la jurisprudence rotale[11] admet que peut être nul le mariage des personnes qui entendent exclure de façon définitive les enfants par l’abstinence conjugale ou par l’utilisation exclusive des méthodes naturelles admises par l’Église[12]».
5. L’abstinence périodique pratiquée systématiquement aux jours de fécondité
Le pape envisage finalement le cas des époux qui restreignent l’usage du mariage aux périodes infécondes :
« Si cette limitation de l’acte aux jours de stérilité naturelle se rapporte non au droit lui-même mais à l’usage du droit, la validité du mariage reste hors de discussion ; cependant, la licéité morale d’une telle conduite des époux serait à affirmer ou à nier, selon que, l’intention d’observer constamment ces périodes est basée ou non sur des motifs moraux suffisants et sûrs. Le seul fait que les époux ne violent pas la nature de l’acte et sont même prêts à accepter et à élever l’enfant qui, malgré leurs précautions, viendrait au monde, ne suffirait pas à soi seul à garantir la rectitude des intentions et la moralité indiscutable de ces mêmes motifs. »
L’abstinence périodique décidée et mise en œuvre d’un commun accord au cours de la vie conjugale ne saurait porter atteinte à la validité du consentement matrimonial. Dont acte. Ceci dit, ni le caractère naturel du procédé ni la disposition des époux à accueillir le cas échéant un nouvel enfant ne suffisent à justifier le recours aux méthodes naturelles. Encore faut-il avoir pour cela « des motifs moraux suffisants et sûrs ».
6. Un principe de droit et de morale
Pour savoir quand le recours aux méthodes naturelles est légitime, Pie XII invoque en premier lieu un principe :
« La raison est que le mariage oblige à un état de vie qui, de même qu’il confère certains droits, impose également l’accomplissement d’une œuvre positive concernant ce même état. Dans ce cas, on peut appliquer le principe général qu’une prestation positive peut être omise si de graves motifs, indépendants de la bonne volonté de ceux qui y sont obligés, établissent que cette prestation est inopportune ou prouvent qu’elle ne peut être légitimement réclamée par le requérant, en l’espèce, le genre humain. »
Le principe énoncé par le pape est valable en droit comme en morale. En droit, « lex positiva non obligat cum gravi incommodo — Une loi positive n’oblige pas lorsqu’elle entraine un grave inconvénient ». En morale, « ce qui tombe sous le précepte affirmatif n’est pas à observer pour tout le temps et n’importe comment, mais une fois prises en compte les conditions nécessaires des personnes, des lieux, des temps et des causes[13]». Quant à la sagesse populaire, elle dit tout simplement : « A l’impossible, nul n’est tenu ».
7. L’œuvre propre des époux : transmettre la vie
En tant qu’état de vie, le mariage comporte une prestation positive dont seuls des motifs graves et indépendants de la bonne volonté des époux peuvent dispenser :
« Le contrat matrimonial, qui accorde aux époux le droit de satisfaire l’inclination de la nature, les établit dans un état de vie, l’état conjugal. Or, aux époux qui en font usage, en posant l’acte spécifique de leur état, la nature et le Créateur imposent la fonction de pourvoir à la conservation du genre humain. Telle est la prestation caractéristique qui fait la valeur propre de leur état : le “bonum prolis, les enfants”. Le peuple et l’État, l’Église elle-même dépendent pour leur existence, dans l’ordre établi par Dieu, du mariage fécond. Par suite, embrasser l’état de mariage, user constamment de la faculté qui lui est propre et qui n’est licite que dans cet état et, d’autre part, se soustraire toujours et délibérément, sans un grave motif, à son devoir principal, serait un péché contre le sens même de la vie conjugale. »
Les époux ont librement assumé la mission d’engendrer et d’éduquer leurs enfants pour le plus grand bien de la cité et de l’Église. Or il serait contradictoire d’entrer dans l’état de vie conjugal et d’en accepter l’œuvre propre —transmettre la vie— tout en se dispensant habituellement et sans raison grave de l’accomplir.
Que dirait-on d’un employé qui, ayant signé un contrat de travail, ne remplirait pas sa part de travail et exigerait que le patron lui assure salaire, vacances et couverture sociale sans qu’aucun motif grave et extrinsèque[14]ne justifie son comportement ?
8. Être attentif aux signes de la Providence
Appliquant le principe énoncé à l’œuvre propre des époux, Pie XII porte un jugement sur le recours aux méthodes naturelles entre époux :
« On peut être dispensé de cette prestation positive obligatoire, même pour longtemps, voire pour la durée entière du mariage, par des motifs sérieux, comme ceux qu’il n’est pas rare de trouver dans ce qu’on appelle “l’indication” médicale, eugénique, économique et sociale. D’où il suit que l’observance des époques infécondes peut être licite sous l’aspect moral ; et, dans les conditions indiquées, elle l’est réellement.
« Cependant, s’il n’y a pas, d’après un jugement raisonnable et juste de semblables graves raisons, soit personnelles, soit découlant des circonstances extérieures, la volonté chez les époux d’éviter habituellement la fécondité de leur union, tout en continuant à satisfaire pleinement leur sensualité, ne peut venir que d’une fausse appréciation de la vie et de motifs étrangers aux règles de la saine morale. »
Confrontés à des difficultés graves et extrinsèques[15], les époux sont dispensés de transmettre la vie aussi longtemps qu’elles perdurent. La pratique de la continence périodique serait alors justifiée et l’acte conjugal posé systématiquement en période inféconde licite. En revanche, là où font défaut ces signes de la divine Providence, le recours habituel aux méthodes naturelles pour ne pas transmettre la vie serait un abus et un péché.
Une voix dans le désert…
En analysant le recours des époux aux méthodes naturelles de régulation des naissance, Pie XII a mis en lumière une double règle qui doit guider les époux : la règle de l’acte conjugal et la règle de l’état conjugal. La contraception s’oppose à la première[16], le recours sans raison graves aux méthodes naturelles à la seconde[17].
Malheureusement, « du discours de Pie XII aux sages-femmes, les laïcs n’ont, au total, retenu que l’affirmation du pape selon laquelle la régulation des naissances est “compatible avec la loi de Dieu”. Mais le devoir de fécondité tout comme les conditions restrictives posées par Pie XII pour l’emploi légitime de la continence périodique (les “motifs sérieux”) ont été oubliés[18])».
Abbé François KNITTEL
Source : Cahiers Saint Raphaël n° 153.
- Cf. Sabrina Debusquat, J’arrête la pilule, Paris, Les Liens qui Libèrent, 2017.[↩]
- Pie XII, Discours au 7e congrès d’hématologie, 12 septembre 1958.[↩]
- En particulier, la dissociation entre la dimension unitive et la dimension procréative de l’acte conjugal, d’une part, et entre le plaisir sensible et la finalité de l’acte conjugal, d’autre part.[↩]
- Pie XII, Discours aux Associations familiales d’Italie, 27 novembre 1951.[↩]
- Tous les textes cités sans référence sont tirés du discours aux sages-femmes italiennes du 29 octobre 1951. L’ordre des paragraphes a été respecté.[↩]
- Saint Thomas d’Aquin, Contra Gentes, lib. 3, c. 123, n° 2965 : « De tous les actes naturels, seule la génération est pour le bien commun ».[↩]
- Pie XII, Discours au 7e congrès d’hématologie, 12 septembre 1958.[↩]
- Paul VI, Encyclique Humanæ vitæ, 25 juillet 1968, n° 11.[↩]
- Ibid.[↩]
- Pie XI, Encyclique Casti connubii, 31 décembre 1930.[↩]
- La Rote est le tribunal du Saint-Siège qui statue en dernière instance sur la validité des mariages dans l’Église.[↩]
- Carmen Peña Garcia, Mariage et causes de nullité dans le droit de l’Église, L’Harmattan, Paris, 2021, p. 206.[↩]
- Saint Thomas d’Aquin, Question disputée De Virtutibus, q. 3, a. 1, c.[↩]
- Observer des horaires, se donner de la peine, collaborer avec des collègues sont des conditions intrinsèques à n’importe quel travail qui ne justifient pas à elles seules de se croire dispensé de travailler.[↩]
- A titre d’exemple, le pape mentionne quelques raisons d’ordre médical, eugénique, économique et social.[↩]
- Pie XII, Discours aux sages-femmes, 29 octobre 1951 : « La nature met à la disposition de l’homme tout l’enchaînement des causes qui seront la source d’une nouvelle vie humaine ; il appartient à l’homme d’en libérer la force vive, à la nature d’en développer le cours et de la conduire au terme. Après que l’homme a accompli son rôle et mis en mouvement la merveilleuse évolution de la vie, son devoir est d’en respecter religieusement la progression, devoir qui lui défend d’arrêter l’œuvre de la nature et d’en empêcher le développement naturel. »[↩]
- Cf. plus haut n° 6–8.[↩]
- Martine Sevegrand, « La méthode Ogino et la morale catholique : une controverse théologique autour de la limitation des naissances (1930–1951) » dans Revue d’Histoire de l’Église de France, tome 78, n° 200, 1992, p. 99[↩]