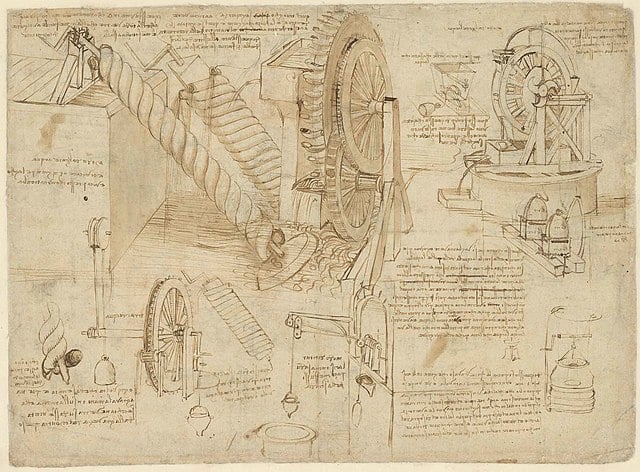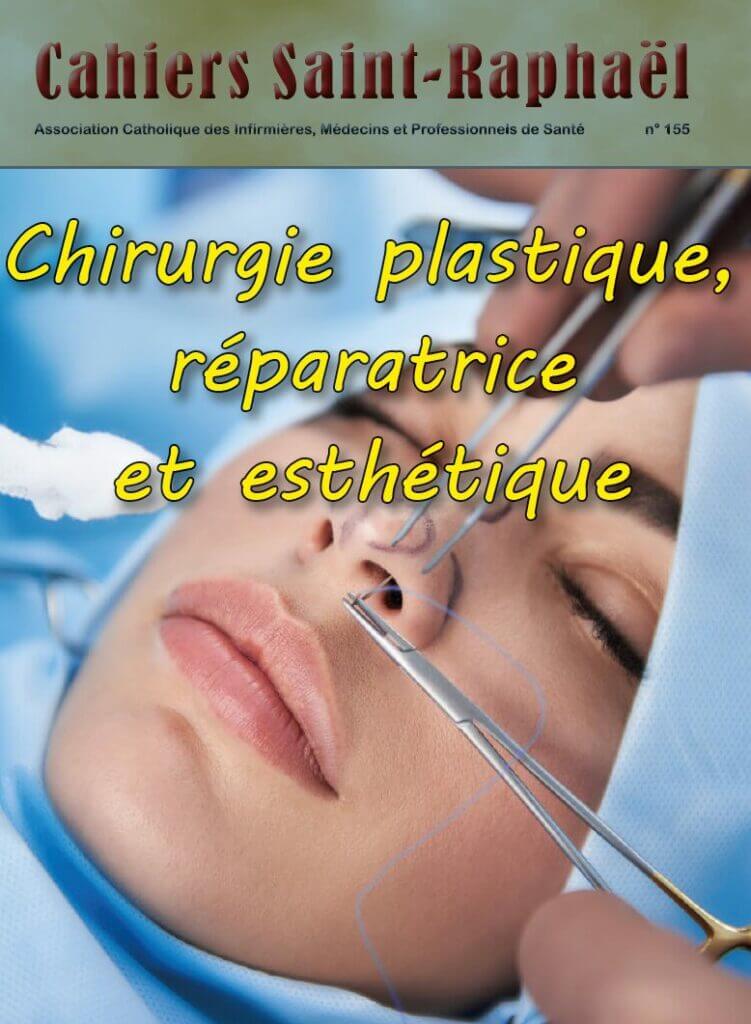Les quatre règles du « volontaire indirect » formalisées par Gury à la fin du XIXe siècle sont-elles incompatibles avec la pensée de saint Thomas d’Aquin ?
L’homme […] n’a pas toujours l’intention de faire ce qui résulte de son action, même s’il l’a prévu[1].
En faisant ce constat, le pape Pie XII avait à l’esprit toutes ces actions qui provoquent à la fois des effets bons et des effets mauvais. Que décider « s’il n’est pas possible de faire le bien sans qu’on commette un mal ou d’éviter le mal sans qu’on omette un bien[2] ? »
Pour sortir de l’impasse, les moralistes recourent aux règles du volontaire indirect qui permettent de vérifier s’il est moralement licite de poser une action qui cause un (ou plusieurs) effet(s) mauvais[3]). Qualifié par Pie XII de « principe général des actions à double effet[4] », « le principe n’est pas repris par Jean-Paul II, en particulier dans l’encyclique Evangelium vitæ[5] ». Apparemment, « son application pose de nombreuses difficultés et est loin d’être unanime[6] ».
Commençons par esquisser à grands traits la lente élaboration d’un principe qui ne relève ni de l’évidence ni de la Révélation avant de nous pencher sur l’homogénéité de son développement.
1. Une lente élaboration
Un passage de la Somme théologique de saint Thomas d’Aquin (1225–1274) est souvent présenté comme l’ébauche des règles du volontaire indirect. Alors qu’il se penche sur les problèmes moraux liés à la légitime défense, l’Aquinate fait cette observation :
« Un acte peut fort bien avoir deux effets dont l’un seulement est voulu, tandis que l’autre ne l’est pas. Or les actes moraux reçoivent leur spécification de ce sur quoi porte l’intention, mais non de ce qui reste en dehors de l’intention et qui demeure, comme on le sait, accidentel. Ainsi l’action de se défendre peut entraîner un double effet ; l’un est la conservation de sa propre vie, l’autre la mort de l’agresseur[7]. »
Que ce texte soit à l’origine des règles du volontaire indirect[8] ou pas[9], les spécialistes en discutent encore. Mais la situation que ces règles ont vocation à éclairer est, elle, clairement posée : « Un acte peut fort bien avoir deux effets ».
Dans un traité consacré à la bonté et à la malice des actes humains publié en 1630, Jean de Saint-Thomas (1589–1644) analyse l’influence des effets mauvais sur la malice d’un acte dès lors qu’ils sont prévus ou prévisibles. Ce faisant, il jette quelques lumières sur l’acte à double effet :
• même prévu, l’effet mauvais d’une action peut rester hors de l’intention de celui qui agit : « Lorsqu’une action est viciée par une cause étrangère à la volonté de l’agent, le vice ne relève pas de cette volonté. N’étant pas volontaire, il n’est ni peccamineux, ni facteur aggravant[10] ».
• l’effet mauvais qui est voulu per accidens ne spécifie pas la volonté de celui qui agit : « Celui qui induit le prochain à pécher ne veut pas lui nuire spirituellement mais cherche pour son propre compte un avantage temporel. A ses yeux, le préjudice est voulu per accidens et non per se car, d’une part, n’étant pas voulu, il demeure en dehors de l’intention du sujet et reste accidentel, et d’autre part, n’ayant aucun lien nécessaire et essentiel avec le préjudice, la malice qui est la sienne découle d’une autre cause[11] ».
• nul ne peut sans réelle nécessité poser une action suivie d’effets mauvais sans que ces derniers soient voulus : « Dans ces cas-là, les préjudices résultent moralement de l’action elle-même car, la volonté qui, sans y être obligé, pose une action dont résulte un dommage ou un effet mauvais, accepte virtuellement ce mal, alors qu’elle devrait préférer le bien d’autrui ou le sien[12] ».
Un siècle plus tard, les carmes de Salamanque se demandent si les effets illicites d’une action sont volontaires. Ils font alors remarquer que le rapport de la volonté à l’effet illicite peut être immédiat ou médiat :
« Certaines causes n’aboutissent de soi qu’à un effet illicite, duquel parfois aussi d’autres effets découlent. Par exemple, verser un poison. D’autres causes aboutissent premièrement à un effet licite qui entraîne un effet illicite. Par exemple, le toucher du chirurgien apportant immédiatement la santé peut conduire médiatement à une pollution, s’il porte sur les parties intimes[13]. »
Il s’ensuit que : « Dans le premier cas, la volonté consent directement aux effets illicites en posant la cause qui provoque un effet illicite ou qui, grâce à ce dernier, débouche sur un effet licite. […] Dans le second, si la cause procure d’abord un effet bon puis un effet mauvais, la volonté peut se porter vers l’effet bon, tout en prévoyant l’effet mauvais qui n’est pas voulu, à condition qu’il existe une nécessité proportionnée à la gravité de la matière[14]. »
Il faut attendre la fin du XIXe siècle pour que Jean-Pierre Gury (1801–1866) formalise dans la 5e édition de son manuel de théologie morale —au demeurant posthume— les conditions de licéité de l’action à double effet[15].
Le jésuite énonce d’abord un principe :
« Il est permis de poser une cause bonne ou indifférente de laquelle dérive deux effets, l’un bon et l’autre mauvais, dès lors qu’existe une raison proportionnellement grave, que la fin de l’agent est honnête et que l’effet bon ne résulte pas de l’effet mauvais[16]. »
En bon pédagogue, il détaille ensuite les quatre règles destinées à faciliter l’examen des situations concrètes :
« Ce principe repose sur quatre conditions nécessaires, à savoir [1] que la fin de l’agent soit honnête, [2] que la cause soit bonne ou au moins indifférente, [3] que l’effet bon ne découle pas de l’effet mauvais, [4] qu’il y ait une raison proportionnellement grave pour poser la cause et que l’agent ne soit tenu de l’omettre en vertu de la justice ou de la charité[17]. »
2. Une difficile conciliation
La comparaison entre les écrits de saint Thomas d’Aquin et ceux de Gury ne laisse pas d’être troublante. Entre la première et la dernière étape de ce long processus élaboration, la conciliation semble difficile. A un premier problème de nomenclature s’ajoute un second, plus grave, de conceptualisation.
2.1 Un problème de nomenclature
Chez saint Thomas, le terme « volontaire indirect » désigne l’omission et ses effets[18] :
« Une chose peut procéder d’une autre de deux façons : soit directement, à l’instar de ce qui procède d’un agent, comme l’échauffement de la chaleur ; soit indirectement, à savoir en l’absence d’action, comme le naufrage du navire est attribué au pilote qui ne le dirige plus[19]. »
« On appelle volontaire non seulement ce qui procède directement de la volonté en tant qu’agissante, mais encore ce qui en résulte indirectement lorsqu’elle n’agit pas[20]. »
« Une chose est dite volontaire soit directement soit indirectement : directement, si la volonté s’y porte ; indirectement, si la volonté ne l’a pas empêché alors qu’elle aurait pu le faire[21]. »
L’Aquinate distingue par ailleurs le volontaire en soi et le volontaire dans sa cause :
« Un acte peut être volontaire en soi, quand la volonté s’y porte directement, ou dans sa cause, quand la volonté se porte vers la cause et non vers l’effet, comme il appert chez celui qui s’enivre volontairement et auquel on impute comme volontaire tout ce qu’il a fait en état d’ivresse[22]. »
« Si quelqu’un veut une cause qu’il sait produire tel effet, il veut en conséquence cet effet. Et bien que peut-être il ne veuille pas cet effet en lui-même, du moins préfère-t-il le voir exister plutôt que de sacrifier la cause. Ainsi si quelqu’un veut faire une marche en été, prévoyant une forte sueur, il veut en conséquence la suée. En effet, bien qu’il ne désire pas la sueur en elle-même, il préfère cependant la supporter plutôt que de s’abstenir de la marche[23]. »
On doit à Cajetan (1469–1534) la mise sur un pied d’égalité du volontaire indirect et du volontaire dans sa cause :
« Si quelqu’un court librement et en ressent de la fatigue, la course est voulue directement et en soi ; la fatigue qui suit est voulue indirectement et dans une autre chose —à savoir la course qui précède— et non en soi ni directement. Le second volontaire est de quelque manière volontaire —indirectement et dans sa cause— et de quelque manière involontaire —directement et en soi[24]. »
Là où saint Thomas distinguait les effets induits par une omission (volontaire indirect) de ceux causés par une action (volontaire dans sa cause), Cajetan et ses successeurs qualifient de volontaire indirect (ou de volontaire dans sa cause) les effets provoqués aussi bien par une action que par une omission.
2.2 Un problème de conceptualisation
L’évolution de la nomenclature cache et révèle à la fois un problème de conceptualisation. Là où saint Thomas spécifiait les actes humains à partir de leur objet et de leur fin, ses lointains successeurs voient les actes humains comme des causes qui produisent des effets[25]. Gury n’invite-t-il pas son lecteur à s’assurer que « la cause soit bonne ou au moins indifférente » (2e condition), « qu’il y ait une raison proportionnellement grave pour poser la cause » (4e condition) et « que l’effet bon ne découle pas de l’effet mauvais » (3e condition) ?
Or, faut-il le souligner, saint Thomas ne juge jamais de la moralité d’un acte humain à partir de ses effets, moins encore à partir de l’ordre entre ces effets. Attentif à ne pas confondre l’ordre moral (agere) et l’ordre technique (facere), l’Aquinate souligne la spécificité du premier par rapport au second :
« Le vice moral réside dans l’action et non dans l’effet produit, car les vertus ne relèvent pas du faire mais de l’agir[26]. »
Le désordre causé par le péché est d’abord intérieur à l’âme avant de lui être, le cas échéant, extérieur :
« Le péché consiste en un certain désordre de l’âme, comme la maladie consiste en un désordre du corps[27]. »
Moralement, le point de vue de l’effet produit n’est pas premier, fut-ce pour évaluer la gravité de la faute :
« Dans la gravité d’une faute, on fait plus attention à l’intention de la volonté perverse qu’à l’effet produit par l’œuvre[28]. »
Lorsqu’il traite de la légitime défense[29], saint Thomas d’Aquin mentionne certes une action à double effet : « un acte peut fort bien avoir deux effets », « l’action de se défendre peut entraîner un double effet ». Mais une lecture attentive du corps de l’article dans sa totalité montre toutefois que le substantif « effet » n’apparaît qu’au tout début, lorsqu’il s’agit de décrire la situation. L’observateur extérieur ne peut alors que faire ce constat : « l’action de se défendre peut entraîner un double effet ; l’un est la conservation de sa propre vie, l’autre la mort de l’agresseur[30]. » Par contre, la solution du problème moral donnée plus loin dans le texte ne repose aucunement sur les deux effets, moins encore sur l’ordre entre les deux effets. Comme n’importe quel acte humain, la légitime défense est moralement évaluée à partir de ses deux principes spécificateurs : l’objet et la fin.
Le refus d’évaluer moralement un acte à partir de ses effets est une constante chez l’Aquinate. Elle l’amène d’ailleurs à prendre ses distances avec Aristote, lequel ne réprouve pas la prodigalité sous prétexte qu’elle ne fait de tort à personne.
Dès le Commentaire des Sentences, saint Thomas est d’un autre avis :
« Le Philosophe appelle un mal, non pas tout acte désordonné, mais seulement celui qui est nuisible pour un autre. Aussi dit-il, au livre 4e livre de l’Éthique, que le prodigue, qui, par vanité, dépense de manière désordonnée, n’est pas mauvais mais vain. Il en dit autant de nombreux vices. Il est ainsi clair qu’il entend lui-même le mal de manière plus restreinte que nous qui disons que n’importe quel désordre rend l’acte mauvais[31]. »
Au terme de sa vie intellectuelle, le maître confirme la position qu’il soutenait comme jeune lecteur en théologie. Au Stagirite qui affirme « des gens indolents et des prodigues » qu’ils « ne sont pas mauvais[32] », l’Aquinate rétorque :
« Le Philosophe appelle proprement mauvais celui qui nuit aux autres hommes ; en ce sens il dit que le prodigue n’est pas mauvais, parce qu’il ne nuit à aucun autre qu’à lui-même ; et il en est ainsi de tous ceux qui ne nuisent pas à leur prochain. Mais nous, nous appelons généralement mal tout ce qui est contraire à la droite raison[33]… »
Quand on sait la bienveillance dont saint Thomas témoigne d’ordinaire envers les autorités qu’il cite, ce « nous, nous appelons » est loin d’être anodin. Il souligne une prise de position originale et résolue.
3. Une possible solution
Faut-il conclure de ces difficultés que les quatre règles du volontaire indirect formalisées par Gury à la fin du XIXe siècle sont incompatibles avec la pensée de saint Thomas d’Aquin ? Que nenni. La conciliation n’est certes pas aisée pour les raisons déjà signalées, mais elle n’est pas impossible.
Mis en présence des règles du volontaire indirect, les esprits curieux ne peuvent que s’interroger : d’où viennent ces règles ? pourquoi ces quatre règles-là ? à quoi renvoient-elles ?
Prises une à une, les règles énoncées par Gury découlent de principes moraux élémentaires :
[1] loin du machiavélisme pour qui la fin justifie les moyens, l’agent doit se proposer une fin honnête ;
[2] l’examen des effets d’une action n’a de sens que si celle-ci est moralement bonne ou indifférente ;
[3] pour éviter que le bien ne résulte du mal (Rom 3, 8), l’effet bon doit découler immédiatement de l’action et non de l’effet mauvais ;
[4] en l’absence d’une raison proportionnellement grave pour tolérer les effets mauvais d’une action (Mt 13, 24–30), celle-ci doit être omise.
Rapprochons maintenant ces règles des principes posés par saint Thomas pour évaluer la moralité des actes humains.
Primo, l’acte humain est moralement spécifié par son objet et par sa fin :
« L’acte moral est doublement spécifié, à savoir par son objet et par sa fin. La fin est en effet l’objet de la volonté, qui a raison de moteur dans les actes moraux. Quant aux puissances mues par la volonté, elles ont chacune leur objet, qui est l’objet prochain de l’acte volontaire et qui joue dans l’acte de volonté par rapport à la fin le même rôle que la matière vis-à-vis de la forme[34]. »
Gury ne dit pas autre chose dans les règles [1] et [2], encore qu’il utilise une autre nomenclature et se réfère à une autre conceptualisation que l’Aquinate.
Secundo, il arrive que certaines circonstances de l’acte humain deviennent déterminantes et passent à la condition d’objet moral :
« Ce qui est considéré comme une circonstance et comme extrinsèque par rapport à un acte d’un certain point de vue peut être considéré comme intrinsèque par rapport à ce même acte envisagé d’un autre point de vue et lui donner son espèce[35]. »
« La circonstance qui reste proprement telle et conserve sa condition d’accident, ne spécifie pas l’acte. Par contre, celle qui devient condition principale de l’objet spécifie l’acte[36]. »
Par la règle [3], Gury veille à s’assurer que certains effets mauvais qui d’ordinaire sont accidentels ne deviennent pas dans un cas précis essentiels[37].
Tertio, faire le bien suppose de prendre en compte des circonstances et d’omettre les actions qui ne sont pas proportionnées à la fin vertueuse poursuivie :
« De toutes les circonstances requises pour un acte vertueux, il en est une principale : l’acte doit être proportionné à la fin poursuivie par la vertu. Or, en corrigeant le pécheur, la charité vise son amendement. C’est pourquoi l’acte ne serait pas vertueux, si l’homme devenait pire du fait de la correction[38]. »
A l’instar de saint Thomas, Gury est conscient dans sa règle [4] que le bien à faire suppose un examen des circonstances concrètes et des effets induits et commande l’omission de l’acte projeté en l’absence d’une raison grave pour commander l’agir.
Au final, saint Thomas aurait pu formuler le principe du volontaire indirect en ces termes :
« Il est permis de poser une action bonne ou indifférente par son objet de laquelle dérivent deux effets, l’un bon et l’autre mauvais, dès lors qu’existe une raison proportionnellement grave, que la fin de l’agent est bonne et que l’effet mauvais ne devient pas condition principale de l’objet ».
Conclusion
Au terme du périple qui nous a mené de saint Thomas à Gury puis en sens inverse, nous pouvons mesurer combien les instruments d’analyse dont nous disposons aujourd’hui sont le fruit d’un effort séculaire. La difficile conciliation entre les étapes extrêmes de ce processus d’élaboration nous invite par ailleurs à ne pas céder à la facilité. La lecture et l’utilisation correctes des règles du volontaire indirect formalisées par Gury reposent en effet sur l’étude de l’acte humain réalisée des siècles auparavant par saint Thomas. Oublier celle-ci, c’est risquer de ne plus comprendre celles-là.
La formalisation de Gury avait suscité une question restée en suspens : à quoi correspondent les quatre règles du volontaire indirect ? Les lumières apportées par l’Aquinate nous permettent désormais d’y répondre. Il y a quatre règles car le mal emprunte quatre voies distinctes pour s’insinuer dans nos actions. Les unes sont viciées par l’objet, les autres par la fin, d’autres encore par une circonstance mauvaise passant à la condition d’objet, les dernières par l’absence de raison proportionnée pour tolérer le mal.
Source : Cahiers Saint Raphaël n° 151, été 2023
- Pie XII, Discours au 7e Congrès international d’hématologie, 12 septembre 1958.[↩]
- Nicolas Hendriks, Le Moyen mauvais pour obtenir une fin bonne, Rome, Herder, 1981, p. 16.[↩]
- « Il s’agit d’un principe moral, d’un guide pour la détermination de la valeur morale des actes humains. » (Hendriks, p. 16[↩]
- Pie XII, Discours au 7e Congrès international d’hématologie, 12 septembre 1958.[↩]
- Jean-Pascal Perrenx, Théologie morale, t. 2 : les actes humains, Téqui, Paris, 2008, p. 369. Par contre, il est bien présent dans le Catéchisme de l’Église catholique (1992) aux n° 1737, 2258, 2268, 2271, 2279, 2296, 2297, 2322 et 2370.[↩]
- Ibid.[↩]
- Saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, II-II, q. 64, a. 7, c.[↩]
- Peter Knauer, « La détermination du bien et du mal moral par le principe du double effet », dans Nouvelle Revue Théologique, n° 87, 1965, p. 357–358 ; Joseph T. Mangan, « An historical analysis of the principle of double effect », dans Theological Studies, n° 10, 1949, p. 49 ; Joseph Ghoos, « L’acte à double effet. Étude de théologie positive », dans Ephemerides Theologicæ Lovanienses, n° 27, 1951, p. 31–32 ; Œuvres de saint Alphonse-Marie de Liguori, t. 6, Paris, Vivès, 1877, p. 381.[↩]
- Vicente Alonso, El Principio del doble efecto en los comentadores de santo Tomas de Aquino desde Cayetano hasta los Salmanticenses. Explicación del derecho de defensa segun santo Tomas de Aquino, Rome, 1937, 4e partie in fine ; Nicolas Hendriks, Le Moyen mauvais pour obtenir une fin bonne, Herder, Rome, 1981, p. 188 ; Théo G. Belmans, Le Sens objectif de l’agir humain. Pour relire la morale conjugale de Saint Thomas, Coll. Studi Tomistici, 8, Libreria Editrice Vaticana, Cité du Vatican, 1980, p. 76.[↩]
- Jean de Saint-Thomas, Cursus theologicus, q. 21, a. 5 disp. 11, art. 6, n° 34 : « Quando aliquis eventus ex aliqua alia causa præter voluntatem operantis vitiatur, non habet vitium, ut procedit a tali voluntate, ergo respectu illius voluntarium non est, et consequens neque peccaminosum, vel malitiam augens. »[↩]
- Ibid., n° 36 : « Quod persuadens ad peccatum non intendendo ipsum nocumentum alterius spirituale, sed propriam convenientiam temporalem, respicit tale nocumentum ut per accidens et non per se consecutum, tum quia ab ipso non intenditur, et sic est præter intentionem et per accidens ; tum quia non habet necessariam et per se connexionem cum tali nocumento, sed debet intervenire alia causa dans totam malitiam ».[↩]
- Ibid., n° 39 : « Quod in illis casibus nocumenta illa sequuntur per se moraliter ex illa actione, eo quod voluntas non habens indigentiam utendi aliquo, ex quo videt sequi damnum vel effectum malum, virtualiter vult malum istud, quia debet potius velle bonum proximi vel suum quam actionem, qua ipse non indiget modo. »[↩]
- Salmanticenses, Cursus theologiæ moralis, t. 5, tract. XX, cap. XIII, punct. III (Nicolas Pezzana, Venise, 1728, p. 54) : « Aliquæ ex causis per se solum habent concurrere ad effectum illicitum, vel si ad alios concurrunt, est mediante illo ; ut veneni propinatio. Aliæ vero sunt, quæ primo influunt in effectum licitum, et eo mediante in illicitum ; ut tactus Chirurgi concurrit immediate ad curationem, et mediate, si sit in verendis, potest concurrere ad pollutionem. »[↩]
- Ibid., p. 54–55 : « Dico primo, volontatem tunc directe consentire in effectus illicitos, quando applicat causam, quæ vel est determinata ad effectum illicitum, vel præcise eo mediante in effectum licitum potest influere. […] Dico secundo, si causa prius, aut æque per se primo habeat effectum bonum, ac malum, si adest sufficiens necessitas juxta gravitatem materiæ, potest licite applicari ad effectum bonum, et tunc voluntas licet effectum malum prævideat ; non tamen ex hoc dicitur illum velle. »[↩]
- Joseph T. Mangan, « An historical analysis of the principle of double effect », p. 59 : « It is only beginning with the various editions of Gury’s admirable and repeatedly reedited Compendium Theologiae Moralis in the nineteenth century that the moral theologicians universally give an adequate, thorough explanation of the principle of the double effect as a general principle applicable to the whole field of moral theology. »[↩]
- Jean-Pierre Gury, Compendium Theologiæ moralis, 5e éd., t. 1 : De actibus humanis, c. 2, n° 9 (Ratisbonne, Ed. Georges-Joseph Manz, 1874, p. 5) : « Licet ponere causam bonam aut indifferentem, ex qua sequitur duplex effectus, unus bonus, alter vero malus, si adsit causa proportionate gravis, finis agentis sit honestus, et effectus bonus non mediante malo ex illa causa proveniat. »[↩]
- Ibid. : « Quatuor autem conditiones in hoc principio enuntiantæ omnino requiruntur, scilicet [1] ut honestus sit finis agentis ; [2] ut causa sit bona vel saltem indifferens ; [3] ut effectus bonus ex malo non proveniat et [4] adsit ratio proportionate gravis ponendi causam nec teneatur agens ex alia obligatione, ut ex justitia, caritate, eam omittere. »[↩]
- Le Catéchisme de l’Église catholique (1992) reprend cette nomenclature au n° 1736 : « Une action peut être indirectement volontaire quand elle résulte d’une négligence à l’égard de ce qu’on aurait dû connaître ou faire… »[↩]
- Saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, I‑II, q. 6, a. 3, c.[↩]
- Ibid., ad 1.[↩]
- Saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, I‑II, q. 77, a. 7, c.[↩]
- Ibid.[↩]
- Saint Thomas d’Aquin, Commentaire sur l’Éthique à Nicomaque, lib. 3, lect. 12, n° 512.[↩]
- Cajetan, In II-II, q. 150, a. 1.[↩]
- Un glissement s’opère de l’agir vers le faire et de la cause formelle vers la cause efficiente.[↩]
- Saint Thomas d’Aquin, Contra Gentes, lib. 3, c. 10, n° 1944.[↩]
- Saint Thomas d’Aquin, De Malo, q. 7, a. 1, c.[↩]
- Saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, II-II, q. 13, a. 3, ad 1.[↩]
- Cf. saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, II-II, q. 64, a. 7, c.[↩]
- Saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, II-II, q. 64, a. 7, c.[↩]
- Saint Thomas d’Aquin, Commentaire sur les Sentences, lib. 2, dist. 40, q. 1, a. 5, ad 1.[↩]
- Saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, I‑II, q. 18, a. 9, obj. 2.[↩]
- Ibid., ad 2.[↩]
- Saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, II-II, q. 110, a. 1, c. Voir aussi I‑II, q. 18, a. 6, c.[↩]
- Saint Thomas, De Malo, q. 2, a. 6, ad 1.[↩]
- Saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, I‑II, q. 18, a. 10, ad 2.[↩]
- Ainsi la dépression respiratoire peut être l’effet secondaire indésirable mais inévitable d’une sédation ou l’effet premier d’un acte euthanasique. De même, les victimes civiles peuvent être l’effet secondaire indésirable mais inévitable du bombardement d’un objectif militaire ou l’effet premier d’une politique de terreur massive.[↩]
- Saint Thomas d’Aquin, De Virtutibus, q. 3, a. 1, ad 1.[↩]