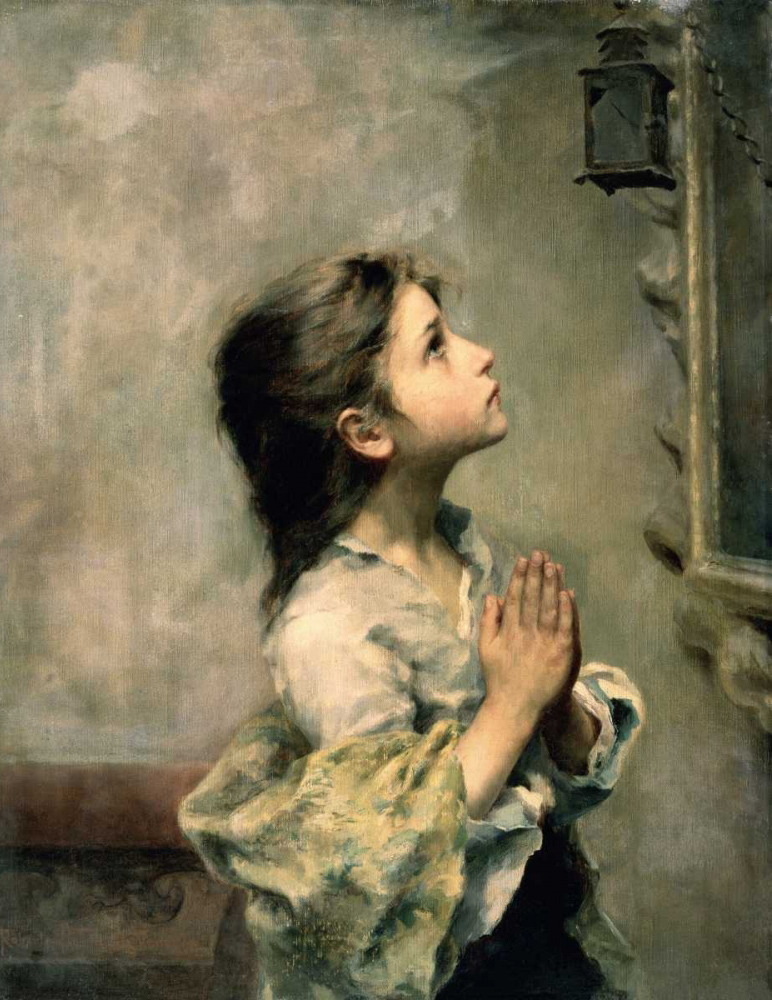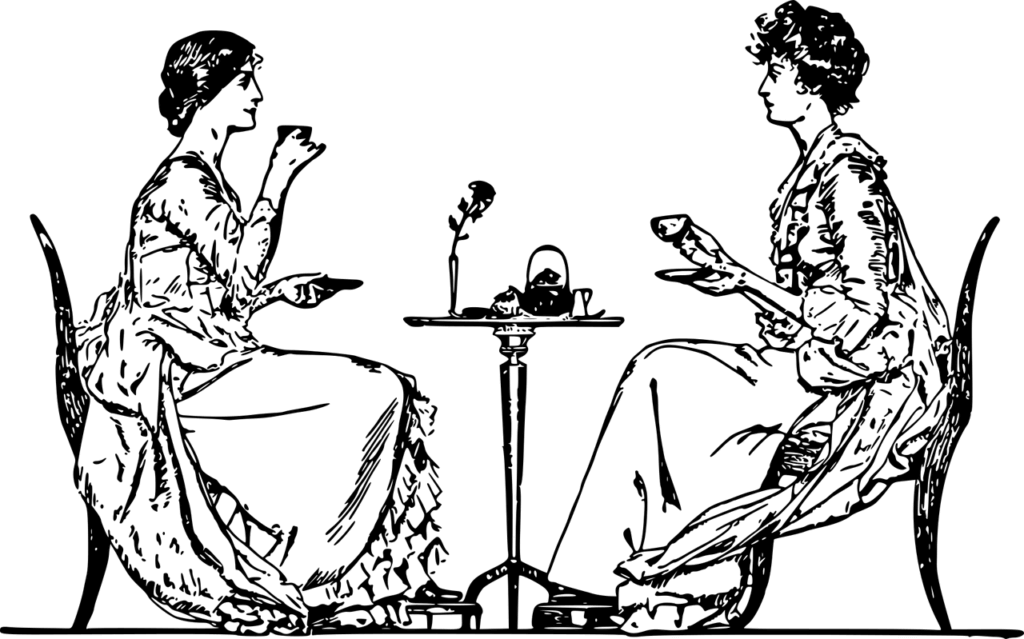La volonté de nivellement par le bas se manifeste par le rejet pur et simple des formules et des gestes de bienséance.
Nous n’ignorons rien de la politesse. Tous, ou presque, nous savons qu’il faut saluer, remercier, céder sa place à certaines personnes, ne pas parler la bouche pleine, mettre les couverts dans un certain ordre et dans un certain sens… Que nous les approuvions ou nous, nous croyons également bien connaître les raisons ou les motifs de ces prescriptions. À mieux y regarder… les motifs invoqués sont en réalité nombreux et très divers. Quels que soient l’époque et le lieu, ils n’ont cessé de changer : les règles d’aujourd’hui ont une explication différentes de leur institution. D’ailleurs, ce à quoi nous attribuons une origine de civilité naturelle, découlant de principes moraux ou religieux, sont pour la plupart des héritages d’institutions pour démarquer les milieux sociaux et exprimer les hiérarchies.
« Non, je ne flatte point… »
Dans le Misanthrope, Alceste est raide. « Je ne trouve partout que lâche flatterie, qu’injustice, intérêt, trahison, fourberie ; Je n’y puis plus tenir, j’enrage, et mon dessein est de rompre en visière à tout le genre humain. » Il reproche à Philinte, son ami, de se compromettre dans cette façon de montrer compréhension et humanité envers tous ceux qui l’approchent. « Je prends doucement les hommes comme ils sont… » lui dit Philinte. Mais pour Alceste, supporter avec une patience l’imperfection et le ridicule des mœurs n’est pas vertu ou politesse, mais hypocrisie. Son caractère si obstiné et ses jugements à l’emporte-pièce sur les mœurs de son temps, poussent le ridicule jusqu’à refuser les formes les plus anodines et les plus extérieures de sociabilité, sont une critique de l’hypocrisie des relations sociales. « Ce chagrin philosophe est un peu trop sauvage, je ris des noirs accès où je vous envisage… » Bien sûr, Alceste, le misanthrope, manque de mesure, et c’est cela que le rire condamne. Mais sa rigueur morale est vraie ; les relations entre les hommes ne peuvent exister lorsque le mensonge et la flatterie sont devenus coutume. S’il se veut impoli, c’est pour mieux dénoncer l’hypocrisie de la politesse, et finalement, mais d’une façon bien odieuse, il veut du bien aux hommes : « Il n’est point d’âme un peu bien située qui veuille d’une estime ainsi prostituée ».
Aux commencements de la politesse
Il est indéniable que la politesse est héritière de pratiques très anciennes. Le décorum et l’urbanitas latins, puis plus tard à l’époque chevaleresque, la courtoisie ont proposé des modèles de comportement, comme celui de l’honnête homme, très remarqués et admirés. Le décorum décrit par Cicéron peut être traduit par ce qui est convenable pour qu’un homme moralement bon soit en harmonie avec lui-même et avec tout ce qui l’entoure : c’est une recherche de la beauté morale. Si la politesse héritera de certaines pratiques du décorum, elle s’en distinguera et par son objet, les relations humaines, et par l’excellence morale qu’elle n’exige pas. L’urbanitas, quant à elle, désigne la douceur des mœurs et les manières raffinées, puis les qualités de langage (la pureté de la langue, la finesse des propos ou l’ingéniosité ), et enfin l’art de plaisanter agréablement avec esprit et sans froisser personne. Comme son étymologie l’indique, urbanitas établissait une distinction sociale entre le milieu urbain – de la ville – dont la vie à Rome était le modèle, et le milieu campagnard, la rusticitas avec son rustique, l’homme sans les codes urbains.
En reprenant la notion d’urbanité, les Français de la Renaissance, puis de l’Age classique, retinrent de ce modèle une forme d’art social, porté à un haut degré de raffinement. Cet ancêtre lointain de la politesse était réservé aux gens du beau monde et forcément cette distinction sera à la défaveur du rat des champs. Heureusement, la fable nous rappellera que le rat des villes était lui-aussi un rat. À la fin du Moyen-Âge apparut la courtoisie. Quel est l’homme courtois ? Celui qui agit conformément à la vie noble. C’est le mode de vie chevaleresque qui est mis en avant et il est réservé aux gens de la Cour. Ce n’est qu’ultérieurement et accessoirement qu’une partie des usages développés dans la vie de Cour seront imités par d’autres couches sociales. Décorum, urbanitas puis courtoisie regroupent à peu près constamment les mêmes formes de comportement au sein d’un milieu privilégié et maître du sens des codes définis. D’autres termes apparaîtront, tels que l’étiquette, la bienséance ou la décence : ils renforceront l’impression de véritables rituels de codes réservés pour déterminer les inégalités sociales, ou de stratégies déployées par un groupe définissant les règles et leur sens pour mieux se démarquer.
À bien les étudier, leur diversité montre que leur origine n’est pas la coutume (ou une habitude naturelle et propre aux hommes comme le serait la politesse), mais une élaboration convenue. Leur ancrage dans un milieu social particulier les distingue de notre vision de la politesse qui a pour objet les relations humaines sans restriction. À l’inverse, on peut dire que le decorum, l’urbanitas ou la courtoisie étaient des formes de politesse. Les éléments de ressemblance ne constituent qu’une partie de ceux qu’ils évoquent. Si certains éléments sont restés dans les mœurs polies, leur signification sociale en a été modifiée.
« Les manières sont tout »
Avec son livre De civilitate morum puerilium (de la civilité puérile), Erasme se démarque par son étude des différents préceptes dispersés relevant de la morale, de l’éducation ou de la mode. Son travail sur la civilité n’invente pas une nouvelle forme historique du devoir-être en société, mais met à jour les motivations qui poussent les hommes à se donner des codes dans leurs relations. La civilité, c’est ce par quoi l’homme cherche à faciliter et à améliorer le commerce social. Sans s’intéresser à l’authenticité des sentiments, ni à la pureté des intentions, la civilité doit susciter l’estime et la bienveillance réciproques, même si elles restent superficielles : une bonne présentation, une apparence avantageuse permettront d’obtenir la confiance et la considération de l’autre. La discrétion, l’attention et les égards marqués aux personnes avec lesquelles on se trouve en rapport est une façon de s’attirer sur-le-champ leur faveur. Cette conception de la civilité comme un art de se rendre agréable se rapproche beaucoup de ce que nous attendons de la politesse.
Reprenant l’idée ancienne que l’âme a son siège dans le regard, Erasme tient tout le comportement extérieur pour l’expression directement lisible de l’homme intérieur. Faisant le lien entre l’apparence et l’être, Erasme voit dans la civilité un moyen de formation personnelle et humaine à la vie sociale, sans restriction. Ce nouveau concept sera à l’origine des transformations sociales profondes de la Renaissance et de l’Age classique. Cependant, trop idéal, le projet humaniste d’une sociabilité universelle restera négligé jusqu’au XVIIIe. Tout au plus, l’accès aux bonnes manières ira-t-il en s’élargissant, mais en rencontrant de constantes réticences et sans jamais parvenir à être reconnu par tous… la courtoisie est réservée, selon Diderot, aux gens de cour et de qualité, la civilité l’est aux personnes de conditions inférieures. Singulièrement, il faudra attendre « les règles de bienséance et de la civilité chrétienne » de saint Jean-Baptiste de la Salle, ouvrage de 1703 utilisé comme manuel par la Congrégation des Frères des écoles chrétiennes, écoles ouvertes aux pauvres, pour que se manifeste expressément l’intention d’enseigner la bienséance aux classes inférieures… même si, en devenant communes, ces règles tendront à passer pour vulgaires aux yeux du monde qui s’empressera d’en rechercher de plus subtiles : le snobisme restera définitivement un met de faux gourmets.
« Hé, Manu ! »
La politesse peut-elle s’identifier à un cérémonial ? Non. Un cérémonial détermine en effet l’ensemble des formes extérieures à observer dans les cérémonies officielles publiques ou religieuses. L’ordre des encensements au cours d’une messe, les inclinations, relèvent du cérémonial. Au temps des rois, le cérémonial de la cour s’appelait l’étiquette : c’était un instrument de pouvoir et de prestige. Dans nos démocraties modernes, il s’appelle le protocole. Ainsi, ce n’est pas par politesse qu’on doit attendre qu’une autorité officielle, publique ou religieuse, nous tende la main pour le saluer : c’est le protocole. Aucune de ces notions ne peut être comparée à la politesse. Elles ont toutes en commun le fonctionnement de certaines institutions ; la politesse concerne les relations individuelles et privées. Qu’on l’aime ou qu’on ne l’aime pas, on ne peut s’adresser n’importe comment à un président de la république ou à un maire.
Le sens de la fourchette…
Il semble qu’il faut écarter aussi la conception qui fait de la politesse un savoir-vivre. Les manuels ou guide du « nouveau savoir-vivre » ou « des convenances », les digest des « usages du monde » ont en commun de présenter la politesse comme une contenu éclectique de règles à connaître et à observer pour être poli. Mais la politesse est-elle une question de savoir, et en l’occurrence de savoir-vivre ? C’est-à-dire : faut-il concevoir la politesse comme la connaissance détaillée des échanges complexes de formalités fixées selon des règles arbitraires ? La querelle fin XIXe sur la présence ou non d’un tiret entre savoir et vivre en est le reflet.
Le premier problème de cette conception est que le plus souvent les auteurs de ces manuels de savoir-vivre sont aussi auteur et interprète des règles qu’ils fixent. Autant de têtes… autant d’exégèses. Ainsi l’épineuse question de savoir s’il faut arriver à l’heure à un dîner. Il fut un temps où la ponctualité était la politesse des rois… mais aujourd’hui, il n’est pas bon ton d’arriver à l’heure… est-ce pour se faire attendre ? est-ce pour ne pas arriver le premier ? est-ce pour ne pas gêner la maîtresse de maison ? allez savoir qui a raison ! le roi, la cuisinière ou les problèmes de circulation ?
La deuxième difficulté est un problème de cohérence. Au travers cette approche formaliste, pour ne pas dire superficielle, il est presque impossible de trouver une valeur, un sens, à ces prescriptions, pour certaines insignifiantes, à partir de motifs aussi divers que contradictoires tels que l’hygiène, l’intérêt, l’étiquette ou l’ordre social et l’esthétique. Est-il vrai que la fourchette est tournée de telle sorte que l’on voit les armes en France, alors qu’en Angleterre, elle est en sens inverse pour ne pas abîmer la nappe ? Enfin se pose la question de l’unité dans l’exposition de ces ouvrages de savoir-vivre : les tentatives pour résumer la politesse à partir d’une somme de pratiques à connaître, échouent à trouver une unité entre les règles : sommes éclectiques indigestes de règles hétérogènes, les manuels se contredisent finalement non seulement eux-mêmes mais entre eux. Ainsi les fameuses règles de préséance ! Comment placer les invités à table, surtout si parmi eux, il y a une jeune femme mariée à un vieux duc et une baronne âgée et malheureusement veuve…
Ne pourrions-nous pas avancer qu’en fait le véritable et inavoué motif des règles de politesse présentées dans ces ouvrages, est le désir de se distinguer ? Pourquoi devrait-on placer la serviette pliée en triangle sur l’assiette pour un déjeuner, alors qu’au dîner, elle est à gauche, et pliée en rectangle sur les couverts ! les Nadine de Rothschild et parangons vous répondront en roucoulant que c’est comme ça qu’il faut faire. Flatter la vanité de ceux qui les observent en permettant de se démarquer de ceux qui les ignorent est la ficelle grossière de la fausse politesse mondaine. L’approche de la politesse comme un savoir-vivre est superficielle : soit elle suppose la politesse connue et se perd dans une somme de codes, soit elle n’en présente que des motifs hétérogènes. Il faut donc bannir de la réflexion sur la politesse la notion et le terme lui-même de savoir-vivre car il est plus propre à entraver la recherche de ce qu’est la politesse qu’à la faciliter.
Fraternité, Égalité… Incivilité
Quelle est-elle finalement ? On pourrait penser que le mot politesse vient du mot grec polis, la cité. En fait il nous vient du verbe latin polire : éduquer, former aux bons usages, polir. Est poli, l’homme qui est raffiné, éduqué, poli en quelque sorte par l’instruction et qui ne présente aucune aspérité. La nature de la politesse est très cachée. Contrairement à ce qu’on pense ordinairement d’elle, ce qui paraît le plus évident n’est pas ce qui la définit exactement. Il y a bien souvent un décalage entre ce qu’elle prescrit et ce qu’elle est. Ainsi les marques de déférence ou d’humilité qui ont si souvent composé la plus grande partie des règles de bienséance : ces attitudes ont parfois laissé croire qu’elles avaient essentiellement pour but de manifester les inégalités sociales et de contribuer à leur maintien. Pour mettre en relation deux personnes, il faut qu’il y ait une certaine correspondance, une certain égalité vécue, comme dans la fable du lion et du rat… « on a toujours besoin d’un plus petit que soi ». Dans l’acte de déférence, comme dans celui de reconnaissance, la politesse dépasse les inégalités et crée un lien. Au cours du temps, on a vu se restreindre et s’affaiblir les expressions hiérarchiques sans que la politesse ne disparaisse pour autant.
Aux temps révolutionnaires, et au nom de l’égalité républicaine, la civilité est suspecte. Le tutoiement du sans-culotte est le signe révolutionnaire : le citoyen nouveau est fier de sa grossièreté, fier de son impolitesse. Avec son froc, sa carmagnole, ses cheveux raides de crasse, son bonnet et ses sabots, il prend constamment le contre-pied de la présentation soignée conforme à l’usage. La volonté de nivellement par le bas se manifeste par le rejet pur et simple des formules et des gestes de bienséance. Est-ce une réaction au mépris des classes inférieures sous l’ancien régime comme que le roman révolutionnaire veut nous le faire entendre ? Il avait été reproché à la civilité d’Erasme de s’appliquer à tous les hommes : la réaction de ses contradicteurs fut d’inventer de nouvelles règles de démarcations. Au moment de la révolution comme du temps d’Erasme, c’est la maîtrise des codes qui est en jeu. La politesse ne vise pas à supprimer les classes. Elle ne les prend pas en considération. Elle met en relation les individus, et, pour un instant, elle les considère sur un pied d’égalité, comme également obligés quant au bien commun. La politesse est l’armature de la société.
À quelques mètres de la mort, la politesse de la reine Marie-Antoinette est d’une délicatesse authentique. Elle vient de marcher sur le pied de son bourreau : Monsieur, je vous demande pardon, je ne l’ai pas fait exprès.
Abbé Vincent Bétin
Source : L’Aigle de Lyon n° 370
Illustration : La reine Marie-Antoinette sortant de la Conciergerie, le 16 octobre 1793, Georges Cain, 1885, Musée Carnavalet, Paris.