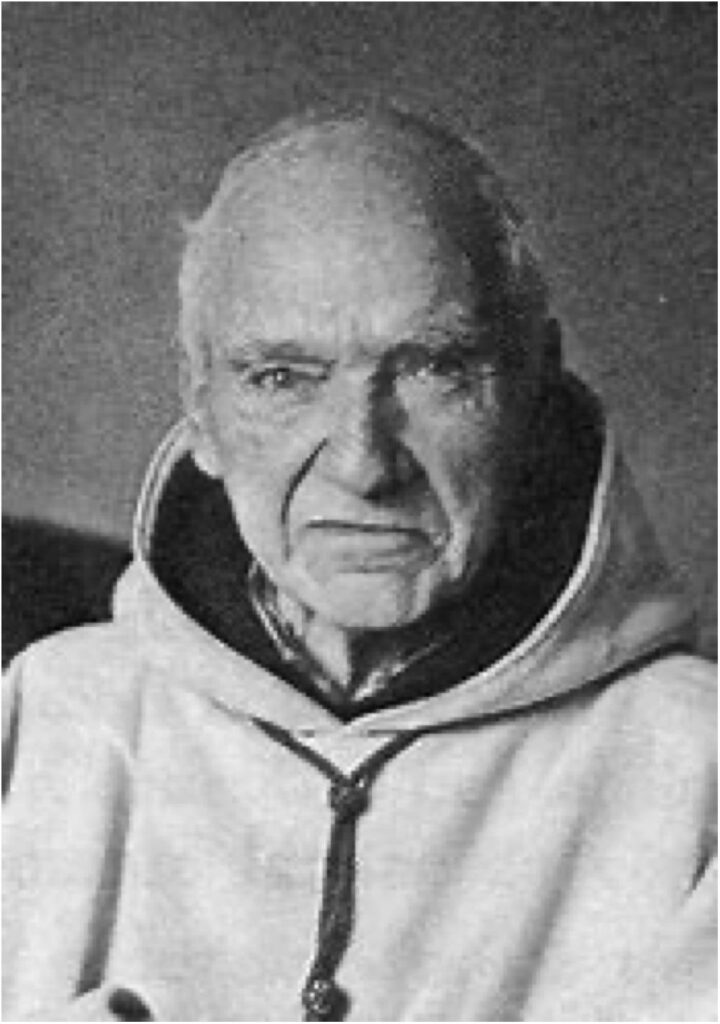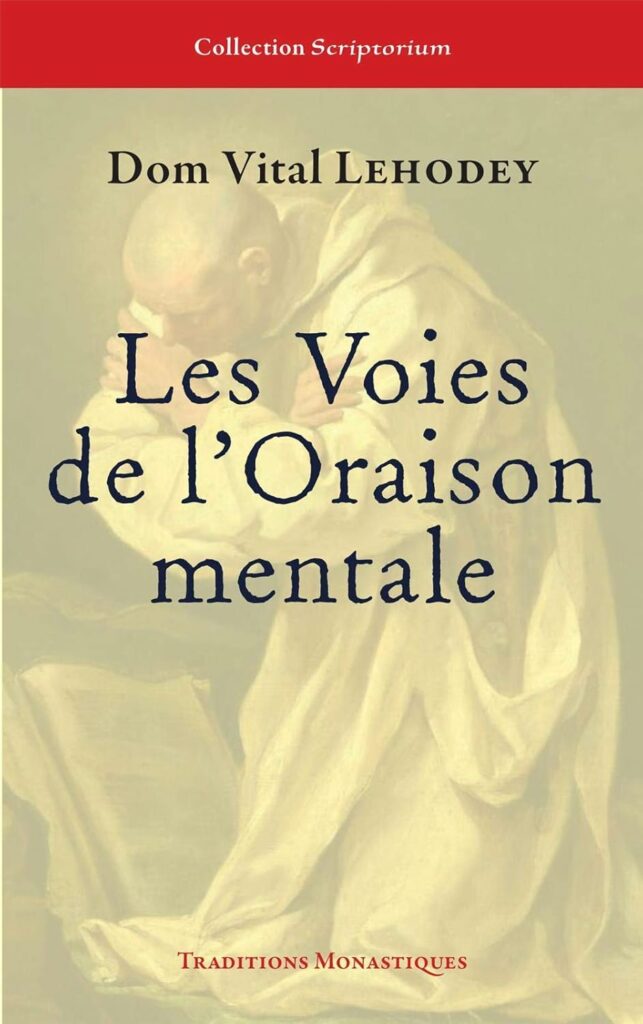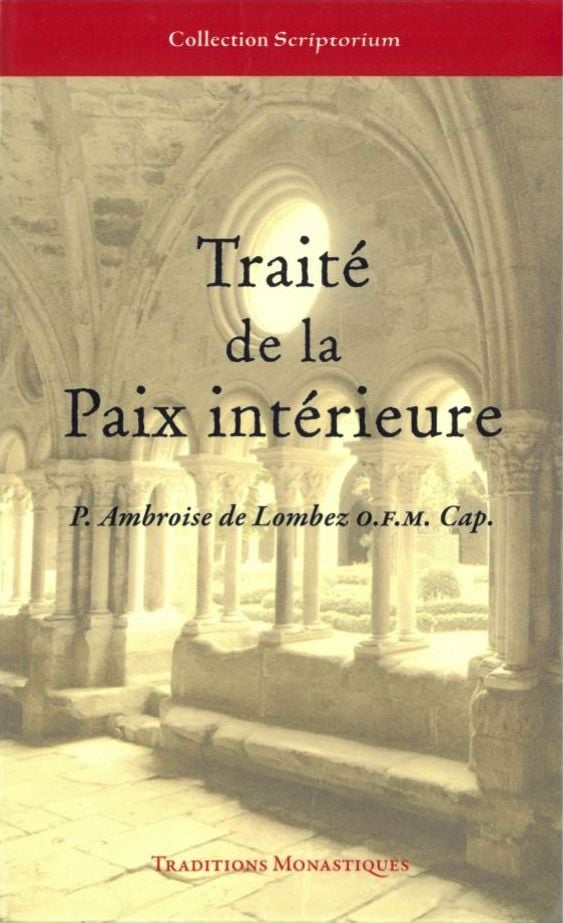Dans son autobiographie inédite, ce moine trappiste qui entretenait une relation privilégiée avec l’Enfant-Jésus, décrit les étapes de sa vie d’union à Dieu.
« J’avais cherché la sainteté de prime abord dans les austérités, et certes, elles ont leur prix et nous devons nous y porter avec amour ; plus tard, je crus la trouver dans les voies de l’oraison, dans l’union plus intime de l’esprit et du cœur avec Dieu, et c’était un réel progrès ; et maintenant je m’efforce de l’obtenir par la sainte petitesse, avec l’obéissance filiale et le confiant abandon : c’est assurément beaucoup mieux. Y a‑t-il quelque chose de plus élevé ? Jusqu’ici, je ne le crois pas… »
Dom Vital nous a laissé une trace de son expérience spirituelle. Avant de parcourir l’opuscule qu’il a consacré à l’oraison, retraçons sommairement les points saillants de sa vie.
Dom Vital Lehodey
Alcime-Jude Lehodey est né le 17 décembre 1857 à Hambye dans la Manche. Il a deux frères plus âgés et une sœur cadette. Son père meurt alors qu’il n’a que 4 ans et demi.
Il fait sa première Communion en juillet 1869 et rentre en 4e au petit séminaire de Mortain en octobre 1871. Il en sort cinq ans plus tard pour frapper aux portes du grand séminaire de Coutances en juillet 1876. Ordonné prêtre le 18 décembre 1880, il devient vicaire de Tessy-sur-Vire le 2 janvier 1881. Le 15 juillet 1887, il est muté —toujours comme vicaire— à la Paroisse Saint-Paul de Granville. C’est là qu’il entend l’appel divin à la vie religieuse.
D’abord tenté par les bénédictins de Solesmes, il opte finalement pour les trappistes de Bricquebec dans la Manche. Rentré à la trappe le 28 juillet 1890, il y reçoit le nom de Vital. Ayant prononcé ses premiers vœux le 20 août 1892, il est nommé dès le lendemain prieur de la communauté par le Père Abbé. Celui-ci étant mort le 19 octobre 1893, Dom Vital est nommé supérieur provisoire le 28 octobre 1893 alors qu’il n’est encore que profès temporaire. Ayant prononcé ses vœux définitifs le 7 juillet 1895, il est élu Père Abbé de sa communauté dès le lendemain.
A partir de ne moment-là, Dom Vital Lehodey va entretenir avec l’Enfant-Jésus une relation singulière :
« Personnellement, je ne l’ai (l’Enfant-Jésus) jamais ni vu, ni entendu. Tout se passe entre nous dans l’ordre de la foi. De temps à autre, il me fait sentir sa présence et son action ; le voile qui le cache se fait transparent. Ce n’est certes pas la claire vision, ce n’est plus tout à fait l’obscurité de la pure foi. Il ne se fait pas voir, il se laisse entrevoir et je converse avec mon très saint petit Bien-Aimé, comme si je le voyais, tant il est évident qu’il est là. Mais c’est une rare exception ; pour l’ordinaire il se contente d’attirer le cœur et par le cœur, l’esprit et la volonté, mais il se tient caché. »
Son abbatiat fut loin d’être de tout repos. En 1900, il fit un long voyage en Chine (secouée alors par la guerre des Boxers) et au Japon pour y superviser deux fondations. Par ailleurs, sa communauté fut expulsée de France en Angleterre entre 1902 et 1919. Ses nombreuses occupations ne l’empêchèrent pas de rédiger Les voies de l’oraison mentale en 1906 et Le saint abandon en 1919.
Dom Vital Lehodey dépose son abbatiat en juillet 1929 et meurt à Bricquebec le 6 mai 1948.
Les voies de l’oraison mentale
Dès l’avant-propos de son ouvrage consacré aux voies de l’oraison mentale, Dom Vital Lehodey parlant à la 3e personne définit son objectif : « L’auteur de ce modeste travail a donc cru faire œuvre utile en offrant à ses frères un exposé clair, simple et court de toute cette matière, un petit directoire dans les voies de l’oraison, un manuel où ils trouveront des conseils pratiques pour tous leurs besoins à mesure qu’ils avanceront dans les voies de l’oraison[1] ».
Nous nous focaliserons ici sur ce qui est dit de la nécessité de l’oraison, de sa pratique et de l’attitude à observer face aux consolations.
a. Nécessité de l’oraison
L’oraison procure quantité de bienfaits :
« La prière n’est donc pas seulement un précepte, c’est une nécessité. Dieu met à notre disposition le trésor de ses grâces, la prière en est la clef. Vous désirez plus de foi, d’espérance et d’amour : “Demandez et l’on vous donnera”. Vos bonnes résolutions demeurent stériles, toujours les mêmes insuccès : “Demandez et l’on vous donnera”. Les préceptes sont nombreux, la vertu pénible, la tentation séduisante, l’ennemi acharné, la volonté faible : “Demandez et l’on vous donnera”. La prière attirera dans votre âme la toute-puissance de Dieu, “elle est plus forte que les démons” (S. Bernard, De modo bene vivendi). Mais je prie et n’obtiens pas. “C’est que vous priez mal” (Jc 4, 3). Il y a longtemps déjà que je demande. “Demandez” encore, “cherchez, frappez” (Mt 7, 7) ; ravivez vos désirs, importunez le ciel, rendez la voix de votre âme plus forte et perçante comme un cri, et, pourvu que votre prière réunisse les conditions requises, “tout ce que vous voudrez, vous le demanderez, et cela se fera” (Jn 15, 7). Le Maître de la grâce, la Vérité même, en a donné sa parole : promesse souverainement encourageante, et on nous reproche seulement “de ne pas demander assez” (Jn 15,16–24) ; mais promesse qui ne laisse aucune excuse à la lâcheté ; on peut toujours prier et rien n’est plus facile. »
L’oraison est aussi le moteur de la conversion de l’âme :
« Nous faisons oraison afin de nous convertir du mal au bien, du bien au mieux, du mieux au parfait. Cette conversion constante et progressive, ou cette tendance à la perfection, comme on dit maintenant, est le but où doivent aboutir toutes les pratiques. »
Finalement, l’oraison prépare et prolonge la vie liturgique :
« Après que le feu de la méditation a enflammé notre âme, la sainte liturgie n’est plus lettre morte, elle parle à l’esprit et au cœur, tout en nous chante les louanges de Dieu. De même, sans le goût de Dieu puisé dans l’oraison mentale, la lecture est froide et presque infructueuse ; avec lui, les livres spirituels nous touchent, et, non contents de présenter la lumière à notre esprit, ils la font pénétrer jusque dans le cœur et la volonté. Il n’y a rien de plus puissant que le Saint Sacrifice et les sacrements ; mais jamais ils ne produisent autant de fruit que lorsqu’une fervente oraison a largement ouvert l’âme aux effusions de la grâce. C’est la vie d’oraison qui nous élève au-dessus des mesquines pensées de la terre et des petites préoccupations de la nature ; c’est elle qui nous fixe en Dieu et nous fait vivre dans le recueillement et la vigilance sur nous-mêmes ; c’est elle qui nous communique l’esprit surnaturel et la dévotion, vivifiant ainsi nos jeûnes, nos veilles, nos travaux et toutes nos œuvres. »
La vie d’oraison est impossible sans une certaine mortification des cinq sens, de la mémoire et de l’imagination :
« La pénitence et la contemplation sont comme nos deux yeux ou mains : nous avons besoin de l’une, et ne pouvons nous passer de l’autre. Elles sont comme les deux tables de la loi : impossible pour nous de plaire à Dieu sans l’austérité, non moins impossible d’en être agréés sans la vie de prière ; il ne suffit pas de rendre à Dieu la moitié de ce que nous lui avons promis. Elles sont les deux ailes, qui ne peuvent nous soulever de terre et nous porter vers Dieu, qu’en harmonisant leurs efforts, en se prêtant un continuel appui. »
b. Pratique de l’oraison
L’objectif de l’oraison n’est pas de nous instruire, mais d’embraser le cœur au feu de l’amour divin :
« Les considérations ne sont pas une étude spéculative. On ne les fait pas pour apprendre ou savoir, mais pour embraser le cœur et ébranler la volonté. On fixe le regard de l’esprit sur une vérité pour y croire, sur la vertu pour l’aimer et la chercher, sur le devoir pour l’accomplir, sur le mal pour le détester et le fuir, sur un danger pour l’éviter. En un mot, la méditation doit conduire à l’amour et à l’action. »
« C’est ainsi que notre oraison atteindra son but. Son principal objectif n’est pas de nous instruire, les pieuses lectures y suffiraient. C’est plutôt d’embraser le cœur, afin qu’il rende mieux à Dieu ses devoirs, et surtout d’adapter notre volonté à celle de Dieu, de sorte que la prière nous détache de tout le reste, nous attache à lui seul et transforme ainsi nos habitudes et notre vie. »
Qui veut s’adonner à l’oraison doit d’abord veiller à son recueillement :
« Il importe donc beaucoup de bien commencer la prière vocale et d’y garder son attention toujours actuelle. C’est pourquoi il est bon de se mettre d’abord en la présence divine pour retirer des choses extérieures toutes les puissances de son âme, les ramener au-dedans de soi et les fixer en Dieu ; il est aussi très utile de ranimer son attention à certains moments déterminés. »
Il faut également cultiver la pureté du cœur et de l’esprit :
« La pureté de conscience est un état d’aversion pour le péché véniel. […] Notre cœur est pur quand nous n’aimons que Dieu ou selon Dieu. […] [La pureté de l’esprit] est la maîtrise exercée sur l’imagination, les souvenirs et les pensées pour chasser ce qui souille l’âme ou la met en danger, et même ce qui la dissipe et la préoccupe. […] Notre volonté est pure quand il n’y a plus en elle que la volonté de Dieu. »
Les fruits réels de l’oraison sont alors palpables par tout un chacun :
« La meilleure oraison, fût-elle la plus aride, est celle d’où nous sortons plus humbles, plus disposés à nous renoncer, à garder l’obéissance, à vivre dans la dépendance qu’exige notre état, à supporter nos frères sans jamais leur être à charge, en un mot à faire en tout la volonté de Dieu. Au contraire, notre oraison, fût-elle un flot de suavités, est stérile et même funeste, quand nous en sortons plus remplis de nous-mêmes et plus attachés aux douceurs ; car notre but n’est pas de jouir ici-bas, mais de tendre à la perfection. »
c. Attitude face aux consolations
Consolations et dévotion ne doivent pas être confondues :
« Les consolations ne sont pas la dévotion ; car cette volonté prompte qui constitue l’essence de la dévotion, peut très bien subsister sans les consolations, et faire défaut malgré elles. »
Face aux consolations dont l’origine est variée, la prudence reste de mise :
« Les consolations et les désolations peuvent venir de Dieu, de la nature ou du démon.
- Dieu, pour attacher l’âme aux biens spirituels, lui fait goûter au commencement le lait des consolations intérieures avec une abondance de larmes. Cela ne prouve pas que l’âme soit forte et dévote, mais qu’elle est faible puisque Dieu la traite en enfant ; c’est Dieu qui est bon et non pas nous. […]
- Le démon n’a aucune entrée directe dans notre esprit et notre volonté ; mais il a une grande action sur le sang, les humeurs, les nerfs, l’imagination, la sensibilité. Tantôt il excite des douceurs et des consolations ; il pousse ainsi l’âme à l’indiscrétion dans les austérités, pour la rendre inutile en ruinant sa santé, ou pour la décourager plus tard en la fatiguant sous un fardeau devenu excessif ; il la provoque à une secrète complaisance en ses vertus, ou à l’amour désordonné de ces douceurs pendant qu’il l’amuse à ce jeu perfide, il lui cache les défauts et les fautes qu’elle a tant besoin de corriger ; il essaie de lui persuader qu’on a les yeux sur elle et qu’on l’admire il la pousse à désirer les faveurs surnaturelles qui la mettraient en relief ; il veut la jeter en un mot dans l’orgueil et le sentimentalisme, au dépens du vrai progrès spirituel solidement basé sur l’humilité et l’abnégation.
Tantôt le démon suscite des sécheresses comme un ferment de discorde entre Dieu et l’âme, dans l’oraison même qui a pour but de les unir. Il fatigue l’esprit par la multitude des pensées étrangères ; il aggrave la stérilité apparente de la prière par des tentations de toutes sortes ; il accable le patient de sommeil, de tristesse, de chagrin ; il lui met dans l’esprit des pensées abominables ; il espère que l’âme se perdra en consentant au mal ou qu’elle se découragera. […] - Les consolations et les désolations peuvent aussi venir de la nature.
Quand la fatigue et les préoccupations ne nous accablent point, que notre corps est plein de vigueur et de santé, que nous avons la tête libre et le cœur content, l’oraison est plus facilement consolée. Il y a aussi des natures sensibles et impressionnables qui s’émotionnent pour un rien ; devant les bienfaits, les miséricordes et les perfections de Dieu, devant les mystères de Notre-Seigneur, spécialement les jours de fête, elles auront le cœur tendre et les larmes promptes.
Au contraire, il y a des jours où la nature est affaissée sous le poids de la fatigue, de la souffrance et des soucis ; l’esprit est vide, le cœur insensible, les yeux secs et toute l’âme sans vie. »
Source : La couronne de Marie n°139 – février 2025
- Toutes les citations sans références sont tirées du Les voies de l’oraison mentale que le lecteur est fortement invité à se procurer, à lire et à méditer dans son intégralité.[↩]