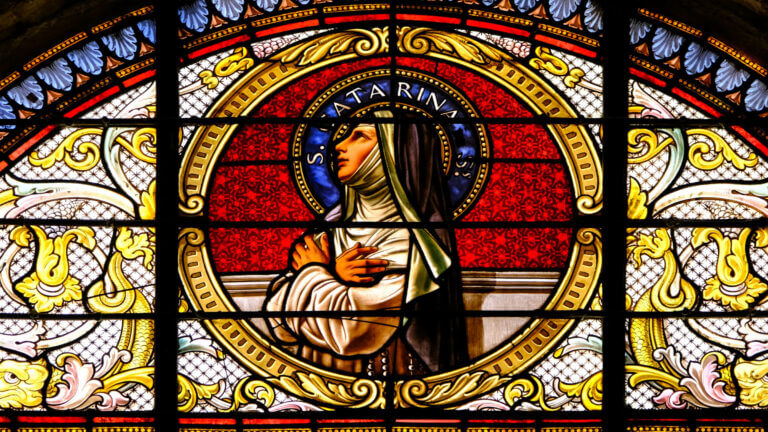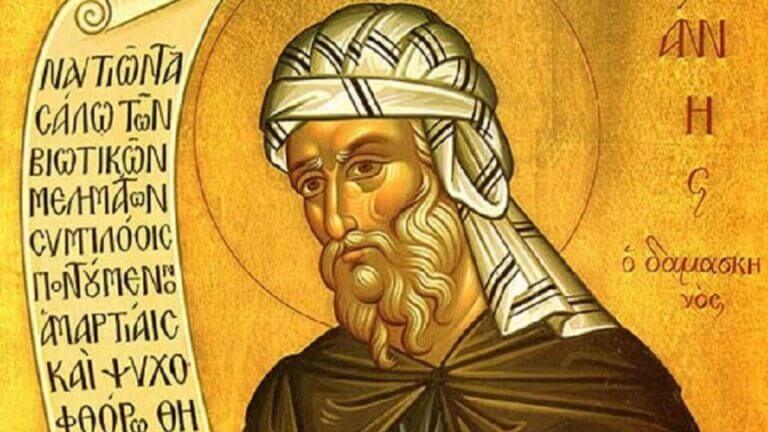Le pèlerin du Bon Dieu : exemple de contradiction au XVIIIème siècle (1748–1783)
Fête le 16 avril.

Vie résumée par l’abbé Jaud
Benoît-Joseph Labre naquit à Amettes, diocèse d’Arras, et fut l’aîné d’une famille de quinze enfants. Âgé de douze ans, il fut reçu chez son oncle paternel, curé d’Érin, pour faire ses études en vue du sacerdoce.
Après la mort de son oncle, Benoît-Joseph passa chez son oncle maternel, vicaire de Conteville, où il ne fit que grandir dans la mortification et la prière. Son attrait était toujours vers le Saint-Sacrement devant lequel il s’abîmait des heures entières en contemplation.
Il y avait longtemps que Benoît-Joseph aspirait à une vie plus parfaite : « Être prêtre est bien beau, disait-il ; mais j’ai peur de me perdre en sauvant les autres. »
Il finit par vaincre les résistances de ses parents et entre chez les Chartreux, espérant y trouver sa voie définitive. Il se trompait, car la Providence permet qu’il soit bientôt renvoyé par ses supérieurs, comme n’ayant pas la vocation de cet Ordre. La pensée de la Trappe, qu’il avait eue d’abord, lui revient ; on ne l’y accepte pas.
Ballotté de nouveau entre la Chartreuse et la Trappe, il est forcé de s’adresser enfin à Sept-Fonts, où ses scrupules, ses peines d’esprit et une maladie sérieuse donnent bientôt lieu à son renvoi.
Toute sa réponse à tant d’épreuves était : « Que la Volonté de Dieu soit faite ! » C’est alors que Dieu lui inspire cette vocation de pèlerin-mendiant qui devait le mener droit, par les chemins les plus ardus de la pénitence, à une éminente sainteté.
Il n’aura plus de relations suivies avec personne, vivra en solitaire au milieu du monde, ira toujours à pied, cherchera tous les lieux consacrés par la dévotion. Il sera revêtu d’un habit pauvre et déchiré, qu’il ne changera point.
Un chapelet à la main, un autre au cou, un crucifix sur la poitrine, sur les épaules un petit sac contenant tout son avoir, c’est-à-dire son Nouveau Testament, l’Imitation de Jésus-Christ et le Bréviaire : tel on verra Benoît-Joseph dans ses continuels pèlerinages.
La pluie, le froid, la neige, la chaleur, rien ne l’arrête ; il couche le pus souvent en plein air, il vit de charité, au jour le jour, sans rien réserver pour le lendemain ; il ne prend que la plus misérable et la plus indispensable nourriture, et se fait lui-même pourvoyeur des pauvres. Souvent il est le jouet des enfants et de la populace ; il est regardé comme un insensé ; il souffre tout avec patience et amour.
Rome, Lorette, Assise et une multitude d’autres lieux saints sont l’objet de sa dévotion.
Abbé L. Jaud, Vie des Saints pour tous les jours de l’année, Tours, Mame, 1950
Version longue (La Bonne Presse)
Jean-Baptiste Labre et sa femme, Anne-Barbe Graudsire, habitaient, vers le milieu du XVIIIème siècle, le village d’Amettes, au diocèse de Boulogne, actuellement d’Arras. Leur union fut bénie, et ils eurent quinze enfants ; Benoît-Joseph était l’aîné. Il naquit le 25 mai 1748.
Dieu, qui voulait combler ce prédestiné de grâces extraordinaires, et faire de toute son existence une protestation vivante contre les vices du siècle, semble l’avoir, à dessein, fait naître dans une famille nombreuse pour marquer combien la fécondité des mariages lui est agréable.
Enfance.
L’enfant fut, dès l’âge le plus tendre, nourri de l’esprit de foi : il correspondait merveilleusement à ces premiers enseignements, et tout ce que nous savons de son enfance nous révèle une piété précoce, une assiduité exemplaire à ses devoirs et une soumission parfaite à ses parents. On le vit s’exercer en cachette à la mortification dont plus tard il devait être le héros, et passer des heures entières en adoration à l’église.
A l’âge de douze ans, il fut placé chez son oncle, M. François-Joseph Labre, curé d’Erin, afin de faire des études classiques en vue du sacerdoce : ce fut l’époque de sa première Communion. Il y puisa un nouvel élan de dévotion et commença à partager son temps entre l’étude, la prière et la lecture des livres de piété, spécialement celle des Saintes Ecritures. A pareille école, il puisa le sentiment profond du néant de l’homme en face des redoutables jugements de Dieu, de l’absolue nécessité du renoncement et de la pénitence. Dès lors, cette âme pure qui, certainement, ne commit jamais aucun péché mortel, se mit à soupirer après le martyre des sens et le supplice de la croix ; cette jeune et innocente imagination cherchait les règles les plus dures pour obéir à des appels dont nous autres pécheurs ne sommes pas dignes et que nous n’entendrions pas s’ils nous étaient adressés.
Humilité et détachement complet de toutes choses.
En 1766, une circonstance imprévue vint tirer Benoît-Joseph de la voie qui devait le conduire à la prêtrise : le typhus, à l’état épidémique, vint fondre sur la paroisse d’Erin : le curé fut atteint, et le Saint, qui s’était dévoué au soin des malades, eut la douleur de voir mourir son oncle et bienfaiteur. Aussi après huit années, il dut retourner à Amettes ; sa première parole fut pour solliciter de ses parents l’autorisation d’embrasser la vie religieuse chez les Trappistes. Les objections ne manquèrent pas, inspirées comme toujours par une tendresse toute naturelle : ce fut seulement au mois d’avril 1767, qu’après avoir passé quelque temps chez son oncle maternel, l’abbé Vincent, curé de Conteville, dans les exercices de la plus tendre piété, il eut la liberté de suivre, non pas à la Trappe, mais chez les Chartreux, une vocation qu’il jugeait certaine.
Benoît-Joseph se croyait au port. Il se trompait et Dieu lui destinait une voie bien autrement dure : il ne devra réussir dans aucune de ses entreprises, ni demeurer nulle part, jusqu’au jour où il saura que, dans son pèlerinage ici-bas, il ne lui est pas même réservé une tente pour s’abriter.
Il alla frapper d’abord à la porte de la Chartreuse du Val-Sainte-Aldegonde, qui était située près de Longuenesse, au diocèse de Saint-Omer ; le couvent étant trop pauvre, on ne put l’y recevoir comme novice. Il revient à Conteville. L’abbé Vincent décide de le présenter au monastère de Neuville, près de Montreuil-sur-Mer ; il y trouve un refus motivé par le défaut de connaissance du chant et de la dialectique. Force lui fut de rentrer à Amettes ; ses parents le confièrent alors à l’abbé Adrien Dufour, vicaire à Ligny lès-Aire, qui engagea bientôt Benoît-Joseph à se présenter de nouveau à Neuville. Celui-ci y fut admis en qualité de postulant, mais bientôt le Père prieur, reconnaissant un manque de vocation, le renvoya.
En face de l’impossibilité de suivre la règle des Chartreux, la pensée des Trappistes revint tout naturellement, et les parents durent se prêter à son désir d’entrer dans leur Ordre : voilà donc le Saint en route pour Mortagne, au diocèse de Séez. Il y trouve encore un mécompte ; il est trop faible de complexion et nul, avant vingt-quatre ans, ne peut franchir le seuil du noviciat. Il faut reprendre tristement le chemin d’Amettes, et retrouver les angoisses, les doutes et les perplexités d’une vocation incertaine. Malgré l’insuccès de ses tentatives à la Chartreuse, Benoît fera un nouvel essai : tout le monde le lui conseille, même Mgr de Pressy, évêque de Boulogne ; il s’y dispose par une confession générale, dit adieu à ses parents, et, le 12 août 1769, il part, se dirigeant de nouveau vers Neuville.
Dès le 2 octobre, il prenait la plume pour annoncer à Amettes un nouveau déboire : on ne l’a pas trouvé propre à l’état de Chartreux, il va reprendre le chemin de la Grande-Trappe : « Le bon Dieu que j’ai reçu avant de sortir m’assistera et me conduira dans l’entreprise qu’il m’a lui-même inspirée. J’aurai toujours la crainte de Dieu devant les yeux, et son amour dans le cœur. J’espère fort d’être reçu à la Trappe. »
Cette espérance ne devait pas se réaliser ; le monastère maintint sa règle de ne point admettre de novices au-dessous de vingt-quatre ans ; il fallut se rejeter sur la Trappe de Sept-Fonts, au diocèse d’Autun. De grandes épreuves l’attendaient en ce lieu : peines d’esprit, maladies et, enfin, certitude de n’être pas appelé à ce genre de vie. Cependant, après l’avoir dépouillé de toute volonté propre, en lui montrant l’inanité de chacun de ses projets, Dieu daigna ouvrir à son esprit un horizon nouveau, lui faisant connaître la voie des pèlerinages, que ses guenilles de pauvre devaient triomphalement parcourir parmi toutes les humiliations.
Vocation définitive de pèlerin.
C’était en premier lieu le chemin de l’Italie. A Rome, il devait trouver le couronnement et l’épanouissement de la sainteté. Il n’y a pas de Saint sans une doctrine absolument pure. En ce temps, l’Eglise de France était plus ou moins sous l’influence rigoriste du jansénisme ; sa foi, qui devait être lavée dans le sang de 1798, n’était pas irréprochable ; atteinte dans sa fécondité, pendant un demi-siècle elle n’avait pas donné un seul Saint. L’élu de Dieu devait respirer un autre air. L’enfant de lumière était attiré par le foyer de la vérité. Il se rendit à Rome.
A partir de ce jour, Benoît-Joseph, obéissant à l’inspiration divine, se résolut à vivre en solitaire au milieu du monde. Il va toujours à pied, en prenant les chemins les moins fréquentés et en s’arrêtant dans les lieux qui rappellent quelque souvenir cher à la piété des fidèles ; il est revêtu d’un habit pauvre qu’il ne quitte point, il porte un chapelet à la main, un autre au cou, un crucifix sur la poitrine, et sur les épaules un sac contenant tout son avoir : le Nouveau Testament, l’Imitation de Jésus-Christ, et le bréviaire qu’il récite chaque jour. La pluie, le froid, la neige, la chaleur, rien ne l’arrête ; il couche le plus souvent en plein air ; il évite les auberges et les hôtelleries, où son recueillement serait troublé par le bruit, les blasphèmes et les chants des voyageurs. Il vit de la charité, an jour le jour, sans mendier et sans rien se réserver pour le lendemain. Il ne prend que la nourriture indispensable pour soutenir son corps qu’il mortifie sans cesse, et, s’il reçoit des aumônes abondantes, il donne aux pauvres tout ce qui ne lui est pas absolument nécessaire pour la journée. Souvent il est le jouet des enfants et de la populace ; on l’insulte, on le maltraite, on le regarde comme un insensé, et il supporte tout avec patience et amour.
Dans ces dispositions, il traverse toute l’Italie et arrive à Lorette où sa dévotion rencontre l’incomparable relique de la Santa Casa : les nuits se passent en plein air, les jours ne suffisent pas à ses prières. Le 18 novembre 1770, il est à Assise, au tombeau du grand patriarche saint François, il reçoit le cordon qu’il portera jusqu’à sa mort.
Enfin, le 3 décembre suivant, il entre dans cette Rome qui va devenir le centre de toute sa vie. On le voit dans les églises, aux pieds des Madones vénérées ; il prie toujours ; pour gîte, il a choisi l’excavation d’une muraille du Colisée.
L’année suivante, il retourne à Lorette en passant par Fabriano, où l’on vénère le corps de saint Romuald ; puis, côtoyant l’Adriatique, il s’arrête au mont Gargan, célèbre pèlerinage en l’honneur de saint Michel. De là il se rend à Bari, ville illustrée par le tombeau de saint Nicolas d’où découle aujourd’hui encore une eau miraculeuse. Puis, c’est le Mont-Cassin, qui garde le tombeau de saint Benoît, son patron, puis Naples et saint Janvier.
Il revient ensuite à Lorette et veut revoir Assise, la Portioncule, le mont Alverne, témoin des stigmates de saint François. Il fait en ce lieu une confession générale pour se disposer au plus long de tous ses voyages, celui de Saint-Jacques de Compostelle, en Espagne ; il traverse la France et s’arrête à Paray-le-Monial pour y vénérer le berceau du culte du Sacré Cœur.
Cette grande entreprise était terminée en 1774, malgré des difficultés de toute nature accompagnées de fatigues inouïes. Benoît, de retour à Rome depuis Pâques, retrouva sa vie habituelle jusqu’au jour où, pour la quatrième fois, il reprit le chemin de Lorette afin de s’élancer de là vers les sanctuaires de Lorraine, de Franche-Comté et de Suisse ; les citer tous est impossible, il suffît de nommer Saint-Nicolas-du-Port, près de Nancy, Notre-Dame des Ermites à Einsiedeln. Le grand pèlerin rentra à Rome le 7 septembre 1775. et y demeura jusqu’au commencement de l’année 1776, qui fut marquée par de nouvelles courses dans l’Italie et en Suisse jusqu’à Einsiedeln ; Lorette, comme d’habitude, en avait été la première station.
Ce fut le dernier grand pèlerinage. A partir de cette époque, la vie terrestre du Saint se partagea entre les diverses églises de la capitale du monde catholique et le voyage de chaque année à Lorette, qu’il visita onze fois. Malgré sa modestie, sa profonde humilité et son désir d’être ignoré et méconnu, il avait fixé l’attention de plusieurs personnes. Ses confesseurs, émerveillés des trésors de sa conscience, le tenaient en grande estime, le peuple le proclamait bienheureux. « Ce n’est point un homme, disait-on, c’est un ange. » Ses discours, quand il se laissait aller à en tenir, le prouvaient autant que sa conduite.
Interrogé sur ce que doit être notre amour pour Dieu, il répond :
Pour aimer Dieu convenablement, il faut avoir trois cœurs en un seul. Le premier doit être tout de feu envers Dieu et nous faire penser continuellement à Dieu, parler habituellement de Dieu, agir constamment pour Dieu et surtout supporter avec patience le mal qu’il lui plaît de nous envoyer pendant toute la durée de notre vie. Le deuxième doit être tout de chair envers le prochain et nous porter à l’aider dans ses besoins spirituels par l’instruction, le conseil, l’exemple et la prière ; il doit surtout s’attendrir pour les pécheurs et plus particulièrement pour les ennemis et demander au Seigneur de les éclairer pour les amener à la pénitence ; il doit aussi être plein d’une pieuse compassion pour les âmes du Purgatoire, afin que Jésus et Marie daignent les introduire au lieu du repos. Le troisième doit être tout de bronze pour soi-même et faire abhorrer toute sorte de sensualité, résister sans relâche à l’amour de soi, abjurer la volonté propre, châtier le corps par le jeûne et par l’abstinence et dompter toutes les inclinations de la nature corrompue : car plus vous vous haïrez et plus vous maltraiterez votre chair, plus grande sera votre récompense dans l’autre vie.
Nul ne saurait exprimer quelles lumières étonnantes versait dans cette âme Celui qui aime les humbles. Ce fut en premier lieu le don de prophétie ; les événements providentiels et terribles de la Révolution française lui furent révélés comme un châtiment réservé à l’impénitence de la société d’alors.
Benoît-Joseph connaissait l’état intérieur des âmes.
Plusieurs fois, l’ardeur de son amour et le feu de sa prière se révélèrent au dehors par l’éclat d’une lumière surnaturelle ou par l’élévation de son corps au-dessus de la terre. Il fît des miracles de son vivant, mais ce ne fut pas en très grand nombre.
Sa sainteté était tout intérieure, toute cachée, tout ignorée : ce fut son caractère spécial. Dieu se plaisait à voiler les sublimités de la grande victime expiatoire jusqu’au jour où elle irait recevoir au ciel sa récompense. A ce moment, tout apparaît, tout se révèle : une foule de témoins se rappellent d’innombrables circonstances ; les prodiges, les guérisons se multiplient et, de ces éléments divers, l’Eglise édifie un impérissable monument à la gloire du Saint.
Ses derniers moments.
Cependant, la nature humaine ne pouvait résister indéfiniment à de pareilles austérités : nourri de la pitance des pauvres qu’il allait recevoir à la porte des couvents et dont il donnait le plus souvent la meilleure part à d’autres pauvres, couchant en plein air, couvert de vermine, les jambes attaquées par des plaies, l’héroïque pénitent vit sa santé s’épuiser. On lui proposa d’entrer à l’hospice évangélique, pour y trouver au moins un abri pendant les nuits ; il accepta, et dans ce lieu s’écoulèrent les dernières années de sa vie. Pendant le jour, il continuait ses longues stations de prières à Sainte-Marie des Monts ou dans d’autres églises ; c’est à quoi il usa le reste de ses forces ; on eût dit un cadavre, et cependant il ne voulait rien s’accorder à lui-même.
A la fin du Carême, le samedi 12 avril 1783, il parut plus exténué que jamais. En sortant de l’église, il dut se soutenir en s’appuyant sur un bâton. Une personne s’approche et lui dit : « Vous êtes bien mal, mon brave. – La volonté de Dieu soit faite ! » répond-il. Elle lui dit de prendre soin de lui ; il incline la tête comme pour marquer son indifférence.
Benoît-Joseph pressentait sa mort prochaine ; il en parlait quelquefois, mais sans se troubler. Si on lui conseillait de se soigner et de ne pas s’exposer à tomber dans la rue, il disait : « Eh ! que m’importe ! » On l’entendait souvent s’écrier : « Appelez-moi, mon Jésus, afin que je vous voie ! »
Le 15 avril, en sortant de l’hospice évangélique, il eut une première défaillance. Malgré sa faiblesse extrême, il se traîna vers l’église Sainte-Praxède où l’on terminait les Quarante-Heures. Près de l’église, il acheta du vinaigre, et le buvant, il dit : « Il y a quelqu’un qui en a bu avant moi et qui, dans cette semaine, a souffert plus que moi pour l’amour des hommes. » Il passa la matinée devant le Saint Sacrement de l’église de Sainte-Praxède, auprès de la chapelle de la Sainte-Colonne. Le soir, il resta longtemps dans l’église de Sainte-Marie des Monts, puis il alla assister à la bénédiction à Notre-Dame de Lorette, sur la place Trajane. Il eut plusieurs syncopes dans la journée ; on le vit près de l’église du Pascolo, étendu par terre, et l’on craignit qu’il ne mourût.
Enfin, le Mercredi-Saint 16 avril, on voulut le retenir à l’hospice, tant son état semblait empiré ; mais il se rendit comme d’habitude à l’église Sainte-Marie des Monts ; il y arriva péniblement et entendit deux messes, puis il demeura quelque temps en adoration devant le Saint Sacrement. Vers 7 heures, il se sentit défaillir et tomba, pour ne plus se relever, sur les marches du parvis.
C’est là qu’un ami, le boucher Zaccarelli, vint le prendre et l’emmena dans sa maison située à peu de distance : à 8 heures du soir, il y rendait le dernier soupir, à l’âge de trente-cinq ans et vingt et un jours.
Le pauvre sordide, couvert de vermine, avait terminé sa vie comme il l’avait passée : aux yeux du monde, nul n’était plus digne de mépris. Et cependant on allait bien vite proclamer sa grandeur et sa sainteté.
Quantité de témoins, a écrit Louis Veuillot en 1868, répondant à un journaliste voltairien, ont attesté que la multitude éprouvait comme un éblouissement de la beauté morale qui rayonnait de son visage et faisait resplendir ses haillons. On reconnaissait le pénitent, le pauvre, l’ami du Christ. Pour beaucoup cette splendeur fut une lumière de Dieu ; elle les tira des délices mondaines, des ambitions, des avarices, des voluptés, de toutes les infections par lesquelles l’homme se perd et nuit aux autres Telle fut la mission particulière de Benoît Labre, en un temps particulièrement dévoré de mollesse et de luxure. Sa vermine prêchait contre une autre vermine qui rongeait le monde, et que Voltaire, qui en était lui-même, adorait, de l’adoration qu’il se rendait à lui-même…
… Il évangélisa, c’est tout dire, et ce seul mot le rattache à tout ce qui a paru de plus utile, de plus auguste parmi les hommes ; il fut un imitateur et un coopérateur du Christ, un ouvrier de la paix, de l’amour, de la lumière. Il évangélisa toute sa vie, prêchant l’Evangile dont le siècle avait surtout besoin : pauvreté, renoncement, humilité, vigueur de la pénitence, dédain des délices qui tuaient les âmes, mépris de cette chair qui, à force de mollesse, devenait une gangrène qu’il faudrait livrer au couteau. Sa mission dura quinze ans.
Durant quinze années, il reprit ainsi les vices, sans offenser les vicieux. Eloquent par son seul silence et son seul aspect, doux à l’injure lorsque par hasard elle lui était adressée, craignant et fuyant la louange qui venait à lui de toutes parts, consolant les pauvres en leur montrant le prix et la gloire de la pauvreté, et en les assistant de son nécessaire. Lorsqu’il mourut, à trente-cinq ans, de la véhémence de son amour pour Dieu, Rome entière cria : « Le Saint est mort ! » Et ceux à qui le genre particulier de ses austérités avait inspiré de la répugnance, vinrent avec la foule lui baiser les pieds sur le grabat où s’étaient exhalés sa dernière prière et son dernier soupir. (Mélanges, 3e série, t. II, 5 janvier 1868.)
Sa glorification.
L’Eglise elle-même allait prononcer son verdict et le placer sur ses autels. Un grand nombre de miracles et les suppliques des fidèles firent commencer la procédure de la cause de béatification. Elle fut introduite dès le 2 avril 1792. Grégoire XVI signa le décret d’héroïcité des vertus le 2 mai 1842 ; puis, après l’approbation de trois miracles, dont deux opérés en mai 1783, c’est-à-dire un mois après la mort du Saint, et le troisième en 1818, Pie IX procéda à la béatification le 20 mai 1860. Dès mars 1861, la cause fut reprise ; enfin, Léon XIII canonisa le serviteur de Dieu le 8 décembre 1883, fixant sa fête au 16 avril.
Ainsi, par ce grand acte, la divine Epouse du Christ a voulu s’attaquer à l’esprit du siècle en exaltant le renoncement complet et le mépris absolu des richesses, de la considération et des biens si aimés des hommes. Humilité, pauvreté, voilà la devise du nouveau Saint : humilité conseillant la pauvreté volontaire et sordide, pauvreté volontaire et sordide servant à son tour d’aliment à l’humilité.
Il est bien évident que pour suivre une voie aussi exceptionnelle, il faut une vocation spéciale, c’est-à-dire un appel particulier de Dieu, reconnu et confirmé par le confesseur ou le directeur de conscience. En effet, la véritable perfection chrétienne consiste, d’après l’illustre docteur de l’Eglise saint François de Sales, moins dans les actions d’éclat et les grandes mortifications que dans l’accomplissement fidèle de son devoir d’état, ou, en d’autres termes, la fidélité à sa vocation quelle qu’elle puisse être.
Saint Benoît-Joseph Labre avait sa vocation : il y a correspondu d’une manière admirable : en suivant d’une manière héroïque des conseils évangéliques si opposés à la nature, il s’est appliqué davantage à ceux qui lui coûtaient le plus ; s’il est condamné à l’abjection et aux tourments de la vermine, c’est que, par goût, il eût voulu être propre et soigné dans sa tenue. Pendant de longues années, il n’avait qu’un pas à faire et qu’un mot à dire pour reprendre dans le monde un rang convenable, et cependant il sut accepter sans une plainte d’être abreuvé de toutes les amertumes, accablé de toutes les hontes de la pauvreté vraie : c’est là un magnifique triomphe de la grâce sur les instincts de la nature. Ici apparaît dans tout son éclat cette pauvreté d’esprit louée et bénie par le Fils de Dieu.
Le Saint est, en outre, le modèle des pèlerins. Au XVIIIème siècle, en France, la notion des pèlerinages était perdue, le culte des saints, la fréquentation des sanctuaires, délaissés. Si l’on est sorti de ce lamentable état de choses, ne le lui doit-on pas ? Visiter les lieux bénis où la grâce afflue, non dans un esprit de distraction ou de vaine curiosité, mais par désir de mortification, voilà ce qu’il inspira, lorsque, depuis 1872, grâce au Conseil général des Pèlerinages fondé alors par le P. Picard, l’on vit des multitudes de prêtres et de fidèles se diriger, en esprit de foi et de pénitence, vers tous les grands sanctuaires de France, puis de Rome et de l’Italie, et enfin de la Terre Sainte. Il en est vraiment le patron.
A. R. C. Sources consultées. – Audigier et Rosière, La vie du grand pénitent Benoît-Joseph Labre. – Léon Aubineau, La vie admirable du bienheureux mendiant et pèlerin Benoît-Joseph Labre. – J. Mantenay, Saint Benoît Labre (Collection Les Saints). – (V. S. B. P., nos 95 et 791.)