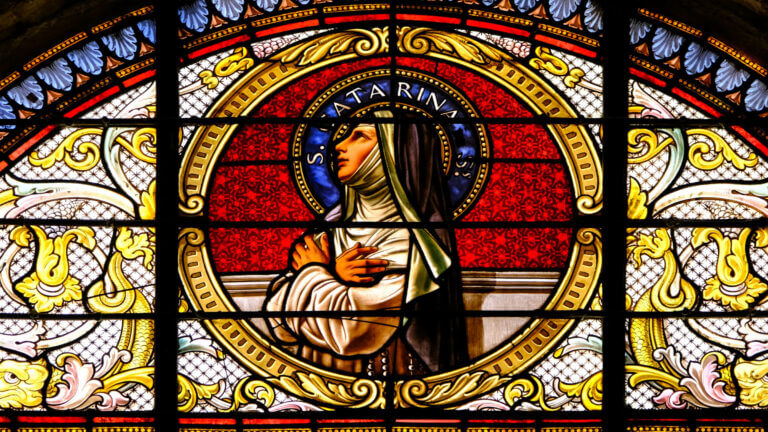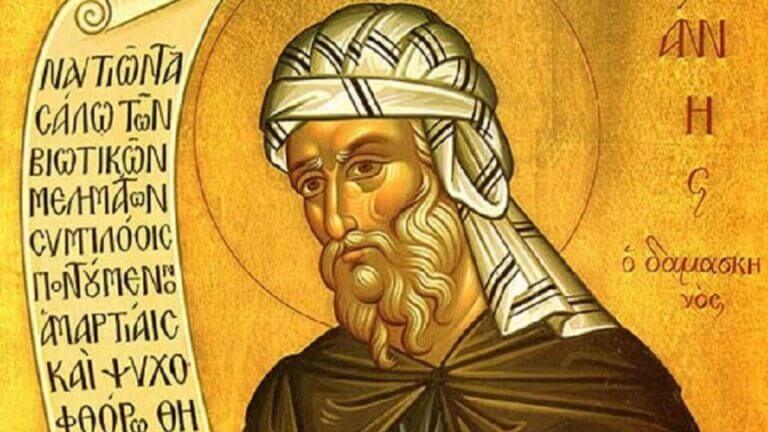Vierge et servante à Lucques (vers 1218–1272)
Fête le 27 avril.

L’Evangile ne prêche pas une égalité chimérique. Sainte Zita n’était qu’une humble servante et, cependant, on retrouve dans sa vie les mêmes traits que dans celle de sa contemporaine sainte Elisabeth, princesse de Hongrie et duchesse de Thuringe. Dans le vieil italien du XIIIème siècle, « Zita » signifie « vierge ». Nulle, plus que Zita, n’eut à souffrir de ces promiscuités douteuses, qui de tout temps, hélas ! ont été le fléau des grandes maisons où le personnel est nombreux ; et nulle, à ce titre, ne mérite mieux qu’elle de servir de modèle et de patronne à toutes les personnes en service qui veulent se bien tenir et rester honnêtes.
Enfance de sainte Zita.
Zita vint au monde en 1211 ou 1218, dans une petite chaumière située à Bozzanello, sur un des riants coteaux qui avoisinent Lucques. Du seuil de la maison, on apercevait la Brentina dont les eaux transparentes reflètent les cimes boisées du mont Catina, du Marendote et du Lapelia.
Que de fois le doux regard de la sainte enfant se sera arrêté sur ce spectacle et aura lu les splendeurs de Dieu dans le grand livre de la nature, le seul probablement qu’elle ait jamais connu. Car Zita, non plus que Jeanne d’Arc, ne sut jamais ni lire, ni écrire, et, suivant le mot d’un de nos vieux chroniqueurs, nul autre que Dieu et leur mère n’enseigna « leur créance » à ces saintes filles. Le père de Zita était connu sous le nom de Jean le Lombard ; sa mère s’appelait Bonissima : « la très bonne » ; les diminutifs et superlatifs italiens dont sont faits les prénoms féminins, sont toujours chantants et charmants. « Bonissima », était, en outre un nom d’une justesse parfaite. Cette femme était très bonne, et aussi très sainte. Un de ses frères, Gratien, vécut en ermite, sur le mont Lapelia, et sa mémoire est restée en vénération dans la contrée. Sa fille aînée, Marguerite, mourut dans un monastère de l’Ordre de Cîteaux.
Bonissima forma de bonne heure le jugement et le cœur de sa fille. Le premier mot qu’elle lui apprit fut le nom de Jésus, et le premier exercice celui de joindre ses petites mains et de lever ses yeux bleus vers le ciel, en disant : « Notre Père qui êtes aux cieux, aimez bien votre enfant. »
Elle lui apprenait aussi à rapporter ses actions et ses sentiments à la volonté de Dieu, ne craignant pas de lui parler déjà de l’immortalité de l’âme et de la fragilité de la vie.
Bonissima faisait mieux encore : elle donnait l’exemple. Pauvre, elle ne refusait jamais l’aumône, au moins celle d’un service.. Sa journée était un exemple vivant d’une vie chrétiennement remplie.
Zita l’aidait dans les soins du ménage, travaillait aux champs et s’acquittait à merveille de tous ses devoirs.
Quand, par suite de sa vivacité naturelle ou de la légèreté de son âge, elle allait se livrer à quelque action répréhensible, sa mère lui disait simplement : « Ma fille, ce que tu fais déplaît à Dieu. » Et aussitôt l’enfant y renonçait.
Sainte Zita quitte son village – Servante à Lucques.
Nous ne saurions préciser quel âge avait Zita, quand un jour son père lui dit :
– Dieu le veut, ma chère enfant, il faut nous séparer. Ta mère est infirme, nous avons besoin de ton travail ; compte sur le secours de Dieu. Il sera ton protecteur.
L’enfant obéit sans murmure. Ce sera d’ailleurs un des traits bien personnels de son caractère de ne jamais bouder à un ordre ni à une remontrance même injuste, et Dieu sait à quelles mortifications d’amour-propre silencieux est exposée à toute minute une pauvre servante, obligée, pour son pain, de dépendre à tout instant, de caprices souvent contradictoires, parfois tyranniques.
Lucques était alors une ville forte, très commerçante et capitale d’une petite république. L’existence de l’enfant, qui, jusqu’alors, n’avait connu que son village, allait être extérieurement bien changée.
Son maître, du nom de Pagano di Fatinelli, chez qui elle entra en 1231, était un riche commerçant ; il tenait un rang élevé dans la république et avait de nombreux domestiques ; les croix de Zita furent donc nombreuses aussi.
Fatinelli était bon, mais vif et emporté ; néanmoins, la patiente douceur de la petite servante ne se démentit jamais.
La volonté de son père et de sa mère avait toujours été pour elle l’expression de la volonté de Dieu. Elle obéit de même à son maître, ne montrant jamais la moindre humeur, la moindre hésitation, qu’elle fût seule ou sous la surveillance de quelqu’un. « La main au travail, le cœur à Dieu », telle était sa devise.
Elle servait ses maîtres, non par intérêt, mais par dévouement ; aussi lui abondonnaient-ils, sans contrôle, l’administration des choses les plus importantes. Pauvre elle-même, elle aimait les pauvres avec une tendresse de mère. Elle gagnait peu, mais ses modestes gages et les humbles étrennes qu’elle recevait, tout était pour eux. Volontiers, elle acceptait d’être marraine de leurs enfants ; et, pour modestes que fussent les responsabilités onéreuses auxquelles l’entraînait cette maternité spirituelle, elle y faisait toujours honneur en se restreignant sur sa nourriture.
La calomnie. – Sa sainteté manifestée par un miracle.
Les serviteurs de Fatinelli, peu consciencieux dans leur service, craignirent d’être dénoncés par Zita, et, ne pouvant en faire leur complice, ils la calomnièrent. Ses actions les plus louables furent dénaturées, et Dieu permit que ses maîtres ajoutassent foi au mensonge. L’amitié fit place aux soupçons ; au lieu d’encouragements, on ne lui adressait que des reproches. Cette épreuve dura plusieurs années, pendant lesquelles Zita, loin de se plaindre, bénit Dieu de lui avoir confié une parcelle de sa croix.
Un jour, Zita descendait l’escalier, emportant du pain dans son tablier. C’étaient des restes dont sa maîtresse lui avait permis de disposer et qu’elle voulait donner à de pauvres familles du voisinage. Fatinelli, l’ayant rencontrée, lui demanda avec humeur où elle allait et ce qu’elle emportait encore de chez ses maîtres. Zita abaissa son tablier et lui répondit en souriant :
– Ce sont des fleurs, mon bon maître, voyez plutôt.
Et, en effet, le tablier était rempli de roses blanches et rouges. Ce miracle des fleurs, Dieu se plaît encore à le refaire, dans des conditions presque identiques, à la même époque, pour honorer la charité d’Elisabeth de Hongrie, et, plus près de nous, pour honorer celle d’une petite paysanne, sainte Germaine Cousin, la bergère de Pibrac.
Mais les pauvres n’y perdirent rien ; car, poursuivant son chemin, Zita leur distribua son aumône : les fleurs étaient redevenues des pains.
Si l’humble fille était illettrée, elle comprenait que l’éducation est un véritable sacerdoce : quand sa tâche matérielle était accomplie, elle s’occupait encore des jeunes enfants de ses maîtres, cherchant surtout à leur inspirer trois amours et trois respects : celui de Dieu, celui des parents et celui de la vérité.
Dès longtemps, elle avait promis de rester vierge. Mais douce et soumise quand il s’agissait de ses devoirs de servante, elle savait tenir en respect, quand il le fallait, les entreprises audacieuses de ceux qui oubliaient leurs distances, et on la vit un jour déchirer de ses ongles le visage d’un homme trop peu réservé.
Cette vertu angélique de l’humble servante, la patience inaltérable qu’elle montrait en son labeur, elle les puisait dans la prière, la fréquentation des sacrements, les oraisons jaculatoires qui sortaient à tout instant de son cœur et de ses lèvres ; elle était assidue à fréquenter les églises dans la mesure où le lui permettaient ses occupations. On montre encore un Crucifix devant lequel elle s’agenouilla bien souvent et qui se trouvait alors dans une chapelle près du cimetière attenant à l’église Saint-Frédien.
Toutes les églises de Lucques l’ont vue prosternée, perdue dans de suaves colloques avec Notre-Seigneur ; elle goûtait aussi de grandes joies à visiter les sanctuaires et les lieux de pèlerinages qui avoisinaient la ville où elle était en service.
Apparition de la sainte Vierge et le Tiers Ordre franciscain.
Munie de la permission de ses maîtres, Zita partit avec une de ses compagnes pour le pèlerinage de Saint-Pierre-a-Grando. Elles étaient à jeun, et la route était longue et difficile. Le courage abandonna son amie ; Zita n’en continua pas moins son chemin.
Arrivée à Saint-Pierre, elle y communia avec sa ferveur accoutumée. puis elle repartit, refusant les divers abris qui lui furent offerts pour la nuit. Cependant, épuisée par le jeûne et la fatigue, elle sentit enfin ses forces défaillir, et, vers l’heure du chant du coq, disent les biographes, elle s’assit au bord d’une fontaine.
Elle puisait de l’eau et la portait à ses lèvres, quand elle sentit une main se poser doucement sur son épaule, et, en même temps, une voix harmonieuse s’éleva :
– Voulez-vous venir avec moi à Lucques ?
Loin d’être troublée, Zita se sentit divinement fortifiée. La faim, la soif, la lassitude, elle avait tout oublié, et elle se mit joyeusement en marche.
Il fallait traverser un fort appelé Pontetollo ; les portes en étaient fermées : à l’approche des deux voyageuses, elles s’ouvrirent d’elles-mêmes pour les laisser passer.
Zita, arrivée devant la demeure de Fatinelli, tendit la main à sa compagne inconnue et la pria de venir prendre un peu de repos, mais celle-ci avait disparu.
Une chapelle s’élève maintenant auprès de la fontaine où Marie immaculée daigna venir en aide à son humble servante.
On croit que vers cette époque Zita s’engagea dans le Tiers-Ordre de Saint-François. Du moins, elle ceignit ses reins de la corde qui en est l’un des insignes, et même elle la serra si étroitement qu’après sa mort on la trouva recouverte par les chairs.
Lucques mis en interdit ; attitude de sainte Zita.
La république de Lucques ayant déclaré la guerre au Saint-Siège, en se livrant à des violences contre les habitants de Lupia qui avaient embrassé le parti du Pape, Grégoire IX (1227–1241) prononça contre elle une sentence interdisant les cérémonies publiques du culte.
Plus d’ornements sur les autels, plus de chants sacrés, plus de cérémonies religieuses ; les prêtres priaient en silence, la désolation régnait dans tous les cœurs. Qu’elle ne fut pas celle de Zita et combien ses prières montèrent, ardentes, vers le ciel, pour obtenir la conversion de la cité !
Elle ne reculait devant aucune fatigue pour aller chercher les secours religieux dans les lieux où ne s’étendait pas l’interdit. Ni la terreur qu’inspiraient les hommes de guerre, ni l’âpreté des chemins, rien n’arrêtait son zèle.
La maison de Fatinelli était souvent un théâtre de luttes el d’intrigues, mais l’humble et douce Zita n’était nullement troublée dans son recueillement.
Les Anges font l’ouvrage de sainte Zita.
Fidèle à ses devoirs d’état, elle prenait sur son sommeil le temps de ses prières. Une fois cependant, absorbée devant Dieu, elle oublia qu’elle devait rentrer pour pétrir le pain. Quel ne fut pas son étonnement de trouver à son retour la farine pétrie et prête à être mise au four ! Elle courut remercier sa maîtresse et les autres servantes. Personne ne sut ce qu’elle voulait dire, et comme cette pâte répandait une délicieuse odeur de pain chaud, nul ne douta que Dieu lui-même, se plaisant dans la compagnie de sa servante, eût envoyé ses anges la remplacer dans les soins du ménage.
Récompense de l’amour pour les pauvres.
Zita, nous l’avons dit, aimait tendrement les pauvres. Elle se dépouillait de tout pour leur venir en aide, et, quand elle n’avait plus rien à leur donner, elle sollicitait pour eux.
Pendant une famine, elle obtint de ses maîtres la permission de puiser à leurs provisions. Elle distribua des aumône si abondantes que la maison de Fatinelli était devenue la pourvoyeuse de tout le pays. Cet homme avait mis en réserve, pour les mauvais jours, une provision de fèves assez considérable. Mais la compassion de Zita pour les pauvres dégénéra vite en largesses inconsidérées, et bientôt le fond des coffres de réserve apparut à nu. Il y avait là un cas de conscience assez épineux. Zita s’en émut. On lui avait permis d’être généreuse, mais non pas d’être prodigue. N’avait-elle pas dilapidé le bien d’autrui ?’ Elle en était là de ses réflexions, quand son maître vint lui demander la clé du coffre, déclarant qu’il avait vendu sa provision de fèves et se disposait à la livrer. Zita approche toute tremblante, mais qu’elles ne sont pas sa reconnaissance et sa joie, en voyant les coffres plus pleins qu’ils ne l’avaient jamais été !
La veille de Noël, pendant un hiver très rigoureux, la servante de Fatinelli se disposait à se rendre à Matines, vêtue aussi légèrement qu’en été. Son maître lui dit :
– Comment cours-tu à l’église par un temps si froid, épuisée comme tu l’es, et pour t’asseoir sur un pavé de marbre ? Prends du moins cette pelisse chaude ; mais ne la laisse pas au dos d’un autre : tu t’attirerais de violents reproches.
– Rassurez-vous, mon maître, dit Zita.
Faibles résolutions du cœur d’une Sainte ! Sur les marches de l’église, il y a un miséreux qui grelotte et claque des dents.
– De quoi vous plaignez-vous, mon frère ?
Mais lui se contente de la regarder, étend la main, touche la fourrure. Il n’a rien dit, mais il en a dit assez. Zita aussitôt donne le manteau, ou plutôt elle le prête, car il est bien entendu qu’à la fin de l’office on le lui restituera. La fin de l’office arriva, en effet, mais de mendiant, point de traces, pas plus que de manteau. Elle revint donc au logis résignée à recevoir un accueil d’une sévérité bien justifiée. Elle raconta comment les choses s’étaient passées ; le maître s’en doutait bien un peu, et il dut murmurer, pour la forme tout au moins. Et voici qu’à la troisième heure, apparaît tout à coup sur l’escalier de la maison un pauvre, d’une distinction et même d’une élégance peu commune. Dans ses bras, il porte un manteau, le rend à Zita, avec un divin sourire. Et comme Zita, au milieu de toute la maison assemblée, le remerciait, il disparut comme un éclair, laissant dans tous les cœurs une joie inconnue qui les ravit longtemps d’admiration.
Un autre jour, Zita était occupée à son travail, quand un pèlerin l’aborda. Il était épuisé de lassitude et implorait d’elle la charité d’un peu de vin. Zita n’en avait pas ; mais, remplie de foi, elle tira de l’eau du puits, la bénit et l’offrit au pèlerin qui assura n’avoir jamais bu d’un vin aussi excellent.
Mort de sainte Zita. – Miracles qui la suivirent.
Après un demi-siècle d’une vie si bien remplie, Zita n’était plus considérée par ses maîtres comme une servante, mais uniquement comme la servante de Dieu. Il la laissèrent libre de faire ce qu’elle voudrait, lui fournissant libéralement, comme à une de leurs filles, tout ce qu’elle voulait. Mais, pauvre d’origine et pauvre d’argent, elle voulut rester pauvre volontaire. Libre de ses mouvements, elle n’en servit pas moins humblement et affectueusement ses maîtres ; ni les infirmités ni l’âge ne purent diminuer la ferveur de sa soumission.
Ce fut le 27 avril 1272, un mercredi, jour consacré depuis à saint Joseph, le grand serviteur de Dieu, qu’elle s’éteignit, sans agonie, entourée d’humbles femmes qui priaient, simplement, comme elle avait vécu. Seulement, dit-on, une étoile brilla au-dessus de la ville de Lucques, à cette heure même, et d’une clarté que n’arrivait pas à éclipser la lumière du soleil, tandis que chacun allait, répétant : Zita, la Sainte, est morte.
Quelques jours après les funérailles, une liqueur semblable à du baume s’échappa du tombeau. On la recueillit et on l’appliqua sur des infirmes qui furent guéris. Un mort même fut ressuscité.
Parmi les favorisés de la servante de Dieu, on cite Pierre Fatinelli ; il appartenait à la famille chez laquelle la Sainte avait servi et on croit même qu’il avait été élevé par elle. Cet homme voyageait en Provence, lorsqu’il tomba malade ; condamné par tous les médecins, il invoqua sainte Zita, et la nuit suivante, une douce lumière s’étant répandue dans la chambre, il vit venir à lui une femme admirablement vêtue :
– Zita, pourquoi m’avez-vous abandonné ? lui dit-il. Je vais mourir loin des miens ; hâtez-vous de me secourir.
La Sainte le rassura et disparut le laissant absolument guéri.
Les miracles opérés auprès du saint tombeau devinrent si nombreux que la coutume s’établit, à chaque nouveau prodige, de sonner la cloche de l’église de Saint-Frédien.
Quelques libres penseurs de l’époque se moquèrent de celle qu’ils appelaient « la faiseuse de miracles ». L’un d’eux, le batelier Mandriano Torsello, voyant un jour un infirme qu’on portait auprès du tombeau de Zita, plaisanta en ces termes :
– Mettez-moi cet homme en terre ; il sera plus vite guéri.
Ces paroles étaient à peine prononcées que Torsello devint subitement muet ; on le vit entrer le lendemain matin à Saint-Frédien, et, à genoux devant le tombeau de la Sainte, répandre d’abondantes larmes de repentir ; puis, les pieds nus, la corde au cou, visiter successivement les principales églises de la ville. Revenu à Saint-Frédien, il obtint que la parole lui fût rendue.

Zita honorée comme Sainte. – Canonisation. – Son culte.
Les restes de Zita furent « levés de terre », ce qui était la forme de la canonisation de cette époque, par les soins de l’évêque de Lucques, Paganello, le 26 mai 1278 ; la fête de la Sainte, dont le corps avait été placé sur un autel, en la basilique de Saint-Frédien, fut fixée au 27 avril, et déclarée fête nationale par la république de Lucques, en 1308.
La république de Gênes rendit aussi des hommages spéciaux à l’humble servante ; une église fut élevée en son honneur, et une confrérie de Sainte-Zita subsista jusqu’à la Révolution. Le nom de la Sainte se répandit rapidement en Europe, et sous la forme de « Sythe » nous le voyons figurer dans le Bréviaire d’Aberdeen, en 1510. Son culte a été reconnu sous Innocent XII, le 9 septembre 1696, par une « canonisation équipollente » ; un office et une messe propres en son honneur ont été concédés en 1777.
A Lucques même, une Congrégation de religieuses porte le nom de cette vierge qui, sans connaître les joies et les immolations du cloître, parvint, dans son modeste état de vie, à une haute perfection.
Les reliques de la Sainte, d’abord déposées en la basilique de Saint-Frédien, furent placées, vers 1321, dans une chapelle contiguë à la même basilique. Elles ont été « reconnues » en 1446, 1581, 1662, 1821, 1841, et l’on a pu constater qu’elles étaient dans un état de conservation parfaite.
Sainte Zita est représentée portant une cruche, pour rappeler le miracle par lequel elle changea de l’eau en vin.
Les servantes et les femmes de charge l’invoquent comme leur modèle et leur protectrice spéciale. Elle leur a laissé plusieurs maximes dont celle-ci : « Une servante paresseuse ne doit pas être appelée pieuse ; une personne de notre condition qui affecte d’être pieuse sans être essentiellement laborieuse, n’a qu’une fausse piété. »
A. Poirson. Sources consultées. – Mgr André Saint-Clair, Vie de sainte Zita, patronne et modèle des personnes de service (Paris, 1919). – Germain des Bruyères, Petite vie de sainte Zita, vierge de Lucques au XIIIe siècle…, d’après l’opuscule du baron de Montreuil (Châtillon-près-Paris, 1927). – (V. S. B. P., n° 115.)