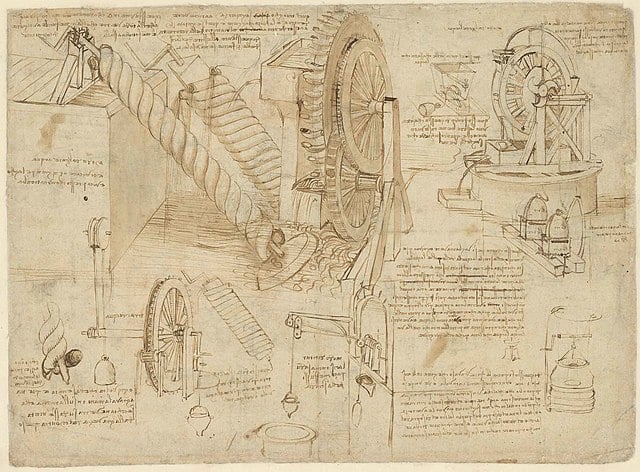Dans la pratique de la médecine, quelle place tient la liberté du patient ?
Au lendemain de la guerre, le pape Pie XII dit sa peine devant les expérimentations médicales pratiquées sur des êtres humains sans leur consentement :
« On trouve, dans les actes, des témoignages et des rapports qui montrent comment, avec l’assentiment et même parfois sur un ordre formel de l’autorité publique, certains centres de recherches exigeaient systématiquement qu’on leur fournît les hommes des camps de concentration pour leurs expériences médicales, et comment on les livrait à ces centres : tant d’hommes, tant de femmes, tant pour telle expérience, tant pour telle autre. Il existe des rapports sur le déroulement et le résultat des expériences, sur les symptômes objectifs et subjectifs observés chez les intéressés au cours des différentes phases de l’expérimentation. On ne peut lire ces notes sans être saisi d’une profonde compassion pour ces victimes, dont beaucoup sont allées à la mort, et sans être pris d’épouvante devant pareille aberration de l’esprit et du cœur[1]».
On pourrait croire que ce genre d’abus de pouvoir est l’apanage des régimes totalitaires. Il n’en est rien, car certaines démocraties ont elles aussi couvert, autorisé ou commandé des atteintes contre l’intégrité corporelle, la santé et la vie de citoyens innocents. Ainsi, entre 1932 et 1972, l’université de Tuskegee en Alabama a‑t-elle piloté une étude sur l’évolution de la syphilis sur plus de 600 afro-américains, pauvres et analphabètes, sans les en informer ni leur procurer les traitements alors disponibles. Quant aux campagnes de stérilisation forcée orchestrées en Suède (de 1925 à 1976), à la Réunion (années 1960), en Inde (depuis 1975 jusqu’à nos jours) et au Pérou (années 1990), elles sont un secret de Polichinelle.
Le consentement libre et éclairé
Ces dérives graves et répétées ont conduit les autorités judiciaires, médicales et politiques à promouvoir le respect du consentement libre et éclairé.
L’impulsion a été donnée par le tribunal de Nuremberg[2] qui, dans sa sentence du 19 août 1947, énonce dix critères —tirés de la jurisprudence pénale internationale— pour évaluer si une expérimentation médicale sur l’homme est acceptable. Ce texte, connu de nos jours comme le Code de Nuremberg, entend protéger le sujet d’expérience dans sa vulnérabilité en faisant de son consentement préalable une obligation avant toute expérimentation :
« Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela veut dire que la personne concernée doit avoir la capacité légale de consentir ; qu’elle doit être placée en situation d’exercer un libre pouvoir de choix, sans intervention de quelque élément de force, de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou d’autres formes sournoises de contrainte ou de coercition ; et qu’elle doit avoir une connaissance et une compréhension suffisantes de ce que cela implique, de façon à lui permettre de prendre une décision éclairée[3]… »
L’Association Médicale Mondiale a emboité le pas aux autorités judiciaires en mettant l’accent sur la subordination des finalités de l’expérimentation à celles de la médecine. Les premières normes ont été adoptées à Helsinki en 1964 :
« L’expérimentation sur un être humain ne peut être entreprise qu’avec le consentement libre et éclairé du sujet et, s’il est juridiquement incapable, celui de son représentant légal[4]. »
Le texte a été développé à Tokyo en 1975 :
« Lors de toute recherche sur l’homme, le sujet éventuel sera informé de manière adéquate des objectifs, méthodes, bénéfices escomptés ainsi que des risques potentiels de l’étude et des désagréments qui pourraient en résulter pour lui. Il (elle) devra également être informé(e) qu’il (elle) est libre de revenir sur son consentement à tout moment. Le médecin devra obtenir le consentement libre et éclairé du sujet, de préférence par écrit[5]. »
De nouvelles précisions ont été apportées à Édimbourg en 2000 :
« Lors de toute étude, la personne se prêtant à la recherche doit être informée de manière appropriée des objectifs, méthodes, financement, conflits d’intérêts éventuels, appartenance de l’investigateur à une ou des institutions, bénéfices attendus ainsi que des risques potentiels de l’étude et des contraintes qui pourraient en résulter pour elle. Le sujet doit être informé qu’il a la faculté de ne pas participer à l’étude et qu’il est libre de revenir à tout moment sur son consentement sans crainte de préjudice. Après s’être assuré de la bonne compréhension par le sujet de l’information donnée, le médecin doit obtenir son consentement libre et éclairé, de préférence par écrit. Lorsque le consentement ne peut être obtenu sous forme écrite, la procédure de recueil doit être formellement explicitée et reposer sur l’intervention de témoins[6]. »
La notion de consentement libre et éclairé, appliquée à l’ensemble de la pratique médicale et pas seulement à la recherche et à l’expérimentation médicale, a été introduite dans le droit français à la faveur de la loi Kouchner de 2002 :
« Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
« Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables.
« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.
« Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111–6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.
« Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables[7].»
Il est heureux que le principe du consentement libre et éclairé ait été intégré au droit français. Chaque personne est en effet responsable de son intégrité corporelle, de sa santé et de sa vie. La maîtrise effective qu’elle exerce sur ses décisions est la pierre angulaire de sa responsabilité juridique et morale[8].
La personne de confiance
Parfois le patient est dans l’incapacité de manifester son consentement libre et éclairé. D’un point de vue objectif, l’urgence vitale ne laisse pas toujours le loisir de requérir et de recevoir le consentement libre et éclairé du patient. D’un point de vue subjectif, les limites imposées par l’âge ou la maladie à l’exercice de l’intelligence et de la volonté restreignent voire obèrent la capacité du sujet à se décider.
Aussi la loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie offre-t-elle au patient la possibilité de désigner une personne de confiance chargée de parler à sa place en cas d’incapacité :
« Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Elle rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est révisable et révocable à tout moment.
« Si le patient le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions.
« Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, ou dans un hôpital des armées ou à l’Institution nationale des invalides, il est proposé au patient de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues au présent article. Cette désignation est valable pour la durée de l’hospitalisation, à moins que le patient n’en dispose autrement.
« Dans le cadre du suivi de son patient, le médecin traitant s’assure que celui-ci est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance et, le cas échéant, l’invite à procéder à une telle désignation.
« Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure protection juridique avec représentation relative à la personne, elle peut désigner une personne de confiance avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Dans l’hypothèse où la personne de confiance a été désignée antérieurement à la mesure de tutelle, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer[9]. »
La personne de confiance n’a pas pour vocation d’imposer sa vision des choses ou sa volonté à celui qui l’a choisie. Elle n’est que l’écho de celui qui est dans l’incapacité de s’informer et de manifester son vouloir. On peut appliquer sans restriction à la personne de confiance ce que Pie XII disait du médecin dans le rapport à son patient :
« L’homme n’est pas le propriétaire, le maître absolu de son corps, il en est seulement l’usufruitier. De là dérivent toute une série de principes et de normes qui règlent l’usage et le droit de disposer des organes et des membres du corps, et qui s’imposent également à l’intéressé et au médecin appelé à le conseiller[10]. »
« Le médecin n’a sur le patient que le pouvoir et les droits que celui-ci lui donne, soit explicitement, soit implicitement et tacitement. Le patient, de son côté, ne peut conférer plus de droits qu’il n’en possède. Le point décisif, dans ce débat, c’est la licéité morale du droit qu’a le patient de disposer de lui-même. Ici se dresse la frontière morale de l’action du médecin, qui agit avec le consentement de son patient[11]. »
Les directives anticipées
Outre la désignation d’une personne de confiance, la loi du 2 février 2016 prévoit également la possibilité de rédiger des directives anticipées :
« Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte médicaux.
« À tout moment et par tout moyen, elles sont révisables et révocables. Elles peuvent être rédigées conformément à un modèle dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé. Ce modèle prévoit la situation de la personne selon qu’elle se sait ou non atteinte d’une affection grave au moment où elle les rédige.
« Les directives anticipées s’imposent au médecin pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement, sauf en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale.
« La décision de refus d’application des directives anticipées, jugées par le médecin manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient, est prise à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire et est inscrite au dossier médical. Elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les conditions d’information des patients et les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. Les directives anticipées sont notamment conservées sur un registre national faisant l’objet d’un traitement automatisé dans le respect de la loi n° 78–17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Lorsqu’elles sont conservées dans ce registre, un rappel de leur existence est régulièrement adressé à leur auteur.
« Le médecin traitant informe ses patients de la possibilité et des conditions de rédaction de directives anticipées.
« Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, elle peut rédiger des directives anticipées avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. La personne chargée de la mesure de protection ne peut ni l’assister ni la représenter à cette occasion[12]. »
La rédaction des directives anticipées n’est pas une procédure inédite dans le droit français puisque la loi de bioéthique du 29 juillet 1994 instaurait déjà un Registre National des Refus (RNR) pour les personnes opposées au don d’organe. Une lecture attentive du formulaire d’inscription au RNR[13] permet d’ailleurs d’identifier les inconvénients qu’il a en commun avec les directives anticipées.
Le refus peut porter sur trois types de prélèvements distingués par leur finalité (greffe d’organes et/ou de tissus, recherche scientifique, autopsie extrajudiciaire). S’agissant du don d’organe en vue d’une greffe, aucune possibilité n’est offerte à celui qui s’inscrit au RNR de limiter ou de préciser l’objet de son refus. La seule alternative proposée est d’accepter (ou de refuser) tous les types de dons d’organe et/ou de tissu. Or, par exemple, le don de cornée ne pose pas du tout les mêmes problèmes moraux que le don de cœur. Le formulaire dans sa configuration actuelle ne permet donc pas la manifestation nuancée et précise du consentement (ou du refus).
Si le mal doit être évité toujours et partout, le bien doit être pratiqué avec discernement[14]). Celui-ci suppose l’exercice de la prudence, à qui il revient de déterminer le juste milieu vertueux[15]) pour chaque acte humain concret[16]). Or, les circonstances précises d’une décision sont rarement prévisibles longtemps à l’avance. D’où la difficulté —voire l’impossibilité— de rédiger des directives anticipées en matière de santé. Par contre, la personne de confiance est à même d’évaluer la situation dans sa singularité et sa complexité avant d’appliquer les principes généraux de la moralité au cas concret.
Liberté chérie
Le Code de Nuremberg énonce le principe du consentement libre et éclairé dès son article premier. Le pape Pie XII ne pouvait que s’en féliciter :
« Ni pendant la paix, ni pendant la guerre, et même beaucoup moins encore alors, les blessés, les prisonniers de guerre, les travailleurs forcés, les déportés des camps de concentration, ne constituent des objets d’expérimentation médicale, dont on puisse disposer librement ou avec l’approbation de l’autorité[17]. »
Mais, ce document fondateur stipule également qu’« aucune expérience ne doit être conduite lorsqu’il y a une raison a priori de croire que la mort ou des blessures invalidantes surviendront ; sauf, peut-être, dans ces expériences où les médecins expérimentateurs servent aussi de sujets[18]». Cette dernière incise a suscité la perplexité du Pasteur Angélique. Il ne suffit pas, en effet, de réaliser librement une expérimentation sur soi-même pour qu’elle soit licite. Du point de vue moral, la liberté de l’agir est une condition nécessaire mais pas suffisante :
« Ce qui vaut du médecin à l’égard du patient vaut aussi du médecin envers lui-même. Il est soumis aux mêmes grands principes moraux et juridiques. Aussi ne peut-il pas non plus se prendre lui-même comme objet d’expériences scientifiques ou pratiques, qui entraînent un dommage sérieux ou menacent sa santé ; encore moins est-il autorisé à tenter une intervention expérimentale qui, d’après un avis autorisé, puisse entraîner mutilation ou suicide. En outre, il faut en dire autant des infirmiers et infirmières et de quiconque est disposé à se prêter à des recherches thérapeutiques. Ils ne peuvent pas se livrer à de telles expériences[19]. »
Le pontife avait deviné les dérives à venir d’une liberté devenue à elle-même sa propre fin. Au fondement de la morale, il y a désormais « le sujet libre donateur de sens[20] ». Le libre développement de la personnalité est devenu la notion fondatrice de plusieurs constitutions politiques contemporaine[21]. En conséquence, « tout acte accompli sur soi-même est bon dès lors qu’il est voulu librement[22] ». De condition sine qua non, la liberté s’est muée au fil du temps en raison d’être. L’Alpha de la vie morale a fini par devenir son Oméga.
- Pie XII, Discours au 1er congrès international d’histopathologie du système nerveux, 14 septembre 1952.[↩]
- A la différence des dignitaires nazis jugés à Nuremberg par un Tribunal militaire international (14 novembre 1945–1er octobre 1946), les médecins nazis ont été déférés dans la même ville devant un Tribunal militaire américain (21 novembre 1946–19 août 1947).[↩]
- Code de Nuremberg, août 1947, art. 1.[↩]
- Association Médicale Mondiale, Déclaration d’Helsinki, juin 1964, art. III-3a.[↩]
- Association Médicale Mondiale, Déclaration d’Helsinki [révisée à Tokyo en octobre 1975], art. I‑9.[↩]
- Association Médicale Mondiale, Déclaration d’Helsinki [révisée à Édimbourg en octobre 2000], art. B‑22.[↩]
- Loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, 4 mars 2002, art. 11.[↩]
- Cf. saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, I‑II, q. 21.[↩]
- Code de la santé publique, Art. L1111‑6 (version en vigueur depuis le 1er octobre 2020).[↩]
- Pie XII, Discours à l’Union médico-biologique Saint-Luc, 12 novembre 1944.[↩]
- Pie XII, Discours au 1er congrès international d’histopathologie du système nerveux, 14 septembre 1952.[↩]
- Code de la santé publique, Art. L1111-11 , version en vigueur depuis le 1er octobre 2020.[↩]
- Cf. https://www.registrenationaldesrefus.fr[↩]
- « Les actes des vertus ne doivent pas être faits n’importe comment, mais en observant toutes les circonstances requises pour que l’acte soit vraiment vertueux : qu’il soit fait où il faut, quand il faut, et comme il faut. » » (Saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, II-II, q. 33, a. 2, c[↩]
- « Il revient à la prudence de déterminer comment et par quelles voies l’homme qui agit peut atteindre le milieu raisonnable. » (Saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, II-II, q. 47, a. 7, c[↩]
- « Il est nécessaire que le prudent connaisse et les principes universels de la raison et les singuliers, objets des opérations. » (Ibid., a. 3, c[↩]
- Pie XII, Discours au 16e congrès de médecine militaire, 19 octobre 1953.[↩]
- Code de Nuremberg, août 1947, art. 5.[↩]
- Pie XII, Discours à la 8e assemblée de l’Association Médicale Mondiale, 30 septembre 1954.[↩]
- Cf. Thierry-Marie Hamonic op, « Le thomisme et le débat sur les fondements de la morale », Thomistes ou l’actualité de saint Thomas d’Aquin, Parole et Silence, Paris, 2003, p. 165.[↩]
- Cf. Alejandro Ordoñez Maldonado, « Personnalisme, libre développement de la personnalité et dissolution du bien commun » dans Miguel Ayuso (dir.), Le bien commun. Questions actuelles et implications politico-juridiques, Editions Hora Decima, Paris, 2021, p. 97.[↩]
- Gregor Puppinck, Les droits de l’homme dénaturé, Paris, Cerf, 2018, p. 87.[↩]