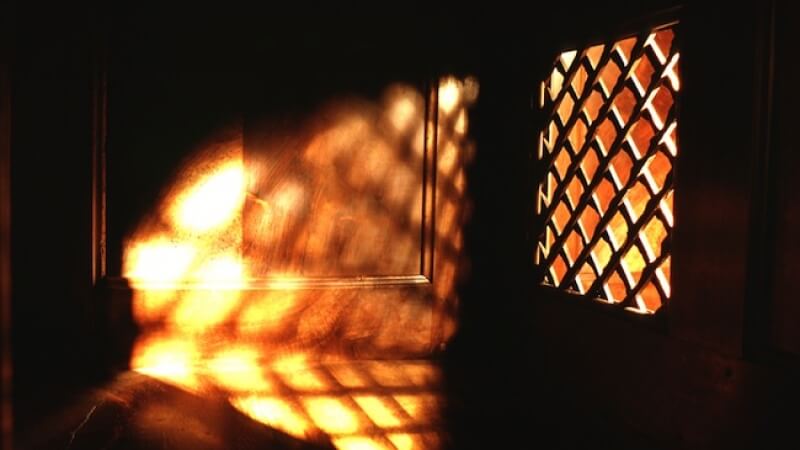La discipline de l’Église au sujet de ce que le prêtre apprend en confession a évolué depuis le Moyen-Age jusqu’au 20e siècle dans le sens d’une sévérité de plus en plus rigoureuse.
Il est clair que le confesseur n’a jamais le droit de trahir le pénitent. Même sous la menace de mort, le prêtre doit garder le silence le plus absolu sur les péchés dont il a entendu l’accusation en confession. Cette loi du secret vaut même si le pénitent est mort, même si le péché accusé n’est que véniel, même si le confesseur n’a pas donné l’absolution, même si la loi civile fait une obligation au prêtre de dénoncer tel type de criminel. N’en déplaise à certains, cette obligation du secret n’admet aucune exception, comme l’Église l’a toujours rappelé au cours de son histoire.
Dans cette obligation est incluse celle de veiller à ne pas trahir indirectement le pénitent. Le prêtre n’a pas le droit, par ses paroles ou ses signes, d’éveiller le moindre soupçon sur le péchés qu’il a entendus. Par exemple, après avoir entendu un adolescent en confession, le prêtre n’aurait pas le droit de dire à ses parents : « Surveillez bien les fréquentations de votre fils ! ». Nous ne reviendrons pas sur ce sujet qui a déjà été abordé dans le Courrier de Rome de janvier 2021.
Mais qu’en est-il de la science acquise au confessionnal, sans lien direct avec les péchés accusés ? Le prêtre a‑t-il le droit d’utiliser les connaissances reçues en confession, lorsque leur usage ne révèle ni le péché ni le pécheur ?
Par exemple, un pénitent s’est souvent accusé à son curé de péchés de vol. Le curé a‑t-il le droit de prendre en compte cette information quand il devrachoisirleresponsabledelaquête ou de la comptabilité de la paroisse ? Et pourrait-il lui retirer sa charge, s’il sait par le confessionnal que ce paroissien s’en acquitte indignement ? A‑t-il le droit de modifier le mot de passe du coffre-fort, s’il apprend au confessionnal que sa servante est malhonnête ?
A toutes ces questions, il faut répondre que si le comportement du confesseur risque d’éveiller chez les autres des soupçons même légers à l’égard du pénitent, alors c’est formellement interdit. Mais qu’en est-il si tout risque deviolationdusecretmêmeindirecteest totalement et certainement inexistant ? En d’autres termes, l’usage de la science du confessionnal est-il licite s’il n’y a aucun péril de révélation des péchés ? Cette question a reçu des réponses contradictoires au cours du temps.
La réponse étonnante du Docteur angélique
Au 13e siècle, saint Thomas d’Aquin se pose la question suivante : un supérieur religieux doit-il retirer sa charge à l’un de ses sujets s’il apprend par la confession que ce sujet en est indigne ?[1]
Nous nous situons dans la perspective d’un supérieur prêtre qui confesse ses religieux, ce qui n’est pas autorisé habituellement aujourd’hui, mais qui l’était au Moyen-Age. Le docteur angélique répond à cette question en distinguant. Si le retrait de cette charge risque d’éveiller des soupçons à l’égard du religieux, alors le supérieur pècherait gravement en agissant ainsi, parce que ce serait trahir le secret de confession. Par exemple, si le religieux avait reçu cette charge pour un temps déterminé, l’en priver soudainement avant la fin de son mandat étonnerait les membres de la communauté et laisserait entendre qu’il a commis une faute.
En revanche, si le supérieur peut démettre son sujet de sa charge sans éveiller le moindre soupçon, alors il peut le démettre, mais il doit le faire avec les précautions requises. Par exemple, si l’usage dans ce monastère veut que le père abbé modifie facilement la répartition des charges à son gré, n’importe quand, sans règle fixe, alors le père abbé ferait bien d’éloigner son sujet d’une fonction dont il s’acquitte mal et qui constitue pour lui une occasion de péché. Le supérieur pourrait aussi inviter vivement son sujet à présenter sa démission.
Saint Thomas envisage aussi le cas du prêtre qui entend un dangereux hérétique en confession. Ce pénitent corrompt la communauté par ses erreurs pernicieuses et, malgré les conseils et les exhortations pressantes du confesseur, refuse de se repentir et de changer de comportement. Bien sûr, il n’est pas en mesure de recevoir l’absolution. Le prêtre peut-il mettre en garde le reste de la communauté, ou au moins le supérieur ? Oui, répond saint Thomas, à condition que cet avertissement ne trahisse aucunement l’hérétique. Le confesseur pourra dire par exemple au prieur : « Veillez avec soin sur votre troupeau ! » et aux religieux : « Attention à ne pas tomber dans l’hérésie ! »[2].
Cette opinion étonnante de saint Thomas n’est pas totalement isolée. Les théologiens de cette époque étaient partagés sur la question. L’absence de doctrine claire en la matière a entrainé quelques abus. Par exemple, chez les jésuites espagnols, des supérieurs religieux ont abusé de leur pouvoir en obligeant leurs sujet à se confesser à eux, afin de se servir ensuite des connaissances ainsi acquises pour le gouvernement extérieur de leur couvent. Ce comportement a provoqué des mécontentements légitimes chez certains religieux, qui se sont plaints au pape Sixte V en l’an 1590. Comme l’expliquent les mécontents au souverain pontife, l’attitude des supérieurs provoque chez les religieux des confessions sacrilèges, puisque certains pénitents, craignant les conséquences de leur accusation, mutilent leur confession. Les plaignants ajoutent avec raison que le sacrement de pénitence est rendu odieux.
Le général de la Compagnie de Jésus, le Père Claude Aquaviva, réagit avec prudence et fermeté. En 1590, il adresse une instruction à tous les jésuites pour interdire aux supérieurs de se servir hors du confessionnal de ce qu’ils ont appris en confession. Cette interdiction vaut même si cet usage de la science du confessionnal n’entraîne pas le moindre soupçon de violation du secret sacramentel.
Cette instruction a un grand retentissement. Cependant, elle n’est adressée qu’aux jésuites. Il manque une directive venant de Rome et concernant l’Église universelle.
Le Saint-Siège intervient
Le 26 mai 1593, le pape Clément VIII rédige un décret à l’adresse de tous les supérieurs d’ordre religieux : « Aussi bien les supérieurs en exercice que les confesseurs, qui plus tard seront promus au rang de supérieurs, se garderont avec le plus grand soin de faire usage, en vue du gouvernement extérieur, de la connaissance qu’ils ont pu avoir, dans la confession, du péché d’autres personnes. Et nous ordonnons donc que cela soit observé par tous les supérieurs de réguliers, quels qu’ils soient »[3].
On pourrait penser que la question est ainsi définitivement résolue et que le débat est tranché. Pourtant, il n’en est rien, parce que le pape ne s’est adressé qu’aux supérieurs religieux. D’où une nouvelle controverse après la publication du décret de Clément VIII : l’interdiction d’user de la science du confessionnal, sans péril de révélation, concerne-t-elle aussi les confesseurs séculiers, c’est-à-dire les prêtres diocésains ?
Il faudra attendre le 18 novembre 1682 pour que l’Église mette fin aux discussions des théologiens sur ce point. Un décret du S. Office, s’adressant à tous les prêtres et pas seulement aux religieux, prohibe tout usage d’où résulterait quelque ennui pour le pénitent. Cette interdiction vaut « quand bien même il n’y aurait aucune révélation proprement dite, directe ou indirecte ; quand bien même on ferait éviter par là au pénitent un inconvénient plus grave encore que celui causé par cette façon d’agir »[4].
Cette doctrine claire sera reprise dans le Code de droit canonique de 1917 au canon 890 : « Est absolument interdit au confesseur tout usage de la science acquise en confession au détriment du pénitent, même si tout péril de révélation est exclu. Les supérieurs en fonction aussi bien que les confesseurs qui deviennent ensuite supérieurs ne peuvent employer en aucune façon pour le gouvernement extérieur la connaissance des péchés qu’ils ont eue par la confession ». Le Code de 1983 dit la même chose au canon 984.
Comme conséquence pratique, les papes interdisent un usage répandu au Moyen-Age, selon lequel les supérieurs pouvaient confesser habituellement leurs sujets. En 1899, le pape Léon XIII défend sévèrement à tout supérieur de communauté religieuse, de séminaire ou de collège romain, d’entendre les confessions de ses inférieurs habitant la même maison, sauf cas de nécessité. L’interdiction sera reprise dans le Code de 1917 aux canons 518 et 530 et étendue à tous les établissements d’enseignement, lorsque les élèves sont pensionnaires.
L’Église a donc précisé sa discipline au cours du temps, pour arriver à une règle très stricte qui protège la sainteté du sacrement de pénitence et rejette tout ce qui pourrait éloigner les fidèles de la confession. En résumé, l’usage de la science du confessionnal sans aucun risque de violation du secret n’est autorisé que s’il ne cause aucun désagrément ni préjudice au pénitent actuel ou potentiel. Le confesseur a donc le droit, par exemple, de se servir de ce qu’il a appris en confession pour mieux réviser son cours de théologie morale, ou pour prier avec plus d’ardeur pour ses fidèles, ou pour donner des conseils plus judicieux à ses pénitents.
La difficulté est donc résolue. Néanmoins, nombreuses sont les problématiques touchant au secret de confession. Sur un autre point, l’Église va être à nouveau amenée à faire preuve de sévérité, pour le bien des âmes.
Une nouvelle question
Il s’agit de savoir si le confesseur a le droit de révéler ce qu’il a entendu en confession, mais qui ne touche pas les péchés accusés, et donc n’entre pas dans l’objet du secret de confession. Peut-il, par exemple, révéler que son pénitent est très vertueux, ou qu’il n’a jamais commis tel péché, ou qu’il a reçu des grâces mystiques extraordinaires, ou qu’il est allé en vacances en tel lieu ?
Dans certains contextes, il est clair que de telles affirmations risqueraient de dévoiler les péchés d’autres pénitents. Par exemple, si le confesseur, après avoir entendu trois confessions, loue la vertu de l’un de ses pénitents, mais garde le silence sur les deux autres fidèles qui se sont confessés à lui, il viole indirectement le secret de confession.
Supposons donc que le prêtre révèle la vertu de l’un de ses pénitents dans un contexte tel qu’aucune violation indirecte n’est commise. Qu’en penser ?
Si le pénitent est encore vivant, il s’agit souvent d’une violation du secret naturel. En effet, il sera désagréable au pénitent vertueux d’apprendre que son confesseur le loue à partir de ce qui a été dit en confession. Le prêtre est donc tenu à la discrétion, non en vertu de l’obligation du secret de confession, mais en vertu d’un devoir élémentaire de réserve sur la vie intime des gens.
Si en revanche le pénitent est mort, le devoir de discrétion est moins impérieux parce qu’une telle révélation n’est aucunement désagréable au défunt ni à sa famille. C’est pourquoi plusieurs confesseurs, après la mort de leur saint pénitent, n’ont pas craint de révéler la vertu qu’ils avaient connue dans le confessionnal. On lit par exemple dans une biographie de sainte Thérèse d’Avila : « Ses confesseurs assurent qu’elle n’a pas commis dans toute sa vie un seul péché mortel. » De même dans une vie de saint François d’Assise : « Mais tout mondain qu’il était en ce temps-là, il conserva néanmoins toujours inviolablement la chasteté. Ses confesseurs ont témoigné qu’il ne se laissa jamais emporter par une pensée à un désir déshonnête ».
Dans le procès de canonisation de saint Jean Berchmans, son confesseur a été admis à témoigner. De même dans la cause de saint Louis de Gonzague, saint Louis roi de France, sainte Marguerite de Cortone, etc. Le Bx Raymond de Capoue écrit dans sa biographie de sainte Catherine de Sienne : « Ainsi qu’elle l’a avoué humblement dans le secret de la confession à mon indignité, Catherine, en ce temps-là, apprit et connut sans leçons, sans maître humain, sous le seul influx de l’Esprit Saint, la vie et les mœurs des Pères du désert ».
Le pape Benoît XIV, dans son célèbre ouvrage sur les béatifications, écrit : « On ne rejette pas les attestations des confesseurs, mais on ne les demande jamais. Encore moins souffre-t-on qu’ils violent le sceau sacré du sacrement de pénitence en révélant les fautes ou les péchés qu’ils ont connus. On leur permet seulement de découvrir, s’ils le veulent, selon leur conscience, des vertus particulières, des grâces extraordinaires, et une intégrité merveilleuse qu’ils auraient trouvées dans leurs pénitents »[5].
Le S. Siège permettait donc de telles révélations.
Cependant, au début du 20e siècle, les autorités de l’Église ont estimé que cet usage pouvait être dangereux en éloignant les fidèles de la confession. Voici un extrait d’une instruction publiée par le S. Office le 9 juin 1915 : « Il arrive que des ministres de ce sacrement salutaire, tout en cachant ce qui pourrait de quelque manière que ce soit trahir le pénitent, se permettent, soit dans des conversations privées soit dans des discours publics au peuple, de parler de choses qui ont été soumises au pouvoir des clés dans la confession, sous prétexte d’édifier les auditeurs. Mais comme, dans une affaire d’une telle gravité, il faut éviter avec le plus grand soin non seulement l’injure poussée à son terme, mais aussi toute espèce et tout soupçon d’injure, il est clair pour tous qu’un tel comportement doit être condamné. En effet, même si le secret sacramentel est substantiellement gardé, ce comportement offense les oreilles pies et suscite de la méfiance dans les âmes. Or cela est assurément étranger à la nature de ce sacrement par lequel le Dieu très clément, par un don de sa très miséricordieuse bonté, efface entièrement et oublie totalement les péchés que nous avons commis par la fragilité humaine »[6].
Bien plus, depuis la promulgation du Code de 1917, les confesseurs ne sont plus autorisés à témoigner lors d’un procès de béatification ou de canonisation de l’un de leur pénitent, même s’ils ont été déliés du lien du secret du vivant du pénitent (canon 2027 §2). Le Code précise au canon 1757 §3 : « Les prêtres sont incapables de porter témoignage lors d’un procès ecclésiastique pour toutes les choses qu’ils ont apprises par la confession sacramentelle, même s’ils ont été relevés du secret. Bien plus, les choses qu’ils ont entendues à l’occasion de la confession ne peuvent pas être reçues comme un indice de vérité ».
Bilan
Il faut donc constater que, depuis le début du 20e siècle, le confesseur n’est pas autorisé à révéler ce qu’il a entendu dans le confessionnal, même si cela ne concerne aucunement les péchés du pénitent. S’il le prêtre le faisait, il ne violerait pas au sens strict le secret de confession, mais il risquerait de causer un malaise chez les fidèles et ainsi de les éloigner du sacrement.
La discipline de l’Église au sujet de ce que le prêtre apprend en confession a donc évolué depuis le Moyen-Age jusqu’au 20e siècle dans le sens d’une sévérité de plus en plus rigoureuse. Le but est aisé à comprendre : plus le secret est vaste et absolu, plus les pécheurs s’approcheront de ce sacrement avec confiance et sérénité. Au contraire, la moindre faille dans l’obligation du secret risque d’éloigner à tout jamais les âmes de ce précieux moyen de salut.
Source : Courrier de Rome n°649