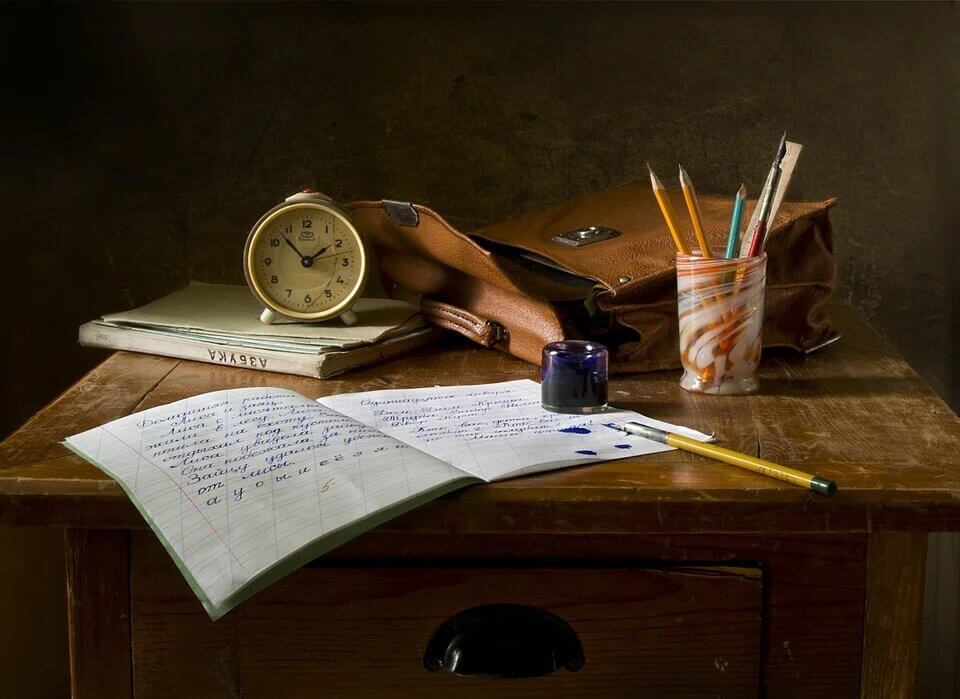Cette victoire retentissante a manifesté la puissance du Rosaire.
En 1571, une menace redoutable planait sur l’Europe catholique. Les Turcs, qui étaient musulmans, profitant de la déchirure due à la rébellion de Luther, s’avançaient peu à peu, répandant la terreur et le sang dans les îles de la Méditerranée [1], jusqu’à menacer insolemment l’Italie et les États pontificaux. Il ne fallait pas tarder à réagir et unir en une Ligue ce qui restait de chrétienté. Saint Pie V appela tous les princes à la défense de la foi, mais en vain, ou presque. Bien peu répondirent généreusement à son appel (la France était alors alliée des Turcs…) et ce fut un jeune homme de vingt-quatre ans, don Juan d’Autriche, que le pape désigna comme général de la sainte Ligue composée d’Espagnols, de Vénitiens, de Génois, de Maltais…
Cette population cosmopolite faillit plus d’une fois mener à l’échec le projet du pape. On peut croire que c’est malgré les hommes que Dieu voulait sauver la chrétienté ! Aussi saint Pie V en appela à une armée plus forte encore : il demanda que l’on récitât le rosaire pour le succès de cette entreprise et que chaque soldat fût muni d’un chapelet. Passons sur une erreur de don Juan qui aurait pu coûter cher à la Ligue : un mois avant le combat, il divisa pour un temps sa flotte, ignorant que les Turcs avaient choisi ce moment pour l’espionner, ce qui les amena à sous-estimer ses forces réelles : que se serait-il passé s’ils l’avaient attaqué à ce moment-là ? Mais le plus dangereux pour les armées catholiques fut, comme nous venons de le dire, la division qui régnait entre ces marins plus ou moins expérimentés, mais tous hommes belliqueux… Le vieux vénitien Veniero avait par exemple du mal à se soumettre au très jeune don Juan et on faillit assister, deux semaines avant le combat, à une bataille navale… entre catholiques ! Il fallut la diplomatie du général de la flotte pontificale, Marcantonio Colonna, pour maintenir entre les chefs une union suffisante qui permit à la sainte Ligue de se présenter à l’entrée du golfe de Lépante, au matin du 7 octobre.
Qu’on imagine ce que fut, aux dires des historiens, la plus grande bataille navale de la Méditerranée : les galères musulmanes et chrétiennes se faisant face sur un front de trois voire quatre kilomètres ! Là encore la bataille faillit tourner à la défaite des catholiques, puisque la situation géographique était largement favorable aux Turcs. Cependant, leur chef Ali Pacha, tellement persuadé de sa victoire prochaine, commit des imprudences en quittant sa forteresse et offrit ainsi aux catholiques un terrain égal pour le combat. Cela suffit-il à assurer la victoire à la sainte Ligue ? Non, car l’aile droite commandée par Doria s’écarta pour opérer une diversion, se mettant ainsi en péril avec le reste de l’armée. Mais enfin, au soir de ce dimanche 7 octobre, les Turcs étaient en déroute, laissant sur place 40 000 morts et 8 000 prisonniers. Les catholiques, quant à eux, n’eurent à déplorer que 8 000 morts et presque autant de blessés.
À l’issue de la bataille, Pie V bénéficia, à Rome, d’une apparition lui annonçant la victoire des armées catholiques. Notre-Dame récompensait ainsi son fils dévot qui avait trouvé le secret de sauver encore une fois la chrétienté : à sa demande, les catholiques avaient récité le rosaire. Ce fut l’origine de la fête de Notre-Dame-du-Rosaire.
La révélation faite au pape
Le 7 octobre, la Confrérie du rosaire faisait des processions dans le monde entier et obtint par ses prières le triomphe des chrétiens. Pie V connut miraculeusement leur succès. Il donnait audience au Vatican ; tout à coup il ouvre la fenêtre, se tourne du côté de la mer, reste immobile comme ravi devant un grand spectacle, et dit ensuite : « Agenouillons-nous et remercions Dieu, les chrétiens sont victorieux. »
Le récit de la bataille de Lépante
Les deux armées s’aperçurent le 7 octobre 1571 au point du jour ; elles étaient à peu près d’égale force. (…) Les confédérés arrivaient en longeant, du nord au sud, la côte d’Albanie, ils défilaient entre les écueils et la terre (…]. Le corps de bataille avait à peine dépassé les écueils, qu’on découvrit la flotte turque rangée parallèlement à la côte de Morée, à dix ou douze milles de distance. (…) Don Juan fit hisser sur sa galère les pavillons de tous les princes de la ligue ; c’était le signal du combat, toute l’armée y répondit par des cris de victoire.
À mesure que les galères sortaient du défilé, elles venaient prendre leur place de bataille, ne laissant entre elles qu’un intervalle où un vaisseau aurait pu passer. Cette ligne avait près de quatre mille de longueur. (…) La droite, sous les ordres de Jean-André Doria, était au large du côté de Céphalonie ; la gauche, que commandait le provéditeur Barbarigo, rasait la côte de Grèce. Au milieu étaient les trois commandants en chef, entourés du prince de Parme amiral de Savoie, du duc d’Urbin amiral de Gênes, de l’amiral de Naples et du commandeur de Castille. Les six galéasses vénitiennes ouvraient le centre. Le provéditeur Quirini, la capitane de Sicile, et les galères de Malte voltigeaient sur les ailes.
Quand les Turcs aperçurent l’armée alliée qui débouchait du défilé, ils ne purent juger de sa force, parce qu’elle marchait en colonne, et lorsqu’ils virent la première division, qui était celle de Doria, s’éloigner vers la droite, tout de suite après avoir doublé les îles Échinades, ce qu’il faisait pour laisser au reste de l’armée l’espace nécessaire pour se déployer, ils jugèrent que son intention était d’éviter le combat, et de reprendre sa direction vers le nord. Aussitôt ils s’avancèrent pour atteindre les alliés, avant qu’ils eussent tous passé le détroit ; en arrivant, ils les trouvèrent rangés en bataille.
Les six galéasses qui marchaient en avant de la ligne commencèrent le feu ; leur artillerie, très supérieure à celle des galères, faisait beaucoup de ravages parmi les Turcs : ils sentirent que, pour attaquer ces gros bâtiments, il faudrait se réunir plusieurs contre un, par conséquent rompre leur ligne et que, pendant ce premier combat, les galères des confédérés arriveraient sur eux ; ils se décidèrent donc à passer entre les galéasses pour aller droit aux galères ennemies. Ce mouvement ne put s’opérer sans quelque désordre ; leur aile droite, qui suivait la côte, fut la première à atteindre les alliés, elle les dépassa même, pour tourner leur aile gauche. Pendant cette évolution, le capitan pacha arrivait sur le centre, et venait droit à la galère de don Juan. Celle de l’amiral Vénier et la capitane du pape accoururent au secours du généralissime. Le combat devint général, et sur toute la ligne cinq cents vaisseaux s’entrechoquèrent. La capitane du pacha, entourée d’ennemis, leur résistait depuis deux heures ; plus d’une fois, on en avait tenté l’abordage, plus d’une fois les alliés avaient occupé la moitié du pont, toujours ils en avaient été repoussés. Sept galères turques vinrent au secours de leur amiral, les alliés furent pressés à leur tour ; mais l’arrière-garde que commandait le marquis de Sainte-Croix s’avança ; deux capitaines vénitiens, Loredan et Malipier, se jetèrent au milieu des ennemis, coulèrent bas une de leurs galères, attirèrent sur eux l’effort de plusieurs, et moururent tous les deux avec la gloire d’avoir sauvé leur général, rétabli le combat, et facilité la prise de la capitane turque. L’amiral ottoman venait d’être tué, les soldats espagnols sautèrent encore une fois à l’abordage, s’emparèrent de la galère, arrachèrent le pavillon turc, et élevèrent à sa place l’étendard de la croix qu’ils surmontèrent de la tête du capitan pacha : plusieurs autres vaisseaux ennemis, qui combattaient au centre, eurent le même sort ; leurs commandants se jetèrent dans des chaloupes pour sauver leur liberté. Trente galères ottomanes firent un mouvement pour se retirer du combat, le provéditeur Querini courut sur elles ; elles prirent la chasse, il les poursuivit et les obligea de se jeter à la côte ; les matelots se précipitaient dans la mer pour échapper au vainqueur.
Des cris de joie s’élevèrent au centre de la ligne, l’aile gauche y répondit par un cri de victoire. Le provéditeur Barbarigo, qui s’était laissé tourner par l’ennemi, avait été enveloppé ; sa galère en avait eu à combattre six à la fois ; il venait de recevoir lui-même une blessure mortelle ; mais Frédéric Nani, qui avait pris sur-le-champ le commandement à sa place, redoublant d’efforts, et non content de sauver son bâtiment, s’était emparé d’une galère ennemie. Une division, conduite par le provéditeur Banale, vint le seconder ; les Turcs commencèrent à plier ; la galère du général de leur aile droite, foudroyée par celles de Banale et du capitaine Jean Bontarini, faisait eau de toutes parts. Mahomet Siloco, couvert de blessures, la vit s’enfoncer ; les Vénitiens le tirèrent du milieu des eaux, mais ce fut pour lui trancher la tête qu’ils arborèrent sur leur pavillon.
Querini, qui revenait de poursuivre les trente galères ottomanes qui s’étaient jetées à la côte, arriva pour terminer ce combat de l’aile gauche des alliés : les Turcs pressés de deux côtés ne songèrent plus qu’à la fuite. Sans ordre, sans chefs, dispersés, poursuivis, les uns s’échappaient avec leurs galères, d’autres les abandonnaient et se précipitaient dans des chaloupes, pour gagner le rivage voisin.
À la droite des alliés, la fortune leur avait été moins favorable ; le roi d’Alger, à force de manœuvrer pour tourner la division de Doria, l’avait obligé de s’éloigner du corps de bataille : la marche inégale des bâtiments les avait séparés les uns des autres : il y avait dans la ligne des chrétiens de grands intervalles. Le roi d’Alger, voyant quinze galères groupées, mais à une assez grande distance, se porta sur elles avec toutes ses forces ; c’étaient des Espagnols, des Vénitiens et des Maltais : enveloppés par un ennemi si supérieur, ils firent d’abord une vigoureuse résistance. La capitane de Malte tomba au pouvoir de l’ennemi et fut reprise par la bravoure de deux de ses conserves. Une galère de Venise, que montait Benoît Soranzo, prit feu et périt avec tout son équipage. (…)
Ullus-Ali restait toujours maître d’attaquer ou d’éviter le combat ; quand il vit le centre de l’armée turque en désordre, et trente galères à la côte, il sentit qu’il ne restait plus aucun espoir de rétablir la bataille : il déploya toutes ses voiles et passa au milieu de la ligne des alliés avec trente de ses vaisseaux ; le reste qui n’avait pu le suivre fut atteint par le vainqueur. Il y avait cinq heures que l’on combattait ; la mer était couverte de sang et de débris : quelques galères fuyaient au loin ; d’autres, à demi brûlées et fracassées, attendaient que les alliés vinssent s’en emparer ; plusieurs flottaient au gré des vents, abandonnées de leurs équipages ; on en voyait trente ou quarante échouées le long de la côte ; enfin celles qui n’avaient pris que peu de part au combat, s’étaient réfugiées dans le golfe de Lépante. Les alliés avaient perdu 4 000 ou 5 000 hommes, parmi lesquels on comptait quinze capitaines vénitiens : le nombre des blessés était infiniment plus grand. La perte des Turcs était impossible à évaluer ; on la fait monter à 30 000 hommes (…). Mais les chiourmes des galères turques étaient composées d’esclaves chrétiens, et dans celles des alliés il y avait un grand nombre d’esclaves mahométans de sorte, que de part et d’autre, il ne s’était pas tiré un coup de canon, dont l’effet ne dût être déplorable.
C’était la plus grande bataille navale qui se fût donnée depuis celle qui, seize siècles auparavant, et au même lieu, avait décidé de l’empire du monde.
Pierre Paru, Histoire de la république de Venise
Source : Fideliter n°254
Image : La bataille de Lépante, Pablo Veronese
- La prise de Chypre fut un atroce supplice pour les chrétiens et Malte ne fut sauvée que grâce à l’héroïsme de ses défenseurs dirigés par La Valette.[↩]