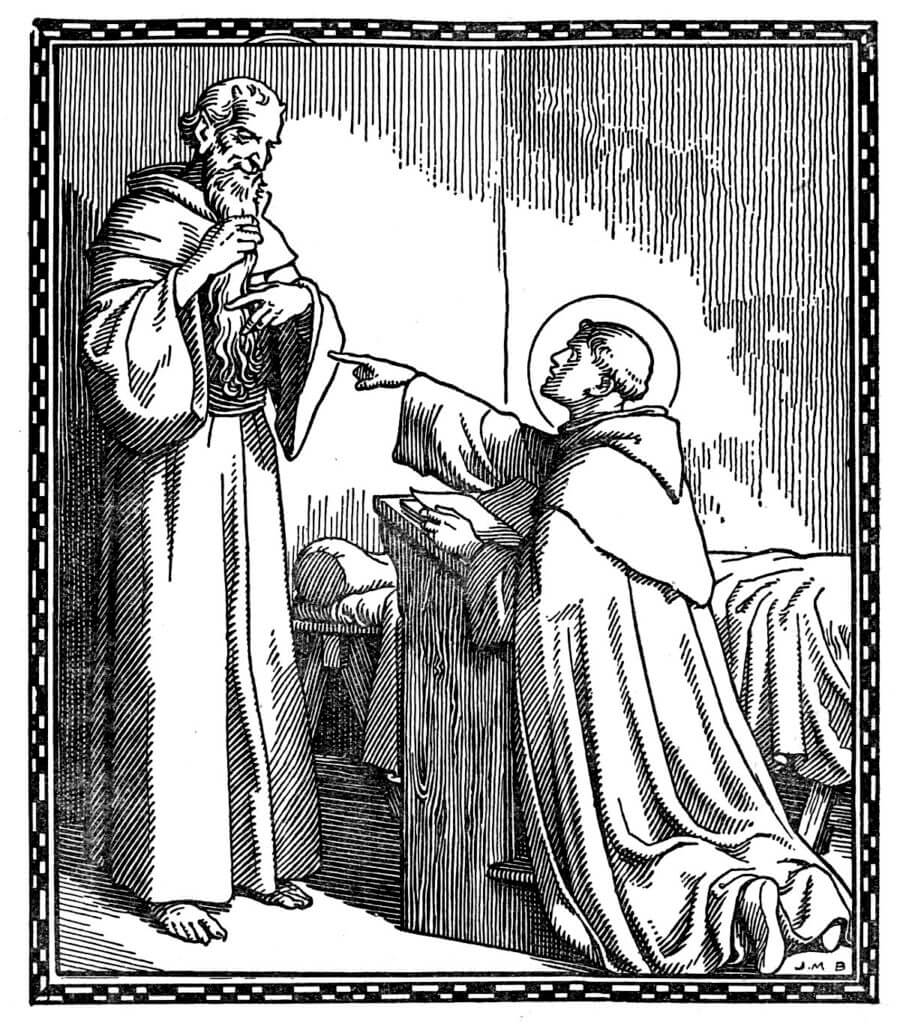Originaire de Valence en Espagne, ce saint Dominicain (1350–1419) marqua son temps troublé par sa prédication et ses miracles. Il finit ses jours à Vannes où il est très vénéré.

Vincent Ferrer – nous disons en français Ferrier, – surnommé « l’apôtre voyageur », est à coup sûr l’un des prédicateurs les plus surprenants de son siècle et même des temps modernes.
Parcourir tous les chemins de l’Europe, prêcher aisément pendant quarante ans, de quatre à six heures par jour, sans fatigue pour lui- même et pour son auditoire, adopter souvent pour thème de ses prédications le sujet le plus terrifiant et le plus capable d’aliéner un auditoire : les fins dernières et le jugement, quelle gageure pour un prédicateur !
Et cependant, ce précurseur de l’heure terrible entraîne après lui des villes et des provinces entières. Il parle à des foules de 80 000 hommes ; on porte à 140 000 le nombre des pécheurs notoires qu’il arrache à leur crime. Difficulté plus grande : il convertit des Juifs en masse. Enfin, suprême tour de force : il amène facilement, à la morale évangélique, celui que le missionnaire catholique n’ose qu’à peine aborder aujourd’hui : le musulman !
Son enfance et sa jeunesse.
Il y avait une âme de feu dans cet enfant prédestiné, dont de merveilleux présages signalèrent la naissance, à Valence d’Espagne, le 23 janvier 1350. On a remarqué dans les armes des Dominicains ce chien que la mère de saint Dominique vit en songe, tenant dans sa gueule un flambeau qui s’échappait de son sein pour embraser la terre. Constance Miguel, femme du notaire Guillaume Ferrier, eut un songe analogue. Vincent s’en autorisera pour dire un jour : « Tel je suis moi-même allant par le monde, aboyant contre les loups infernaux. C’est une grande dignité d’être ainsi le chien du Seigneur. »
Grandi sous un soleil resplendissant, l’Espagnol est précoce, Mais Vincent était exceptionnellement doué. Son esprit était si pénétrant, et sa mémoire si extraordinaire, qu’à dix-sept ans il avait terminé le cycle des études qui d’ordinaire s’achève à dix-huit. La science théologique s’ouvrit pour lui et lui fit non seulement connaître, mais « sentir » Dieu, selon l’heureuse expression de Fénelon. Une dévotion très tendre s’épanouissait en même temps dans son cœur, à l’égard de la, Vierge, appui instinctif des heures troublées de l’adolescence. Pour Vincent, tout prédicateur qui parlait d’elle parlait bien. Aussi, plus tard, lorsqu’il prêchera, ses sermons commenceront- ils invariablement par l’Ave Maria.
Vocation. – Caractère de sa parole dans la chaire.
Quand l’heure vint de fixer sa vie, l’adolescent avait depuis longtemps choisi dans son cœur. Son âme ardente et contemplative trouverait chez les Frères Prêcheurs cette alternance, si bien faite pour sa nature, de la contemplation et de l’activité. Il entra donc, le 5 février 1368, au couvent de Saint-Dominique, à Valence. Ce que fit un pareil homme au noviciat, ses premiers biographes l’ont défini en quatre coups de crayon : « Humilité sans feinte, oraison sans tiédeur, assiduité sans ennui, affabilité sans ombre. » « La première condition d’une grande vie, a dit Lacordaire, c’est de se proposer une grande ambition. » Le jeune novice étudia et copia si bien la vie du fondateur de son Ordre, que plus tard on ne saura plus distinguer le disciple du maître, ce qui ne va pas sans quelque inconvénient pour l’exactitude de sa biographie.
Son noviciat terminé, et après avoir enseigné la philosophie à ses frères, il fut envoyé à Barcelone, puis à l’Université de Lérida, où on l’honora du bonnet de Docteur (1378).
Rappelé à Valence, il fut chargé par l’archevêque d’annoncer au peuple la parole de Dieu. On accourait de toutes parts, pour entendre ce prédicateur de vingt-quatre ans – il n’était encore que diacre, – dont la manière ne rappelait aucune autre. Sa voix, tour à tour douce et formidable, subjuguait les foules.
L’originalité du missionnaire a souvent fait perdre de vue en Vincent Ferrier, le prédicateur de talent. Fort heureusement, beaucoup de ses sermons nous ont été conservés, grâce aux notes de ses auditeurs.
Ils mettent en face d’un philosophe puissant, d’un théologien original, d’un psychologue savoureux, d’un orateur plein de verve et de nuances, d’un diplomate avisé… Plus on fait connaissance avec cet auteur du XVe siècle, plus on est charmé d’y trouver un homme, non pas un homme quelconque, mais une physionomie haute en couleurs, et de traits accentués, originaux, avec quelque chose de simple et de souriant.
Max Gorce
Outre le talent de l’orateur et l’accent de la persuasion, Dieu avait départi à Vincent le don de prophétie. Et rien n’est grand dans l’imagination des hommes comme un prophète.
Il n’était pas rare de le voir interrompre un développement familier pour jeter tout à coup à son auditoire une révélation prophétique.
En 1374, la famine sévissait en Espagne. A Barcelone, sur le conseil de Vincent, des processions suppliantes sillonnèrent la ville. L’apôtre harangua cette foule de 20 000 hommes, l’exhortant à l’expiation, puis à la confiance en Dieu, qui ne frappe que pour guérir. Tout à coup son visage s’illumina : « Rassurez-vous, dit-il, avant la nuit, deux navires chargés de blé seront au port. » Beaucoup demeurèrent sceptiques. Son prieur le tança vertement, et lui enjoignit de se dispenser à l’avenir de toute espèce de prophétie ou de manifestation intempestive qui sortirait de l’ordre commun, sans l’assentiment de son supérieur. Et voilà que le soir, dans l’irradiation du soleil couchant, deux voiles blanches apparurent, signalées par la sentinelle de Montjuich, se dirigeant vers le port, et, en effet, chargées de grain.
A quelques jours de là, s’il faut en croire la légende, Vincent sortait de son couvent. Au moment où il passe, un maçon tombe d’un échafaudage, et reste accroché dans une situation périlleuse : « Fray Vincenti, s’écrie-t-il, sauvez-moi ! » Alors le moine, préoccupé avant tout d’obéir à son supérieur : « Attends, dit-il, que j’aille demander la permission. » Puis muni de l’autorisation de son supérieur assez courroucé : « Va, dit-il au malheureux, tu peux descendre. » Et l’homme se laissa choir doucement, comme en parachute. Voilà pourquoi on trouve un peu partout en Espagne, en Italie et dans le midi de la France, des confréries de maçons érigées en l’honneur de saint Vincent Ferrier. Voilà pourquoi on voit dans beaucoup d’églises, à Vérone par exemple, des tableaux représentant des scènes étrangement mouvementées, et pour lesquelles les guides peu avertis n’ont pas d’explication.
Saint Vincent aux prises avec Satan.
Une nuit que Vincent était en prière, il voit s’avancer vers lui un vénérable ermite à l’aspect austère et mortifié : « Je suis, dit-il, un ancien Père du désert, devenu un grand Saint, malgré les désordres de ma vie. Croyez-en donc un vieillard expérimenté : je vous donne le conseil de vous ménager un peu plus, et de vous accorder quelque répit et quelques plaisirs. » Le piège était par trop grossier ; Vincent n’y tomba point. Le démon usa d’une tactique plus directe et se servit comme intermédiaire d’une créature passionnée et effrontée, dont les artifices demeurèrent vains ; cette méchante femme, tout à coup possédée, s’agitait avec fureur quand on arriva auprès d’elle. On employa tous les exorcismes, mais inutilement. Elle s’écriait : « Celui-là seul pourra me chasser de ce corps, qui n’a point brûlé au milieu du feu. » Paroles énigmatiques dont on eut bientôt l’explication. A peine Vincent Ferrier, mandé en toute hâte, avait-il mis le pied sur le seuil, que Satan fît entendre un effroyable rugissement : « Le voilà, s’écrie-t-il, cet homme qui n’a point brûlé au milieu du feu. Je sors ! » Et à ces mots, il s’enfuit, laissant la femme à demi morte.
Saint Vincent et l’Eglise.
Le « Grand Schisme d’Occident » divisait alors l’Eglise. La France et l’Espagne venaient de se soustraire à l’autorité légitime du Pape de Rome, Urbain VI, pour obéir à l’antipape d’Avignon Clément VII et à son successeur, Benoît XIII, qui, avant son élection frauduleuse, se nommait Pierre de Lune, cardinal d’Aragon.
Benoît XIII fit venir auprès de lui maître Vincent. Celui-ci se rendit à Avignon, où résidait l’antipape, fixa sa résidence au couvent des Dominicains, et donna à l’usage du clergé un cours de théologie très pénétrant.
Disons tout de suite qu’il croyait sincèrement à l’autorité légitime de Benoît XIII. D’ailleurs, la question du Pape véritable présentait à cette époque une telle confusion et ambiguïté qu’elle était bien plus difficile à résoudre alors qu’elle ne le devint par la suite. A côté de saint Vincent Ferrier on citera toujours le bienheureux cardinal Pierre de Luxembourg, évêque de Metz, comme un des plus nobles appuis de la cause de Benoît XIII.
Tout en restant convaincu de la légitimité du Pape d’Avignon, Vincent était aussi persuadé que l’abdication de celui-ci était le seul moyen de mettre fin au schisme, et il fit tous ses efforts pour décider Benoît XIII à se démettre, ainsi que ce Pape l’avait d’ailleurs promis.
Cette proposition sembla trop dure à Pierre de Lune. La douleur de l’homme de Dieu s’accrut tellement qu’une violente fièvre le conduisit en quelques jours aux portes du tombeau. Quand il revint à la santé, en vain Benoît XIII lui offrit-il les plus hautes dignités, l’épiscopat, le cardinalat même : Vincent Ferrier, acceptant seulement le titre de légat a latere Christi (4 octobre 1398), qui lui conférait tout pouvoir de prêcher, de lier et de délier, inaugura sa vraie mission qui était de sauver les âmes. Il commença, dès lors, ces courses dont chaque pas fut un miracle, chaque parole une victoire pour le ciel.
Saint Vincent voyageur.
Vincent avait quarante-huit ans lorsqu’il commença les pénibles travaux qui devaient l’occuper jusqu’à sa mort. Vouloir fixer rigoureusement les itinéraires qu’il suivit dans les pays d’Europe qui obéissaient alors au Pape d’Avignon serait pure utopie. Nous le trouvons à Alexandrie, en France, en Italie, en Espagne, en Angleterre, en Suisse et en Ecosse. En Dauphiné, il retrouve son propre frère, Général des Chartreux. Sur sa route, il moissonne des âmes d’élite, tel le Franciscain Bernardin de Sienne, que l’Eglise devait mettre sur ses autels en 1450, cinq ans avant Vincent Ferrier. Nous le suivons en Lombardie, puis en Piémont, puis en Savoie. Le 5 mars 1404, il entre à Fribourg ; la même année il pose la première pierre du couvent des Frères Prêcheurs à Chambéry. Annecy l’accueille avec enthousiasme. Lorsque deux cents ans plus tard saint François de Sales paraîtra, il n’aura qu’à rappeler ce souvenir, et dans son cœur il bénira cet illustre ancêtre d’apostolat « des prédications duquel la ville d’Annecy a été quelquefois honorée ».
En Lorraine, Nancy a vu passer maître Vincent ; de même, en Franche-Comté, Besançon et Poligny, où il rencontrera la grande réformatrice des Clarisses, sainte Colette : ensemble les deux Saints écriront (1417) au Concile réuni à Constance, et l’attitude résolue de ces deux âmes, qui précédemment avaient eu foi en Benoît XIII, mais qui ne reculaient pas devant la vérité une fois connue, contribua à hâter la déposition de l’antipape et l’élection incontestée de Martin V. Sainte Colette prédit d’ailleurs à Vincent qu’il mourrait en France.
Le don des langues.
Notre-Seigneur renouvela en faveur de son serviteur le miracle de la Pentecôte. Les gens de nationalités diverses, qui ne se comprenaient pas entre eux, le comprenaient comme s’il eût parlé leur langue, chacun s’imaginant que le prédicateur avait étudié son idiome. Or, il est constant qu’il ne sut jamais que les langues mortes et le valencien, sa langue maternelle. Que dans le midi de la France, dans les pays de langue romane il pût être compris, c’est vraisemblable ; mais l’apôtre acheva sa vie en Basse-Bretagne, où se parle communément le breton, et là est le prodige. Certainement Dieu intervint en accordant à son missionnaire la grâce de se faire comprendre d’auditeurs très éloignés de lui par leur langue maternelle, tels que les Basques et les Bretons ; devant eux, l’apôtre parlait sans gêne, sans plus s’inquiéter de la différence radicale des idiomes que des nuances qui avaient pu se rencontrer dans les autres pays. « Prodigieux succès ! et, en tout cas, immense popularité », écrit un directeur de l’Ecole des Chartes qui n’admet pas le miracle.
Le Saint et l’apôtre.
Sa vie, dit un témoin, était très dure, même en voyage. Il allait toujours à pied ; puis, quand il fut malade d’une jambe, sur un âne. Il ne mangeait jamais de viande et ne faisait qu’un repas par jour : point de lit, mais une simple paillasse étendue par terre. Il se levait à 2 heures, récitait l’office du chœur, puis le psautier. Souvent il prenait une sanglante discipline. A Toulouse, l’archevêque lui demanda de modérer un peu, pour le bien des âmes, les rigueurs de ses mortifications, car il était sexagénaire. « Permettez-moi, répondit-il, d’achever ce que j’ai commencé ; à mon âge, tout changement est dangereux. » L’archevêque sourit et n’insista pas.
Pour qui connaît la nature humaine, cette continuité sans relâche est un vrai prodige, même au couvent. Mais, quand c’est au dehors qu’il s’agit de maintenir avec une rigueur inflexible cette austère uniformité, et cela tous les jours, avec une infinie multiplicité d’affaires, sous toutes les latitudes, en toutes saisons, dans toutes dispositions d’esprit et de corps, cela suppose une énergie et un état d’âme qui n’est pas naturel. Quand on porte, comme il le faisait, le poids d’une journée de dix-huit heures, c’est bien lourd ; de plus, le court sommeil qu’il prenait était souvent interrompu par de cruelles insomnies et les rancunes de l’enfer. Mais comme Dieu était glorifié et comme les âmes se trouvaient préparées à leur insu, par les souffrances du missionnaire, à recevoir la grâce !
Vincent ne cueillit la palme du martyre que par la véhémence de ses désirs ; mais il subit en réalité, tous les jours, le martyre de la patience. Faim, soif, chaleur, fatigue, tempêtes, ravins, torrents ; que d’actes d’abnégation ! Et il parcourut ainsi une partie de l’Europe, à plusieurs reprises, au XVe siècle, alors que les chemins n’étaient que d’effroyables fondrières !
Il avait sa manière de corriger les gens, qui ne manquait pas d’à‑propos. Un homme se plaignait qu’on lui eût refusé l’absolution parce qu’il n’avait pas voulu pardonner à un cordonnier, son ennemi. Vincent l’entend. « Vous ne voulez pas pardonner au cordonnier ; soit, pardonnez-vous à vous-même. Vous êtes là à vous ronger le cœur, sans compter l’âme qui se perd, pendant que lui boit, mange et prend du bon temps. » L’autre revint : « Je comprends à présent, dit-il, quelle sottise est la haine ! »
Pour inspirer le respect des saints mystères, le missionnaire racontait qu’un homme, vêtu avec recherche, n’osait se mettre à genoux de peur de gâter ses habits. Il fut tué par un démon qui lui dit : « Traître, si Dieu avait fait pour nous, les anges, ce qu’il a fait pour vous, les hommes, nous serions encore prosternés à ses pieds. »
Il né reculait pas non plus devant l’effet d’un trait d’humour. Une femme vint le trouver un jour, se plaignant des brutalités de son mari : « Allez trouver, dit Vincent, le Frère portier de notre couvent, et faites-vous donner de l’eau du puits. Quand votre mari rentrera, prenez aussitôt une gorgée de cette eau et gardez-la dans la bouche. Vous verrez bientôt merveille. » Ainsi fut fait : le mari rentre et commence à s’impatienter. La femme ne répond pas, ayant la bouche pleine d’eau. Confus de parler tout seul, le brave homme finit par se taire, remerciant Dieu d’avoir changé le cœur et fermé la bouche de sa femme. La chose est passée en proverbe en Espagne, et l’on dit encore : « Buvez de l’eau de maître Vincent. »
Il convient d’ajouter que les Dominicains distribuent aux malades, surtout pour les yeux, une eau dite de saint Vincent Ferrier.
Saint Vincent meurt en Bretagne.
Après avoir die nouveau parcouru la France et prêché particulièrement dans le Midi, à Toulouse, à Albi, dans le Rouergue, à Besançon, à Bourg, à Clairvaux, à Dijon, au Puy, Vincent Ferrier partit de Nantes pour Vannes, où il allait mourir.
Le zélé Dominicain paraît avoir aimé particulièrement la Bretagne. Recherchant les pauvres, il devait affectionner ce pays où le pauvre était peut-être plus pauvre qu’ailleurs.
Ce n’est pas qu’il négligeât les grands. Ainsi son premier miracle fut d’obtenir, pour la duchesse de Bretagne, la grâce d’une postérité dont tout espoir semblait perdu.
Il va de Nantes à Vannes par Guérande et Redon, mais en s’arrêtant presque à chaque bourg. Cette entrée à Vannes dut vivement frapper les esprits, car de nombreux témoins en ont parlé. A quelques milles de la ville, le duc Jean V et la duchesse, l’évêque, les magistrats, le peuple, vinrent à sa rencontre ; mais comme on approchait des portes, se déploya sur deux lignes immenses tout ce que la misère humaine connaît d’infirmités. Il faut avoir assisté à quelque grand pardon de Sainte-Anne d’Auray pour se faire une idée de cette collection d’estropiés, de manchots, de cancéreux, de culs-de-jatte et de mendiants de toutes sortes. On conçoit l’enthousiasme populaire quand on vit tout ce peuple déguenillé, sous la bénédiction de Fr. Vincent, se redresser, jeter ses béquilles, laisser dans les fossés ses petites charrettes, ces mille trophées de la misère.
Le lendemain le missionnaire célébra le saint Sacrifice et prêcha sur la place des Lices, devant le château de l’Hermine, en présence de la cour ducale et du peuple. Il recommença tous les jours, du IVe dimanche de Carême au mardi de Pâques. Comme partout, après sa prédication, il guérissait les malades qui se présentaient, en faisant sur eux le signe de la croix et en disant : « Au nom de Jésus ! »
L’espoir de mettre lin à la guerre de Cent Ans le fit aller aussi en Normandie, centre des opérations du roi d’Angleterre. Mais c’est la Bretagne qui a gardé le plus fidèlement son souvenir : Jocelyn, Ploërmel, Guingamp, Hennebont, Quimperlé, Quimper, Châtelaudren, etc. Il consacra dix jours à Saint-Brieuc et à Lamballe. Par Jugon et Moncontour, il se dirigea vers Dinan, puis vers Saint-Malo. Il était touché à mort quand il fut de retour à Vannes. Mais, là où avait été son berceau, il souhaitait avoir sa tombe ; il voulait donc retourner à Valence pour y mourir. Ce départ n’était pas chose facile à entreprendre. Les Vannetais se considéraient comme ayant un grand trésor en garde ; et comme il était plus facile, dit un témoin, d’emporter la ville de Vannes que saint Vincent Ferrier, on choisit la nuit pour cette opération. La tradition montre encore l’endroit précis où il s’embarqua, presque en face de la porte Saint-Vincent. Le mal s’étant aggravé, il dut revenir et fut reçu au son de toutes les cloches.
Dix jours après (5 avril 1419), sa belle âme s’envolait au ciel. L’évêque et le Chapitre durent faire soigneusement garder le corps, n’entendant pas qu’il fût enseveli ailleurs que dans leur cathédrale.
La canonisation.
Par trois fois, sur le grand chemin du monde, Vincent Ferrier s’était arrêté, à Cavalls, devant un enfant et avait dit : « Celui-là me canonisera. » L’enfant, nommé Alphonse Borgia, devint, en effet, plus tard, en 1455, le Pape Calixte III. C’est ce Pontife qui, le 29 juin 1455, procéda à la canonisation solennelle du saint missionnaire.
Son tombeau, en la cathédrale de Vannes, devint rapidement un centre de prodiges. On a relevé en particulier soixante-dix cas de possession guéris et l’on conserve le manuscrit des dépositions des témoins.
La prière de saint Vincent Ferrier s’étend, avec une efficacité bien évidente, sur cette Bretagne qu’il a tant aimée. Si par leur ténacité vigoureuse, leur foi, leur respect des traditions, les Bretons sont encore, au milieu de l’indifférence, un peuple à part, ils le doivent sans doute à la protection du saint apôtre.
A. Poirson.
Sources consultées. – Abbé A. Bayle, Vie de S. Vincent Ferrier (Paris, 1855). – R. P. Fages, des Frères Prêcheurs, Histoire de saint Vincent Ferrier (Paris). – René Johannet, Saint Vincent Ferrier (La Vie et les œuvres de quelques grands Saints, t. II, Paris, 1928). – (V. S. B. P., n° 164.)
Source de l’article : Un Saint pour chaque jour du mois, Avril, La bonne presse, 1935