Aux côtés de saint Paul, saint Augustin ou saint Ignace de Loyola, Charles de Foucauld est une grande figure de converti.
Une inconduite notoire
Jeune vicomte, en possession d’un immense héritage, l’aspirant de Foucauld s’installe confortablement dans sa chambre de l’école de cavalerie de Saumur. « Qui n’a vu Foucauld dans sa chambre, en pyjama de flanelle blanche à brandebourgs, installé sur sa chaise longue ou dans un excellent fauteuil, dégustant un savoureux pâté de foie gras, arrosé d’excellent vin de Champagne, ne peut se faire une idée de ce qu’est un homme heureux de vivre », raconte l’un de ses camarades, le futur général d’Urbal.
La gourmandise l’a rendu gras et lourd mais il soigne son élégance vestimentaire, faisant la fortune des tailleurs et des bottiers de Saumur et, pour s’épargner toute fatigue, fait venir le coiffeur à domicile. D’une folle prodigalité, il joue des sommes considérables, n’allant jamais toucher sa solde. Son attirance pour les fêtes du monde lui vaut des semaines répétées de forteresse.
A l’issue de son séjour à Saumur, l’inspecteur général donnera cette appréciation sur Charles de Foucauld : « A de la distinction, a été bien élevé. Mais la tête légère, et ne pense qu’à s’amuser ».
Ne pense-t-il qu’à s’amuser, est-il vraiment si heureux ? Son comportement est toutefois parfois bien étrange : disparu un jour de Saumur, on le retrouvera déguisé en clochard, guenilleux et misérable, errant dans la campagne et mendiant son pain.
Sorti 87ème sur 87 élèves de l’école de cavalerie, il est nommé sous-lieutenant au 4ème Hussards à Sézanne ; mais il s’y ennuie affreusement et se fait muter à Pont-à-Mousson où il reprend sa vie de plaisirs mais en plus grand et en plus dévergondé. C’est alors qu’il affichera une liaison avec une certaine « Mimi », mondaine et légère, qu’il présentera à Sétif, en Afrique, comme la vicomtesse de Foucauld. Il ira, en effet, prendre ses quartiers en Afrique, son régiment étant devenu en décembre 1880 le 4e Chasseurs d’Afrique. Cette liaison lui vaudra reproches puis ordres de ses supérieurs, mais le sous-lieutenant de 23 ans n’admettra pas qu’on s’immisce dans ses affaires personnelles ; il ne se soumettra à personne et préférera quitter l’armée. Sa compagne n’est en réalité pour lui qu’une insignifiante maîtresse, mais son orgueil le rend intraitable. Mis en non-activité « pour indiscipline doublée d’inconduite notoire », il rentre en France et s’installe à Evian avec Mimi.
Retour sur son enfance et sa jeunesse
L’élève-officier de Foucauld « a de la distinction, a été bien élevé », estimait un de ses supérieurs. Certes, il n’est pas rare que des parents, pourtant soucieux de donner une bonne éducation à leurs enfants souffrent de les voir plus tard vivre sans foi ni loi. Il est vrai aussi que des circonstances, ou des failles dans l’éducation, peuvent favoriser des désordres de conduite. Faisons donc un petit flash back sur l’enfance de Charles pour y trouver quelque explication au dévergondage du jeune officier. Rappelons toutefois que des circonstances atténuantes ne peuvent excuser totalement de ce que plus tard Charles de Foucauld appellera « une volonté positive de rejeter toute croyance et, à partir de là, toute règle ».
Alors qu’il a cinq ans, son père, gravement atteint de tuberculose, donne sa démission d’inspecteur des Eaux et Forêts et devient gravement tourmenté. Il s’en va résider chez sa sœur Inès Moitessier tandis que sa mère se réfugie avec ses deux enfants, Charles et Marie, chez son père, le colonel de Morlet. Elisabeth de Foucauld mourra d’une fausse couche le 13 mars 1864. Cinq mois plus tard, son époux s’éteint à Paris, loin de ses enfants. Charles, orphelin à cinq ans, gardera sans cesse la nostalgie de ces quelques années paisibles où sa mère vivait encore et le tournait vers Dieu. Il sera confié, avec sa sœur, à son grand-père qui se montrera d’une grande faiblesse envers ses petits enfants, surtout envers Charles.
A dix ans, il entre en sixième au lycée de Strasbourg où il se montre, d’après son professeur, « un élève intelligent et studieux mais loin de faire pressentir la nature ardente et primesautière qu’il devait manifester ». En réalité, Charles est un enfant replié sur lui-même, d’une forte sensibilité et recherchant la solitude. Il souffre de la mort de ses parents et cela se traduit par un tempérament fermé, vulnérable et susceptible, agressif et impatient.
C’est alors qu’il retrouvera comme un nouveau foyer chez sa tante Inès qui l’accueillera dans sa propriété près d’Evreux pour quelques semaines de vacances. Il fera surtout la connaissance de celle qui sera son « ange gardien » et comme sa deuxième mère tout au long de ses années d’égarement : Marie Moitessier, son aînée de neuf ans, ornée d’une foi profonde et d’une grande bonté chrétienne.
Mais en 1870 la guerre éclate avec son cortège de sang, de famine et de défaites ; elle affectera douloureusement Charles, qui a douze ans.
C’est au lycée de Nancy qu’il fera sa troisième. Le 28 avril 1872 fut un de ses plus beaux jours, celui de sa première communion, dont il écrira vingt-cinq ans plus tard qu’elle fut « entourée des grâces, des encouragements de toute une famille chrétienne, sous les yeux des êtres que je chérissais le plus au monde ». Marie Moitessier est présente, venue tout exprès de Paris avec un cadeau : le livre de Bossuet qui contribuera dans quelques années à sa conversion. La Providence, comme toujours, veille.
Hélas, ce jour de ferveur sera sans suite. Entré en classe de seconde, Charles de Foucauld s’adonne à toutes sortes de lectures qui l’écarteront de la pratique religieuse puis contribueront à lui faire perdre la foi. Dieu n’est plus pour lui que l’Inconnaissable. Ses maîtres sont Montaigne et Voltaire. Il est plongé dans le scepticisme : « rien ne me paraissait assez prouvé ; la foi égale avec laquelle on suit des religions si diverses me semblait la condamnation de toutes ». Cette « septicémie » de l’intelligence est aussi le fruit amer de l’œcuménisme régnant, provoquée par cette bactérie mortifère et quasi homonyme : le scepticisme. Toutes les religions sont également dignes de respect, donc aucune n’est vraie – fermons la parenthèse. Charles demeurera « douze ans sans rien nier et sans rien croire, désespérant de la vérité et ne croyant même pas en Dieu, aucune preuve ne (lui) paraissant assez évidente ».
De plus, Marie s’est mariée le 11 avril 1874 ; elle est devenue la vicomtesse de Bondy. Charles se retrouve plus seul que jamais, rongé par ses doutes. Dans cette même année, il passe son premier baccalauréat à l’âge de quinze ans et décide d’embrasser la carrière militaire à laquelle il aspire depuis longtemps. Son grand-père souhaiterait qu’il passât comme lui-même par Polytechnique mais Charles, paresseux, opte pour Saint-Cyr, plus facile. Il réussit tout juste le deuxième baccalauréat et commence une deuxième année à « Sainte-Geneviève ». C’est alors que ses doutes, puis l’éloignement de la foi, engendreront une déchéance morale quasi complète. Citons-le : « Je vivais comme on peut vivre quand la dernière étincelle de foi est éteinte (…) j’étais tout égoïsme, tout impiété, tout désir du mal, j’étais comme affolé ». Rejetant toute croyance, il s’affranchit de toute règle et cela lui paraissait la seule attitude normale, cohérente : « lorsque je vivais le plus mal, j’étais persuadé que cela était absolument dans l’ordre et que ma vie était parfaite ». Paresse et mauvaise conduite seront les causes de son renvoi de « Sainte-Geneviève ». Il mettra tout de même son point d’honneur à rentrer à Saint-Cyr. Avec l’aide du précepteur que lui donna son grand-père, il y fut admis en même temps que Driant, Sarrail et le futur maréchal Pétain. Mais son cœur ne rêve pas d’honneur et de hauts faits. Charles est indifférent à la vie, indolent, s’ennuie, n’a aucun souci de sa tenue. La nouvelle de la mort de son grand-père, qu’il aimait tendrement, brisera le dernier lien qui le retenait encore. Il se laissera aller à un véritable dégoût de vivre, ne fera plus rien, perdra ses galons et sortira de Saint-Cyr 333e sur 386.
Nous avons déjà évoqué la triste suite, à Saumur, à Pont-à-Mousson et à Sétif où il quittera l’armée.


Un début de conversion, « naturelle »
A Evian, Foucauld se traîne avec Mimi, cherchant à s’étourdir dans des plaisirs mondains sans retenue. Mais quand il se retrouve seul avec lui-même il ne trouve que tristesse, dégoût, désespoir ; « Je suis un homme fini », s’écriera-t-il.
C’est alors que survint un évènement décisif, qui freinera sa descente aux enfers. Il lit dans un journal : « Sud-Oranais, insurrection des Ouled sidi Cheikh – le 4ème Chasseurs est jeté en plein combat ». Charles de Foucauld dévore l’article. Ses camarades se battent ! Sa réaction est immédiate. Il quitte Evian, se rend à Paris, obtient une audience au Ministère de la guerre et demande sa réintégration dans l’armée, prêt à servir comme simple cavalier chez les spahis. Mais son grade lui est rendu. Il rejoint aussitôt son régiment dans le Sud-Oranais.
Mais cet homme paresseux, jouisseur, orgueilleux, s’adaptera-t-il à des combats d’Afrique ? Laperrine nous répond : « Au milieu du danger et des privations des colonnes expéditionnaires, ce lettré fêtard se révéla un soldat et un chef, supportant gaiement les plus dures épreuves, payant constamment de sa personne, s’occupant avec dévouement de ses hommes, il faisait l’admiration des vieux mexicains du régiment, des connaisseurs ». Certes, Charles a retrouvé la joie et une raison de vivre et de se battre, il est franc, serviable, détendu ; mais il est encore loin d’être chrétien comme en témoignent ces paroles prononcées avec un certain cynisme lors de l’enfouissement d’un cheval qu’il aimait : « Tu appartiens à la catégorie de ces chevaux qui vont droit au paradis. Je le regrette, car ainsi, nous ne nous rencontrerons plus jamais ».
Il y a, néanmoins, dans ce départ pour l’Afrique, une première étape de sa conversion. La grâce ne détruit pas la nature et si cette dernière grandit dans le bien, le don de soi, le respect de la loi naturelle, elle offrira un terrain favorable à la grâce. On ne fait pas pousser des fleurs sur du béton, même en les arrosant.
Les effets de ce premier pas sont en tout cas de bon augure : Il brise sa solitude, entre en contact avec les autres. Surtout il se réhabilite auprès des siens. Sa tante reconnaît son courage et l’intègre dans ce qui représente la tradition familiale. Ensuite, Charles découvrit la fraternité d’armes. Il est à la tête d’une troupe d’hommes qui feraient n’importe quoi pour lui parce qu’ils sentent qu’il les aime. Enfin, il rencontra des adversaires, les arabes, qui « produisirent sur lui une profonde impression », comme il le dira plus tard. Et puis il connut cette fascination du désert dont parle Lyautey : « l’Afrique, ce fut une ivresse de deux ans, l’oubli, une ivresse pure, celle-là, une griserie de soleil, de lumière »…, et Psichari d’ajouter : « parce que l’Afrique est la figuration de l’éternité, j’exige qu’elle me donne le vrai, le bien, le beau et rien de moins »…
En janvier 1882, Foucauld demande un congé à ses chefs pour faire « un voyage en Orient », ce qui lui fut refusé. Il obtiendra alors sa démission de l’armée pour entreprendra une exploration du Maroc, pays mystérieux et réputé dangereux où personne n’était encore entré. Pour ne pas dévier de notre propos, retenons de ce voyage ces paroles brèves prononcées à son retour et qui donnent une idée de sa ténacité : « Cela a été dur, mais très intéressant, et j’ai réussi ». Il n’y a pas fait que des découvertes géographiques, il a rencontré des hommes prosternés devant leur Dieu. « La vue de ces musulmans vivant dans la continuelle présence de Dieu m’a fait entrevoir quelque chose de plus grand et de plus vrai que les occupations mondaines », écrira-t-il plus tard à son cousin Henry de Castries.
A peine revenu de son exploration, il se donne à nouveau à la débauche, preuve que, si l’idée d’un Dieu fait son chemin, la grâce n’a pas encore œuvré dans son âme. C’est Marie de Bondy, sa cousine, qui le sauvera. Sa bienveillance, faite de patience et de charité, et sans doute sa prière, l’inciteront à « voir et respecter le bien oublié ». Il mènera dès lors une existence solitaire, mais d’une solitude peuplée des présences aimées et silencieuses de sa famille.
L’heure de Dieu
En février 1886, Charles de Foucauld loue un appartement à Paris, à deux cent mètres de l’église Saint-Augustin. Il veut travailler et préparer d’autres explorations. Se penchant quelques années plus tard sur son passé, il écrira : « Mon cœur et mon esprit restaient loin de vous, mon Dieu, mais je vivais pourtant dans une atmosphère moins viciée ; ce n’était pas la lumière ni le bien, il s’en faut… mais ce n’était plus une fange aussi profonde, ni un mal aussi odieux… La place se déblayait peu à peu… l’eau du déluge couvrait encore la terre, mais elle baissait de plus en plus, et la pluie ne tombait plus… Vous aviez brisé les obstacles, assoupli l’âme, préparé la terre en brûlant les épines et les buissons ».
En travaillant le récit de ses explorations, Foucauld se remémore les rencontres faites au Maroc et la forte impression que lui avait causée les musulmans. Mais il ne se fera pas musulman : « L’islamisme n’a pas assez de mépris pour les créatures pour pouvoir enseigner un amour de Dieu digne de Dieu. Sans la chasteté et la pauvreté, l’amour et l’adoration restent très imparfaits ». Ce Dieu qu’il cherche, digne d’un amour parfait, le prépare doucement : « La chasteté me devint une douceur et un besoin du cœur ». Sa tante, Mme Moitessier et sa cousine, Mme de Bondy, contribuent par leur affection et leur délicatesse à son égard, à élever ses sentiments : « Vous leur inspiriez, mon Dieu, de me recevoir comme l’enfant prodigue à qui on ne faisait même pas sentir qu’il eût jamais abandonné le toit paternel. Vous leur donniez pour moi la même bonté que j’eusse pu attendre si je n’avais pas failli. Je me serrai de plus en plus contre cette famille bien-aimée. J’y vivais dans un tel air de vertu que ma vie revenait à vue d’œil, c’était le printemps rendant la vie à la terre après l’hiver ; c’était à ce doux soleil qu’avaient crû ce désir du bien, ce dégoût du mal, cette impossibilité de retomber dans certaines fautes, cette recherche de la vertu ».
Charles de Foucauld lit encore des philosophes païens, mais en éprouve une vive déception, n’y trouvant « que le vide et le dégoût ». C’est alors qu’il tombe sur le livre que lui avait offerte sa cousine le jour de sa première communion : Elévations sur les mystères, de Bossuet, qui lui fait « entrevoir que peut-être la religion chrétienne était vraie ». Il cherche en fait des vertus païennes dans un livre chrétien, demeurant au plan purement moral, tout en pensant qu’il ne peut atteindre la vérité et connaître la vraie religion. C’est encore l’exemple de Marie de Bondy qui corrigera sa trajectoire spirituelle : « Puisque cette âme est si intelligente, la religion qu’elle croit si fermement ne saurait être une folie comme je le pense ».
Pourtant Marie n’agissait que par son silence, sa douceur, sa bonté, sa perfection, travaillant ainsi avec Dieu. Cette méthode lui avait été enseignée par son confesseur, l’abbé Huvelin, vicaire à la paroisse Saint-Augustin. Lui-même avait coutume de dire : « Lorsque l’on veut convertir une âme, il ne faut pas la prêcher ; le meilleur moyen n’est pas de lui faire des sermons, c’est de lui témoigner qu’on l’aime ». Ce conseil était d’autant plus frappant que ce prêtre, agrégé d’histoire et grand orateur, était parfaitement capable d’user d’arguments fort convaincants, comme aussi Marie de Bondy.
Au cours du mois d’octobre 1886, Foucauld ressent une faim extraordinaire de Dieu. « Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse ! » est la prière qu’il répète inlassablement dans des églises. Il attend une réponse de Dieu, mais veut aussi interroger un « maître en religion ». Sa cousine lui parle de l’abbé Huvelin, auquel elle a déjà vraisemblablement parlé de Charles. Dans les derniers jours d’octobre, un matin, Charles de Foucauld entre dans l’église Saint-Augustin. Il cherche l’abbé Huvelin, et le trouve à son confessionnal. « Monsieur l’abbé, je ne viens pas me confesser, mais vous poser des questions sur Dieu et la religion ». L’abbé Huvelin lui dit simplement : « Mettez-vous à genoux et confessez-vous ». Aussitôt après, il lui dit d’aller communier.
Sa conversion est totale. Charles de Foucauld fait alors le don absolu de toute sa vie : « Aussitôt que je crus qu’il y avait un Dieu, je compris que je ne pouvais faire autrement que de ne vivre que pour lui ». Les mots de Saul, converti sur le chemin de Damas : « Que voulez-vous que je fasse »?, lui reviendront désormais souvent sur les lèvres, jusqu’en 1888, l’année où il trouvera sa vocation : Là aussi, l’abbé Huvelin lui montrera le chemin qu’il devra suivre : « Notre Seigneur a tellement pris la dernière place que jamais personne n’a pu la lui ravir ».
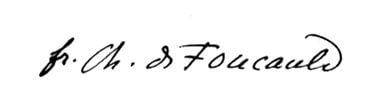
L’abbé Henri Huvelin (1830–1910). Normalien, agrégé d’histoire, de grec et de lettres, il fut ordonné prêtre en 1867. En 1873, son père retrouve la foi, c’est son premier converti. En 1875, il est nommé vicaire à l’église Saint-Augustin où ses conférences connaissent un grand succès auprés des jeunes gens et où surtout son confessionnal ne désemplit pas. Appelé l’apôtre de Paris, comparé au Curé d’Ars, il est là, dit-il, “non pour poser des idées mais pour aider la grâce”. Accablé depuis 1888 d’une cruelle maladie, elle ne l’empêchera pas d’assurer son ministère jusqu’à la fin. Emile Littré, ancien franc-maçon, père du célèbre dictionnaire et du positivisme, compta parmi ses convertis et dirigés. Il s’éteint au soir du 10 juillet 1910, avec sur ses lèvres ces mots : « Numquam satis amabo », je n’aimerai jamais assez.
Source : Fideliter n°231 de mai-juin 2016













