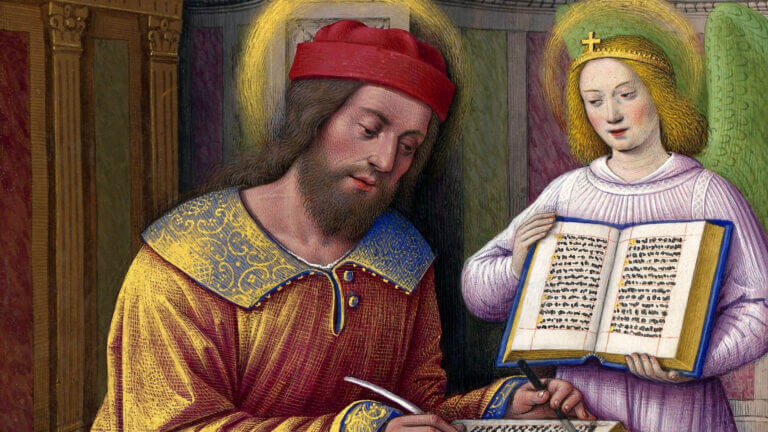Réformatrice du Carmel (1515–1582)
Fête le 15 octobre.

Thérèse naquit le 28 mars 1515, dans la cité d’Avila en Castille. Son père, don Alonzo Sanchez de Cepeda, a consigné l’événement dans son livre de famille :
Le mercredi, vingt-huitième jour du mois de mars 1515, est née Thérèse, ma fille, à 5 heures du matin, peut-être une demi-heure plus tôt, peut-être une demi-heure plus tard, en tout cas ce mercredi-là au lever du soleil. Son parrain fut Vela Nunez, et sa marraine, dona Maria del Aguila, fille de Francisco de Pajarès.
Enfance.
Ses parents, de la haute noblesse castillane, étaient foncièrement chrétiens.
Mon père, nous dit-elle, avait une admirable charité envers les pauvres et la compassion la plus vive pour les malades. Sa bonté à l’égard des serviteurs allait si loin que jamais il ne put se résoudre à prendre des esclaves… Ayant eu quelque temps chez lui une esclave de son frère, il la traitait à l’égal de ses enfants.
Don Alonzo mourut comme un Saint, en exprimant le regret de n’être pas moine.
De sa mère, Béatrix de Ahumada, Thérèse parle en ces termes :
Elle était d’une modestie parfaite. D’une beauté rare, jamais elle ne parut en faire la moindre estime. A trente-trois ans, quand elle mourut, elle s’habillait déjà comme une vieille personne. Elle charmait par la douceur de son caractère et l’agrément de son esprit.… Sa mort fut des plus chrétiennes.
Béatrix eut neuf enfants. En l’épousant en secondes noces, son mari lui apportait une fille et deux fils de son premier mariage…
Parmi ses neuf frères et ses deux sœurs, Thérèse dit qu’elle avait un préféré ; c’était probablement Rodrigue. Il avait quelques années de plus que Thérèse, et partageait sa ferveur. Ensemble, ils lisaient la vie des Saints ! Les supplices que les Saintes enduraient pour l’amour de Dieu faisaient envie à Thérèse. « Je trouvais, dit-elle, qu’elles achetaient à bon compte le bonheur d’aller au ciel. » Une chose surtout frappait la jeune imagination des deux enfants : l’éternité des châtiments et des récompenses ! « Nous aimions à redire sans nous lasser : quoi ! pour toujours, toujours, toujours ! » Et voici qu’un beau matin, ils se sauvent de la maison paternelle, franchissent le pont de l’Adaja, et marchent droit devant eux sur la route de Salamanque ; leur dessein est d’aller en mendiant au pays des Maures dans l’espoir de se faire couper la tête ! Mais à un quart de lieue d’Avila un oncle bien fâcheux les rencontre, et les ramène à leur mère qui les gronde comme il faut. Et Rodrigue de se défendre en rejetant la faute sur sa sœur.
— C’est la nina (la petite) qui m’a emmené !
A sept ans, Thérèse avait déjà les qualités d’un chef ! et d’un chef opiniâtre, car le premier échec ne la découragea pas.
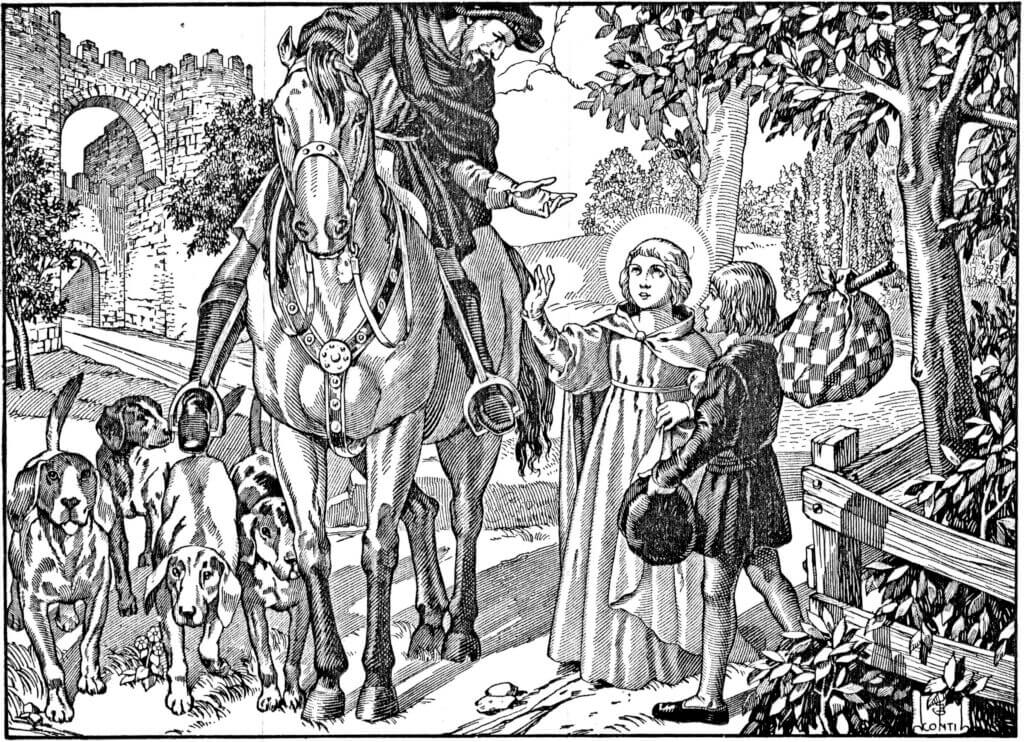
Voyant qu’il nous était impossible d’aller nous faire tuer pour Dieu, nous résolûmes de mener la vie des ermites, et dans un jardin qu’il y avait près de chez nous, nous nous mîmes à construire de notre mieux des ermitages, en posant l’une sur l’autre de petites pierres qui tombaient presque aussitôt !
Petite âme altérée d’infini bonheur, et méprisant pour lui les pauvres biens terrestres, jeune volonté capable de passer vivement des désirs généreux aux actes héroïques et d’entraîner les autres dans sa fougue ! C’est déjà le caractère de la grande Sainte qui s’ébauche en ces traits enfantins !
Thérèse avait environ douze ans quand elle perdit sa mère. La pauvre petite alla se jeter au pied d’une image de la Vierge, et la conjura de lui servir désormais de mère. « Depuis ce moment, dit-elle, jamais je ne me suis recommandée à cette Vierge souveraine sans éprouver visiblement son secours. »
Adolescence.
Vint le moment où mes yeux s’ouvrirent sur les grâces de la nature ; et Dieu, disait-on, en avait été prodigue envers moi. J’aurais dû l’en bénir ; hélas ! je m’en servis pour l’offenser, comme on va le voir par ce récit.
C’est en ces termes que la Sainte commence la confession de ce qu’elle appelle en forçant les mots « ses grands péchés ». Elle nous a prévenus du reste que, malgré ses désirs, on lui a commandé de passer sur bien des choses, car, autrement, elle se serait noircie beaucoup plus.
Elle s’accuse premièrement d’avoir aimé les romans de chevalerie. Au XVIe siècle ils avaient grande vogue en Espagne ; et la bibliothèque de Béatrix de Ahumada en était abondamment pourvue. Le cœur aimant de la tendre et ardente jeune fille s’épanouit parmi ces lectures. Elle dut lire avec ferveur, comme elle faisait toutes choses, sous l’œil indulgent d’une mère dont l’exemple la rassurait. Mais elle se cachait de son père qui voyait avec déplaisir ce goût excessif des aventures romanesques. « Je m’y livrais avec entraînement, dit-elle, et pour être contente, il me fallait un livre nouveau I »
Deuxième « grand péché » : la coquetterie. « Je commençai à prendre goût à la parure, et à désirer plaire en paraissant bien je n’épargnais ni les parfums ni aucune de ces industries de la vanité pour lesquelles j’étais fort ingénieuse. » Toutefois le souci de la vérité l’oblige à faire cette réserve : « Je n’avais nulle mauvaise intention ; et je n’aurais voulu pour rien au monde faire naître en qui que ce fût la moindre pensée d’offenser Dieu. »
La jeune fille qui « désirait plaire » y réussit, en effet. Elle avait plusieurs cousins germains de son âge ; et les jeunes cavaliers trouvaient leur cousine agréable et jolie. Thérèse se reproche d’avoir pris plaisir à cette aimable société. Quelles conséquences pouvaient avoir de telles relations pour cette adolescente au cœur délicat et jaloux de garder intact son honneur ? Thérèse affirme simplement qu’elle n’a jamais senti le moindre attrait pour ce qui aurait pu flétrir l’innocence et que sur divers points de sa conduite, elle avait pris les conseils de son confesseur.
Enfin, elle eut la faiblesse de se lier intimement avec une parente frivole dont les propos légers avaient sur elle une mauvaise influence. « C’est la vérité que la conversation de cette jeune parente produisit en moi le plus triste changement… Je voudrais qu’instruits par mon exemple, les pères et les mères fussent d’une extrême circonspection sur ce point. »
Tels sont les « grands péchés » de jeunesse que Thérèse pleura toute sa vie… Souvent, au cours de l’histoire de sa vie, le mot de péché va revenir sur les lèvres de Thérèse. N’oublions pas en l’écoutant que ses humbles aveux ne sont pas à prendre à la lettre ; car plus une âme est sainte et plus elle frémit au moindre effleurement du mal.
Entrée au monastère de l’Incarnation d’Avila.
Cette effervescence de jeunesse ne fut pas de longue durée. Don Alonzo de Cepeda profita du mariage de sa fille Marie pour placer Thérèse comme pensionnaire chez les Augustines de Notre-Dame de Grâce. Elle avait alors seize ans. Après huit jours de nostalgie profonde, la jeune fille goûta la paix : « Je me trouvais beaucoup plus heureuse dans cet asile que dans la maison de mon père. » Cela ne l’empêchait pas de sentir un « éloignement mortel » pour la vie du cloître. Toutefois l’entretien d’une sainte religieuse, Marie Briceno, diminuait insensiblement sa répulsion, et faisait renaître en elle la pensée et le désir des choses éternelles. Peu à peu elle devenait soumise à la volonté divine, mais elle aurait bien voulu que « le bon plaisir de Dieu ne l’appelât pas à la vie religieuse ».
Sur ces entrefaites, elle tomba malade et passa quelques jours de convalescence chez son oncle Sanchez de Cepeda, qui était un grand serviteur de Dieu. A la faveur des entretiens qu’elle eut avec le saint homme, le néant de tous les biens qui passent lui apparut aussi vivement que pendant son enfance, mais sa volonté moins souple qu’à sept ans résistait à l’appel. « Alors, dit-elle, je me décidai à me faire violence ! » Usant de ruse contre elle-même, elle commença par déclarer à son père sa détermination de prendre le voile, car en vraie fille castillane, elle savait que rien au monde ne lui ferait reprendre sa parole donnée. Don Alonzo refusa son consentement. Thérèse sentit qu’en cédant à son père, elle se perdait à jamais. Alors elle s’enfuit avec son frère Antoine. Antoine entra chez les Dominicains de Santo-Tomàs, Thérèse frappa à la porte des Carmélites de l’Incarnation d’Avila.
On hésita à la recevoir, d’abord parce qu’on ne voulait pas se brouiller avec don Alonzo, ensuite parce que le couvent était pauvre et que Thérèse n’apportait pas sa dot.
Après deux mois et demi de résistance, le père se rendit enfin et signa par-devant notaire l’acte de dotation. Alors Thérèse put revêtir la bure de postulante (2 novembre 1536).
Les étapes de la sainteté.
Lorsque je reçus l’habit, le Seigneur me fit comprendre combien il favorise ceux qui s’imposent violence pour le servir. A l’instant même, il versa dans mon âme une si grande satisfaction de mon état, que rien n’a pu l’altérer jusqu’à ce jour.
Réaction bienfaisante après la froide immersion dans la vie claustrale que son âme appréhendait si fort, douceur de la paix intérieure à la suite d’une lutte douloureuse, assurance intime d’occuper enfin sa place providentielle, crainte de l’enfer à tout jamais bannie, et par-dessus tout l’ineffable don de la grâce de Dieu ! C’est de tous ces éléments de joie qu’est faite la « grande satisfaction » de la petite postulante au moment où elle pose sa sandale sur le premier degré de la voie montante qui doit la conduire aux cimes de la vie parfaite. Mais qu’elle ne s’y trompe pas ; la souffrance va la ressaisir, et elle sera torturée jusqu’en haut.
Son âme était d’une essence telle qu’elle ne pouvait pas échapper au martyre intérieur. Elle unissait à une sensibilité avide et frémissante un esprit lucide et profond. Quand ils ont la foi et quand surtout la grâce les favorise d’illuminations spéciales, des êtres aussi richement doués ne sont jamais en paix avant de jouir de Dieu. Très vite, dès sa tendre enfance, la petite Thérèse a découvert le mensonge des biens terrestres. C’est fini ! elle n’en goûtera jamais paisiblement la saveur ! Que faire en ce monde ? Où puiser le vrai bonheur dont son cœur est altéré ? A l’ombre du cloître ; c’est là qu’il jaillit du sein même de Dieu. Mais pendant vingt ans Dieu va lui paraître bien lointain et bien froid !
Je n’avais pas alors, il me semble, l’amour de Dieu… Mais une lumière me faisait voir le peu de valeur de ce qui doit finir et au contraire le très grand prix des biens qui s’acquièrent par cet amour, car ils sont éternels.
Les grâces d’illumination lui sont données, c’est le cœur qui n’est pas rempli. Alors ce pauvre cœur, sevré de joies surnaturelles, s’accroche en dépit d’elle-même aux biens délicats mais humains dont la vie de communauté n’est pas avare pour une nature d’élite comme la sienne. Du reste, il faut reconnaître que le cloître d’Avila s’ouvre largement sur le monde. Au parloir et dans sa petite chambre ornée joliment d’objets pieux, Thérèse reçoit sa famille et ses amis. On converse bien agréablement en brodant les nappes d’autel, les aubes de lin et les chasubles soyeuses. Oh ! sans doute, la langue aussi bien que l’aiguille travaille à la gloire de Dieu et des Saints. Mais quel prédicateur est assez surnaturel pour ne pas prêter l’oreille au son de sa voix quand il la sait éloquente ? Et quelle sainte religieuse peut, en les déployant dans un but d’édification, rester elle-même insensible aux charmes de son esprit et aux grâces de sa personne ?
Surtout, surtout, c’est le cœur de Thérèse, son cœur aimant, qui s’attache avec ferveur à ceux qui l’admirent et qui lui témoignent de l’affection. Evidemment, son amour ressemble à son âme. Il est toujours très idéal et très pur. Mais elle se complaît excessivement dans cette douceur d’aimer. Elle partage l’encens de son cœur entre Dieu et les créatures ; elle essaye de boire aux deux coupes.
Ainsi le sacrifice qu’elle avait eu l’impression de consommer une fois pour toutes en prenant le voile était à recommencer chaque jour. Le monde qu’elle avait cru laisser à la porte du cloître, le monde habitait en elle et partageait son cœur avec Dieu ; et elle ne se sentait pas la force de lui retirer sa part !
Torture mystique que seule la grâce pouvait apaiser !
Ajoutez qu’une âme si vibrante ébranlait à tout moment une santé toujours défaillante, car Thérèse souffrit toute sa vie de maux extraordinaires ; l’enveloppe matérielle était comme impuissante à contenir les mouvements impétueux de l’esprit !
Arrive enfin l’heure de Dieu : Thérèse est âgée de quarante ans. Voici bientôt vingt ans qu’elle est au cloître, ménageant les exigences du monde et celles de Dieu, remettant toujours au lendemain le don total d’elle-même. Un jour, un Ecce Homo déposé dans son oratoire s’anime, palpite et saigne en sa présence. Thérèse se jette aux pieds du Christ et le supplie de lui « accorder une bonne fois la force de ne plus l’offenser ». La lecture des Confessions de saint Augustin dont elle fait son modèle achève de la déterminer à s’amender sans retard et sans retour. Elle prolonge ses oraisons et ses intimités avec Notre-Seigneur.
Enfin le dernier lien du cœur qui l’attachait tendrement à ce qu’elle appelle « les mauvaises occasions », disons à ses amitiés excessives, se brisa à tout jamais. Dans cette circonstance très solennelle de sa vie écoutons-la parler elle-même :
Un jour, comme j’étais restée longtemps en oraison, suppliant le Seigneur de m’aider à le contenter en tout, je commençai l’hymne, et pendant que je le disais, il me vint un ravissement si subit qu’il me tira pour ainsi dire hors de moi-même : fait dont je ne peux absolument pas douter, car il fut très connu. C’est la première fois que le Seigneur me fit cette grâce des ravissements. J’entendis ces paroles : « Je ne veux plus que tu converses avec les hommes, mais avec les anges. »
Thérèse comprit les exigences du Christ. Elle brisa aussitôt les derniers liens qui la retenaient à des affections trop chères. Elle eut encore des amis ; mais elle ne leur témoigna plus cette tendresse passionnée, dont le Seigneur se réservait à lui-même les élans impétueux. Alors Thérèse entra dans la possession de Dieu ! Le Christ la choisit pour épouse !
C’était le 18 novembre 1572. Thérèse allait communier. Notre-Seigneur lui adressa ces paroles : « Ne crains pas, ma fille, personne ne peut te séparer de moi. »
Ensuite, dit Thérèse, se montrant à moi, dans le plus intime de mon âme, il nie donna sa main droite et me dit : « Regarde ce clou, c’est la marque et le gage que dès ce jour tu seras mon épouse ; jusqu’à présent tu ne l’avais point mérité : à l’avenir non seulement tu verras en moi ton Créateur, ton Roi et ton Dieu, mais tu amas soin de mon honneur comme ma véritable épouse : mon honneur est le tien ; ton honneur est le mien… » Cette grâce fut si puissante que j’étais comme ravie hors de moi, et dans ce transport, je dis au Seigneur : « Transformez ma bassesse ou épargnez-moi une telle faveur ! » Il me semblait, en effet, qu’elle était excessive pour ma faible nature. Je demeurai ainsi tout le jour profondément ravie. Depuis lors, j’ai éprouvé les effets merveilleux de cette grâce ; et, d’un autre côté, je suis plus confuse et plus affligée que jamais, quand je vois combien je suis loin d’y répondre ! »
C’en est fait : le rêve ingénu de la petite Thérèse, les aspirations douloureuses de la Carmélite altérée d’amour infini se réalisent dès ici-bas. Elle jouit du bonheur qui doit durer « toujours, toujours ». Visions, ravissements, extases deviennent ses états presque habituels, faveurs mystiques qui loin d’énerver ses facultés d’action leur communiquent, au contraire, une énergie surhumaine.
Œuvres extérieures : réforme du Carmel et fondations.
Notre-Seigneur avait ordonné à Thérèse de s’employer à la réforme de son Ordre selon la règle primitive. Il lui avait promis qu’il serait fidèlement servi dans ces nouveaux monastères, et qu’il se plairait avec les âmes qui les habiteraient. La Sainte Vierge et saint Joseph étaient venus eux-mêmes encourager la Carmélite dans une apparition. Malgré toutes les difficultés de l’entreprise, et bien qu’il fût inouï qu’une simple femme se mêlât de réformer un grand Ordre religieux, Thérèse, sans raisonner, sans calculer, s’était mise à la disposition du divin Maître. Autorisée par ses supérieurs et par un bref de Pie IV, elle avait pu fonder à Avila, au prix de tribulations sans nombre, le premier couvent des Carmélites Déchaussées, qu’elle plaça sous le vocable de « son glorieux père saint Joseph » (27 août 1562). Ce fut en Europe la première église dédiée au saint Patriarche.
Depuis, tous les chemins de l’Espagne l’avaient vue passer, poursuivant son œuvre sans relâche, courant d’une ville à l’autre, supportant toutes les fatigues, surmontant tous les obstacles, luttant sans se lasser contre les dégoûts, les dédains, la pauvreté, la persécution. Avec le concours d’un admirable Saint, saint Jean de la Croix, elle avait étendu aux Carmes le bienfait de la réforme. Jusqu’à son dernier souffle, elle ne devait cesser de travailler à sa propagation ; et lorsqu’enfin elle mourra à la tâche, faible femme sans ressources, elle aura fondé trente-deux monastères : dix-sept de Carmélites et quinze de Carmes Déchaussés.
Ses miracles et ses livres.
Le Seigneur ne cessa de confirmer par d’éclatants miracles la mission qu’il avait donnée à sa servante. Lorsqu’on bâtissait le premier couvent de la Réforme, Saint-Joseph d’Avila, une muraille en s’effondrant avait enseveli sous ses pierres un jeune enfant, Gonzalve de Ovalle, neveu de la Sainte. Thérèse se mit aussitôt en prières, prit l’enfant entre ses bras et le rendit vivant à sa mère.
Mais le plus grand miracle de sainte Thérèse, ce sont ses divins ouvrages. L’Eglise en a qualifié sa doctrine de céleste dans l’oraison de sa fête et elle souhaite que tous les fidèles s’en nourrissent.
Outre tous les présents de la divine munificence dont le Tout-Puissant voulut orner son épouse bien-aimée, dit Grégoire XV, il la remplit encore de l’esprit d’intelligence, afin que non seulement elle laissât dans l’Eglise de Dieu les exemples de ses vertus, mais qu’elle l’arrosât en même temps, par autant de sources fécondes qu’elle nous a légué d’écrits sur la théologie mystique et autres sujets, écrits dont les fidèles retirent les fruits les plus abondants, et qu’ils me sauraient lire sans sentir s’allumer dans leurs âmes un désir ardent de la céleste patrie.
Elle meurt, à Albe, consumée par le divin amour.
L’obéissance l’avait conduite à Albe, malgré l’entier épuisement de ses forces (20 septembre 1582). Le jour de la fête de saint Michel, elle fit venir le P. Antoine de Jésus, et demanda les derniers sacrements. Comme il s’apprêtait à lui porter le Viatique, elle dit aux religieuses qui l’entouraient :
— Mes filles, je vous demande pour l’amour de Dieu de garder fidèlement les règles et constitutions de notre Ordre.
Lorsqu’elle vit entrer le Saint Sacrement dans sa cellule, elle voulut descendre de son lit, mais on l’en empêcha.
— Mon Seigneur est mon Epoux, dit-elle ; le moment après lequel je soupirais avec tant d’ardeur est enfin arrivé.
Elle remercia Dieu de l’avoir fait naître catholique. On l’entendit répéter souvent : « Vous ne rejetterez point, Seigneur, un cœur contrit et humilié. » Puis elle entra en extase, et y demeura quatorze heures, jusqu’à sa mort. Enfin, l’effort de l’amour brisant les derniers liens du corps, ainsi qu’elle le révéla à la Mère Catherine de Jésus, elle expira doucement sur les 9 heures du soir. C’était le jeudi 4 octobre de l’an 1582. Elle était âgée de soixante-sept ans.
L’année même où mourut sainte Thérèse, Grégoire XIII opéra la réforme du calendrier, alors en retard de dix jours ; cette réforme était applicable précisément dans la nuit du 4 au 5 octobre, c’est-à-dire le jour même de la mort de la Sainte, ce qui fait que le lendemain se trouva être le 15. Et c’est cette date qui a été choisie pour sa fête.
Elle fut canonisée par Grégoire XV le 12 mars 1622 ; sa fête a été élevée au rite double par Clément IX le 11 septembre 1668.
Le cœur de sainte Thérèse, ainsi que son corps, se vénère au Carmel d’Albe de Tormes.
A. B. Sources consultées. — Henri Joly, Sainte Thérèse (Collection Les Saints). — Marcel Bouix, S. J., La vie de sainte Thérèse (traduction de l’ouvrage du P. François de Ribéra ; Paris, 1864). — Louis Bertrand, Sainte Thérèse (Paris, 1927). — (F. S. B. P., nos 123, 124, 142, 609 et 1180.)