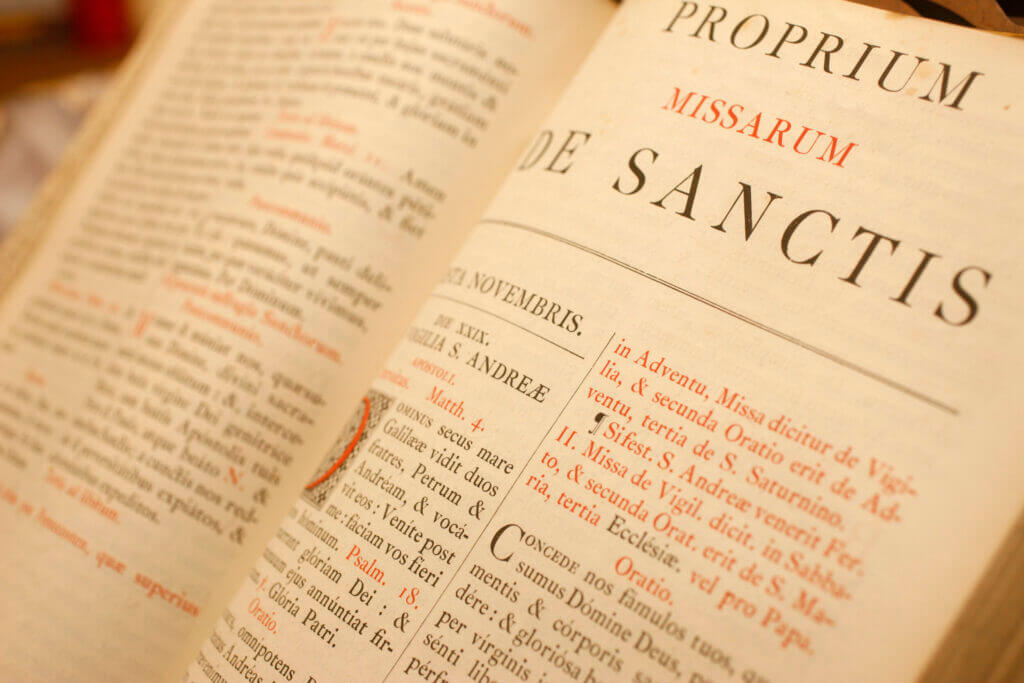Réunis à Lourdes du 5 au 10 novembre dernier, les évêques de France ont traité de la question de la pédophilie.
Le 7 mai 2019, le président de la Conférence des Évêques de France, Mgr de Moulins-Beaufort, avait estimé que cette question était un « problème systémique » « mal traité pendant longtemps ».
Pourquoi une telle difficulté à affronter cette éprouvante question ? Entre erreur et inconséquence, retour sur quelques principes.
La Porte Latine
Le 5 avril 2016, Mgr Stanislas Lalanne a été interrogé sur les ondes de RCF –Radios chrétiennes francophones– au sujet de la pédophilie. Sujet brûlant s’il en est après les semaines de lynchage médiatique orchestré contre le Card. Barbarin. A la question de savoir s’il s’agit d’un péché, l’évêque de Pontoise a répondu :
« La pédophilie est un mal. Est-ce que c’est de l’ordre du péché ? Ça, je ne saurai le dire, c’est différent pour chaque personne. Mais c’est un mal et la première chose à faire, c’est de protéger les victimes ou les éventuelles victimes. »
La réaction des auditeurs, des médias et Mme Najat Vallaud-Belkacem ne s’est pas fait attendre : Mgr Lalanne a été sommé de clarifier sa position. Ce qu’il a fait le soir même dans un communiqué qui précisait entre autres :
« La pédophilie, dans tous les cas, est un péché objectivement grave, “un crime atroce qui offense Dieu et blesse la dignité de la personne humaine créée à son image” (Benoît XVI). La question difficile qui se pose pour chaque cas, c’est le degré de conscience et donc de responsabilité de celui qui commet des actes aussi atroces. Dans tous les cas, l’acte est gravement condamnable. »
Notons au passage le pharisaïsme des suppôts de l’inquisition laïque. Pour s’en convaincre, il suffit de remplacer « pédophilie » par « homosexualité » dans la réponse initiale de l’évêque. Ainsi modifiés, ses propos n’auraient pas manqué de provoquer un tollé chez ses censeurs… mais en sens contraire.
Un soutien inattendu
À trois jours près, le prélat français aurait pu trouver un soutien de poids à ses déclarations. En effet, dans l’exhortation apostolique publiée le 8 avril 2016, on lit sous la plume du pape :
« A cause des conditionnements ou des facteurs atténuants, il est possible que, dans une situation objective de péché –qui n’est pas subjectivement imputable ou qui ne l’est pas pleinement– l’on puisse vivre dans la grâce de Dieu, qu’on puisse aimer, et qu’on puisse également grandir dans la vie de la grâce et dans la charité, en recevant à cet effet de l’aide l’Église. » (Pape François, Exhortation apostolique Amoris lætitia, 19 mars 2016, n° 305)
Quant à cette aide de l’Église, le document précise que « dans certains cas, il peut s’agir aussi de l’aide des sacrements » (Ibid., note 351).
Comme le communiqué épiscopal, l’exhortation pontificale distingue avec raison la dimension objective et la dimension subjective du péché. Il arrive en effet qu’un acte objectivement désordonné ne soit pas subjectivement imputable. C’est le cas lorsque la violence, la crainte, l’ignorance ou la convoitise diminuent ou suppriment la dimension volontaire de l’acte.
Mais, pour n’être pas imputable, l’acte mauvais en devient-il bon, au point de permettre l’accès aux sacrements comme le suggère Amoris lætitia ?
Sincérité et vérité
Pour répondre à la question, examinons le cas d’un scientifique qui calcule la trajectoire d’une fusée. Il est possible que le savant se trompe dans ses calculs et que son erreur ne soit due ni à sa paresse ni à sa négligence, mais à sa fatigue causée par un surcroît de travail. Que l’erreur ne soit pas moralement imputable, est-ce suffisant pour rendre justes des calculs faux et programmer la trajectoire correcte de la fusée ? Certainement pas. En fait, l’erreur ayant été constatée, la trajectoire sera recalculée avant le lancement de la fusée. Ici, pas plus qu’ailleurs, sincérité ne rime pas avec vérité.
Que nombre de personnes vivent dans une situation objective de péché sans se rendre compte de la gravité de leur état, c’est possible. Que cette ignorance puisse être compatible avec l’état de grâce, c’est également envisageable –pourvu que l’ignorance ne soit pas elle-même volontaire. Mais, du caractère non coupable de cette ignorance, Dieu seul est témoin. Aussi, les ministres du Christ ne sauraient-ils administrer les sacrements de la pénitence et de l’eucharistie à ceux qui persistent à vivre publiquement dans une situation objective de péché. En l’absence d’éléments contraires, ils doivent supposer que l’agir extérieur correspond à l’intention profonde de celui qui agit. Ils veilleront donc à éclairer les consciences obscurcies, à obtenir les corrections nécessaires et à disposer les âmes à la digne réception des sacrements.
Aucun pasteur ne saurait s’accommoder d’une situation où il faut présumer de la bonne foi et de l’ignorance invincible du pécheur pour que celui-ci fasse son salut. Si une telle présomption était de mise, pourquoi le bon pasteur se mettrait-il en quête de la brebis perdue ?
En réalité, « si Jésus a été bon pour les égarés et les pécheurs, il n’a pas respecté leurs convictions erronées, quelque sincères qu’elles parussent ; il les a aimés pour les instruire, les convertir et les sauver » (Saint Pie X, Encyclique Notre charge apostolique, 25 août 1910).
Retour à Vatican II
La confusion sous-jacente à l’exhortation apostolique Amoris lætitia affleurait déjà dans la déclaration sur la liberté religieuse.
Résumant la doctrine de ses prédécesseurs, Pie XII enseignait que « ce qui ne répond pas à la vérité et à la morale n’a objectivement aucun droit à l’existence, ni à la propagande, ni à l’action » (Discours à des juristes italiens, 6 décembre 1953).
L’exercice public des faux cultes ne peut donc se prévaloir d’aucun droit, même s’il peut parfois faire l’objet d’une tolérance. Bref, l’erreur –même non imputable– reste un mal qui ne fonde aucun droit dans l’espace public.
Inversement, le concile Vatican II « déclare que la personne humaine a droit à la liberté religieuse », ce qui signifie « qu’en matière religieuse nul ne doit être forcé d’agir contre sa conscience ni empêché d’agir, dans de justes limites, selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d’autres » (Dignitatis humanæ, n° 2).
D’une tolérance ponctuelle et prudentielle, on est passé à un droit naturel fondé sur la dignité humaine. L’exercice public de n’importe quel culte –vrai ou faux– est désormais considéré comme un bien, puisqu’il est fait l’objet d’un droit. La mention des justes limites qui doivent en encadrer la réalisation le confirme, car le mal est toujours à éviter alors que le bien doit être pratiqué avec poids et mesure.
Paradoxalement, Jean-Paul II –pourtant chantre de la liberté religieuse– rappelle dans l’encyclique Veritatis splendor que le mal commis à cause d’une ignorance invincible ou d’une erreur de jugement non coupable, s’il n’est pas imputable à la personne qui le commet, « n’en demeure pas moins un mal, un désordre par rapport à la vérité sur le bien. En outre, le bien non reconnu ne contribue pas à la progression morale de la personne qui l’accomplit : il ne lui confère aucune perfection et ne l’aide pas à se tourner vers le Bien suprême » (n° 63).
Là où le pape François fait preuve de logique en appliquant le même raisonnement faux à la liberté religieuse et à la communion des divorcés remariés, Jean-Paul II fait preuve d’inconséquence en refusant d’appliquer à l’exercice public des cultes faux le même raisonnement vrai qu’à la situation des divorcés remariés.
Puissent ceux qui saisissent aujourd’hui la confusion dont est grosse l’exhortation apostolique en tirer les conséquences pour la liberté religieuse enseignée par Vatican II.
Abbé François Knittel, prêtre de la FSSPX
Sources : La Lettre de Saint Florent n° 222 de juin 2016 /La Porte Latine du 15 novembre 2019