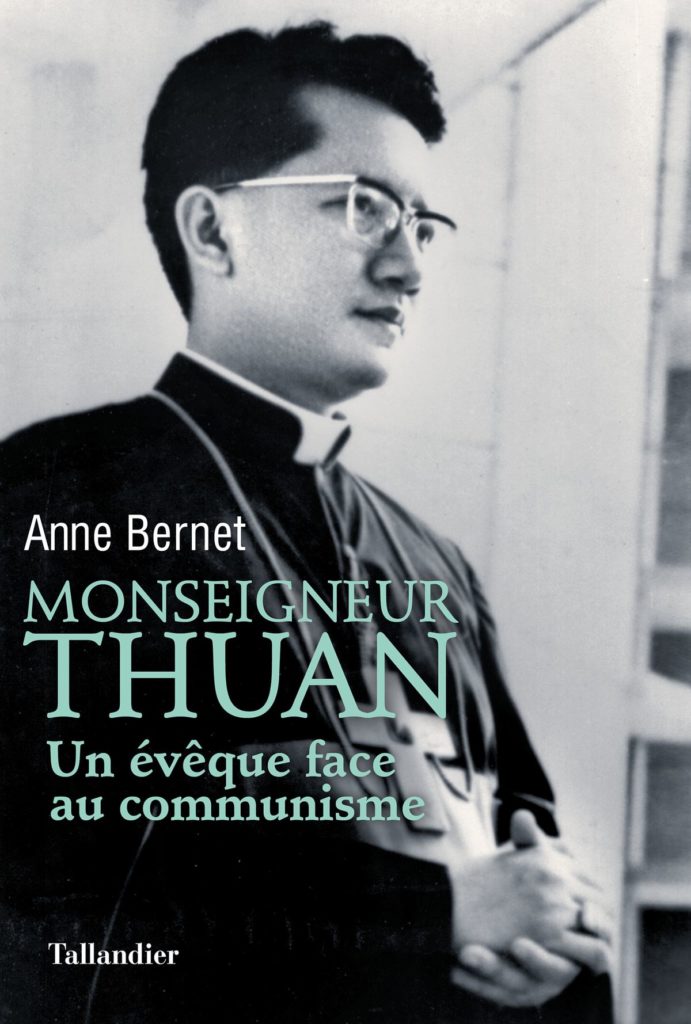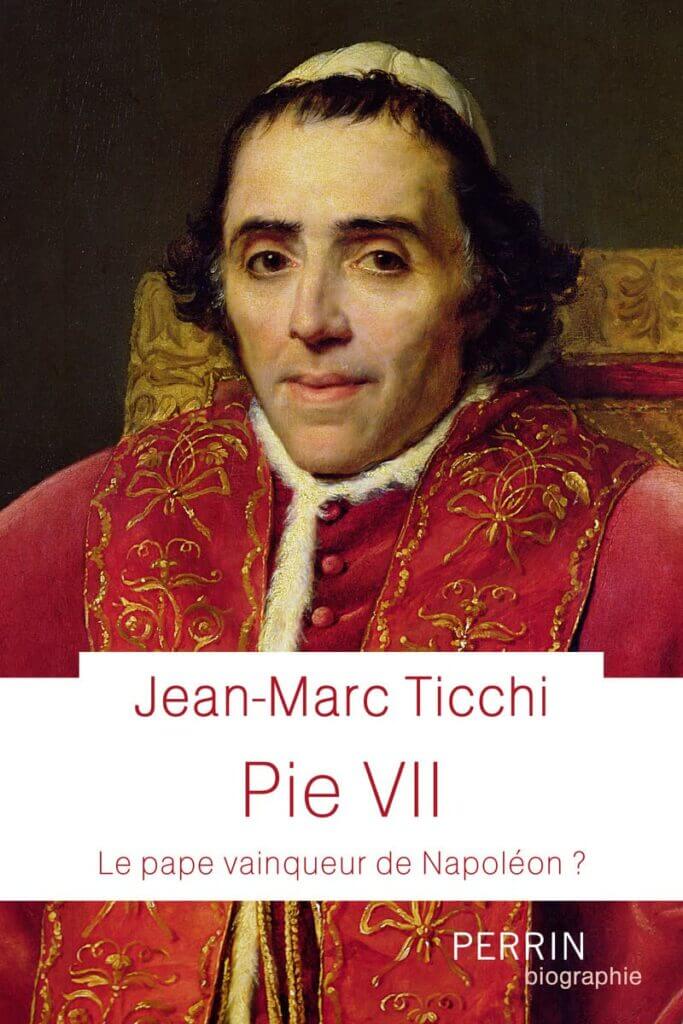Gabriel GARCIA-MORENO (1821–1875)
PRESIDENT CATHOLIQUE de la REPUBIQUE DE L’EQUATEUR
Gabriel GARCIA-MORENO naquit la veille de Noël de l’an 1821, à Guayaquil, port principal de l’Equateur. Il était le huitième et dernier enfant d’une famille jadis opulente que les révolutions successives avaient réduit à la pauvreté.
C’était un enfant peureux que tout épouvanté : l’orage, les ténèbres, la vue d’un cadavre… Son père réussit partiellement à le guérir de ses terreurs en l’obligeant tout jeune encore à en affronter les causes, dans une ville livrée aux horreurs, violences et dangers quotidiens. Il surmonta si bien ce handicap que, plus tard, il abordera les situations les plus dramatiques avec un sang froid et un courage devant lesquels ses pires ennemis durent s’incliner.
Un charitable religieux ayant remarqué l’intelligence et les dons exceptionnels de cet enfant pauvre, s’intéressa à lui. Il commença son éducation puis le confia à deux dames sans fortune qui l’accueillirent chez elles, à Quito, la capitale du pays, afin qu’il put y poursuivre ses études à l’université. Il avait quinze ans et trouvait chez ces dames un foyer où le logement et la nourriture lui étaient offerts généreusement. Le jeune garçon reconnaissant, mena sous leur toit une vie austère, toute consacrée au travail, obtenant de si brillants résultats qu’ils attirèrent sur lui l’attention générale.
D’une piété profonde, le jeune homme songea un moment à se consacrer à Dieu, mais il comprit vite qu’il était fait pour le combat. En attendant, l’étude était pour lui une véritable passion et son unique distraction, chaque matière nouvelle le reposant de la précédente. Il apprit ainsi les langues : le français, l’anglais, l’italien, qu’il parlait avec aisance. De toutes les disciplines abordées, ses préférences allaient vers les mathématiques et la chimie. Cette passion pour l’étude lui faisait limiter par trop son temps de sommeil et il fit une grave névrose qui lui imposa un long temps de repos.
A la faveur de ces loisirs forcés, il fit la connaissance des salons qui s’ouvrirent tout grands devant ce beau jeune homme de 20 ans au visage régulier éclairé de grands yeux noirs, doué d’esprit et de qualités de cœur. Le renom de ses succès universitaires éclatants l’avait précédé. Recherché, fêté, flatté, il se prit à aimer les mondanités. Lorsqu’il en eût conscience, pour couper court à la tentation, il se rasa la tête et s’enferma à nouveau avec ses livres. Au bout de six semaines il reparut, mais il avait perdu définitivement le goût des frivolités. A 23 ans, le métier d’avocat ne le retint pas et il s’orienta vers la politique.
On était en 1839 et le général Florès avait été élu premier président de la jeune république équatorienne pour un mandat de 4 ans. La situation lui plut et il tourna donc la constitution afin de prolonger de huit ans des pouvoirs quasi absolus, appliquant une politique anticléricale et absolument arbitraire aboutissant à une révolution qui le chassa du pays. Garcia-Moreno qui s’était engagé dans la lutte n’eut pas longtemps à se réjouir de ce succès car son successeur, Roca, profita de sa situation pour s’enrichir au détriment de ses administrés. Indigné, Garcia-Moreno fonda le journal « Le Fouet » pour dénoncer tous les scandales du gouvernement. Or, trois mois n’étaient pas écoulés que la menace d’une invasion espagnole conduite par Florès interrompit la publication, remplacée par « Le Vengeur » destiné à informé le pays du danger, y intéresser anglais et américains qui s’interposèrent, évitant un conflit.
Les luttes d’influences ne tardèrent pas à se manifester à Guayaquil, la mettant à feu et à sang. Roca désemparé, fit appel à Garcia-Moreno. Malgré qu’il fut malade à ce moment, il n’hésita pas à arriver pour trouver une foule en délire à laquelle il sut si bien s’imposer que huit jours lui suffirent pour ramener l’ordre et le calme. Il refusa toute rétribution afin de garder les mains libres, sachant qu’il lui faudrait attaquer ce gouvernement corrompu sans tarder. Il avait 26 ans.
Le journal « Le Fouet » fut remplacé par « Le Diable » dont la virulence ne corrigea pas les maîtres du jour et eut peu d’impact sur le peuple. Voyant ses efforts à sauver le pays inutiles, Garcia-Moreno quitta l’Equateur et pendant six mois, parcourut l’Angleterre, la France et l’Allemagne, tirant comme conclusion à ses observations qu’une nation sans religion oscille entre l’anarchie et la dictature. Il s’était promis de renoncer désormais à la politique, mais les circonstances en décidèrent autrement avec la rencontre qu’il fit de religieux jésuites expulsés de la Nouvelle Grenade sous régime maçonnique intolérant. Garcia-Moreno retrouvant sa pugnacité proposa aux exilés de les mener à Quito d’où leur Ordre avait été chassé depuis près d’un siècle et où leur enseignement serait bien utile. Cette initiative était audacieuse or, la Convention accueillit les religieux avec chaleur et la ville, avec enthousiasme.
La franc-maçonnerie ne tarda pas à partir en guerre contre ces jésuites. Garcia-Moreno les défendit, sachant qu’après eux, c’était l’Eglise qu’ils viseraient, puis les prêtres, et enfin, tous les catholiques. Son énergique intervention ramena un calme momentané car, en 1851, un coup d’état porta à la présidence, Urbina, l’homme de toutes les traîtrises, inaugurant son mandat par la terreur et l’expulsion des jésuites.
Garcia-Moreno entama donc une campagne de presse virulente contre le dictateur avec « La Nation » dont le premier numéro lui attira les menaces du nouveau président auxquelles Garcia-Moreno répondit :
- « J’avais déjà de nombreux motifs de poursuivre mon action ; j’en ai maintenant un de plus, celui de ne pas me déshonorer en cédant à des menaces. »
La parution du n°2 lui valut un arrêté d’expulsion mais, échappant à ses gardiens, il rentra secrètement à Quito. Faute de moyens, il dût cependant s’expatrier. Quelques semaines plus tard, les électeurs de Guayaquil le nommaient sénateur et, à l’ouverture du congrès, il était présent. Bien que son nouveau titre l’ait rendu inviolable, Urbina se plaçant au-dessus des lois le fit déporter au Pérou, sur la plage déserte de Payta où il demeura 18 mois avec pour toute compagnie la lecture et l’étude. A la fin de cette période, il partit pour Paris, s’installa au quartier latin d’où il approfondit ses connaissances en chimie. Il avait 33 ans et les circonstances le ramenaient à une ardente pratique religieuse qu’il ne devait plus abandonner.
En Equateur cependant, le mandat d’Urbina dont celui-ci avait profité pour persécuter l’Eglise, opprimer le peuple et dilapider l’argent des contribuables, se terminait. Dès son accession, son successeur, Roblez, rouvrit le pays aux exilés et, en 1856, après deux ans passés à Paris, Garcia-Moreno rentrait en Equateur où, à peine arrivé, il fut nommé recteur de l’université de Quito. Son activité et ses compétences lui permirent de créer une faculté des sciences où il donnait lui-même les cours de chimie tout en réorganisant l’enseignement.
La politique pour Garcia-Moreno finissait toujours par reprendre ses droits et, en raison de l’approche des élections, il lançait « l’Union Nationale » pour tenter de regrouper les opposants au gouvernement. Malgré la majorité obtenue par l’opposition, on vit Urbina venir épauler Roblez. Selon son habitude, Garcia-Moreno refusa de se dérober et, entouré des tueurs qui n’attendaient qu’un signe pour agir, sans le moindre mouvement d’émotion, Garcia-Moreno parla avec une telle force et une telle éloquence que les « tauras » (assassins) déconcertés, sortirent en tremblant alors que lui-même était ramené chez lui en triomphe.
La situation n’en fut pas pour autant clarifiée, Urbina et Roblez s’étant attribué tous les pouvoirs.Une période de violence inouïe obligea Garcia-Moreno à se réfugier précipitamment au Pérou laissant derrière lui un pays en effervescence, proclamant la déchéance de Roblez et un gouvernement provisoire dont lui-même était nommé le chef. Accourant, il lança un nouveau journal dont le titre annonçait le but : « A bas les tyrans » ; mais ces tyrans disposaient d’une armée et non le gouvernement provisoire.
Sur ces entre faits, Franco, gouverneur de Guayaquil éliminait le président en poste et pour se donner une apparence de légalité il se présenta seul aux électeurs, obtenant 161 voix dont 160 allant spontanément à Garcia-Moreno qui ne s’était pas présenté, l’infime majorité obtenue par Franco se situant uniquement dans sa province et non dans le pays.
Garcia-Moreno le voyant pactiser avec l’ennemi péruvien, s’occupa de recruter et de former une armée, de créer et de diriger une fabrique d’armes et de poudre, d’administrer les affaires et de tenter une activité prodigieuse et toujours sous la menace d’un assassinat. Un jour, d’ailleurs, il fut assailli par une troupe soudoyée par Franco pour l’éliminer. Poursuivi à travers les défilés montagneux, dans la forêt tropicale, cet homme extraordinaire franchit des escarpements réputés impraticables avec une rapidité qui découragea ses poursuivants. Arrivé enfin à Riobamba parmi des troupes fidèles, il éprouvait un urgent besoin de repos et dormait d’un profond sommeil lorsqu’il fut brutalement tiré par une révolte de la garnison. Un officier vint insolemment lui réclamer sa démission :
– « Jamais ! » répondit-il et devant l’attitude menaçante de son interlocuteur :
- « Vous pouvez briser ma vie, mais aucun d’entre vous n’est assez fort pour briser ma volonté ! »
Les insurgés le jetèrent donc en prison.
Un ami lui envoya son serviteur, lui conseillant de s’évader par la fenêtre, un cheval scellé étant tenu à sa disposition :
- « Dites à votre maître, répondit-il, que je sortirai par la porte comme j’y suis entré. »
Et il tint parole.
Au garde préposé à sa surveillance, il demanda :
« A qui as-tu fait serment de fidélité ? »
« Au chef de l’Etat. »
« Eh bien, le chef légitime de l’Etat, c’est moi. Tes officiers sont des parjures. N’as-tu pas honte de leur prêter main forte et de trahir ainsi ton Dieu et ton pays ? »
Le soldat effrayé, tombant à genoux, demanda grâce.
« Je te ferai grâce si tu veux m’obéir et faire ton devoir. »
Quelques instants après, le prisonnier libéré galopait, bride abattue, retrouver 14 fidèles avec lesquels il retournait à la caserne de Riobamba où les mutins étaient ivres ou endormis. Leurs meneurs appréhendés furent immédiatement jugés sur la place publique. Constatant cependant la disparition de plusieurs compagnies, avec sa mince escorte renforcée de quelques braves, la nuit suivante, il se lançait à la poursuite des fuyards qu’il neutralisa dans le désordre et la confusion causés par la surprise de sa venue, nul n’ayant imaginé le si petit nombre des assaillants. Ainsi, grâce à son audace, à son sang froid et à un courage invincible, il avait, une fois encore, rétabli l’ordre.
Le nouveau chef du gouvernement allait avoir besoin de son inébranlable énergie car, en novembre 1859, Franco venait d’ouvrir les frontières du pays à 6 000 péruviens auxquels il était prêt à céder une partie du pays en échange de leur aide contre Garcia-Moreno.
La situation était si grave que celui-ci en fut effrayé, songeant même, un moment, à solliciter le protectorat de la France. La démarche n’ayant pas abouti, il prépara le pays à la défense. Par son énergie et un sens aigu de la stratégie, Garcia-Moreno, contournant des forces largement supérieures, les mit en fuite ne laissant plus que Guayaguil à Franco, lequel proposait le démembrement du pays au Pérou, toujours en échange de son aide militaire.
La position de Guayaquil paraissait imprenable or, Garcia-Moreno simulant une attaque d’un côté, fit passer de nuit son armée entière avec ses canons, par des marais inextricables, réputés impénétrables. La surprise totale assura la victoire aux assaillants et Franco s’enfuit sur un navire péruvien. C’était le 24 septembre 1860, en la fête de N.D. de la Merci. Le pays était sauvé contre toute attente et Garcia-Moreno plaça l’armée sous la protection de N.D. de la Merci, le gouvernement et elle, devant désormais fêter solennellement cet anniversaire.
Depuis 15 ans, Garcia-Moreno combattait sans relâche contre les factions qui déchiraient le pays. A 39 ans, il en était devenu le chef incontesté ; il fut élu à l’unanimité président de la République. Tout était à faire maintenant dans un pays dévasté et ruiné. Sa première décision fut de refuser la moitié du traitement qui lui était attribué, l’autre moitié étant réservée intégralement aux bonnes œuvres, vivant lui-même sur ses modestes revenus personnels.
L’armée dût se plier à une stricte discipline, inconnue jusqu’alors. Sans attendre, un concordat fut conclu avec Rome, consacrant l’indépendance de l’Eglise. La religion catholique devenait la religion de l’Etat à l’exclusion de toute autre, lui donnant toute autorité dans le secteur de l’enseignement. A ce stade, les sociétés secrètes se déchaînèrent contre le nouveau président, orchestrées par la presse américaine.
De l’étranger, Urbina intriguait pour renverser le pouvoir, trouvant, en Nouvelle Grenade, l’appui du président Mosquera, ennemi acharné de l’Eglise, qui rêvait de conquérir l’Equateur et le Vénézuela à son profit. Le 15 août, il annonça son intention de remplacer « l’oppression théocratique » par les doctrines radicales.
Il fallait donc recourir à nouveau à la force, mais l’armée était divisée. Trahie par des officiers, elle fut défaite et, cette fois encore, Garcia-Moreno se trouvait dans une situation angoissante. Dans une proclamation au peuple, il lui rendit courage et, contre toute attente, une nouvelle armée put s’opposer aux ambitions de Mosquera qui, en dépit de toutes ses tentatives, dût renoncer à s’emparer de l’Equateur.
La guerre était terminée mais Garcia-Moreno, toujours en difficulté avec des éléments hostiles, envoya sa démission. Tout le pays, y compris ses adversaires effrayés, l’assurèrent de leur adhésion à toute sa politique pour éviter de le voir abandonner la direction du pays qui sembla donc s’acheminer enfin vers le calme. Voyant l’échec de leurs entreprises de déstabilisation, les francs-maçons ne virent plus que la solution de l’assassinat. Ils trouvèrent des traîtres : le général Maldonado et l’aide de camp de Garcia-Moreno qui, averti à la dernière minute, échappa à la mort.
Urbina, pendant ce temps, avait conclu un accord avec le Pérou, introduisant une troupe de pirates dans une province de l’Equateur pendant que des vaisseaux péruviens débarquaient des troupes sur différents points de la côte. Dans ce moment critique, le général Maldonado qui s’était enfui, fut pris. Garcia-Moreno le fit immédiatement fusiller sur la grande place, intimidant par cette mesure les partisans d’Urbina. Les péruviens se retiraient ; les tentatives du Pérou avaient échoué. Le pays était à nouveau sauvé grâce à l’extraordinaire force de caractère de Garcia-Moreno dont l’autorité se trouvait renforcée. Il n’était cependant pas au bout de ses peines car les révolutionnaires furieux, arraisonnèrent par surprise l’unique bateau de guerre de l’Equateur.
Garcia-Moreno, à ce moment-là était malade et au repos forcé. Cependant, à l’annonce de cette nouvelle, il partit immédiatement en pleine nuit pour Quito, en dépit de ses difficultés de santé. De Quito, il prit la direction de Guayaquil qu’il atteignit en trois jours, à marche forcée, à travers une région montagneuse, inextricable, dépourvue de voie de communication. Il arriva en pleine nuit, surprenant un conseil municipal urbiniste hostile. Le voyant, un employé affolé, fit irruption dans la salle du conseil en criant : « Garcia-Moreno ». La foudre n’aurait pas produit plus d’effet sur cette assemblée qui s’enfuit précipitamment s’enfermer chacun chez soi. Telle était l’aura de cet homme que, seul et désarmé, son nom suffisait à mettre ses ennemis en fuite. Le calme était revenu comme par enchantement dans la ville.
Puis on vit ce que peut faire la volonté et l’esprit de décision d’un homme d’une telle valeur : louant « le Talca », un vapeur anglais, Garcia-Moreno l’arma puis, au capitaine qui refusait de remplacer le drapeau anglais par celui de l’Equateur, il le ramena à l’obéissance en lui disant avec un regard terrible :
« Je vais vous faire fusiller sur le champ et votre drapeau vous servira de linceul ! »
Précédé d’un petit vapeur qui servait d’éclaireur au « Talca », Garcia-Moreno partit pour une nouvelle expédition maritime d’une hardiesse folle, avec seulement 250 soldats déterminés, dont nul ne pensait qu’il reviendrait vivant.
Le lendemain, le « Talca » retrouvait les trois vaisseaux ennemis dont les capitaines dînaient joyeusement. La goélette fondit comme l’éclair sur le premier qui sombra sous le choc. Le reste de la flotte, prise au dépourvu tombait entre les mains de Garcia-Moreno. C’était une déconfiture totale de l’adversaire et, dès lors, Urbina cessa de s’attaquer à une personnalité de cette trempe.
Parti de Quito assez gravement malade, Garcia-Moreno y revenait guéri pour y être reçu en triomphe ; mais il désirait abandonner un pouvoir épuisant, maintenant qu’il avait écarté successivement de l’Equateur tous ses ennemis. Il nomma Carion pour le remplacer. Le nouveau président manquant d’énergie, laissa l’opposition reprendre pied dans le pays dont Garcia-Moreno avait été éloigné avec une mission diplomatique au Chili. Ses ennemis pensaient qu’on pourrait lui interdire son retour et trouver, sur place, des tueurs à gages. De fait, débarquant à Lima, Viteri, parent d’Urbina tira sur lui à bout portant, le blessant légèrement. Garcia-Moreno, avec sa rapidité de réaction habituelle, s’élançant sur lui, déviait la troisième balle. La franc-maçonnerie acquitta immédiatement son agresseur, cherchant par contre le moyen de le condamner sans cependant y parvenir.
Sa mission accomplie et le pouvoir ne l’ayant pas enrichi, l’ex-président dût travailler, rejoignant son frère dans une branche commerciale, à Guayaquil. Le mandat de Carion fut un échec complet. Garcia-Moreno réussit à le convaincre de se démettre en faveur du scrupuleux Espinosa qui fut tout aussi incapable de diriger fermement le pays. Attristé de ne pouvoir trouver un homme énergique, Garcia-Moreno se retira à la campagne où sa santé avait bien besoin de se rétablir que tant de luttes avaient ébranlé. Veuf de sa première femme, il avait épousé l’une de ses nièces, Mariana de Alcazar qui vivait dans l’angoisse en raison des menaces permanentes qui pesaient sur son mari. Le ménage s’était retiré dans la province d’Harra, loin de la vie publique, dans une propriété agricole que Garcia-Moreno avait résolu d’exploiter lui-même.
Après un an de retraite, il refusa de se présenter à l’élection présidentielle ainsi qu’on le pressait de le faire. Cet homme exceptionnel s’estimait incapable de gouverner convenablement son pays mais lorsqu’un partisan d’Urbina se présenta, il sortit subitement de son isolement pour lui barrer la route. Le résultat fut immédiat : le candidat adverse se retira devant cet homme si fort. Les révolutionnaires ourdirent une nouvelle fois de le faire assassiner…
A Guayaquil, la situation était redevenue explosive. Garcia-Moreno y partait sans délai avec une poignée d’amis, mais c’est seul qu’il se présentait, de nuit à la caserne .
« Qui vive » ! cria la sentinelle.
« Garcia-Moreno. »
Le soldat qui l’avait acclamé bien des fois se troubla, lui demandant ce qu’il voulait à pareille heure.
- « Je veux sauver la religion et la patrie. Tu me connais ; laisses-moi passer. »
Et la sentinelle de crier :
- « Vive Garcia-Moreno » !
En un instant, toute la caserne retentissait du même cri, répercuté quelques heures après dans toute la ville.
Les projets d’Urbina étaient déjoués et Garcia-Moreno recevait le titre de président intérimaire, annonçant en même temps qu’une fois l’ordre rétabli, il quitterait le pouvoir. Ni les pressions, ni supplications ne le firent revenir sur cette décision. Son beau-frère, Manuel Ascabuti fut ainsi élu à la présidence à titre provisoire, avec une convention nouvelle, élaborée par Garcia-Moreno, commençant ainsi :
« Au nom de la Sainte Trinité, au nom de Dieu, Auteur, Conservateur et Législateur de l’univers… »
L’Eglise recevait la protection officielle du pouvoir temporel. L’Etat se proclamait catholique, seule religion du pays, tout membre d’une société secrète était déchu de ses droits de citoyen. La pression populaire en faveur de Garcia-Moreno fut si forte et unanime que, malgré son opposition, il fut contraint d’accepter sa nomination à la présidence. Le 30 juillet 1869, il prêtait donc serment, y ajoutant :
« Si je tiens parole, que Dieu soit mon aide et ma défense ! Sinon, que Dieu et la patrie soient mes juges. »
L’insurrection muselée n’avait plus que le poignard pour agir. Un complot fut découvert dont les protagonistes furent condamnés à mort. L’un deux, Cornejo, vint supplier Garcia-Moreno avec tant de pleurs et de cris, qu’ému par sa jeunesse et un repentir apparent si violent que le nouveau président le gracia. Or, à peine libéré, il passa la frontière, se répandant en pamphlets odieux contre lui. Instruit par ces faits, à une occasion suivante, Garcia-Moreno répondit par une sévère leçon aux pétitions en faveur des conjurés :
« Quand on reste sourd aux cris des victimes, on perd le droit d’invoquer la clémence en faveur des assassins. »
Dès ce moment, un calme, inconnu du pays depuis tant d’années s’y établit, permettant enfin à Garcia-Moreno la réalisation de son vaste et ambitieux programme. Il put également mettre en application le souhait de sainte Thérèse qui disait :
Oh ! Si les chefs d’Etat faisaient une demi-heure d’oraison chaque jour, que la face de la terre serait renouvelée » !
C’est bien ce qu’il fit : en dépit d’un programme de travail quotidien accablant qui aurait pu occuper plusieurs personnes, il se réservait une demi-heure chaque matin pour réfléchir sur ses devoirs, méditer le plus souvent sur un passage de l’Evangile, puis il entendait la messe. De même, il visitait chaque jour les malades de l’hôpital de la ville où il se trouvait, se préoccupant des soins qu’ils recevaient et de leur nourriture. A un malade qui trouvait à redire sur l’ordinaire, il fit la réponse suivante :
« Mon ami, je ne suis pas si bien servi que vous, moi, le président de la République. »
Il resta, effectivement, sa vie durant, d’une sobriété extrême, s’abstenant habituellement de vin.
Un jour, trouvant de nombreux malades couchés par terre sur des nattes, il s’en étonnait auprès du gouverneur de la province qui l’accompagnait, lequel invoqua le manque de ressources :
« Cela ne vous empêche pas de dormir confortablement, vous qui êtes bien portant, alors que ceux-ci qui souffrent doivent coucher par terre. »
Le gouverneur promit que le nécessaire serait fait dans quelques semaines.
« Dans quelques semaines ! s’écria Garcia-Moreno. Ils n’ont pas le temps d’attendre. Vous coucherez ici, ce soir, à côté d’eux, sur une natte et il en sera ainsi jusqu’à ce que vous ayez procuré un lit à chacun d’eux. »
Avant la fin du jour, le gouverneur avait résolu le problème.
Au début de sa première présidence, sa femme essaya de le persuader d’offrir un grand banquet aux diplomates et aux ministres. Il prétexta de la modicité de ses ressources.
« Qu’à cela ne tienne. Voici 500 piastres sur ma fortune personnelle. Allez donc et faites dignement les choses. »
A son retour, elle lui demanda si la somme avait suffi ?
« Parfaitement, répondit-il en riant. Je l’ai portée à l’hôpital où l’on a fait un magnifique festin en notre honneur. J’ai pensé qu’un bon dîner ferait plus de bien aux malades qu’aux diplomates. »
Un autre jour, on le vit arriver à l’improviste chez les lépreux, s’asseoir à leur table pour juger lui-même de quelle manière ils étaient servis. Jugeant l’ordinaire insuffisant, il le fit améliorer. Autant on le vit intraitable sur des sanctions qui lui paraissaient nécessaires, autant les humbles trouvaient toujours en lui un défenseur. Un jour, une pauvre veuve vint en pleurant, se plaindre qu’un homme riche lui avait extorqué 10 000 piastres.
« Donnez 10 000 piastres à cette femme », dit-il à son trésorier »
« Et qui les remboursera » ? demanda ce dernier. »
« Le voleur. Inscrivez la somme à son compte. »
Il se préoccupa du sort des indiens, spoliés par des usuriers auxquels il faisait confisquer la chose prise, avant de les expulser du pays. La charité de cet homme s’étendait à tous les secteurs dont les prisonniers n’étaient pas exclus. En tout, il agissait en parfait chrétien, disant :
« Puisque nous avons le bonheur d’être catholiques, soyons-le logiquement et franchement, dans la vie publique comme dans la vie privée.
En six ans, Garcia-Moreno transforma l’Equateur de fond en comble.
Il commença par rendre l’école gratuite et obligatoire dans le primaire avec des enseignants catholiques. Il fit venir de France des jésuites qu’il chargea d’ouvrir des collèges pour les garçons des classes favorisées ; les dames du Sacré-Cœur étant chargées d’une tâche similaire pour les filles. A Quito, une école professionnelle formait des ouvriers qualifiés. Une faculté des sciences s’ouvrit à Quito ainsi qu’une faculté de médecine, une académie des Beaux-Arts, un observatoire pour les études astronomiques.
Le président réussit à donner à ce peuple inculte, le goût de l’étude.
Sur le plan du réseau routier, à son arrivée, l’Equateur était un véritable chaos de montagnes et de précipices entrecoupés de torrents, au milieu d’une végétation tropicale luxuriante et inextricable sans la moindre route or, après 10 ans d’efforts, d’énormes ponts et viaducs permettaient l’inauguration d’une route nationale reliant Quito à Guayaquil et à la mer. Quatre autres grandes voies de communication au nord et au sud, ouvraient au pays de riches perspectives au commerce et à la libre circulation.
Garcia-Moreno avait trouvé le trésor vide et un pays aux abois. Or, des travaux considérables dans tous les secteurs, loin d’avoir endetté le pays, grâce à une gestion méticuleuse, prudente et équilibrée, ennemie acharnée du gaspillage, était devenu florissant. Garcia-Moreno avait élevé le traitement des agents de l’Etat d’un tiers, sauf le sien, diminué de moitié. Le commerce connaissait une merveilleuse extension ; les revenus de l’Etat avaient doublé en trois ans.
Conscient de l’influence salutaire de la religion, Garcia-Moreno encourageait son extension, nommait des aumôniers dans les casernes pour l’instruction des soldats, envoyait des missionnaires chez les indiens, demandait que des curés s’installent dans les villes et les campagnes.
Il surveillait étroitement le fonctionnement des services publics, n’hésitant pas à réprimer les abus ou complaisances coupables. Une si haute moralité s’instaura dans tout le pays que la prison neuve resta inoccupée. Il n’avait pas fallu plus de six ans, durée d’un mandat pour que la valeur exceptionnelle d’un tel homme obtint tous ces résultats. Tout le peuple le vénérait, conscient de l’immense travail accompli.
En 1873 avait eu lieu la consécration officielle de cette jeune république au Sacré-Cœur dont la conséquence immédiate fut la condamnation à mort du président par la franc-maçonnerie des loges d’Allemagne dans ses assemblées secrètes, décision chaleureusement accueillie par les loges d’Amérique. Lima avait réuni des franc-maçons du Pérou, du Chili, de la Colombie et de l’Equateur qui n’avaient pu empêcher son élection. Une campagne de presse calomnieuse de leur fait n’ayant pas obtenu de meilleurs résultats, l’assassinat fut choisi, n’étant un secret pour personne. Garcia-Moreno en était informé de différents côtés. Sans s’émouvoir, il répondait :
« Je crains Dieu mais Dieu seul », rajoutant :
« Je pardonne de bon cœur à mes ennemis. Je leur ferai du bien si je les connaissais et si j’en avais l’occasion. »
Il ajoutait encore qu’il était content d’être détesté et calomnié à cause de Dieu et le serait plus encore s’il lui était accordé la grâce de verser son sang pour Celui qui, étant Dieu, avait voulu verser le sien pour nous sur la croix .Le pressentiment du drame l’emplissait cependant d’une profonde tristesse. A un ami en partance pour l’Europe, il lui disait en l’embrassant :
« Nous ne nous reverrons plus, je le sens, c’est notre dernier adieu », puis se détournant pour cacher ses larmes, il répéta :
« Adieu, nous ne nous reverrons plus. »
Quelques mois plus tard, il confirmait ses pressentiments à ce même ami auquel il écrivait :
« Je vais être assassiné. Je suis heureux de mourir pour ma foi. Nous nous reverrons au ciel. »
Son mandat venait d’être renouvelé pour six autres. Le 5 août 1875, il fut pressé de prendre des précautions :
« Les ennemis de Dieu et de l’Eglise peuvent me tuer, répondait-il. Dieu ne meurt pas. »
Le soir même, on le prévint que l’attenta était programmé pour le lendemain. Il ne modifia rien de son programme quotidien très chargé puis, passa une partie de la nuit en prières.
Le lendemain, 6 août, était à la fois le jour de la Transfiguration et premier vendredi du mois. Dès six heures du matin, selon son habitude, il se dirigeait vers l’église saint Dominique pour assister à la messe et recevoir la sainte communion. Les groupes des conjurés l’épiaient sur la place, mais ils n’osèrent rien faire à ce moment. A 13 heures, passant devant la cathédrale, Garcia-Moreno y entra pour une adoration avant de se rendre au palais du gouvernement. Comme il s’y attardait, l’un des conjurés vint lui dire qu’on désirait lui parler au palais pour une affaire pressante ; il sortit donc. Arrivé à l’entrée du palais, Rayo qui le suivait le frappa d’un énorme coutelas, suivi aussitôt des coups portés par ses comparses, armes blanches et révolver. Rayo acheva le moribond en criant :
« Meurs, bourreau de la liberté ! »
» Dieu ne meurt pas ! » furent les dernières paroles de Garcia-Moreno.
 La foule accourue, avait entouré Rayo, lui faisant payer immédiatement son crime. Ses poches étaient bourrées des chèques du Pérou. La franc-maçonnerie s’était montré généreuse, comptant qu’une révolution renverserait le gouvernement abhorré pour acclamer les « libérateurs ». IL n’en fut rien et tout le peuple vint de tout le pays, rendre un dernier hommage au vénéré martyr. Beaucoup pleurait amèrement, disant :
La foule accourue, avait entouré Rayo, lui faisant payer immédiatement son crime. Ses poches étaient bourrées des chèques du Pérou. La franc-maçonnerie s’était montré généreuse, comptant qu’une révolution renverserait le gouvernement abhorré pour acclamer les « libérateurs ». IL n’en fut rien et tout le peuple vint de tout le pays, rendre un dernier hommage au vénéré martyr. Beaucoup pleurait amèrement, disant :
« Nous avons perdu notre père. Il a donné son sang pour nous. »
Une heure avant de tomber sous les coups des tueurs, voici le message que Garcia-Moreno avait rédigé :
« J’achève dans quelques jours la période du mandat qui m’a été confié en 1869. La république a joui de six années de repos et, durant ces six années, elle a marché résolument dans la voie du progrès sous la protection visible de la Providence. Bien plus grands eussent été les résultats obtenus si j’avais possédé pour la gouverner les qualités qui me manquent malheureusement ou, si pour faire le bien, il suffisait de le désirer avec ardeur.
« Si j’ai commis des fautes, je vous en demande pardon mille et mille fois, et ce pardon, je le demande avec des larmes très sincères, à mes compatriotes, les priant de croire que ma volonté n’a jamais cessé de poursuivre leur bien. Si, au contraire, vous croyez que j’ai réussi en quelque chose, attribuez-en d’abord le mérite à Dieu et à l’Immaculée, dispensatrice de tous les trésors de sa miséricorde, puis à vous-même, au peuple, à l’armée et à tous ceux qui, dans les différentes branches du gouvernement, m’ont aidé avec tant d’intelligence et de fidélité, à remplir mes difficiles fonctions. »
Ces lignes reflétaient bien la hauteur humaine, morale et spirituelles de cet homme exceptionnel, et de façon providentielle laissait un témoignage de son passage et un message exemplaire aux générations qui allaient se succéder.
L’Equateur fit ériger une statue de marbre le représentant, sur son mausolée où fut gravée l’expression de l’amour et de la reconnaissance du pays.
G.T. – Toulouse, d’après le R.P. BERTHE