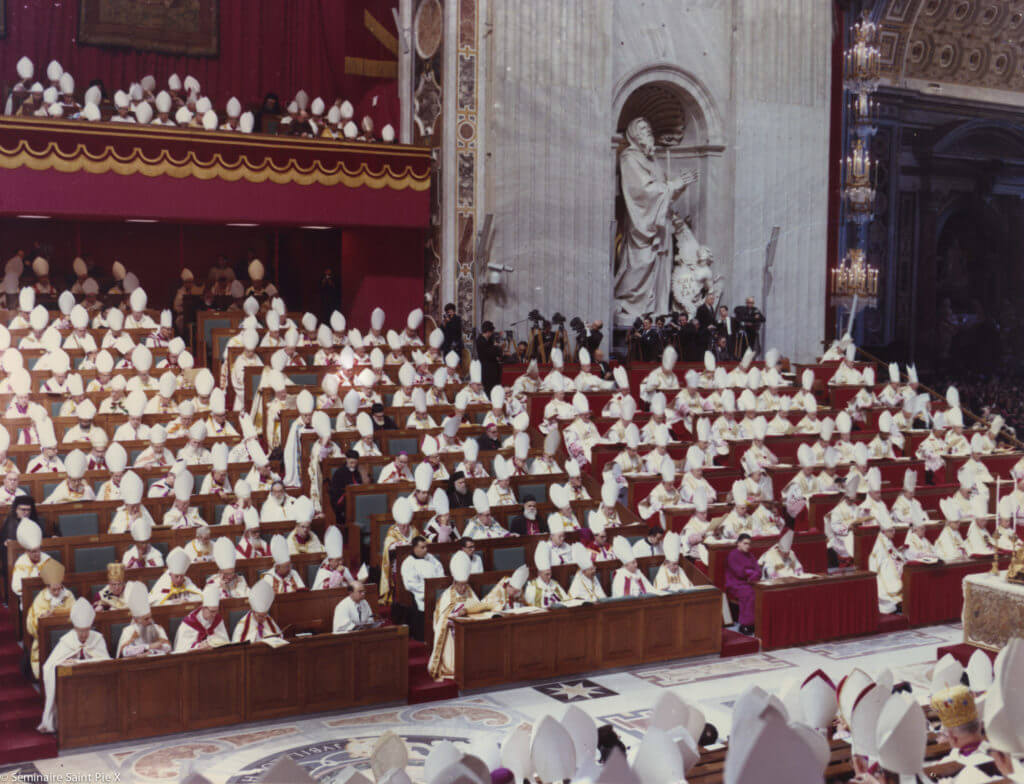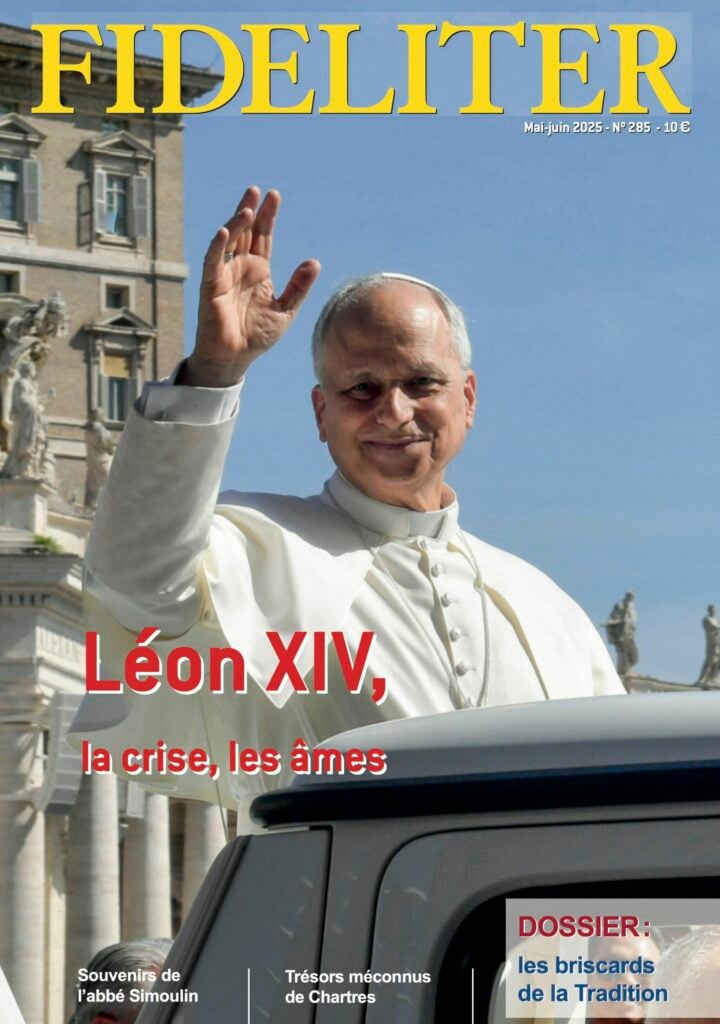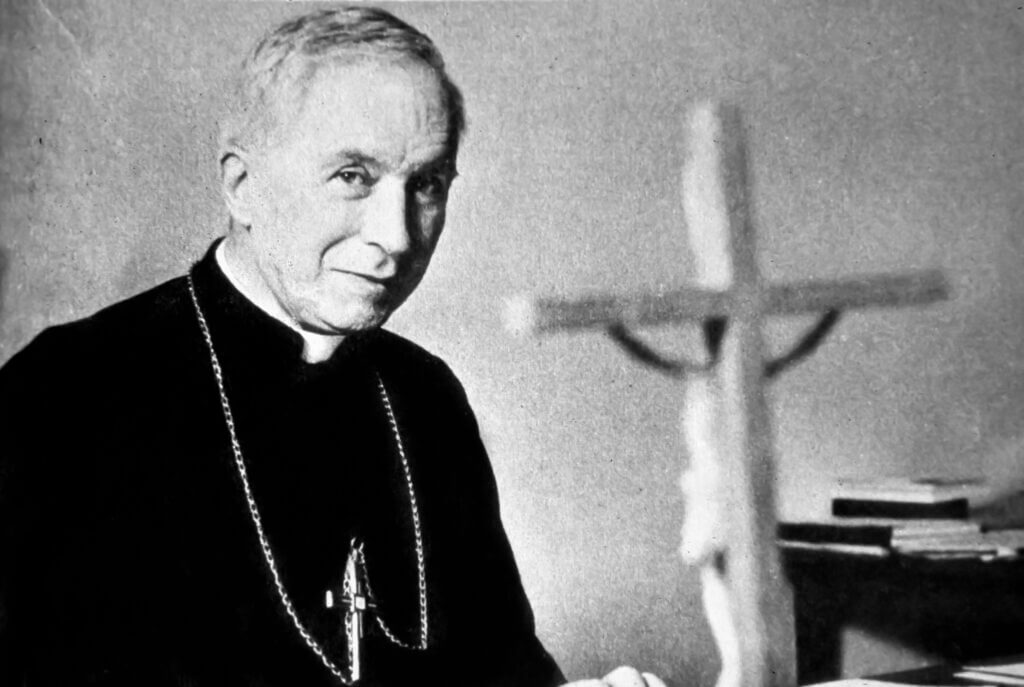A la lumière de la doctrine de Léon XIII, il est urgent de revenir au but premier de l’Eglise, le salut des âmes.
L’actualité de l’Eglise invite à se pencher sur la figure et sur l’enseignement du pape Léon XIII, dont le successeur actuel évoque volontiers la sollicitude en matière sociale, illustrée par l’encyclique Rerum novarum (1891). Le riche enseignement doctrinal du prédécesseur direct de saint Pie X concerne cependant bien d’autres domaines de la doctrine catholique, en particulier au sujet de l’Eglise dont il est question dans l’encyclique Satis cognitum (29 juin 1896) sur l’unité de l’Eglise.
Or comme l’Eglise est le prolongement de l’œuvre du Sauveur, la meilleure manière d’expliquer en quoi consiste son unité est de préciser son but :
Comme la mission divine [de Jésus-Christ] devait être durable et perpétuelle, Il s’est adjoint des disciples auxquels Il a fait part de Sa puissance, et ayant fait descendre sur eux du haut du ciel « l’Esprit de vérité », Il leur a ordonné de parcourir la terre entière et de prêcher fidèlement à toutes les nations ce que Lui-même avait enseigné et prescrit, afin qu’en professant Sa doctrine et en obéissant à Ses lois, le genre humain pût acquérir la sainteté sur la terre et, dans le ciel, l’éternel bonheur.
Tel est le plan d’après lequel l’Eglise a été constituée, tels sont les principes qui ont présidé à sa naissance.
Le rôle de l’Eglise est donc de conduire les âmes à la sainteté ici-bas, au ciel dans l’au-delà. C’est là l’œuvre principale et l’œuvre de civilisation, de pacification, la sollicitude pour les problèmes terrestres en découlent spontanément, tout en étant œuvre secondaire. La première mission est bien d’évangéliser, de transmettre la foi, car « celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, qui ne croira pas sera condamné »[1].
L’esprit de Vatican II, avec sa confiance optimiste dans les valeurs du monde contemporain, qui, « dans la mesure où elles procèdent du génie humain, qui est un don de Dieu, sont fort bonnes[2] », et sa logique de la liberté religieuse qui conduit à rendre timide l’affirmation publique de la foi catholique, a eu un effet imprévu, que Josef Ratzinger, alors archevêque de Munich, rapporte :
Récemment, j’ai reçu deux évêques sud-américains avec lesquels j’ai parlé de projets sociaux ainsi que d’expériences et d’efforts pastoraux. Ils m’ont parlé de la publicité intensive avec laquelle une centaine de dénominations chrétiennes se réclamant de la Réforme ont fait irruption dans le catholicisme traditionnel du pays et ont transformé le visage religieux du pays. Ils ont évoqué un résultat étrange qu’ils ont considéré comme symptomatique et qui les a obligés à faire un examen de conscience sur le cours de l’Église catholique sud-américaine depuis la fin du Concile. Ils ont raconté que les émissaires de certains villages sont venus voir l’évêque catholique et lui ont annoncé qu’ils avaient désormais rejoint une communauté évangélique. Ils ont profité de l’occasion pour remercier l’évêque de toutes les actions sociales qu’il avait menées pour eux au cours des années et qu’ils ont appréciées à leur juste valeur. « Mais nous avions aussi besoin d’une religion », disaient-ils, « et c’est pour cela que nous sommes devenus protestants. » Lors de telles rencontres, mes deux hôtes ont dit qu’ils avaient à nouveau pris conscience de la profonde religiosité qui habite les Indiens et les habitants de leur pays, et qu’ils avaient un peu négligée en pensant qu’il fallait d’abord développer et ensuite seulement évangéliser.
Josef Ratzinger, Theologische Prinzipienlehre, Wewel Verlag, 1982, p.139. Traduction française : Les principes de la théologie catholique, Téqui, 2005.
Les media commentent à l’envi les informations dont on dispose sur le nouveau pape, ils glosent sur ses tendances et attachent une grande importance à des thèmes tels que la paix dans le monde, les problèmes sociaux, l’écologie, la liberté des journalistes, les rapports avec les autres religions, mais aussi avec les chrétiens acatholiques, etc.
Romano Amerio avait dénoncé dans Iota Unum[3], cette erreur du « christianisme secondaire », qui consiste à juger de la religion par ses effets secondaires. Sa caricature est l’affirmation d’un pasteur protestant controversé, Martin Niemoller :
Le christianisme n’est pas du tout une religion, c’est un message qui vient de Dieu et que nous devons transmettre aux hommes pour qu’ils redeviennent des hommes. Cela n’a pas de rapports avec la religion. Il y a des religions beaucoup plus riches que la soi-disant religion du Nouveau Testament.
On a l’impression que les leçons de cette erreur n’ont pas encore porté. L’urgence dans l’Eglise est précisément de restaurer l’esprit de religion, c’est-à-dire de culte divin, en commençant par la prédication intégrale et précise de la foi, l’exhortation à la vie intérieure, la dignité de la liturgie, et pour cela la formation des prêtres. Le reste sera donné par surcroît. « Si je suis Père, où est le culte qui m’est dû[4] ? »
Nos prières accompagnent le nouveau pape pour accomplir cette œuvre.