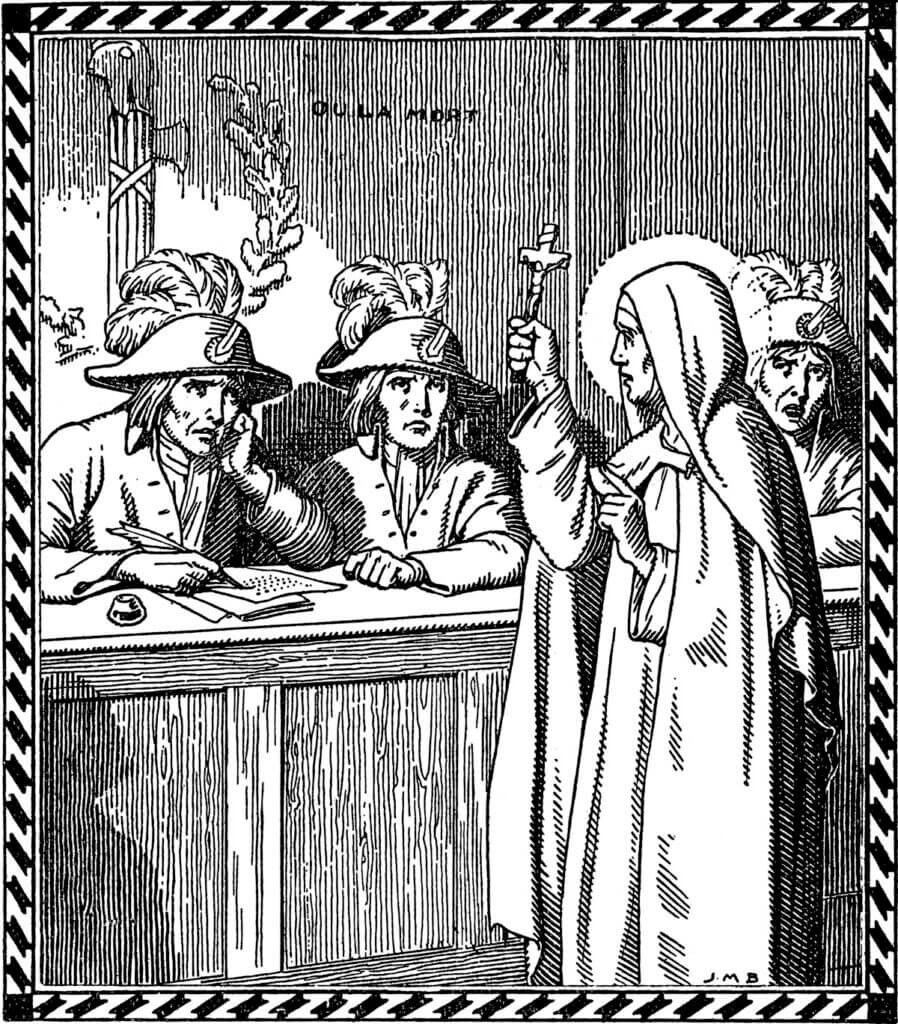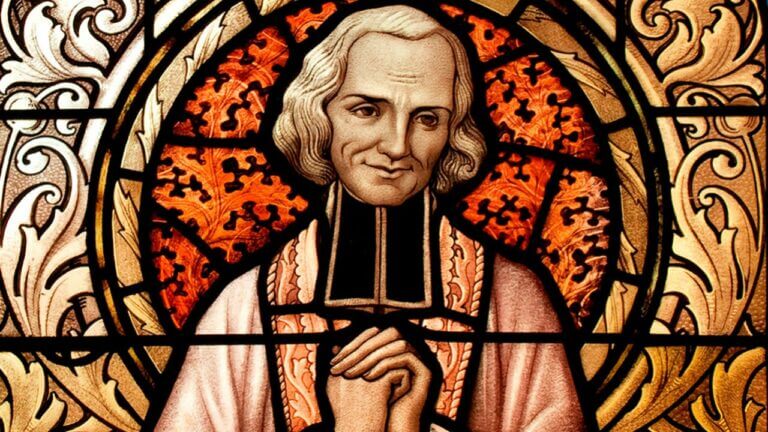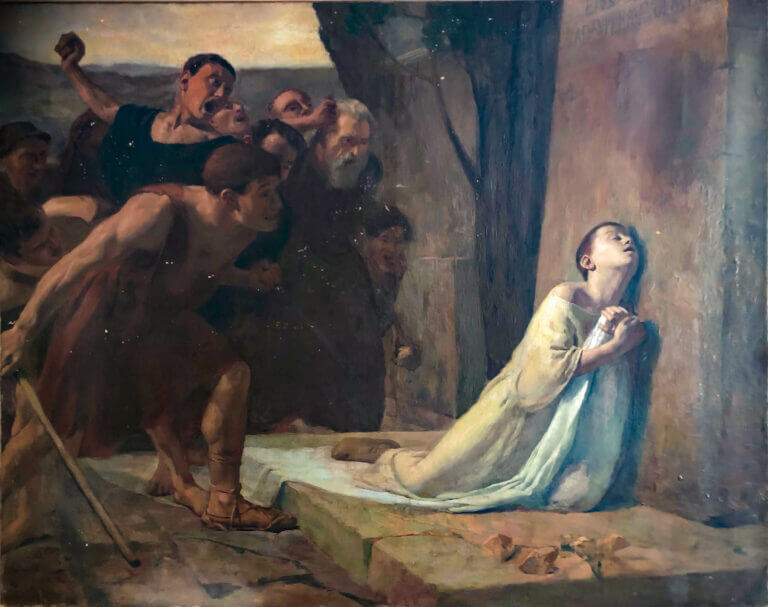Carmélite à Compiègne, et ses 15 compagnes martyres († 1794).
Fête le 17 juillet.

Durant la tourmente révolutionnaire de la fin du xviiie siècle, plusieurs religieuses Carmélites moururent sur l’échafaud. Dieu réservait à celles de Compiègne la faveur d’offrir toutes ensemble leur vie en holocauste et de verser leur sang virginal pour l’Eglise et pour la France. Pour le salut d’un peuple, dans la balance divine, un martyr pèse plus qu’un héros.
La prieure du Carmel de Compiègne en 1789.
Au début de la Révolution française, en 1789, le monastère des Carmélites de Compiègne, fondé en 1641, comptait seize religieuses de chœur, trois Sœurs converses et une novice ; deux tourières assuraient le service du dehors. La prieure alors en charge était la Mère Thérèse de Saint-Augustin. Née à Paris le 22 septembre 1752, elle s’appelait dans le monde Madeleine-Claudine Lidoine. Réunissant une solide piété à une belle intelligence que développa l’éducation la plus soignée, elle se sentit de bonne heure attirée vers le Carmel. Mais sa famille avait des ressources trop modestes pour pouvoir lui constituer la dot exigée pour l’entrée en religion. La Providence allait enlever cet obstacle. L’aspirante au Carmel trouva une protectrice dans la vénérable Thérèse de Saint-Augustin, dans le monde Madame Louise de France, une des filles de Louis XV, qui s’était faite Carmélite. Présentée à cette sainte religieuse, Madeleine-Claudine Lidoine lui fit une excellente impression : et la Mère Thérèse, pauvre elle-même, obtint de Marie-Antoinette, encore dauphine, qu’elle payât sur sa cassette la dot de la postulante. Elle destina sa protégée au monastère de Compiègne, avec lequel elle était en relations depuis de longues années.
Madeleine-Claudine entra donc au Carmel de Compiègne en août 1773 ; trois mois après, elle prenait l’habit religieux, et en mai 1775 elle faisait profession sous le nom de Thérèse de Saint-Augustin, c’est-à-dire sous le nom de son auguste protectrice, la prieure du Carmel de Saint-Denis. Ses remarquables qualités intellectuelles et morales, la fermeté de son caractère, sa douceur dans les relations, furent vite appréciées par ses supérieures et par ses compagnes de cloître. En 1785, elle fut élue prieure, puis réélue à l’expiration de son premier triennat. Elle montra dans l’exercice de sa fonction beaucoup de sagesse et de prudence : très dure pour elle-même, les privations qu’elle s’imposait étaient, à l’entendre, affaire de régime ; elle concentrait toute son attention sur les besoins de ses filles, leur procurant tous les secours possibles. Ferveur, piété, mansuétude, élan religieux, énergie, on ne savait ce que l’on devait le plus admirer dans cette religieuse destinée à préparer et à aider ses sœurs à cueillir l’auréole du martyre.
Premières vexations infligées aux Carmélites de Compiègne.
Le 26 octobre 1789, l’Assemblée constituante décrétait que désormais, dans les monastères, on ne ferait plus de vœux, la loi ne reconnaissant plus le vœu religieux. L’unique novice du Carmel de Compiègne, la Sœur Constance, née Meunier, n’eut donc pas la consolation de faire sa profession, mais elle resta novice.
Peu de temps après, confiscation des biens ecclésiastiques au profit de la nation, puis, le 13 février 1790, suppression des Ordres religieux eux-mêmes. Cependant, les religieuses sont autorisées à rester dans leurs maisons. Que de préoccupations naissaient pour la prieure, de ces mesures vexatoires et des incertitudes du lendemain ! Qu’allait devenir le monastère ? Que deviendraient ses religieuses privées de leurs dots ? La Mère Thérèse Lidoine conservait le calme et puisait dans la prière les forces et les lumières dont elle avait besoin pour l’exercice de sa charge. La communauté continuait sa vie régulière.
Le 4 août 1790, les membres du Directoire du district de Compiègne se présentent au Carmel et font l’inventaire des effets, argenterie, argent monnayé, livres et papiers, laissant du reste le tout à la charge et garde des religieuses. Le lendemain, ils revinrent ; placèrent des soldats en sentinelle aux portes des cellules, des cloîtres, de la grande salle. Le président fit appeler, une à une, les quinze religieuses de chœur et les trois Sœurs converses ; il les interrogea séparément, invitant chacune à parler sans crainte et à déclarer si elle voulait sortir du cloître et rentrer dans sa famille.
La prieure comparut la première. Elle déclara « vouloir vivre et mourir dans cette sainte maison ». Sans se laisser intimider, toutes les autres religieuses affirmèrent, sous des formes différentes, la même volonté et résolution : on a conservé la déclaration de chacune. Cette unanime fidélité à la vie religieuse et au Carmel causa une grande joie à la Mère Thérèse : elle était une force pour le présent et une garantie pour les terribles épreuves qui allaient atteindre la communauté.
Au mois de mai 1792, la Mère prieure se rendit à Paris, appelée par le prêtre qui avait autorité sur les Carmels, pour se concerter sur les précautions à prendre, l’attitude à garder devant les éventualités de l’avenir : on voulait aussi lui remettre des reliques de la bienheureuse Marie de l’Incarnation Acarie, béatifiée l’année précédente.
Expulsion du couvent. — Vie claustrale des sécularisées : elles offrent leur sang pour l’Eglise et pour la France.
L’Assemblée législative acheva l’œuvre néfaste de la Constituante au sujet des Ordres religieux. Deux fois déjà le costume religieux avait été déclaré illégal et prohibé. Le 17 août 1792, un décret décidait que, pour le 1er octobre suivant, les religieuses devaient évacuer leurs couvents qui seraient vendus. La Mère Thérèse Je Saint-Augustin se pourvut aussitôt de locaux en ville pour y loger ses sœurs. Afin de s’éviter de graves ennuis, toutes quittèrent l’habit religieux et se vêtirent comme des séculières. Des agents de la municipalité vinrent enlever la plus grande partie des objets inventoriés deux ans auparavant, ne laissant aux Carmélites que le strict nécessaire. Enfin, le 12 septembre, elles reçurent l’ordre d’abandonner immédiatement leur monastère.
La Mère prieure obtint pourtant deux jours de délai, et en la fête de l’Exaltation de la Sainte Croix, la communauté, qui comprenait alors vingt personnes, évacuait, les larmes aux yeux, sa chère maison. Les Sœurs furent partagées en quatre « groupes », logés dans des appartements différents, situés néanmoins dans le même quartier, proche de l’église Saint-Antoine, où le curé accorda aux sécularisées une chapelle spéciale. La prieure s’était arrangée pour sauvegarder, autant que possible, dans la dispersion, la vie de communauté, la pratique de la règle. Les vivres étaient préparés au domicile de la supérieure ; les tourières les portaient ensuite aux habitations des trois autres groupes. La prieure allait d’une maison à l’autre donner les avis, les exhortations, les permissions utiles. Dans chaque maison, on faisait à la même heure, comme au Carmel, les exercices de piété et les divers travaux prescrits par les Constitutions : en un mot, chaque groupe vivait comme une petite communauté, unie de cœur et d’action aux autres groupes.
Cinq jours après leur expulsion, toutes les religieuses furent réunies, sur l’ordre de la municipalité, à la résidence de la Mère prieure. Le maire leur fît signer le serment dit « de liberté et d’égalité », imposé à tous ceux qui étaient pensionnés par l’Etat. Ce serment n’avait rien de commun avec celui qu’exigeait la Constitution civile du clergé : les supérieurs ecclésiastiques le jugeaient licite. La prieure hésita cependant à signer ; elle ne s’exécuta qu’après avoir entendu les explications et les assurances données par le maire. Par cette signature, les Carmélites évitaient de se rendre suspectes, pouvaient recevoir la pension de l’Etat, épargnaient à la municipalité l’ennui de sévir contre elles. De fait, pendant les vingt et un mois qui vont suivre, elles ne furent pas inquiétées. Si, plus tard, elles regrettèrent leur serment et eurent à cœur de le rétracter, ce fut par excès de délicatesse de conscience.
Dans les derniers mois de cette année 1792, les Carmélites perdirent une de leurs sœurs ; l’abbé Conrouble, leur chapelain, dénoncé comme pouvant occasionner des troubles par son ministère, dut les quitter. Les parents de certaines religieuses essayèrent aussi, mais en vain, de les faire revenir près d’eux. Se conformant à l’esprit du Carmel, la prieure proposa à ses filles de faire un acte de consécration par lequel la communauté s’offrirait en holocauste pour apaiser la colère de Dieu et obtenir le retour de la paix dans l’Eglise et la nation. Cette consécration, cet holocauste de réparation et d’expiation, fut accepté par toutes et renouvelé chaque jour.
Ainsi, deux ans avant leur martyre, les Carmélites de Compiègne l’acceptent librement ; cet acte d’offrande de leur vie en holocauste d’expiation domine et explique leur conduite dans la suite, leur inébranlable cohésion, leur élan vers la mort.
L’année 1793 et les premiers mois de 1794 se passèrent sans apporter à la petite communauté de graves difficultés. En mars 1794, la supérieure permit, pour des raisons urgentes, à deux de ses religieuses de rester quelque temps dans leur famille et à une troisième de se rendre à Paris. A son tour, elle partit le 13 juin pour la capitale ; sa mère voulait la voir avant de se retirer dans le Doubs. Huit jours après, Mère Thérèse rentrait à Compiègne.
Perquisitions, arrestation et emprisonnement.
Or, ce jour-là même, 21 juin 1794, le Comité révolutionnaire et de Salut public de la ville décidait de perquisitionner dans les trois logements (par suite des départs et des décès, il restait seize Carmélites, la novice et les deux tourières comprises) des ci devant religieuses. Quoi de moins séditieux que les pièces saisies ! Des lettres où il était parlé de scapulaires, de prêtres, de neuvaines ; une relique de sainte Thérèse, un portrait du roi Louis XVI et une copie de son testament ; des images et un cantique en l’honneur du Sacré Cœur. C’était tout. Après examen des pièces, le Comité accusa les ci-devant Carmélites de vivre en communauté, d’avoir entre elles une correspondance criminelle tendant au rétablissement de la royauté, de faire des vœux pour la contre-révolution et la destruction de la République. Il les fit arrêter tout de suite, toutes, et on les écroua dans l’ancien couvent des Visitandines de la ville.
On les logea dans des chambres situées vis-à-vis de celles qu’occupaient les Bénédictines anglaises, arrêtées à Cambrai. Un mur de séparation fut construit pour empêcher les deux communautés de se voir et de communiquer. Dans cette prison où elles restèrent enfermées trois semaines, les Carmélites eurent à supporter des privations de tout genre. Elles eurent pourtant la joie de se retrouver en communauté et de pratiquer leur vie de prière un peu comme au Carmel. La prieure comprit que sa destinée et celle de ses Sœurs les acheminaient vers le sacrifice de leur vie et la réalisation de leur acte de consécration. Et craignant d’avoir offensé Dieu par le serment de liberté et d’égalité quelle avait prêté environ deux ans auparavant, elle le rétracta ainsi que ses compagnes.
Lessive inachevée. — En route pour la Conciergerie.
Le 12 juillet, quand arriva l’ordre de transférer immédiatement les Carmélites à Paris, celles-ci étaient occupées à laver leur pauvre linge. Longtemps, elles avaient sollicité la faveur de se procurer du linge nouveau ou de laver celui qu’elles portaient. Enfin, au bout de vingt jours seulement, on le leur accordait, sans toutefois leur laisser le temps d’achever la lessive commencée.
La Mère Thérèse supplie que l’on n’oblige pas les Sœurs à partir avec des effets mouillés ; elle demande aussi qu’on leur laisse terminer leur maigre repas avant de se mettre en route. Le maire, un ancien protégé du Carmel, lui répond grossièrement :
— Va, va, tu n’as besoin de rien, ni toi ni tes compagnes ; dépêchez-vous de descendre, les voitures sont là qui attendent.
Les Carmélites laissèrent là les objets mouillés qui leur appartenant ; le Comité en fît ensuite cadeau aux Bénédictines anglaises sous le beau prétexte que ces femmes « embéguinées, guimpées et revêtues comme elles l’étaient de costumes bigarrés, ne pouvaient qu’offenser les regards républicains ». Celles-ci conservèrent comme de précieuses reliques les bonnets et les fichus des martyres.
Les mains liées, les Carmélites furent installées sur deux voitures garnies de paille. Le convoi quitta Compiègne dans la soirée, sous l’escorte de gendarmes et de dragons. Sauf un court arrêt à Senlis pour changer d’attelage, on voyagea toute la nuit et on arriva à Paris vers 3 ou 4 heures de l’après-midi.
Le cortège pénétra sans incident dans la cour de la Conciergerie. On fit descendre les Sœurs de voiture, et comme la Sœur Charlotte de la Résurrection, religieuse âgée et infirme, ne pouvant s’aider d’un bâton ou du bras d’une de ses compagnes, car toutes étaient garrottées comme elle, attendait qu’on vînt la tirer de là, un farouche républicain, escaladant la charrette, prit brutalement la vénérable Sœur et la jeta sans pitié, comme un vulgaire fardeau, sur le pavé de la cour, où elle demeura sans mouvement, à demi morte et le visage couvert de sang.
Leur passage de cinq jours seulement à la Conciergerie fut pour les autres prisonniers comme une vision de paix. Un certain Denis Blot, détenu dans cette prison, mais jouissant d’une liberté relative, put leur rendre de légers services.
L’usage était, dans certains Carmels, de célébrer une fête ou un anniversaire par quelque poésie de circonstance. La vaillante prieure devait soutenir ses filles non seulement par ses exhortations et ses prières, mais par l’élan, l’enthousiasme dans le sacrifice. Elle, ou plus vraisemblablement la Mère Henriette de Jésus, sur sa demande, composa, dans la forme et sur Pair de la Marseillaise, quelques couplets sans prétention littéraire, mais qui sont comme le chant du combat. On l’écrivit avec du charbon de bois.
Devant le tribunal révolutionnaire. — Le sacrifice.
Le 17 juillet, lendemain de la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel, à 10 heures du matin, les Carmélites comparaissaient dans la grande salle dite de « la liberté ». On leur avait adjoint dix-huit autres personnes, ce qui faisait trente-quatre accusés à juger dans une séance. Le président du tribunal révolutionnaire était Toussaint-Gabriel Scellier (fils), né à Compiègne : sa dureté, son mépris des formes judiciaires, son insolence à l’égard des prévenus, étaient notoires. Avec son collègue Dumas, il rivalisait de rapidité sommaire dans ses jugements. Le greffier lut l’acte d’accusation. Il reprochait aux Carmélites d’avoir continué, depuis la Révolution à vivre comme des religieuses : dans les visites qu’elles se faisaient les unes aux autres, après leur sortie de leur couvent, elles conspiraient contre la République, comme le prouvaient le portrait du « tyran » (Louis XVI), les cœurs, la correspondance, le cantique du Sacré-Cœur, trouvés dans leurs logements. Des preuves matérielles et morales du délit de conspiration existaient ; dès lors, en vertu de l’article 13 de la loi du 22 prairial, le tribunal n’avait pas besoin d’entendre des témoins pour ou contre. De même, la loi n’accordait pas de défenseurs aux prévenus coupables du délit de conspiration.
Ni les pièces officielles, ni les archives du tribunal révolutionnaire, ni le témoignage d’un témoin oculaire, ne nous apportent les moindres renseignements sur ce qui se passa au sujet des Carmélites lors de cette audience. La prieure répondit seule probablement au nom de ses filles et revendiqua toute la responsabilité du prétendu délit de conspiration. On raconte cependant qu’une Sœur, entendant l’accusateur public leur reprocher à toutes leur « fanatisme », lui aurait demandé ce qu’il voulait dire.
— J’entends par là votre attachement à des croyances puériles, à de sottes pratiques de religion.
— Ma Mère et mes Sœurs, s’écria cette religieuse, félicitons-nous, nous allons mourir pour Dieu.
De fait, elles furent condamnées à mourir sur l’échafaud pour délit de fanatisme et de conspiration. Elles avaient, disait la sentence, formé des rassemblements et des conciliabules contre-révolutionnaires, entretenu des correspondances fanatiques, conservé des écrits liberticides ainsi que les caractères de ralliement (images et cantique du Sacré-Cœur) des rebelles de la Vendée. Fanatique et chrétien étaient alors des expressions synonymes, et s’entendre ainsi qualifier et condamner par ses juges, c’était obtenir la preuve orale et écrite d’une mort soufferte pour la cause de la foi.
A la lecture de l’arrêt de mort, l’une des tourières, Thérèse Soiron, fut prise de faiblesse et s’évanouit. La prieure pria un gendarme d’aller chercher un verre d’eau. La tourière reprit vite ses sens et, confuse de sa défaillance, s’en excusa. Il faut dire que les pauvres religieuses étaient à jeun depuis la veille. Une fois descendues de la salle du tribunal, la supérieure, avec le prix de vente d’une pelisse, procura à chacune une modeste collation.
L’exécution des condamnées à mort eut lieu dans la soirée de ce 17 juillet 1794. Les mains liées derrière le dos, les seize religieuses furent sans doute, sous l’œil vigilant de la prieure, placées sur la même charrette. Durant le long trajet de la Conciergerie à la place du Trône, aujourd’hui place de la Nation, elles se mirent à psalmodier les Complies, le Salve Regina, le Te Deum, et d’autres prières liturgiques sans doute. La charrette passa devant l’église Saint-Louis (maintenant Saint-Paul-Saint-Louis) ; sur les degrés se tenait sous un déguisement un prêtre, pas toujours le même, chargé de donner l’absolution aux victimes conduites à l’échafaud.
Arrivées au lieu d’exécution, les Carmélites descendent de leur charrette et se groupent autour de leur prieure. Point d’adieux ; toutes ensemble, elles renouvellent leurs vœux de religion. Quand leur tour fut venu (car il y avait ce soir-là, avec les religieuses, quatorze autres condamnés), elles entonnèrent le Veni Creator ; la plus jeune, Sœur Constance Meunier, novice depuis 1789, s’agenouilla devant la prieure, reçut sa bénédiction, lui demanda la permission de mourir, et monta à l’échafaud pour se présenter au bourreau. Ainsi firent tour à tour, au bruit des chants qui continuaient en s’affaiblissant, les autres religieuses. Assurée ainsi de la fidélité de ses filles à qui la mort et la gloire allaient la joindre, la Mère Thérèse fut immolée la dernière.
La sépulture. — La béatification.
Dans la soirée de ce 17 juillet 1794, les restes mutilés des seize Carmélites, avec ceux des autres condamnés, furent transportés à près d’un kilomètre de la place du Trône, au lieudit Picpus, dans une profonde carrière de sable affectée à la sépulture des victimes de la guillotine. En un mois, ce cimetière en reçut 1 307 ; on était à la période (juin-juillet 1794) la plus violente de la Terreur. Dans la suite, des parents des victimes achetèrent l’emplacement de la fosse commune — à laquelle on n’a jamais touché depuis plus d’un siècle — et le terrain situé autour. Il y eut là comme un double cimetière, celui des victimes de la Terreur, et, à côté, séparé par un mur, celui de quelques membres de leurs familles. Sur les parois de la chapelle du couvent des religieuses des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie, se lisent les noms des 1 307 victimes ; du numéro 924 au numéro 939 figurent ceux des Carmélites de Compiègne, martyres de la foi. En voici la liste :
Madeleine-Claudine Lidoine (Mère Thérèse de Saint-Augustin) ; Marie-Anne-Françoise Brideau (Sœur Saint-Louis) ; Anne-Marie Thouret (Sœur Charlotte de la Résurrection) ; Marie-Anne Piedcourt (Sœur de Jésus-Crucifié) ; Françoise de Croissy (Sœur Henriette de Jésus) ; Marie Hanisset (Sœur Thérèse du Saint-Cœur de Marie) ; Marie-Gabriel Trezel (Sœur Thérèse de Saint-Ignace) ; Marie Biard (Sœur Euphrasie de l’Immaculée-Conception) ; Rose Chrétien de La Neuville (Sœur Julie-Louise de Jésus) ; Anne Pebras (Sœur Henriette de la Providence) ; Marie Meunier (Sœur Constance), novice ; Angélique Roussette (Sœur Marie du Saint-Esprit), converse) ; Marie Dufour (Sœur Sainte-Marthe), converse ; Julie Vérolot (Sœur Saint-François-Xavier), converse ; Catherine Soiron, tourière ; Thérèse Soiron, tourière.
Le procès canonique pour la béatification des seize Carmélites fut ouvert le 23 février 1902. Le 27 mai 1906, elles étaient déclarées bienheureuses par Pie X, en présence d’un grand nombre de pèlerins et de plusieurs évêques français, des membres des familles des nouvelles Bienheureuses. Dans les diocèses de Paris et de Beauvais, on célèbre la fête de la bienheureuse Thérèse et de ses compagnes, martyres, à la date du 17 juillet.
G. Octavien.
Sources consultées. — Victor Pierre, Les seize Carmélites de Compiègne (collection Les Saints) (Paris, 1905). — A. Odon, Les Carmélites de Compiègne (Lille-Paris, 1897). — (V. S. B. P., n° 1246.)