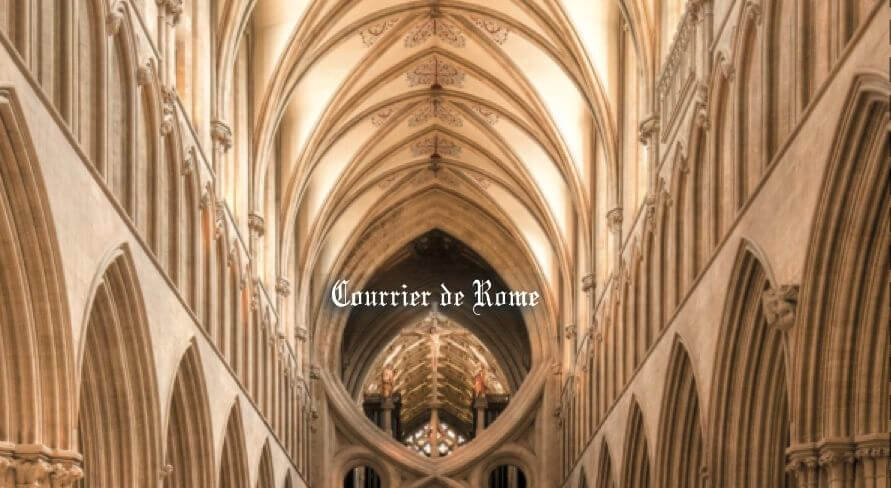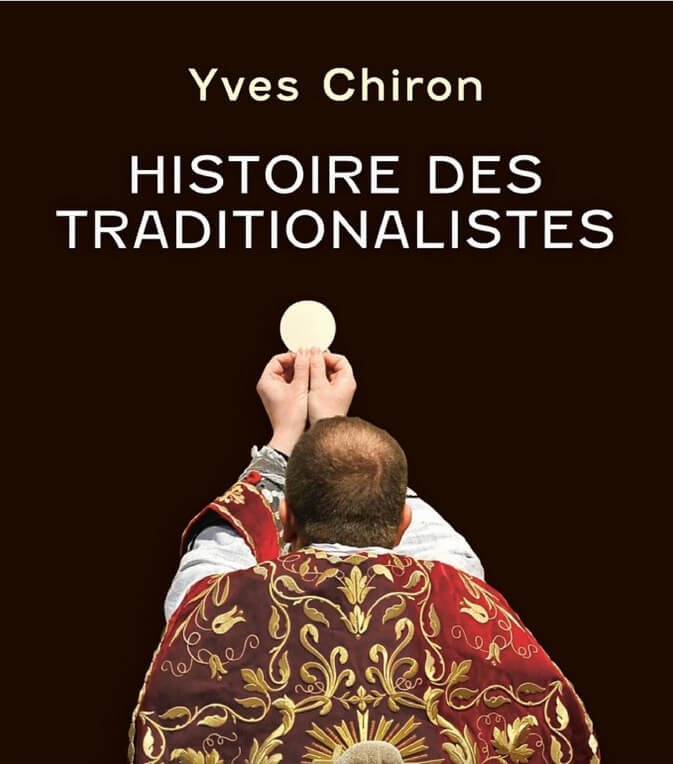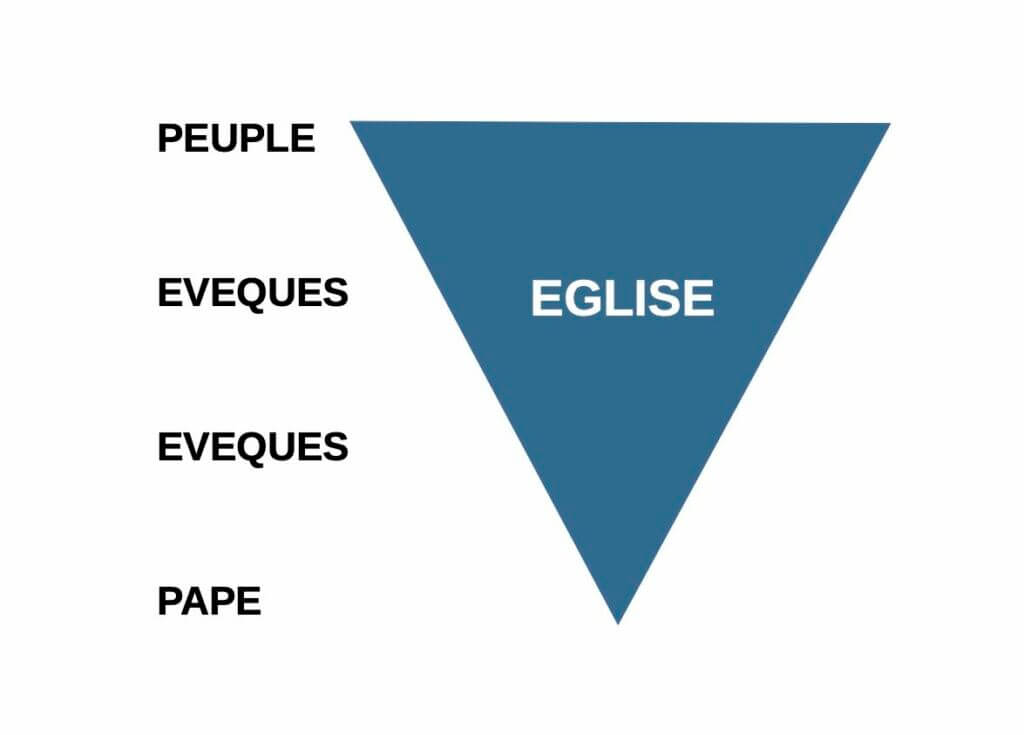« Il n’est pas si loin le jour où des jeunes adultes ne maîtriseront plus assez la langue pour comprendre un courrier qui leur est adressé ou pour en rédiger un ».
Recension
« Par peur de stigmatiser, nous avons perdu, nous perdons l’habitude de corriger les erreurs des élèves, de les rependre sur une formulation erronée, ou la présentation peu soignée voire carrément illisible de leurs cahiers. Il ne faut pas trop leur en demander. Or, cet état d’esprit témoigne d’un certain mépris pour ces jeunes. Ne pas trop attendre d’eux, c’est finalement être convaincus qu’ils ne peuvent pas plus que ce qu’ils montrent à travers leurs travaux. […] Si je ne relève pas les fautes d’orthographe dans une copie de géographie, si je ne me formalise pas en voyant un cahier où les traits sont tirés à main levée et où le rose fuchsia succède au noir, qui lui-même succède au crayon papier, n’est-ce pas au fond parce que je pense que les élèves ne sont pas capables de plus ? C’est, quand on y pense, incroyablement méprisant. Être exigeant, au contraire, reprendre une formulation erronée, souligner les fautes d’orthographe – même au stylo rouge – demander à des élèves de refaire un exercice parce que les lignes dans leur cahier sont illisibles, les contraindre à écrire plutôt que de leur donner des photocopies toutes faites, n’est-ce pas, finalement, leur signifier à quel point nous croyons en leur potentiel ? Renouons avec l’exigence. Renouons avec la rigueur. Montrons ainsi à nos élèves la confiance que nous avons en leurs capacités, en leur potentiel, potentiel qu’eux-mêmes peinent si souvent à voir. »
Marie Pedroni n’a pas froid aux yeux. Issue d’une famille valaisanne solidement enracinée dans son terroir, elle a mené des études universitaires en langues et effectué sa formation pédagogique tout en enseignant dans des écoles privées lausannoises – dont la prestigieuse institution de Champittet, près de Pully. Depuis dix ans, elle est professeur d’anglais et de français, au degré secondaire (équivalent des classes de la 5e à la 3e en France) dans le canton du Valais. Les lignes citées plus haut sont extraites (p. 137–138) de son livre dernièrement paru en Suisse, aux Editions Favre, à Lausanne, Désolé pour l’ortografe. Réflexions sur l’effritement du niveau scolaire. Un livre qui entend regarder la réalité en face, un livre qui voudrait donner les moyens de guérir.
Le constat est accablant et il se donne sans complaisance, à travers les deux premiers chapitres (« Etat des lieux », p. 15–26 et « Les difficultés », p. 27–62). En témoignent aussi les échantillons éloquents – et savoureux – réunis en annexe aux pages 169–171 du livre.
L’état des lieux ou le constat de base (p. 24) est celui que font les enseignants dans l’enseignement secondaire, en Suisse, et il est quasi unanime : « le niveau des élèves baisse, et cette baisse s’est accélérée ces dernières années ». L’indice assez parlant s’en trouve dans les examens qui sanctionnent la fin du primaire : « En compréhension écrite, la difficulté des textes a progressivement diminué et elle s’accompagne de questions qui, tant dans leur forme que dans leur contenu, se sont simplifiées ». […] « En 1998, les élèves lisaient des extraits de Vol de Nuit de Saint-Exupéry. Il ne viendrait aujourd’hui à l’esprit d’aucun professeur d’oser imaginer proposer le même texte en examen, confrontés comme ils le sont quotidiennement aux difficultés des élèves ». Les inquiétudes sur le niveau scolaire ne datent pas d’hier, elles ont été objet de débats récurrents, mais, au-delà d’une rengaine trop entendue, la situation devient urgente. « Elle l’est parce que, si un constat formel n’est pas effectué et si des mesures ne sont pas prises en conséquence, nous courons le risque que sortent de l’enseignement obligatoire des élèves qui n’auront plus la compétence de base qu’est la maîtrise de la langue – lecture, vocabulaire, expression orale et écrite – et sans laquelle ils ne peuvent, à terme, penser et communiquer ».
Les difficultés ne se limitent pas à la « mise en péril » de l’orthographe (p. 27–34). Certes, le péril est réel et il est d’autant plus grand que « consciemment ou inconsciemment, les enseignants partent de plus en plus du principe que le combat de l’orthographe est d’ores et déjà perdu, et par là même dénué de sens ». La maîtrise de l’orthographe en devient « une utopie ». La même forme de résignation se trouve d’ailleurs chez les élèves, « preuve en est le titre de cet ouvrage, inspiré par un mot laissé par un élève à la fin d’une copie d’examen ». La chute se poursuit comme en témoignent les copies de plus en plus illisibles des élèves. « Nous nous acheminons assez nettement vers un avenir où les jeunes adultes ne seront plus en mesure de communiquer par écrit. Et le nombre d’illettrés déjà très inquiétant en Suisse – l’association Lire et Écrire en recense environ 800 000 – risque bien d’augmenter encore ».
Mais au-delà de l’orthographe, c’est la pauvreté du registre lexical qui suscite, elle aussi, de vives inquiétudes (p. 34–39). « Les façons d’enrichir son vocabulaire sont multiples et nécessitent une répétition. On ne saisit parfois totalement le sens d’un mot qu’après l’avoir entendu plusieurs fois, dans différents contextes et cela ne signifie pas encore que l’on soit capable de l’utiliser soi-même. Mais toutes les études et articles disponibles insistent sur l’importance de la lecture. Certaines ont même montré que vingt-cinq minutes de lecture par jour permettaient d’acquérir 1000 mots par année. Or, si ce type d’habitude n’est pas pris dès le plus jeune âge, et entretenu au fil des ans, on s’expose à une accumulation de lacunes, pour arriver au secondaire I [équivalent en Suisse de la classe de 5e en France] avec des élèves incapables de comprendre un texte relativement simple ». Si c’est un fait que l’acquisition du vocabulaire se fait avant tout par des interactions avec les parents, les ressources que les parents mettent – ou ne mettent pas – ensuite à disposition de leurs enfants sont tout aussi primordiales. « Les enfants ont-ils accès à des livres ? Sont-ils encouragés à la lecture ? Ecoutent-ils des histoires ? De la musique ? Et si oui quel type de musique ? » Celui qui ne lit pas et qui passe ses journées à écouter Ninho (rappeur français) ou PNL (groupe de rap français) n’aura pas le même registre lexical qu’un autre, qui lit régulièrement ou auquel ses parents auront fait découvrir ne serait-ce que Jacques Brel ou les classiques du cinéma français.
Si l’on ajoute à cela les difficultés devenues insurmontables dans le simple déchiffrement d’un texte (le décodage des mots et l’intelligence de la syntaxe), on ne sera pas surpris de constater l’inévitable : « c’est jusqu’à la lecture des consignes d’exercices ou des questions d’examens qui en pâtit » (p. 45). Lors des examens, la proportion des élèves qui, non contents de donner des réponses fausses, manifestent aussi qu’ils n’ont pas compris la question elle-même s’accroît dans des proportions inquiétantes. Alain Bentolila, auteur du « Rapport de mission sur l’acquisition du vocabulaire à l’école élémentaire », tire une conclusion qui pourrait s’appliquer à de nombreux adultes : « Lorsque la nécessité se fera sentir d’affronter l’inconnu, les moyens linguistiques ne seront pas là pour le permettre, et faute de pouvoir mettre en mots sa pensée, faute de pouvoir expliquer et convaincre, c’est l’agression physique qui prendra le relais ». En attendant, c’est déjà, et Marie Pedroni ne se fait pas faute de le souligner, l’agression verbale qui devient omniprésente sur les réseaux sociaux. En attendant les coups de couteau, ce sont les slogans qui remplacent les véritables mots.
Dernière difficulté : l’apathie des élèves en classe. L’âge ingrat est de tous les temps et de tous les pays, mais il y a ici plus que de l’ingratitude de l’âge. Derrière ce type d’attitude, « chez un nombre important d’élèves qui, sans être apathiques ou perturbateurs, ont des difficultés scolaires », on retrouve systématiquement « un rejet de tout ce qui s’apparente à un effort. Tout doit être immédiat » (p. 58). Un travail demandant plus de dix minutes finit par représenter un effort surhumain et il arrive très souvent, lors des examens, que les élèves rendent une copie vingt minutes en avance, avec des parties laissées en blanc. Sans doute. Mais « le retour des entreprises chez qui ces élèves commencent leur apprentissage est sans appel ». Les professionnels observent, s’étonnent et témoignent : ces jeunes ne maîtrisent plus les règles élémentaires de politesse, telle la ponctualité, ni un langage et une attitude appropriés au cadre de travail.
Le troisième chapitre du livre s’intitule : « A qui la faute ? » et Marie Pedroni y part à la recherche des causes. Recherche menée avec méthode et discernement. L’école ? Les parents ? Les écrans ? Les trois sûrement, sans qu’il y ait pour autant de complot organisé, mais non plus de fatalité irrémédiable. Pour dire juste un mot de l’école (et ce terme abstrait appelle bien des distinctions), retenons ce fait que l’héritage de Rousseau et de son Émile pèse assez lourd. Marie Pedroni le montre de façon convaincante. L’école ludique où chacun est censé pouvoir s’exprimer et se révéler est une illusion, dénoncée avec verve par l’écrivain Chesterton : « Il est possible de tirer d’un enfant des cris et des grognements par de simples pichenettes, ou en l’enquiquinant. […] Mais vous pouvez attendre et l’observer patiemment, vous n’arriverez pas à en tirer la langue anglaise. C’est quelque chose que vous devez lui inculquer » (p. 71). Transmettre des connaissances ou accompagner une découverte ? Tel est le dilemme. La découverte a du bon, certes. Mais il reste que « donner un cours » demeure dans bien des cas la substance même de l’enseignement – et de l’éducation. Savoir par cœur n’est pas savoir, dira-t-on. Mais pour qui n’a pas la science infuse – et les élèves de Marie Pedroni sont de ceux-là, comme l’immense majorité de l’espèce humaine – la mémorisation est la toute première étape qui doit inévitablement précéder la juste compréhension des choses. Car l’intelligence ne saurait reposer sur la suppression préalable de son objet et, bien souvent, cet objet est d’abord appris avant d’être su. Appris par cœur, justement.
Le quatrième et dernier chapitre envisage des solutions et s’intitule « Quelles pistes » (p. 123–160). Ces pistes se trouvent au même niveau que les causes : à l’école, chez les parents et … dans la société médiatisante et numérisante à l’extrême. L’exemple de La Fère (p. 136–138), cette école pilote créée par Jean-Baptiste Nouailhac en 2017 dans le département de l’Aisne – qui enregistre le nombre record d’élèves en difficulté scolaire – est là pour démontrer que les pistes existent et peuvent nous conduire à sortir de l’impasse. Quant à ce que peuvent faire les parents et les responsables de notre vie sociale à grande échelle, les réflexions profondes de l’auteur, outre qu’elles témoignent d’une expérience éprouvée, devraient nous rappeler que le retour aux exigences du réel, s’il demande du courage, est le plus souvent le premier fondement d’une espérance ferme.
La conclusion du livre (p. 161–166) met en vedette un aspect essentiel et inévitable de ce réel. « Disons-le une fois pour toutes. Non, les jeunes actuels – à quelques exceptions près – ne sont pas extraordinaires, pas plus que nous ne l’étions à leur âge. Mais ils ont le potentiel de le devenir, et il est essentiel de nous demander collectivement comment favoriser le développement de ces capacités encore non réalisées. S’il ne fallait retenir qu’un seul mot de toutes les pages précédentes, ce serait celui d’exigence » (p. 164). Exigence qui, comme le ton qui anime tout le livre et finalement le cœur et l’âme d’enseignante de Marie Pedroni, n’est que la suite nécessaire et le reflet d’une immense miséricorde, la miséricorde spirituelle de l’Evangile, l’un des plus beaux fruits de la sainteté et de la charité apostolique de l’Eglise catholique.
Pour aller plus loin
Entretiens avec Marie Pedroni :