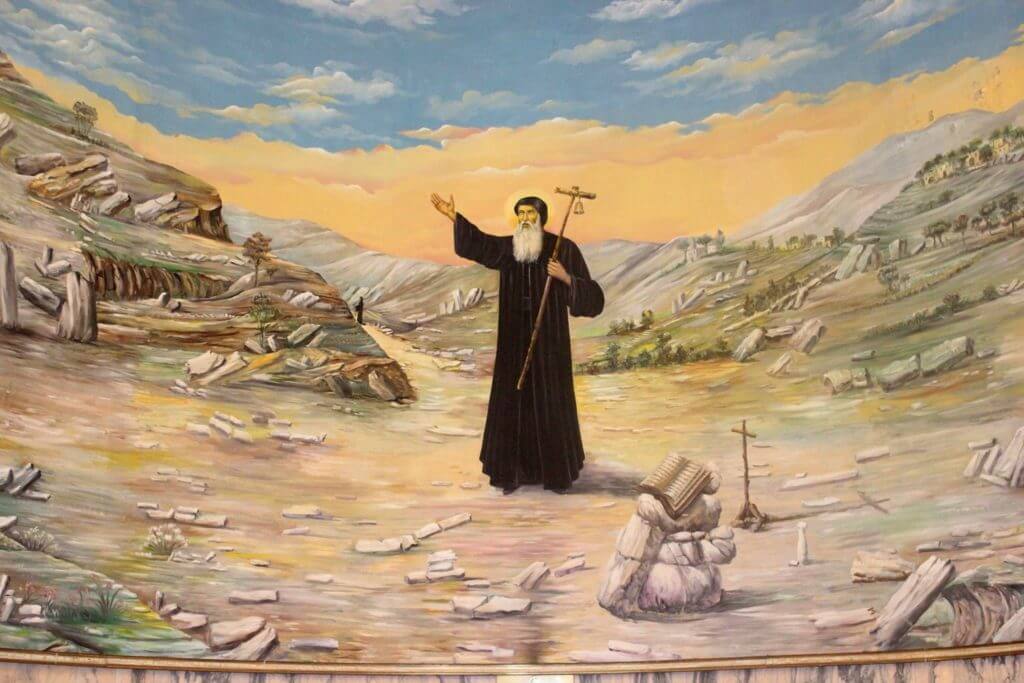Histoire
D’après la tradition, l’Inde fut évangélisé par l’apôtre saint Thomas. En effet, après la Pentecôte, celui-ci, après avoir évangélisé la Mésopotamie, débarqua sur la côte ouest de l’Inde vers l’an 52, dans une région nommée le Malabar (actuellement le Kerala). Les indiens qui reçurent alors l’Évangile prirent le nom de chrétiens de saint Thomas.
Dans les commencements jusqu’au XVe siècle, ces chrétiens dépendaient juridiquement de l’Église d’Orient (qui correspond à l’Église chaldéenne d’aujourd’hui). Or cette dernière étant, à l’époque, schismatique, les chrétiens de saint Thomas se trouvaient alors de facto en dehors de l’Église catholique.
L’arrivée de missionnaires portugais compliqua nettement la situation. Voici un court résumé de cette histoire complexe.
Vers 1500, lorsque débarquèrent les portugais, ceux-ci découvrirent une centaine de milliers de chrétiens. Des missionnaires tentèrent d’avoir des contacts, ce qui se passa tranquillement. Et même ils obtinrent, de ces chrétiens, de revenir à l’unité de l’Église catholique, pour des raisons bien plus politiques que religieuses.
Si les portugais s’en étaient tenus à ce stade, l’Église catholique aurait joui d’avoir retrouvé en son sein ses brebis égarés hors de son unité. Mais ceux-là commirent la grande erreur de latiniser leur rite, voire même de leur imposer le rite latin, ce qui souleva l’ire des chrétiens de saint Thomas qui voyaient leur tradition apostolique et toute honorable supprimée.
En juin 1599, l’archevêque portugais de Goa, Mgr de Menendez, convoqua un synode nommé Diamper afin de décider de cette union. Les chrétiens, contraints d’accepter, furent regroupés sous le nom d’ « Église catholique syro-malabare ». Cela leur fut difficile à deux points de vue : ils perdirent une certaine autonomie ainsi que leur tradition.
C’est en 1653 qu’un tiers de ces chrétiens nouvellement catholiques se révoltèrent, quittèrent l’Église catholique et formèrent une nouvelle Église nommée « Église orthodoxe syro-malankare » se plaçant sous la juridiction des schismatiques syriens (jacobites d’Antioche), afin de reprendre leur rite syrien.
N’étant pas sous la gouvernance du Saint-Esprit, des divisions eurent lieu parmi ces orthodoxes. Au cours du temps, trois Églises dérivèrent de l’ « Église orthodoxe syro-malankare » : les Églises « orthodoxe malankare », « malabare indépendante » et « malankare indépendante Mar Thoma ».
En 1930, 35 000 orthodoxes syro-malankars sentirent le besoin de se rapprocher de l’Église catholique et firent, sous la conduite de leur archevêque Mgr Georges Ivanios, leur accession à Rome. Elle fut effective en 1932.
Les années qui suivirent furent encourageantes pour ces nouveaux catholiques. En effet, plusieurs évêques schismatiques rejoignirent leur rang. Prions pour que davantage de schismatiques reviennent au sein de l’Église de Jésus-Christ. Prions aussi pour que ces chrétiens persévèrent dans la foi catholique, malgré la persécution politique du gouvernement indien.
Liturgie
Si les syro-malankares avaient le rite chaldéen, au commencement de leur évangélisation, la suite des événements, tels que relatés dans l’article précédent, le leur fit perdre, notamment avec l’union à Rome. C’est, au final, après plusieurs « péripéties », du rite syrien que leur liturgie s’est largement inspirée, au XVIIe siècle.
Pour ce qui est de la structure de l’église, ainsi que des habits sacerdotaux, la liturgie syro-malankare est moins ornementée que celle des syriens. C’est ainsi que leur sanctuaire est à peine visible depuis la nef, car un mur sépare les deux parties. Seul un trou, large d’à peine 2 mètres, permet l’accès au sanctuaire. Et si des fidèles choisiraient leur place pour voir un peu mieux de ce qui se passe à l’autel, la déception sera grande lorsque les acolytes tireront un rideau, cachant l’autel tous les temps principaux de la réalisation des mystères sacrés.
D’ailleurs, ce mur est assez sobre. Au lieu d’être une iconostase pleine de représentation de saints, il n’est recouvert que de quelques icônes. Peut-être est-ce dû au manque de moyen de l’Église, ayant toujours été sous domination hindoue, empêchant ainsi le culte de se déployer dans toute sa splendeur.
En revanche, contrairement aux syriens, le rite syro-malankare compte beaucoup plus de symboles, au point que certains liturgistes affirment que c’est, sans doute, la messe la plus riche en symboles.
Pour prouver cette assertion, il suffit de voir comment les malankares veulent symboliser la réception des bénédictions de Dieu depuis l’autel. En voici trois exemples marquants.
- Durant le Saint Sacrifice de la messe, le prêtre adresse au peuple cette salutation : « La paix soit avec vous », à quatre moments différents.
À chaque fois, ce vœu est accompagné de six bénédictions : trois du côté de l’autel, trois vers le peuple.
Pour ce faire, le prêtre touche chaque offrande (pain et vin) ; puis il appuie sa main gauche sur l’autel, se tourne vers le peuple, et de la main droite, largement ouverte, il la transmet aux fidèles. - Une autre manière de retirer symboliquement la bénédiction du saint Sacrifice de la messe est de tracer un petit signe de croix sur la pierre d’autel, la patène et le calice, puis de refaire le même petit signe de croix sur le missel pour y transférer la bénédiction.
- Enfin, une troisième façon de « puiser » la bénédiction consiste à poser les mains sur le calice et la patène avant de les ramener sur la poitrine. Le prêtre fait ce geste à six reprises, durant les prières nommées Intercessions.
Pour terminer, voici la bénédiction que le prêtre donne au peuple après la sainte Communion, insistant sur la miséricorde divine :
Dieu grand et admirable, qui avez abaissé le ciel et êtes venu sur terre pour sauver l’humanité, regardez-nous avec miséricorde et pitié. Bénissez votre peuple et conservez votre héritage afin que nous puissions toujours vous rendre gloire. Vous êtes notre vrai Dieu, dans l’unité du Père qui vous a engendré, et avec l’Esprit-Saint, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Amen.